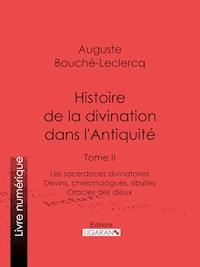Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Théosophie et anthroposophie
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : Dans "La science des rêves dans l'antiquité", Auguste Bouché-Leclercq nous plonge dans un univers fascinant où mythes et réalités s'entremêlent pour éclairer l'art complexe de l'interprétation des rêves dans les civilisations anciennes. L'auteur explore les croyances et pratiques oniriques des cultures grecque, romaine et égyptienne, révélant comment ces sociétés considéraient les rêves comme des messages divins ou des présages. En s'appuyant sur des textes anciens, des inscriptions et des artefacts archéologiques, Bouché-Leclercq analyse les méthodes utilisées par les prêtres et les devins pour déchiffrer les rêves, mettant en lumière leur rôle crucial dans la prise de décisions politiques et personnelles. Ce livre offre une perspective unique sur l'importance des rêves dans l'élaboration des mythes et des légendes qui ont façonné l'imaginaire collectif de ces civilisations. En filigrane, l'auteur interroge également la place des rêves dans notre compréhension moderne du subconscient, proposant une réflexion sur la continuité des pratiques oniriques à travers les âges. Grâce à une approche rigoureuse et documentée, "La science des rêves dans l'antiquité" s'adresse autant aux passionnés d'histoire qu'aux amateurs de psychologie, invitant chacun à redécouvrir la richesse symbolique des rêves et leur impact durable sur la culture humaine. __________________________________________ BIOGRAPHIE DE L'AUTEUR : Auguste Bouché-Leclercq (1842-1923) est un historien français renommé, spécialisé dans l'étude de la religion et de la magie dans l'Antiquité. Professeur à l'Université de Paris, il a consacré une grande partie de sa carrière à l'analyse des croyances et pratiques religieuses des civilisations anciennes, notamment grecques et romaines. Auteur prolifique, Bouché-Leclercq a écrit plusieurs ouvrages de référence, dont "L'Astrologie grecque" et "Histoire de la divination dans l'Antiquité", qui demeurent des contributions majeures à la compréhension des systèmes de pensée anciens. Son travail se distingue par une approche méthodique et une rigueur académique qui ont fait de lui une figure incontournable dans le domaine des études classiques. Bien que ses oeuvres soient principalement axées sur l'Antiquité, Bouché-Leclercq s'intéressait également aux influences de ces pratiques sur les sociétés modernes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Introduction
Chapitre premier: Divination par les songes ou Oniromancie
§I. — Oniroscopie
§ II. — Onirocritique
Chapitre deuxième : Divination nécromantique
INTRODUCTION
La science divinatoire repose sur l’interprétation de signes extérieurs dont le sens a été fixé soit par une révélation primitive, soit par l’expérience. L’âme humaine ne connaît la pensée divine que par le moyen de symboles : la lumière d’en haut ne lui arrive que réfléchie par des intermédiaires, toujours affaiblie, souvent dénaturée par l’inertie ou l’activité propre des milieux qu'elle traverse. Aux erreurs qui peuvent résulter de l’imperfection des instruments dont se servent les dieux s’ajoutent les méprises de l’intelligence mal éclairée par une lueur douteuse et obligée de discerner, en présence des phénomènes conformes aux lois naturelles, la part de l’intention surnaturelle qui s’y ajoute. Les prodiges qui accusent nettement cette intention ne sont pas le langage ordinaire des dieux; le plus souvent, la pensée divine se cache dans des incidents vulgaires qui peuvent s’expliquer sans elle et le devin a besoin, pour l’y découvrir, de l’analyse la plus pénétrante. Il arrive ainsi que l’on est exposé non seulement à se tromper dans le travail si compliqué de l’interprétation, mais à méconnaître la nature des phénomènes observés, à prendre pour signe ce qui n’en est pas et, réciproquement, à considérer comme un fait sans valeur un signe véritable.
En résumé, les inconvénients de la méthode inductive sont, d’une part, la difficulté de constater l’existence des signes, toutes les fois que ces signes ne sont pas des prodiges, et d’autre part, la difficulté non moins grande d’en dégager le sens caché sous une forme symbolique1.
On pouvait facilement concevoir des modes de révélation dans lesquels l’une de ces chances d’erreur, ou même l’une et l’autre, seraient supprimées. Pour obvier aux méprises et aux incertitudes provenant de la confusion entre les signes et les phénomènes naturels, ainsi que de l’altération des signes par des instruments imparfaits, il fallait mettre l’âme directement en rapport avec les dieux, et, pour prévenir les erreurs d’interprétation, il fallait substituer au langage symbolique le langage humain. Tel fut le rôle de la divination intuitive ou subjective.
Considérée dans son rôle historique, cette branche de l’art mantique est plus récente que l’autre; mais la possibilité d’un contact direct entre l’intelligence humaine et l’intelligence divine a été acceptée de tout temps par les religions, qui reposent elles-mêmes sur une révélation première. La religion des Grecs ne fait pas exception à la règle. Les dieux d’Homère déterminent parfois, non seulement les actes extérieurs, mais les pensées et les volitions des héros. De même ceux-ci, soit par l’effet d’un don spécial, soit par l’influence mystérieuse qu’exerce sur l’âme l’approche de la mort, peuvent lire, sans le secours des signes, dans la pensée divine. Ainsi, Calchas explique les motifs du courroux d’Apollon sans faire ou, ce qui revient au même, sans invoquer d’observations préalables2; Hélénos «comprend dans son cœur» la conversation que tiennent à distance Apollon et Athênè3; Télémos, chez les Cyclopes4, Tirésias, dans l’Hadès5, prophétisent par inspiration; Théoclymène se sent tout à coup saisi par l’instinct prophétique6 en dehors de toute interprétation symbolique, et Pénélope paraît bien avoir eu recours à un «confident des dieux» différent des devins ordinaires7. Hélène elle-même, qui n’a jamais étudié la mantique et n’a eu jusque-là d’autre faculté spéciale que celle de plaire, prend tout à coup la parole pour expliquer un prodige, «selon ce que les dieux lui suggèrent au cœur8.» De même, Patrocle mourant découvre que le coup mortel lui vient d’Apollon9, et, avant d’expirer, Hector prédit, avec des détails circonstanciés, le trépas de son meurtrier10. Il n’y a plus qu’un pas à faire, à éliminer la part de coopération que l’intelligence personnelle du prophète apporte à la révélation intérieure, pour obtenir l’enthousiasme mantique, la « fureur ou folie divine, » qui fait vibrer, sous l’impulsion directe des êtres surnaturels, l’instrument le plus parfait dont ils puissent se servir, l’âme et le corps de l’homme, l’une recevant, l’autre traduisant au dehors, en langage humain, la pensée d’en haut. Ce sera l’œuvre de ces siècles mal connus qui couvrent de leur ombre le berceau des oracles apolliniens et lèguent à l’âge historique les pythies déjà installées sur leur trépied, en face des « chresmologues, » ou prophètes libres, dont les prédictions versifiées volent déjà de bouche en bouche.
Mais la divination intuitive n’avait pas attendu, pour prendre possession du monde hellénique, ce progrès décisif qui la porta du premier coup à sa perfection. Elle existait déjà, à l’état d’ébauche et associée à la divination conjecturale, dès la plus haute antiquité, sous la forme d’oniromancie ou interprétation des songes. L’oniromancie ne supprime pas le langage symbolique, qu'elle interprète et commente par la méthode conjecturale, mais les signes dont elle tient compte sont produits dans l’âme même que le sommeil livre, assouplie et docile, à l’action des dieux11.
Le sommeil est déjà l’image de l’enthousiasme ou possession divine ; il produit les mêmes effets ; il enlève à l’âme son initiative, la direction d’elle-même, et ne lui laisse que ses facultés passives. Elle contemple alors, sans pouvoir les distinguer de la réalité, les images symboliques qu’une puissance supérieure fait défiler sous son regard, et son inertie même répond de la fidélité de ses perceptions.
L’oniromancie, qui doit à l’intuition, et non plus à l’observation extérieure, les données sur lesquelles elle établit ses conjectures, a été classée pour cette raison, dans l’antiquité, parmi les procédés de la divination naturelle ou intuitive. En réalité, elle tient le milieu entre les deux grandes méthodes mantiques, car elle participe de l’une et de l’autre et les résume toutes les deux12.
1 Les difficultés d’interprétation encouragent déjà au scepticisme les héros d’Homère.
2 Hom. Iliad., I, 94-100.
3 Hom. Iliad., VII, 44.
4 Hom. Odyss., IX, 508.
5 Hom. Odyss., XI, 90-151.
6 Hom. Odyss., XX, 351-337.
7 Hom. Odyss., 1,415.
8 Hom. Odyss., YN, 172.
9 Hom. Iliad., XVI, 843 sqq.
10 Hom. Iliad., XXII, 358 sq. Cf. Alberti, De aegrolorum vaticiniis. Halle, 1724.
11 Cic. Divin., I, 2.
12 Cic. Divin., II, 71.
CHAPITRE PREMIER: DIVINATION PAR LES SONGES OU ONIROMANCIE
S’il est un mode de divination en faveur duquel on puisse invoquer le témoi-gnage du consentement universel, c’est, à coup sûr, l’interprétation des songes ou oniromancie13. Il n’est point de peuple et, dans l’antiquité, presque point d’individus qui n’aient cru à une révélation divine par les songes. Les Hébreux même ont accepté pour leur compte la foi générale : l’un des fils de Jacob fait fortune en Égypte pour avoir expliqué un songe du Pharaon, et l’Écriture est remplie d’apparitions et de songes prophétiques.
Il est donc superflu de se demander d’où vint aux Hellènes la croyance aux songes. L’oniromancie est aussi vieille que le monde, et, s’il n’est pas sûr qu'elle doive finir, il est certain qu'elle n’a pas eu de commencement que puisse signaler l’histoire. C’est qu'elle repose sur un fait psychologique et physiologique dont une science avancée peut seule rendre raison, et que l’on expliquait commodément par une cause surnaturelle. L’invincible illusion produite par le rêve, l’impuissance de la volonté, en face des images bizarres et incohérentes qui traversent le champ de l’imagination, semblaient prouver avec la dernière évidence que l’homme n’est pas lui-même l’artisan de cette fantasmagorie qui, cent fois démentie par les constatations du réveil, retrouvent toujours le spectateur aussi crédule dès que le sommeil l’a enlevé à la vie consciente. On ne pouvait admettre que les songes fussent produits par des impressions extérieures, puisqu’ils sont d’ordinaire en contradiction avec la réalité présente ou même avec les lois connues de la nature, et que, d’ailleurs, les sens engourdis paraissent incapables d’ouvrir à ces impressions leur accès accoutumé. Si la cause de phénomènes aussi mystérieux ne se rencontrait ni dans l’âme, ni dans les objets extérieurs, où pouvait-on la chercher, sinon dans ce monde surnaturel où l’esprit humain a toujours trouvé sans peine la solution des problèmes les plus désespérés ? Pris dans son ensemble, le monde antique n’a jamais douté un seul instant que les songes ne fussent suscités dans l’âme par une influence divine14. Ce point acquis, il restait encore à examiner pour quel motif les dieux jouaient ainsi, devant l’âme enchaînée, des drames qui seraient ridicules s’ils étaient inutiles. La question fut résolue partout de la même manière, c’est-à-dire que, posée en ces termes, elle ne comportait qu’une solution. La divinité, en agissant ainsi, ne pouvait avoir qu’un seul but, parler à l’âme, soit pour lui faire connaître sa volonté, soit pour lui révéler ce qu'elle devait savoir afin de régler ses actes sur les desseins de la Providence. Les songes étaient donc autant de communications surnaturelles, faites en langage symbolique, qui devenaient intelligibles après avoir été interprétées suivant certaines règles.
L’oniromancie comprend, par conséquent, deux opérations successives, l’observation des signes, ou oniroscopie proprement dite, et leur interprétation ou onirocritique.
La première, bien que soustraite à l’action directe de la volonté, peut cependant être préparée ou facilitée par certains procédés artificiels ; l’autre est toute de convention et constitue une science dont les principes mêmes peuvent être différents, suivant les temps et les pays.
Nous allons étudier l’oniromancie, sous ce double aspect, telle qu'elle nous apparaît dans l’histoire et la littérature des Hellènes.
§1. — ONIROSCOPIE
La production et l’observation spontanée des songes, étant un fait de nature, est du domaine de la physiologie et de la psychologie; elle ne peut être l’objet d’une étude historique. Ce que nous avons à noter ici comme appartenant à l’histoire de la divination hellénique, ce sont, d’une part, les idées des Grecs sur la nature et l’origine des songes, de l’autre, les pratiques qu’ils ont considérées comme pouvant modifier la qualité ou provoquer l’éclosion des images symboliques entrevues dans le rêve. Pour Homère, les songes sont des figures aériennes (eïdôla) qui prennent toute espèce de formes. Ainsi, celui que Zeus envoie à Agamemnon apparaît au roi des rois sous la figure de Nestor15. Des fantômes habitent en foule nombreuse (dêmos oneïrôv) au-delà de l’Océan, à la porte des Champs-Élyséens16, ce qui n’empêche pas chaque divinité d’en fabriquer à nouveau, comme fait Athênè lorsque, pour rassurer Pénélope sur le sort de Télémaque, elle forme un fantôme semblable à Iphthimè, fille du magnanime Icaros17. Il arrive même parfois que les dieux en personne, ou les âmes des morts avant qu’elles soient entrées dans l’Hadès, prennent la place de ces ombres artificielles et formulent directement leurs conseils et leurs désirs. C’est ainsi qu'Athênè apparaît en songe à Nausicaa et à Télémaque18, et que Patrocle vient demander à Achille de hâter ses funérailles19. Dans ces apparitions oniroscopiques, les dieux gardent ou échangent à leur gré contre une autre leur forme naturelle. Athêné parle à Nausicaa sous la figure d’une des compagnes de la princesse, et elle se laisse, au contraire, reconnaître par Télémaque. La religion hellénique invoqua souvent, en faveur de son anthropomorphisme, des visions de ce genre, et put garantir par là la vérité des représentations divines qu'elle offrait à la vénération des croyants. Ainsi, au Vesiècle, le sculpteur Onatas refit la Démêter noire des Phigaléens d’après un modèle aperçu en songe20, et, plus tard, Parrhasius se vantait d’avoir dessiné de la même manière son Héraklès de Lindos21. L’apparition des types divins en songe était un argument dont la philosophie atomistique elle-même tint grand compte, et qui parut bon encore à opposer aux chrétiens22.
Homère ne dit pas d’où vient ce peuple de songes qui attendent, sur l’autre bord de l’Océan, les ordres des dieux; mais les poètes postérieurs ne pouvaient manquer de combler cette lacune en leur créant une généalogie. Pour Hésiode, les songes sont fils de la Nuit et frères du Sommeil. «Nyx, dit-il, enfanta le cruel Destin et la Kère noire et la Mort; elle enfanta aussi le Sommeil et engendra la race des Songes23.» Cette donnée fut développée par l’imagination facile des mythographes. D’après la légende qu’expose Ovide24, les songes habitent le palais du Sommeil, leur père, au pays des Cimmériens. Parmi eux, le poète distingue Morphée, qui prend à son gré toutes les formes humaines (morphê) ; Ikelos ou Phobêtor, qui revêt toutes les formes animales, et Phantasos, qui copie la nature inanimée. Lucien, décrivant l’île des Songes, située dans l’Océan occidental, la trouve gouvernée par le roi Sommeil ayant pour satrapes Taraxion et Plutoclès, fils de Phantasion25. Ainsi, dans le symbolisme naïf de la tradition hésiodique, les Songes sont ou frères ou enfants du Sommeil, qui est lui-même fils de la Nuit.
Une autre tradition, représentée principalement par Euripide26