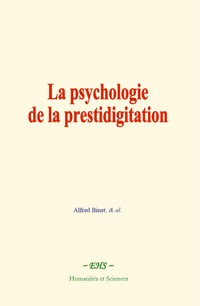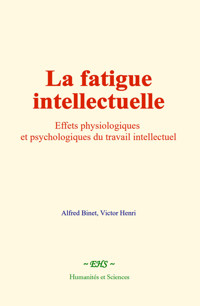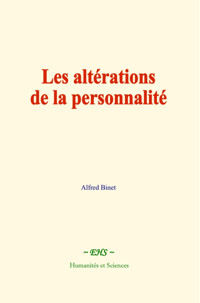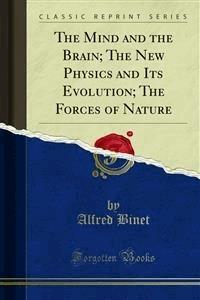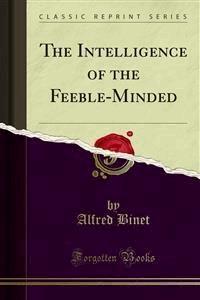Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
En 1900, Binet fut le premier savant à avoir établi sur des fondements scientifiques une psychologie du témoignage en étudiant la suggestibilité chez les sujets normaux. "Apprécier la suggestivité d'une personne sans avoir recours à l'hypnotisation tel est aussi brièvement indiqué que possible le sujet de ce livre" [...] "L'hypnotisation doit rester à mon avis une méthode clinique" [...] "Les nouvelles méthodes que je vais décrire ce sont essentiellement des méthodes pédagogiques" Pour Binet, la question n'était pas de savoir si les enfants étaient suggestibles, mais plutôt de savoir comment les enfants deviennent suggestibles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Suggestibilité
Pages de titreIntroductionChapitre Premier(Suite)Chapitre V – L’action moraleChapitre VII – L’imitationsubconscientsConclusionPage de copyright1
La Suggestibilité
Alfred Binet
2
Introduction
Apprécier la suggestibilité d’une personne sans
avoir recours à l’hypnotisation ou à d’autres
manœuvres analogues, tel est, aussi brièvement
indiqué que possible, le sujet de ce livre.
Il sufit de réféchir un moment pour comprendre
tous les avantages de cette séparation entre l’étude
de l’hypnotisme et celle de la suggestion. Quoi que
l’on pense de l’hypnotisme, ‒ et quant à moi j’estime
que c’est une méthode de premier ordre pour la
pathologie mentale ‒ il est incontestable que cette
méthode d’expérimentation qui constitue une
mainmise sur un individu, présente des inconvénients
pratiques très graves : elle ne réussit pas chez toutes
les personnes, elle provoque chez quelques-unes des
phénomènes nerveux importants et pénibles, et en
outre elle donne aux sujets des habitudes
d’automatisme et de servilité qui expliquent que
certains auteurs, Wundt en particulier, aient considéré
l’hypnotisme comme une immoralité. C’est pour cette
raison que les pratiques en ont été sévèrement
interdites dans les écoles et dans l’armée, et je crois
cette mesure excellente : l’hypnotisation doit rester, à
mon avis, une méthode clinique.
Jusque dans ces cinq dernières années, hypnotisme
et suggestion étaient termes presque synonymes ; on
ne faisait de la suggestion que sur des sujets
3
préalablement hypnotisés, ou bien, si l’on essayait de
faire de la suggestion à l’état de veille, c’était
exactement par les mêmes procédés que ceux de
l’hypnotisme, c’est-à-dire par des afirmations
autoritaires amenant une obéissance automatique du
sujet et suspendant sa volonté et son sens critique.
Les méthodes nouvelles que je vais décrire n’ont, je
crois, aucun rapport pratique avec l’hypnotisme ; ce
sont essentiellement des méthodes pédagogiques : et
j’ai pu les employer pendant plusieurs mois de suite
dans les écoles, sous l’œil attentif des maîtres, sans
éveiller chez eux la moindre crainte que leurs élèves
fussent l’objet de manœuvres d’hypnotisation ; c’est
qu’en efet ces méthodes ne provoquent pas plus
d’émotion ou de trouble chez les sujets qu’un exercice
de dictée ou de calcul. Je dirai plus : ces expériences
peuvent rendre de grands services aux élèves, si on a
le soin de leur expliquer, quand le résultat est atteint,
quel est le but qu’on se proposait, si on leur met sous
les yeux l’erreur qu’ils ont commise, si on leur indique
pourquoi ils ont commis cette erreur, comment ils ont
manqué d’attention ; c’est une leçon de choses, et en
même temps une leçon morale dont l’enfant profte
souvent, j’en ai eu la preuve, car j’en ai vu plusieurs
qui, à chaque épreuve, apprenaient à se corriger et
devenaient moins suggestibles.
Certes, ce n’est pas seulement aux enfants que
cette leçon serait salutaire, mais surtout aux adultes,
qui trop souvent, comme on l’a vu dans ces derniers
temps, perdent l’habitude d’exercer leur sens critique,
de se faire une opinion personnelle et raisonnée, et se
laissent servilement suggestionner par les polémiques
de presse !
4
Chapitre Premier
Historique
Toutes les fois qu’on cherche à classer les
caractères d’une manière utile, d’après des
observations réelles et non d’après des idées a priori,
on est amené à faire une large part à la suggestibilité.
Tissié utilisant les remarques qu’il a faites dans le
monde des sports, sur les entraîneurs et les entraînés,
divise les caractères en trois catégories, qui ne sont
au fond que des catégories de suggestibilité : 1° les
automatiques, ceux qui obéissent passivement et sans
réplique, les modèles de la discipline aveugle ; ceux
qui, suivant l’auteur, obéissent au « je veux » ; 2° les
sensitifs, ceux dont on obtient l’obéissance en
s’adressant à leurs sentiments, et particulièrement à
leur afection ; 3° les actifs, les volontaires, qui sont
eux-mêmes, qui ont une personnalité tranchée, et sur
lesquels on ne peut pas agir directement, mais
seulement par esprit de contradiction ; ils répondent
au « tu ne peux pas » ; 4° les rétifs, quatrième
5
catégorie, que Tissié ne donne pas, mais que les
instituteurs m’ont indiquée, car elle existe dans les
écoles, et elle n’est point aimée des maîtres ; ce sont
des révoltés, des indisciplinés ; probablement cette
catégorie est formée pour une bonne part de nerveux
et de dégénérés.
Naturellement, je ne puis me porter garant de cette
classifcation, qui ne repose pas, à ce qu’il me semble,
sur des observations régulières ; et il faudrait sans
doute rechercher s’il est exact que les individus sur
lesquels on n’a prise que par l’esprit de contradiction
1
sont toujours des volontaires ; j’en doute un peu .
Mais l’essentiel est de montrer que ce projet de
classifcation des caractères repose sur des
distinctions de suggestibilité ; les automatiques sont
les plus suggestibles de tous, les sensitifs le sont déjà
moins, et enfn les actifs et les rétifs ne peuvent être
suggestionnés que dans une petite mesure, et au
moyen de Détours.
Un auteur américain, Bolton, a donné, en passant, il
y a quelques années, une classifcation de caractères,
dans laquelle on retrouve encore une préoccupation
2
de la suggestibilité des individus . Il faisait une
expérience sur le rythme, expérience longue et
minutieuse, dans laquelle il était obligé de rester
longtemps en relation avec ses sujets, et de les
examiner de très près.
1 J’ai observé bien souvent que l’esprit de contradiction est très
développé chez des personnes nerveuses, auxquelles on
donne l’obsession d’un acte, rien qu’en les mettant au déf de
l’accomplir. Pitres signale avec raison les hystériques comme
des sujets qu’on peut souvent suggestionner à fond, en les
prenant par l’esprit de contradiction. Je crois bien que la
tendance à contredire n’est pas nécessairement un indice de
personnalité bien organisée et capable de résister à la
suggestion.
2 Voir Année psychol., I, p. 360.
6
Il faisait entendre aux personnes des sons rythmés
de diférentes façons, et devait ensuite, par des
interrogations minutieuses, chercher à savoir
comment chaque personne avait perçu les sons, les
avait groupés et rythmés. Il fut frappé de la manière
fort diférente dont chacun se prêtait à l’expérience,
et il les classa tous en trois catégories : 1° d’abord,
ceux qui s’empressent d’accepter toutes les
suggestions de l’opérateur ; ils n’ont aucune idée à
eux, adoptent celle qu’on leur suggère avec une
docilité surprenante ; ce sont les automatiques ou
passifs de la classifcation précédente ; 2° ceux qui
cherchent à se faire une opinion personnelle ; leur
attitude est celle d’un scepticisme modéré et
raisonnable : ils donnent leurs impressions avec
exactitude, ce sont les meilleurs sujets.
L’opinion à laquelle ils arrivent sur la question n’est
pas toujours juste, car elle repose le plus souvent sur
des données incomplètes ; 3° les contrariants ; c’est
l’espèce détestable, le désespoir des
expérimentateurs. Ce sont des gens qui poussent
l’esprit de contradiction jusqu’à la mauvaise foi ; ils
critiquent tout, le but de l’expérience, les conditions
où l’on opère ; ils sont subtils ; ils refusent de donner
leur opinion, tant qu’ils ne connaissent pas celle des
autres sujets ou celle de l’expérimentateur ; dès qu’ils
la connaissent, ils s’empressent d’en prendre le
contre-pied, avec un grand entrain d’ergotage, Si on
ne livre à leur critique aucune opinion, ils refusent de
dire la leur et se renferment dans un silence
dédaigneux.
Cette seconde classifcation des caractères
‒ quoique l’auteur n’ait pas eu le moins du monde la
prétention d’en faire une ‒ ressemble beaucoup à la
première, avec les diférences obligées ; et soit dit en
passant, c’est de cette manière-là seulement ‒ en
7
classant les réactions des sujets d’après une série de
points de vue, ‒ qu’on arrivera à établir une théorie
générale des caractères, et non en faisant des
classifcations théoriques, véritables châteaux bâtis en
l’air. Mais ce n’est point, pour le moment, le sujet que
nous avons en vue. Nous avons voulu simplement
montrer, en reproduisant les deux classifcations
précédentes, que la suggestibilité en forme le fond, et
qu’on ne peut pas étudier le caractère sans tenir
compte de cet élément essentiel.
3
G. de Lapouge , traitant de l’inégalité parmi les
hommes, a proposé de rattacher chaque individu ou
chaque groupe à quatre grands types intellectuels :
1° Le premier type est celui des initiateurs, des
inventeurs ; tout ce qui change une civilisation leur
est dû.
2° Le second est celui des hommes intelligents et
ingénieux, qui reprennent et perfectionnent les
inventions des premiers.
3° Le troisième type réunit les individus à esprit de
troupeau, comme dit Galton, qui sont les ennemis de
toutes les idées nouvelles, de tous les progrès, et
opposent soit une lutte opiniâtre, s’ils sont
intelligents, soit une inertie absolue s’ils sont
inférieurs.
4° Le quatrième type est incapable de produire, de
combiner, et même de recevoir par éducation la plus
modeste somme de culture.
Nous pensons que le mot de suggestibilité répond à
plusieurs phénomènes que l’on doit provisoirement
distinguer ; ces phénomènes sont les suivants :
3 G. de Lapouge, De l’inégalité parmi les hommes, Revue
d’anthrop., 3e série, III, 1888, p. 9. Cette classifcation des
types intellectuels est curieuse ; elle ne me paraît fondée sur
aucune recherche expérimentale ; je l’ai reproduite parce
qu’elle repose, comme celle de Tissié, au moins en partie sur
la notion de suggestibilité.
8
1° L’obéissance à une infuence morale, venant
d’une personne étrangère. C’est là le sens technique,
en quelque sorte, du mot suggestibilité ;
2° La tendance à l’imitation, tendance qui dans
certains cas peut se combiner avec une infuence
morale de suggestion, et dans d’autres cas, exister à
l’état isolé ;
3° L’infuence d’une idée préconçue qui paralyse le
sens critique ;
4° L’attention expectante ou les erreurs
inconscientes d’une imagination mal réglée ;
5° Les phénomènes subconscients qui se produisent
pendant un état de distraction ou par suite d’un
événement quelconque qui a créé une division de
conscience. C’est à cette catégorie qu’appartiennent
les mouvements inconscients, le cumberlandisme, les
tables tournantes et l’écriture spirite.
Je crois utile d’ajouter que les distinctions que je
viens de proposer sont entièrement théoriques ; elles
résultent d’une simple analyse de la question et leur
but est de préparer les voies à des recherches
expérimentales ; l’expérimentation seule peut éclairer
ces diférents points ; je me suis servi de cette analyse
comme point de départ pour instituer diférentes
expériences ; il faudra rechercher ensuite si
l’expérience confrme les distinctions susdites.
Nous allons maintenant reprendre chacune de ces
variétés de suggestibilité, la défnir avec soin et
rechercher comment les auteurs ont pu en faire
l’étude, par des méthodes absolument étrangères à
l’hypnotisme.
9
I – Suggestibilité proprement dite ou
obéissance
Être suggestible ou être autoritaire, voilà un
dilemme qui se pose à propos de chaque individu : le
succès de toute une carrière en dépend et on peut
dire que les autoritaires ‒ toutes choses égales
d’ailleurs, c’est-à-dire si la mauvaise fortune,
l’inconduite, etc., ne se mettent pas en travers ‒ ont
bien plus de chance d’arriver dans la vie que les
suggestibles. On ne pourrait pas citer beaucoup
d’individus ayant atteint de hautes situations qui
manqueraient d’autorité. L’autorité peut remplacer
toutes les autres qualités intellectuelles ; dans un
cercle, quel est celui qu’on écoute ? ce n’est pas le
plus intelligent, celui qui pourrait dire les choses les
plus curieuses ; c’est celui qui a le plus d’autorité,
dont le regard est volontaire, dont la parole, pleine,
sonore, articule lentement des phrases interminables,
dont tout le monde supporte respectueusement
l’ennui. Il y a plaisir à analyser, témoin invisible, une
conversation de cinq ou six personnes, à laquelle on
ne prend aucune part ; on voit de suite quel est celui
qui fait de la suggestion ; celui-là guide la
conversation, en règle l’allure, impose son opinion,
développe ses idées ; puis il y a parfois lutte ; un
autre, plus ferré sur un certain terrain, prend
l’avantage et réussit à se faire écouter. Un
interlocuteur nouveau peut changer complètement
l’état des forces, car, chose surprenante, l’autorité est
une qualité toute relative ; une personne A en exerce
sur B, qui en exerce sur C, et C à son tour tient A sous
son autorité.
La manière d’afirmer, le ton de la voix, la forme
grammaticale peuvent révéler celui qui a de
10
l’autorité : il y a des phrases modestes comme : « je
ne sais pas », ou « je vous demande pardon », qu’un
homme d’autorité afirme avec éclat.
Certaines qualités physiques augmentent
l’autorité ; la conscience de sa force en donne
beaucoup. Un sportsman de mes connaissances, qui
fait le courtier de commerce, disait que le secret de
son aplomb réside dans sa conviction de ne jamais
rencontrer des poings plus forts que les siens. Le
costume ajoute aussi à l’autorité, le costume militaire
surtout, ainsi du reste que tout ce cérémonial dont
Pascal s’est moqué, mais dont il a parfaitement
compris le sens. Le nombre est aussi un facteur
important : douze individus en groupe qui regardent
un individu isolé exercent sur lui une autorité
énorme ; malheur à celui qui est seul. On a
parfaitement ce sentiment quand on croise, isolé, dans
une rue de village, une compagnie de militaires qui
vous regardent : il faut beaucoup d’autorité pour
soutenir tous ces regards, et l’homme timide se
détourne. Cette infuence de masse, nous l’avons vue
et en quelque sorte mesurée, M. Vaschide et moi, dans
des expériences que nous faisions récemment dans les
écoles sur la mémoire des chifres. Ces expériences
avaient lieu collectivement ; nous réunissions dans
une classe dix élèves ou davantage, et après une
explication, nous dictions des chifres que les élèves
devaient écrire de mémoire, sans faire de bruit, sans
plaisanter et sans tricher. Nous étions deux, et seuls
pour maintenir la discipline ; les jeunes gens avaient
de seize à dix-huit ans, parisiens, et passablement
bruyants ; nous n’avions sur eux aucune autorité
matérielle, ne pouvant pas leur infiger de punition ;
enfn, l’épreuve était monotone et assez fatigante. Il
nous fut très facile de constater que nous pouvions
tenir en respect une dizaine de ces jeunes gens, mais
11
dès que ce nombre était dépassé, la discipline se
relâchait, les élèves étaient plus bruyants et quelques
tricheries se déclaraient.
Les considérations, précédentes ont surtout pour
but de montrer que l’étude de la suggestion peut se
faire ailleurs que dans des séances factices
d’hypnotisme et sur des malades à qui on fait manger
des pommes de terre transformées en oranges ; dans
les milieux de la vie réelle, les phénomènes
d’infuence, d’autorité morale prennent un caractère
plus compliqué ; et je renvoie le lecteur curieux
4
d’exemples à un chapitre fort intéressant, du livre du
regretté professeur Marion sur l’Éducation dans
l’Université.
Tout d’abord, comment devons-nous défnir, à ce
point de vue nouveau, la suggestion ? Quand est-ce
que la suggestion commence ? À quel caractère la
distingue-t-on des autres phénomènes normaux qui ne
sont point de la suggestion ? Cette défnition est tout
un problème, et on a dit depuis longtemps que la
plupart des gens qui emploient le mot de suggestion
n’en ont pas une idée claire. Il faut évidemment
reconnaître comme erronée l’opinion de tout un
groupe de savants pour lesquels la suggestion est une
5
idée qui se transforme en acte ; à ce compte, la
suggestion se confondrait avec l’association des idées
et tous les phénomènes intellectuels, et le terme
aurait une signifcation des plus banales, car la
transformation d’une idée en acte est un fait
psychologique régulier, qui se produit toutes les fois
que l’idée atteint un degré sufisant de vivacité.
Au sens étroit du mot, dans son acception pour ainsi
4 Pages 310 et seq.
5 Voici une phrase cueillie dans un ouvrage tout récent : la
suggestion n’est-elle pas l’art d’utiliser l’aptitude que
présente un sujet à transformer l’idée reçue en acte ?
12
dire technique, la suggestion est une pression morale
qu’une personne exerce sur une autre ; la pression est
morale, ceci veut dire que ce n’est pas une opération
purement physique, mais une infuence qui agit par
idées, qui agit par l’intermédiaire des intelligences,
des émotions et des volontés ; la parole est le plus
souvent l’expression de cette infuence, et l’ordre
donné à haute voix en est le meilleur exemple ; mais il
sufit que la pensée soit comprise ou seulement
devinée pour que la suggestion ait lieu ; le geste,
l’altitude, moins encore, un silence, sufit souvent
pour établir des suggestions irrésistibles. Le mot
pression doit à son tour être précisé, et c’est un peu
délicat. Pression veut dire violence : par suite de la
pression morale l’individu suggestionné agit et pense
autrement qu’il le ferait s’il était livré à lui-même.
Ainsi, quand après avoir reçu un renseignement, nous
changeons d’avis et de conduite, nous n’obéissons
point à une suggestion, parce que ce changement se
fait de plein gré, il est l’expression de notre volonté, il
a été décidé par notre raisonnement, notre sens
critique, il est le résultat d’une adhésion à la fois
intellectuelle et volontaire. Quand une suggestion a
réellement lieu, celui qui la subit n’y adhère pas de sa
pleine volonté, et de sa libre raison ; sa raison et sa
volonté sont suspendues pour faire place à la raison et
à la volonté d’un autre ; on dit à cet individu : vous ne
pouvez plus lever le bras, et efectivement tous ses
eforts de volonté deviennent impuissants pour lever
le bras ; de même, on lui afirme qu’un oiseau est
perché sur son épaule, et il ne peut pas se
débarrasser de cette hallucination, il voit l’oiseau, il
l’entend, il est complètement dupe de cette vision.
6
C’est ce que Sidis exprime dans un langage très clair,
mais un peu schématique, quand il dit qu’il existe en
6 The Psychology of Suggestion. New York, 1898, p. 70.
13
chacun de nous des centres d’ordre diférent : d’abord
les centres inférieurs, idéo-moteurs, centres réfexes
et instinctifs, et ensuite les centres supérieurs,
directeurs, sièges de la raison, de la critique, de la
volonté.
L’efet de la suggestion est d’imprimer le
mouvement aux centres inférieurs, en paralysant
l’action des centres supérieurs ; la suggestion crée
par conséquent, ou exploite un état de désagrégation
mentale.
Il y a beaucoup de vrai dans cette conception,
quoique la distinction des centres inférieurs et
supérieurs soit un peu grossière. Je ne pense pas qu’il
soit nécessaire de faire intervenir dans l’explication,
même sous forme d’image, une idée anatomique sur
les centres nerveux ; je préférerais, quant à moi,
distinguer un mode d’activité simple, automatique et
un mode d’activité plus complexe, plus réféchi, et
admettre que par suite de la dissociation réalisée par
la suggestion, c’est le mode d’activité simple qui se
manifeste, le mode complexe étant plus ou moins
altéré.
Un clinicien bien connu, M. Grasset, a du reste
montré récemment l’inconvénient que peut présenter
la schématisation à outrance des phénomènes de
7
suggestion . Cet auteur a supposé que le pouvoir de
direction et de coordination résidait dans un centre
spécial de l’encéphale, le centre O ; et que les actes
automatiques sont produits par des centres inférieurs
réunis par des fbres associatives, et formant un
polygone qui se sufit à lui-même. Cette supposition
lui permet de défnir plusieurs cas d’automatisme et
de dédoublement sous une forme qui est très
pittoresque, mais qui, prise à la lettre, conduirait à de
7 Leçons de clinique médicale. L’automatisme psychologique.
Montpellier, 1896.
14
graves erreurs.
La distraction, par exemple, serait une dissociation
entre le centre O et le polygone : « quand Archimède
sort dans la rue en son costume de bain, criant
Eureka, il marche avec son polygone et pense à son
problème avec son centre O. »
Érasme Darwin a raconté l’histoire d’une actrice
qui, tout en jouant et chantant, ne pensait qu’à son
canari mourant. « Elle chantait avec son polygone, et
pleurait son canari avec O. » Nous admettons qu’il y a
peut-être quelque avantage, pour la clarté d’une
exposition purement médicale, destinée à des
étudiants en médecine, à imaginer un centre
psychique supérieur et un polygone de centres
inférieurs ; mais on commettrait une erreur en
prenant ces hypothèses simplistes au pied de la lettre.
Ce centre O, qui ressemble un peu trop à la glande
pinéale dans laquelle Descartes logeait l’âme, que
devient-il dans les dédoublements de personnalité
analogues à ceux de Felida qui vit, pendant des mois,
tantôt dans une condition mentale, tantôt dans une
autre ? Peut-on dire que l’une de ces existences est
une vie automatique, (polygonale, sous-association de
O) et que l’autre de ces existences est une vie
complète (avec le polygone et O synthétisés) ?
Évidemment non ; et l’embarras de Grasset à
s’expliquer sur ce point (voir la page 98) montre le
défaut de la cuirasse qui existe dans la théorie. Il n’y a
point de séparation nette entre la vie psychique
supérieure et la vie automatique, au moins à notre
avis ; la vie automatique, en se compliquant, en se
rafinant, devient de la vie psychique supérieure, et
par conséquent, nous pensons qu’il est inexact
d’attribuer à ces formes d’activité des organes
distincts.
Le premier caractère de la suggestion est donc de
15
supposer une opération dissociatrice ; le second
caractère consiste dans un degré plus ou moins
avancé d’inconscience ; cette activité, quand la
suggestion l’a mise en branle, pense, combine des
idées, raisonne, sent et agit sans que le moi conscient
et directeur puisse clairement se rendre compte du
mécanisme par lequel tout cela se produit.
L’individu à qui on défend de lever le bras, rapporte
8
Forel , est tout étonné et ne comprend pas comment il
peut se faire que son bras soit paralysé ; ce procédé
de paralysie, qui s’est réalisé en lui, et qui est de
nature mentale, reste pour lui lettre close ; de même,
l’hystérique à qui l’on fait apparaître une
photographie sur un carton blanc, tiré d’une douzaine
de cartons tous pareils, et qui retrouve ensuite ce
9
carton , ne peut pas nous expliquer quels sont les
repères qui la guident ; ce sont des repères qui sont
inconscients pour elle, et cette inconscience est un
caractère de la dissociation.
Enfn, pour achever cette rapide défnition de la
suggestion, il faut tenir compte d’un élément
particulier, assez mystérieux, dont nous ne pouvons
donner l’explication, mais dont nous connaissons de
science certaine l’existence, c’est l’action morale de
l’individu. Le sujet suggestionné n’est pas seulement
une personne qui est réduite temporairement à l’état
d’automate, c’est en outre une personne qui subit une
action spéciale émanée d’un autre individu ; on peut
appeler cette action spéciale de diférents noms, qui
seront vrais ou faux suivant les circonstances : on
peut l’appeler peur, ou amour, ou fascination, ou
charme, ou intimidation, ou respect, admiration, etc.,
8 Quelques mots sur la nature et les indications de la
Thérapeutique suggestive. Revue médicale de la Suisse
romande, décembre 1898.
9 Voir Magnétisme animal, par Binet et Féré, p. 166 et seq.
16
peu importe : il y a là un fait particulier, qu’il serait
oiseux de mettre en doute, mais qu’on a beaucoup de
peine à analyser. Dans les expériences d’hypnotisme
proprement dit, ce fait se produit surtout par ce que
l’on appelle l’électivité ou le rapport ; c’est une
disposition particulière du sujet qui concentre toute
son attention sur son hypnotiseur, au point de ne voir
et de n’entendre que ce dernier, et de ne soufrir que
son contact.
On a du reste décrit longuement les efets de
l’électivité non seulement pendant les scènes
10
d’hypnotisme, mais encore en dehors des séances .
Les premières expériences méthodiques, de moi
connues, qui ont été faites sur des sujets normaux
pour établir les efets de la suggestion en dehors de
tout simulacre d’hypnotisme, sont celles du zoologiste
11
Yung, de Genève . Cet auteur les a décrites un peu
brièvement dans son petit livre sur le sommeil
hypnotique. Il raconte que dans son laboratoire, ayant
à exercer des étudiants à l’usage du microscope, il
mettait sur le porte-objet une préparation quelconque,
il décrivait d’avance des détails purement
imaginaires, puis il priait les débutants de regarder,
de décrire à leur tour ce qu’ils voyaient ; très souvent,
dit-il, les étudiants ont attesté qu’ils voyaient les
détails annoncés par leur professeur ; quelques-uns
même les ont dessinés. Le fait est intéressant, sans
doute ; mais on voudrait plus de détails ; peut-être
n’ont-ils fait le dessin que par pure complaisance,
parce qu’ils voulaient faire plaisir à leur futur
examinateur, et il n’est pas certain qu’ils aient cru voir
ce qu’ils ont dessiné.
10 Voir Pierre Janet. L’infuence somnambulique et le besoin de
direction, Revue philosophique, février 1897.
11 E. Yung. Le sommeil normal et le sommeil pathologique.
Paris, Doin.
17
12
Sidis a fait dans le laboratoire de Münsterberg, à
Harvard, des recherches analogues. Il faisait asseoir
son sujet devant une table, et le priait de regarder
fxement un point d’un écran ; cette fxation avait lieu
durant vingt secondes ; pendant ce temps-là, le sujet
devait chasser toute idée et s’eforcer de ne penser à
rien ; puis brusquement, on enlevait l’écran,
découvrant une table sur laquelle divers objets étaient
posés, et il était convenu que lorsque l’écran serait
enlevé, le sujet devait exécuter, aussi rapidement que
possible, un acte quelconque laissé à son choix.
L’expérience se déroulait en efet dans l’ordre
indiqué ; seulement, quand l’écran était enlevé,
l’opérateur donnait à haute voix une suggestion,
comme de prendre un objet placé sur la table, ou de
frapper 3 coups sur la table. Cette suggestion de
mouvements et d’actes n’a pas été infaillible,
puisqu’elle s’adressait à des personnes éveillées ;
cependant Sidis rapporte qu’elle réussissait dans la
moitié des cas. Ceux même qui n’obéissaient pas
paraissaient parfois impressionnés, car il en est
quelques-uns qui restaient immobiles, comme frappés
d’inhibition, incapables d’exécuter le plus petit
mouvement. Parmi ceux qui obéissaient, il s’en est
trouvé un, jeune homme très intelligent, qui exécutait
à la manière d’un mouvement réfexe l’acte
commandé. Quant aux autres, on les voyait bien
exécuter l’acte, mais il était dificile de se rendre
compte de la façon dont ils avaient été
impressionnés : si on les interrogeait, si on leur
demandait pourquoi ils avaient obéi, ils répondaient
en général que c’était par simple politesse. L’auteur a
raison de douter qu’une telle explication soit valable
pour un si grand nombre de cas. Analysant son
expérience, il a cherché à se rendre compte des
12 Op. cit., p. 35.
18
raisons pour lesquelles elle restait obscure. Pour
qu’une suggestion réussisse à l’état de veille, il faut
réunir un certain nombre de conditions qui ont pour
but de procurer au sujet un état de calme physique et
moral et de diminuer son pouvoir de résistance. Or,
lorsqu’on adresse à haute voix une injonction à une
personne, on emploie la suggestion directe, qui a
toujours le tort d’éveiller la résistance ; de là les
insuccès fréquents. L’auteur pense que ce sont surtout
les suggestions indirectes qui réussissent pendant
l’état de veille, et les suggestions directes pendant
l’état d’hypnotisme.
Cette formule présente une netteté très curieuse,
mais nous doutons qu’elle soit absolument juste, et
puisse convenir à tous les cas.
Ce qui me paraît entièrement vrai, c’est que la
résistance du sujet peut faire échouer les suggestions
directes. Cette cause d’échec est moins à craindre
pendant l’état d’hypnotisme, mais elle n’y subsiste pas
moins, et je me rappelle plus d’un sujet rebelle qui a
mis dans un grand embarras son opérateur : un jour
que Charcot montrait quelques-unes de ses
hypnotisées à des étrangers, il voulut faire écrire à
l’une d’elles une reconnaissance de dette égale à un
million ; l’énormité du chifre provoqua de la part de
l’hypnotisée une résistance invincible, et pour la
décider à donner sa signature il fallut se borner à lui
faire souscrire une dette de cent francs. D’autre part,
j’ai bien constaté que pendant l’état d’hypnotisme, les
suggestions données sous une forme indirecte sont
très efectives ; au lieu de dire à une malade rebelle :
« Vous allez vous lever ! » on obtient un efet qui
quelquefois est plus sûr, en se contentant de dire à
demi-voix à un assistant : « Je crois qu’elle va se
lever. » Suivant les circonstances, tel mode de
suggestion réussit et tel autre mode échoue.
19
Mais revenons à l’étude de l’état normal. Il faut
distinguer les suggestions de sensations et d’idées et
les suggestions d’actes ; ces dernières sont toujours
dificiles à réaliser, car elles impliquent d’une part
commandement et d’autre part obéissance, et il est
bien vrai qu’un ordre donné sur un ton autoritaire a
quelque chose d’ofensant qui excite un sujet à la
résistance. Il y aurait donc lieu d’imaginer une forme
d’expérience un peu diférente de celle de Sidis.
Un petit détail, assez insignifant en apparence, est
à relever dans les descriptions de cet auteur. Avant de
donner sa suggestion, dit-il, il avait soin d’engager la
personne à regarder un point fxe pendant vingt
secondes.
Il ne dit pas pourquoi il a employé cette fxation du
regard, ni si les sujets qui n’avaient pas eu soin de
regarder fxement un point étaient plus suggestibles
que les autres. Je pense que cette pratique, qui
rappelle beaucoup le procédé de Braid pour
hypnotiser, devrait être étudiée avec soin dans ses
conséquences psycho-physiologiques.
La recherche de Sidis ne comporte point une étude
de détail, de psychologie individuelle sur la
suggestibilité ; elle nous apprend seulement qu’on
peut faire des suggestions d’actes sur des élèves de
laboratoire et réussir ces suggestions. C’est le fait
même de la suggestibilité qui est mis ici en lumière, et
pas autre chose. L’étude de Sidis a donc ce même
caractère préliminaire que les études bien antérieures
de Yung.
Un autre auteur, Bérillon, qui s’est beaucoup
occupé de l’hypnotisation des enfants comme méthode
13
pédagogique, vient de publier un opuscule où il
rapporte plusieurs exemples de suggestion donnée à
13 L’hypnotisme et l’orthopédie mentale, par E. Bérillon, Paris,
Ruef. 1898.
20
l’état de veille.
Ces observations ne rentrent pas absolument dans
le cadre de notre travail, car, ainsi que nous l’avons
annoncé, nous ne nous occuperons point des
suggestions dites de l’état de veille, lorsqu’elles sont
données d’après les mêmes méthodes que la
suggestion de l’hypnotisme ; cependant nous croyons
devoir dire un mot des recherches de Bérillon, à cause
de la curieuse assertion dont il les accompagne.
D’après son expérience, des enfants imbéciles,
idiots, hystériques, sont beaucoup moins facilement
hypnotisables et suggestibles que « les enfants
robustes, bien portants, dont les antécédents
héréditaires n’ont rien de défavorable ».
Ces derniers seraient « très sensibles à l’infuence
de l’imitation. Ils s’endorment souvent, lorsqu’on a
endormi préalablement d’autres personnes devant
eux, d’une façon presque spontanée. Il sufit de leur
afirmer qu’ils vont dormir pour vaincre leur dernière
résistance. Leur sommeil a toutes les apparences du
sommeil normal, ils reposent tranquillement les yeux
14
fermés ».
Voici maintenant ce que l’auteur pense de ceux qui
résistent aux suggestions : « Au point de vue
purement psychologique, la résistance aux
suggestions est aussi intéressante à constater qu’une
extrême suggestibilité. Elle dénote un état mental
particulier et souvent même un esprit systématique de
contradiction dont il faut neutraliser les efets. Parfois
cette résistance est inspirée par des motifs dont il y a
lieu de ne pas tenir compte. Le plus fréquent de ces
motifs est la peur de l’hypnotisme, que nous arrivons
assez facilement à dissiper.
« Le degré de suggestibilité n’est nullement en
rapport avec un état névropathique quelconque. La
14 Op. cit., p. 10.
21
suggestibilité, au contraire, est en rapport direct avec
le développement intellectuel et la puissance
d’imagination du sujet. Suggestibilité, à notre avis, est
synonyme d’éducabilité.
« Le diagnostic de la suggestibilité. ‒ Ce diagnostic
peut être fait à l’aide d’une expérience des plus
simples. Cette expérience a pour objet d’obtenir chez
le sujet la réalisation d’un acte très simple, suggéré à
l’état de veille. Voici comment je procède :
« Après avoir fait le diagnostic clinique et interrogé
l’enfant avec douceur, je l’invite à regarder avec une
grande attention un siège placé à une certaine
distance, au fond de la salle, et je lui fais la suggestion
suivante : « Regardez attentivement cette chaise ;
vous allez éprouver malgré vous le besoin irrésistible
d’aller vous y asseoir. Vous serez obligé d’obéir à ma
suggestion, quel que soit l’obstacle qui vienne
s’opposer à sa réalisation. »
« J’attends alors le résultat de l’expérience. Au bout
de peu de temps (une ou deux minutes) on voit
ordinairement l’enfant se diriger vers la chaise
indiquée, comme poussé par une force irrésistible,
quels que soient les eforts qu’on fasse pour le retenir.
Dès lors je puis poser mon pronostic, et déclarer que
cet enfant est intelligent, docile, facile à instruire et à
éduquer et qu’il a de bonnes places dans sa classe. Je
puis ajouter qu’il sera très facile à hypnotiser.
« Si l’enfant reste immobile, et déclare qu’il
n’éprouve aucune attraction vers le siège qui lui est
désigné, je puis conclure de ce résultat négatif qu’il
est mal doué au point de vue intellectuel et mental, et
qu’il sera facile de retrouver chez lui des stigmates
accentués de dégénérescence. L’opinion des maîtres
et des parents vient toujours confrmer ce
diagnostic. »
On sera sans doute étonné, de prime abord, qu’un
22
auteur voie dans la suggestibilité des signes
d’éducabilité ; les hypnotiseurs nous ont du reste
habitués aux afirmations tranchantes et inattendues.
Delbœuf n’a-t-il pas soutenu que l’hypnotisme exalte
la volonté humaine ? Nous pensons inutile de décrire
à nouveau ce que nous entendons par état de
suggestibilité, état dans lequel il y a une suspension
de l’esprit critique, et une manifestation de la vie
automatique, et par conséquent nous n’insisterons pas
pour prouver qu’un développement anormal de
l’automatisme ne saurait en aucune façon être une
preuve d’intelligence. En somme, ce sont là des
discussions théoriques, qui n’engendrent pas toujours
la conviction, et il vaut bien mieux traiter la question
sous une forme expérimentale.
Sur ce dernier point, je crois intéressant de
remarquer que Bérillon se contente d’afirmer sans
rien prouver.
On aurait été curieux d’avoir sous les yeux une
statistique de bons élèves et de mauvais élèves, et
d’étudier le pourcentage des hypnotisables dans ces
deux catégories. C’est ainsi que nous procédons en
psychologie expérimentale, nous donnons nos chifres,
et nous les laissons parler. L’habitude maintenant est
si bien prise que lorsque nous rencontrons une
afirmation sans preuves, nous la considérons comme
une impression subjective, sujette à des erreurs de
toutes sortes. Voilà ce qu’aurait dû se rappeler un
15
auteur américain, M. Luckens , qui dit avoir été très
frappé, dans une visite faite à Bérillon, de cette
assimilation de la suggestibilité à l’éducabilité ; il
aurait dû demander des preuves, et jusqu’à ce qu’elles
16
lui eussent été fournies, suspendre son jugement .
15 Luckens. Notes abroad, Pedagogical Seminary, 10, 1898.
16 Je crois devoir ajouter quelques remarques sur les rapports
pouvant exister entre la suggestibilité d’une personne et son
23
J’ai fait il y a cinq ans environ, en collaboration avec
V. Henri, des expériences de suggestion qui rentrent
dans cette catégorie, c’est-à-dire qui sont la mise en
œuvre de l’autorité morale ; ce n’étaient point des
suggestions d’actes ou de sensations ; la suggestion
était dirigée de manière à troubler seulement un acte
de mémoire. Une ligne modèle de 40 millimètres de
longueur étant présentée à l’enfant, il devait la
retrouver, par mémoire ou par comparaison directe,
dans un tableau composé de plusieurs lignes, parmi
lesquelles se trouvait réellement la ligne modèle. Au
moment où il venait de faire sa désignation, on lui
adressait régulièrement, et toujours sur le même ton,
la phrase suivante : « En êtes-vous bien sûr ? N’est-ce
pas la ligne d’à côté ? » Il est à noter que sous
l’infuence de cette suggestion discrète, faite d’un ton
très doux, véritable suggestion scolaire, la majorité
des enfants abandonne la ligne d’abord désignée et en
choisit une autre. La répartition des résultats montre
que les enfants les plus jeunes sont plus sensibles à la
suggestion que leurs aînés : en outre, la suggestion
intelligence. Il me paraît incontestable qu’un certain degré
d’intelligence est nécessaire pour comprendre la suggestion
donnée, et une personne qui ne comprendra pas une
suggestion trop complexe pour son intelligence se trouvera,
par ce fait même, incapable de l’exécuter ; l’échec ne viendra
pas de son défaut de suggestibilité, mais de son défaut
d’intelligence. Je prends tout de suite un exemple : un enfant
d’école primaire ne pourra pas, par suggestion, résoudre une
équation à deux inconnues, ou faire un problème de calcul
intégral. Dans ce sens, on peut dire que l’intelligence du sujet
n’est pas sans relation avec sa suggestibilité. Nous
rencontrons du reste cette relation lorsque nous nous
adressons pour nos recherches aux enfants très jeunes ; à
cinq ans, et à six ans, un enfant me paraît être en général
beaucoup plus suggestible qu’à neuf ans ; mais son extrême
suggestibilité se trouve neutralisée dans bien des cas par son
incapacité à comprendre la suggestion.
24
est plus eficace quand l’opération qu’on cherche à
modifer est faite de mémoire que quand elle est faite
par comparaison directe (c’est-à-dire le modèle et le
tableau de lignes se trouvant simultanément sous les
yeux de l’enfant) ; voici quelques chifres :
NOMBRE DES CAS OÙ LES ENFANTS ONT CHANGÉ
LEUR RÉPONSE
Cours élémentaire
Dans la mémoire : 89 %
Dans la comparaison directe : 74 %
Moyenne : 81,5 %
Cours moyen
Dans la mémoire : 80 %
Dans la comparaison directe : 73 %
Moyenne : 76,5 %
Cours supérieur
Dans la mémoire : 54 %
Dans la comparaison directe : 48 %
Moyenne : 51 %
Dans ces chifres sont confondus les enfants qui,
avant la suggestion, ont fait une désignation exacte de
la ligne égale au modèle, et les enfants qui ont fait
une désignation fausse. Il faut maintenant distinguer
ces deux groupes d’enfants, dont chacun présente un
intérêt particulier. Les enfants qui se sont trompés
une première fois font en général une désignation
plus exacte, grâce à la suggestion ; ainsi, si l’on
compte ceux dont la seconde désignation se
rapproche plus du modèle que la première, on en
trouve 81 p. 100, tandis que ceux qui s’en éloignent
davantage forment une petite minorité de 19 p. 100.
Quant aux enfants qui ont vu juste la première fois, ils
25
sont remarquables par la fermeté avec laquelle ils
résistent à la suggestion, qui, dans leur cas, est
perturbatrice ; 56 p. 100 seulement abandonnent leur
première opinion, tandis que dans le cas d’une
réponse inexacte, il y en a 72 p. 100 qui changent de
désignation.
Je ferai remarquer que cette étude de V. Henri et de
moi a été conçue dans un esprit un peu diférent de
celui qu’on trouve dans d’autres travaux du même
genre. Nous ne nous sommes pas simplement
proposés de montrer que les enfants, ou que tels et
tels enfants sont suggestibles, mais nous avons
cherché à préciser le mécanisme de cette
suggestibilité, en étudiant les conditions mentales où
la suggestion réussit le mieux ; on a vu que la
suggestion réussit le mieux dans les cas où la
certitude de l’enfant, sa confance est le plus faible,
par exemple lorsqu’il fait sa comparaison de mémoire
au lieu de faire une comparaison directe, ou lorsqu’il a
fait une première comparaison erronée ; d’où l’on
pourrait déduire cette règle provisoire que : la
suggestibilité d’une personne sur un point est en
raison inverse de son degré de certitude relativement
à ce point.
Il y a donc un progrès, me semble-t-il, entre cette
recherche de V. Henri et de moi, et quelques-unes des
recherches antérieures. Nous ne nous sommes pas
contentés d’observer l’existence de la suggestibilité à
l’état de veille, nous avons en outre pu apprécier les
degrés de cette suggestibilité, ce qui nous a permis
d’établir que ce degré varie avec l’âge de l’enfant, et
varie aussi suivant la justesse de son coup d’œil ou
suivant qu’il fait la comparaison avec la mémoire ou
avec sa perception. Mais hâtons-nous d’ajouter que
l’appréciation que nous avons pu faire des degrés de
suggestibilité est encore bien rudimentaire ; pour
26
savoir que les enfants sont plus suggestibles à tel âge
qu’à tel autre, et dans telle condition que dans telle
autre, qu’avons-nous fait ? Nous avons employé la
méthode statistique ; à tel âge, avons-nous calculé, il y
a 81 enfants sur 100 qui obéissent à la suggestion,
tandis qu’à un âge plus avancé, on n’en trouve plus
que 51 pour 100 de suggestibles. Ce procédé
d’évaluation n’est possible qu’à la condition d’opérer
sur un grand nombre de sujets ; évidemment, ce n’est
pas un procédé directement applicable à la
psychologie individuelle ; il ne pourrait pas servir à
déterminer dans quelle mesure un enfant particulier
est suggestible.
Dernièrement, un anthropologiste italien, Vitale
17
Vitali , a reproduit nos expériences dans les écoles de
la Romagne, et il est arrivé à des résultats encore plus
frappants que les nôtres. Il a constaté comme nous
que les changements d’opinion se font bien plus
facilement dans l’opération de mémoire que dans la
comparaison directe ; le nombre de ceux qui changent
d’opinion est à peu près le double dans le premier
cas ; il a vu aussi que cette suggestibilité diminue
beaucoup avec l’âge, et enfn qu’elle est moins forte
chez ceux qui ont vu juste la première fois que chez
ceux qui s’étaient trompés.
Nos chifres étaient les suivants : pour ceux ayant
vu juste la première fois, les suggestibles étaient de
56 p. 100, tandis que pour ceux qui s’étaient trompés,
les suggestibles étaient de 72 p. 100. Les résultats de
Vitale Vitali sont encore plus nets ; pour le premier
groupe, il trouve 32 p. 100, et pour le second 80 p.
100. C’est donc une confrmation sur tous les points.
Le même auteur a imaginé une variante curieuse de
l’expérience susdite, en appliquant deux pointes de
compas sur la peau d’un élève, et en lui demandant,
17 Studi antropologici, Forli, 1896, p. 97.
27
lorsque l’élève avait accusé une pointe ou deux : « En
êtes-vous bien sûr ? » Les élèves de moins de quinze
ans ont changé d’avis sous l’infuence de cette
suggestion, dans le rapport de 65 p. 100, et les élèves
de plus de quinze ont changé dans le rapport de 44 p.
100 ; c’est une nouvelle démonstration de l’infuence
de l’âge sur la suggestibilité. Comme l’auteur le fait
remarquer, cette méthode renferme une plus grande
cause d’erreur que les exercices sur la mémoire
visuelle des lignes, parce que le sens du toucher se
perfectionne rapidement au cours des expériences et
cela change les conditions.
Ainsi que nous l’avons fait nous-mêmes, Vitali
insiste sur l’importance de la personnalité de
l’expérimentateur, personnalité qui fait beaucoup
varier les résultats. Il déclare même qu’ayant répété
après quelque temps les mêmes tests sur les mêmes
sujets, il a trouvé des variations énormes. Nous
croyons qu’il eût été utile d’étudier ces variations et
d’en rechercher les causes.
Cela est très curieux, et on pourrait bien, de cette
manière, mesurer la suggestibilité du sujet par le
nombre de fois qu’il perçoit une pointe au lieu de
deux ; mais il aurait été très intéressant de savoir s’il
y a quelque relation entre la suggestibilité de la
personne et la fnesse de sa sensibilité tactile ; c’est
une question qui malheureusement n’a pas été
examinée.
Les expériences de MM. Henri et Tawney sont des
expériences de suggestion ; voici pourquoi : il n’y a
pas, à proprement parler, d’ordre donné sur un ton
impératif ; mais l’idée préconçue de deux pointes est
acceptée par le sujet pendant toute la séance parce
qu’il a confance dans la parole de l’opérateur et qu’il
croit que l’opérateur est incapable de le tromper ; en
efet, comme dans les laboratoires de psychologie on
28
ne fait guère d’expériences de suggestion, les élèves
ne sont point habitués à des expériences de
mensonge, et ils ne songent pas à se méfer de ce
qu’on leur dit. C’est donc de la suggestion dans le
sens de confance plutôt que dans le sens
d’obéissance. Ce sont de petites nuances qui se
préciseront sans doute dans les études ultérieures.
J’ai repris dernièrement, avec M. Vaschide, sur 86
élèves d’école primaire élémentaire, la recherche de
suggestion que j’avais commencée avec M. V. Henri ;
seulement nous avons employé une méthode un peu
plus rapide.
18
M. Victor Henri a fait avec M. Tawney quelques
expériences sur la sensibilité tactile, pour étudier
l’infuence de l’attente et de la suggestion sur la
perception de deux pointes lorsqu’on ne touche qu’un
seul point de la peau ; avant chaque expérience on
montrait au sujet le compas avec les deux pointes
présentant un écart bien déterminé ; puis le sujet
fermait les yeux, et on touchait sa peau avec une seule
pointe ; sous l’infuence de cette suggestion, les
appréciations du sujet sont profondément troublées ;
le plus souvent, il perçoit deux pointes au lieu d’une,
et de plus, il juge l’écart d’autant plus grand que
l’écart réel qu’on lui a montré est plus grand.
L’expérience avait été confée à M. Michel, directeur
de l’école ; c’était lui seul qui parlait et expliquait,
nous restions simples témoins. M. Michel se rendait
donc avec nous dans les classes, il faisait distribuer
aux élèves du papier et des plumes, il faisait écrire sur
chaque feuille les noms des élèves, la classe, le nom
de l’école, la date du jour et l’heure ; puis après ces
préliminaires obligés de toute expérience collective, il
annonçait qu’il allait faire une expérience sur la
mémoire des lignes, des longueurs ; une ligne tracée
18 Voir Année Psychologique, II, p. 295 et seq.
29
sur un carton blanc serait montrée pendant trois
secondes à chaque élève, et chaque élève devait,
après avoir vu ce modèle, s’empresser de tracer sur sa
feuille une ligne de longueur égale. M. Michel allait
ensuite de banc en banc, et montrait à chaque élève la
ligne tracée ; par suite de la discipline parfaite que
notre distingué collaborateur sait faire régner dans
son école, les élèves restaient absolument silencieux,
et aucun ne voyait la ligne deux fois. Il fallait environ
soixante-dix secondes pour montrer la ligne à tous les
élèves de la classe. Ceci terminé, M. Michel remontait
en chaire et annonçait qu’il allait montrer une
seconde ligne un peu plus grande que la première ;
cette afirmation était faite d’une voix forte et bien
timbrée, avec l’autorité naturelle d’un directeur
d’école ; mais l’afirmation n’avait lieu qu’une fois, et
collectivement, M. Michel s’adressant à toute la
classe. Or, la seconde ligne n’avait que 4 centimètres
de longueur, alors que la première en avait 5. La
seconde ligne était montrée à chaque élève,
exactement comme on avait fait pour la première fois.
Entre ces deux expériences s’écoulait pour chaque
élève un temps moyen de deux à trois minutes. Cette
épreuve a été faite sur 86 enfants, comprenant les
trois premières classes de l’école primaire, et âgés de
neuf à quatorze ans.
Quels ont été les résultats ?
Notons tout d’abord que la reproduction de la
première ligne ‒ ce qui est une pure expérience de
mémoire, sans suggestion d’aucune sorte ‒ donne lieu
à d’énormes diférences individuelles, comprises, pour
la première classe, entre deux extrêmes : 60
millimètres et 28 millimètres ; la ligne avait en réalité
50 millimètres ; or, il y a eu seulement trois élèves sur
vingt-cinq qui ont dessiné une ligne égale ou
30
supérieure au modèle ; tous les autres ont dessiné une
ligne plus petite ; par conséquent, on peut afirmer
qu’il y a bien (comme nous l’avons vu autrefois), une
tendance des enfants à diminuer la longueur des
lignes de 50 centimètres en les reproduisant dans la
mémoire. Dans la deuxième classe, il y a eu 3 élèves
reproduisant une ligne supérieure à 50 ; tous les
autres élèves ont reproduit des lignes plus courtes ;
enfn, semblablement, dans la troisième classe, nous
n’en trouvons que deux dessinant une ligne plus
longue que le modèle, tous les autres ont fait plus
court.
En examinant quelle diférence les élèves ont
indiquée entre la première ligne (50 millimètres) et la
seconde (40 millimètres) on trouve que bien peu
d’élèves ont jugé réellement la seconde ligne plus
petite que la première ; par conséquent, la suggestion
a été eficace ; 9 élèves seulement, sur les 86 des trois
classes, ont dessiné une seconde ligne plus courte ; on
peut donc dire que 9 élèves seulement ont résisté à la
suggestion et ont cru au témoignage de leur mémoire
plus qu’à la parole de leur maître ; et encore, cette
remarque comporte une réserve ; il est probable que
ces réfractaires ont quand même été un peu
infuencés par la suggestion, car un seul a rendu la
seconde ligne plus petite de 10 millimètres, ce qui
était l’écart réel ; tous les autres ont amoindri cette
diférence ; 2 l’ont faite de 7 millimètres, 2 l’ont faite
de 5, etc.
Ils ont composé entre le témoignage de leur
mémoire et la parole du maître. Quant à ceux qui,
obéissant à la suggestion, ont dessiné la seconde ligne
plus grande que la première, ils présentent des degrés
très diférents de suggestibilité. Les écarts ont pu
atteindre 10 millimètres assez fréquemment, et une
fois même, l’écart a dépassé 20 millimètres, ce qui
31
veut dire qu’au lieu de faire la seconde ligne plus
courte de 10 millimètres, le sujet a été tellement
docile à la suggestion, qu’il a fait la seconde plus
longue de 20 millimètres ; en d’autres termes, la
suggestion a produit dans ce cas extrême, une erreur
de 30 millimètres, erreur énorme si on considère
qu’elle a porté sur une longueur totale de 50
millimètres. En moyenne, on a fait la seconde ligne
plus grande de 6 millimètres et comme elle était en
réalité plus petite de 10 millimètres, l’erreur totale est
de 1 cm 5 environ.
Il est à remarquer que les enfants les plus jeunes se
sont montrés les plus suggestibles. Nous trouvons en
efet, dans la première classe, que 7 élèves seulement
ont fait la seconde ligne de 5 millimètres plus grande
que la première ; au contraire, dans la troisième
classe, le nombre d’élèves qui sont dans ce cas est de
16. Du reste, dans nos expériences antérieures avec
M. Henri sur la suggestibilité scolaire, nous avions
aussi constaté que les plus jeunes enfants ont plus de
suggestibilité que les enfants plus âgés.
La description que nous avons donnée de notre
expérience de suggestion n’est pas complète ; nous
l’avons poussée plus loin. Lorsque tous les élèves
eurent reproduit de mémoire la ligne de 40
millimètres, le directeur de l’école leur présenta une
troisième ligne, longue de 50 millimètres, et il leur dit
avant de la présenter : « Je vais vous présenter une
troisième ligne qui est un peu plus courte que la
seconde. »
En faisant cette nouvelle tentative de suggestion,
nous avions deux raisons ; la première était de
chercher à vérifer l’épreuve précédente, la seconde
était de savoir s’il est possible de donner
successivement plusieurs suggestions du même genre
sans nuire au résultat.
32
Cette seconde suggestion a été moins eficace que
la première ; les élèves semblent s’être mieux rendu
compte de la longueur vraie des lignes ; tandis que la
première fois 5 élèves seulement avaient fait un
dessin en sens contraire de la suggestion, on en
trouve 16 dans le même cas à la seconde reprise.
Il nous a paru nécessaire d’examiner nos résultats
de plus près, et de rechercher si chaque élève avait
présenté pendant les deux épreuves la même
suggestibilité ou la même résistance.
Nous allons diviser tous nos sujets en cinq groupes :
1° ceux qui ont fait à la première suggestion une
seconde ligne moindre que la première (ce sont les
élèves les plus exacts) ; 2° ceux qui ont fait à la
première suggestion une seconde ligne égale à la
première, ou supérieure de 1, 2 à 4 millimètres ; 3°
ceux qui ont fait à la première suggestion une seconde
ligne supérieure de 4 à 8 millimètres ; 4° ceux qui ont
fait à la première suggestion la seconde ligne
supérieure de 8 à 12 millimètres ; enfn, 5° ceux qui
ont fait à la première suggestion la seconde ligne
supérieure de 12 à 20 millimètres. On voit que ce
groupement exprime l’ordre de suggestibilité, les
élèves du cinquième groupe se sont montrés plus
suggestibles que ceux du quatrième groupe, et ainsi
de suite jusqu’au premier groupe. Or voici les
résultats donnés par ce calcul :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k77176m.texteImage
Ces chifres, pour être clairs, exigent une courte
explication. Dans la première épreuve, rappelons-le, la
33
seconde ligne présentée était plus courte que la
première de 10 millimètres, mais la suggestion
donnée était que cette seconde ligne était la plus
longue. Par conséquent, les élèves qui l’ont dessinée
plus courte, comme ceux de notre premier groupe qui
l’ont dessinée avec une longueur moindre de 4 mm 6,
ont été plus exacts que ceux du deuxième groupe, qui
ont donné à cette ligne une longueur plus grande que
la première, plus grande de 3 mm 07 ; à leur tour, les
sujets du second groupe ont été plus exacts que ceux
du troisième et ceux du quatrième groupes, puisque
ceux-ci ont allongé encore davantage la seconde ligne,
qui était cependant plus courte.
Il est donc bien clair que nous avons établi nos
quatre groupes dans l’ordre de la suggestibilité
croissante. Or, qu’on comprenne bien ce point, ce sont
les sujets formant chacun de ces quatre groupes dont
on a cherché à apprécier les résultats dans la seconde
épreuve ; nous avons voulu savoir si les élèves A, B, C,
etc., formant le premier groupe, le meilleur, le plus
résistant à la suggestion de la première épreuve ont
manifesté les mêmes qualités d’exactitude et de
résistance à la suggestion dans la seconde épreuve ;
et pour cela, nous avons calculé les écarts de lignes
présentés par ces sujets dans cette seconde épreuve.
Seulement, il faut se souvenir que dans la seconde
épreuve la suggestion donnée était une suggestion de
raccourcissement ; et que la ligne qu’on présentait à
dessiner était réellement plus grande que la
précédente ; par conséquent, les élèves les plus exacts
à cette seconde épreuve sont ceux qui ont dessiné la
ligne plus grande que la précédente ; et parmi ceux
qui l’ont dessinée plus courte, les plus exacts sont
ceux qui ont le moins exagéré cette diférence en
moins. Ces explications feront comprendre les
oppositions de signe algébrique que l’on rencontre
34
dans les résultats des épreuves pour un même groupe
de sujets. Il est clair maintenant qu’il existe une
concordance bien remarquable entre les deux
épreuves ; on voit en efet, que les élèves du premier
groupe qui avaient résisté à la suggestion
d’allongement de la première épreuve ont également
résisté à la suggestion de raccourcissement de la
seconde épreuve, puisqu’ils ont dessiné la troisième
ligne avec 2 millimètres en plus tandis que la
suggestion tendait à la faire dessiner plus petite ; de
même, on voit dans les groupes suivants que plus un
groupe a obéi à la suggestion d’allongement de la
première épreuve, plus il a obéi à la suggestion de
raccourcissement de la seconde. Le résultat est aussi
net qu’on peut le souhaiter.
Qu’est-ce que ces expériences nous apprennent de
plus sur la suggestibilité des enfants ? C’est là une
question utile qu’on devrait se poser à propos de
chaque étude nouvelle. Nos expériences fournissent
un nouveau moyen, d’une eficacité vérifée, pour
mesurer la suggestibilité des enfants ; et le procédé
nous paraît recommandable puisqu’il fait apparaître
de très grandes diférences individuelles.
Nous avons pu constater en outre que les enfants
les plus suggestibles sont ceux de la troisième classe,
c’est-à-dire les plus jeunes. Cette épreuve nous a
montré la possibilité de faire à la suite l’une de l’autre
deux exercices de suggestibilité, dans lesquels les
enfants se comportent à peu près de la même
manière, et gardent chacun leur degré propre de
suggestibilité ; cette confrmation est très
importante ; elle nous montre que la suggestibilité
présente un certain caractère de constance, au moins
lorsque l’expérience est bien conduite. Enfn, nous
avons eu à noter qu’une suggestion répétée a moins
d’eficacité la seconde fois que la première : cet
35
afaiblissement est sans doute spécial à ces
suggestions indirectes de l’état de veille, qui ne
constituent point à proprement parler des mains-
mises sur l’intelligence des individus ; dans les
expériences d’hypnotisme, au contraire, la
suggestibilité de l’individu hypnotisé croît avec le
nombre des hypnotisations.
M. Michel m’a communiqué le classement
intellectuel que les professeurs ont fait des élèves qui
ont servi à ces expériences ; le classement est, comme
c’est l’habitude, tripartite ; les élèves sont divisés en :
1° intelligence vive ; 2° intelligence moyenne ; et 3°
intelligence faible.
Je désirais savoir si l’intelligence des élèves ‒ il
s’agit ici bien entendu d’une intelligence toute
spéciale, qu’on pourrait appeler l’intelligence
scolaire ‒ présente quelque relation avec la
suggestibilité. C’est, on se le rappelle, l’opinion de M.
Bérillon. Je ne suis point arrivé à la confrmer. La
suggestibilité moyenne est à peu près la même dans
les 3 groupes.
De notre expérience collective à une expérience de
cours il n’y a qu’un pas.
Dans une courte note publiée récemment par
19
Psychological Review , E.E. Slosson relate une
expérience de suggestion qu’il a faite sur ses
auditeurs dans un cours public ; la suggestion a
consisté à produire l’hallucination d’une odeur forte.
L’auteur verse sur du coton l’eau d’une bouteille, en
écartant la tête, puis il annonce qu’il est certain que
personne ne connaît l’odeur du composé chimique qui
vient d’être versé, et il émet l’espoir que quoique
l’odeur soit forte et d’une nature toute particulière,
personne n’en sera incommodé. Pour savoir quelle
19 A Lecture Experiment in Hallucinations. Psychological
Review, VI, 4, juillet 1899, p. 407-408.
36
serait la rapidité de difusion de cette odeur, il
demande que toutes les personnes qui la sentiront
s’empressent de lever la main ; 15 secondes après, les
personnes du premier rang donnaient ce signal, et
avant la fn d’une minute les trois quarts de l’auditoire
avaient succombé à la suggestion. L’expérience ne fut
pas poussée plus loin, car quelques spectateurs,
désagréablement impressionnés par cette odeur
imaginaire, se préparaient déjà à quitter la place. On
les rassure et on leur explique que le but réel de
l’expérience avait été de provoquer une hallucination ;
cette explication ne choqua personne.
Voilà à peu près quelles sont les études qui ont été
faites jusqu’ici sur la suggestibilité ou suggestion à
l’état de veille et chez les sujets normaux.
Il semble que quand elle est réduite à sa forme la
plus simple, l’épreuve de la suggestion à l’état de
veille constitue un test de docilité ; et il est
vraisemblable que des individus dressés à
l’obéissance passive s’y conformeront mieux que les
indépendants.
Rappelons-nous ce fait si curieux, que d’après les
statistiques de Bernheim les personnes les plus
sensibles à l’hypnotisme ‒ c’est-à-dire à la suggestion
autoritaire ‒ ne sont pas, comme on pourrait le croire,
les femmes nerveuses, mais les anciens militaires, les
anciens employés d’administration, en un mot, tous
ceux qui ont contracté l’habitude de la discipline et de
l’obéissance passive.
37
II – Erreurs d’imagination
Il fut une époque, dans l’histoire de l’hypnotisme,
où l’on a prononcé souvent les mots d’attention
expectante ; c’était l’époque où l’on cherchait à
découvrir sur les malades l’infuence des métaux et
des aimants. On avait prétendu qu’en appliquant
certains métaux, de l’or, du fer, de l’étain par exemple,
sur les téguments d’un malade hystérique, on pouvait
soit provoquer de l’anesthésie dans la région de
l’application, soit provoquer des contractures, soit
faire passer (transfert) dans l’autre moitié du corps un
symptôme hystérique qui n’en occupait qu’une moitié.
Beaucoup d’auteurs restaient sceptiques, et
supposaient que ces efets qu’on observait sur les
hystériques dans les séances de métallothérapie
n’étaient point dus à l’action directe des métaux, mais
à l’imagination des malades, qui étaient mises en état
d’attention expectante, et qui se donnaient à elles-
mêmes, par idée, par raisonnement, les symptômes
divers que d’autres attribuaient au métal. Aujourd’hui
la terminologie a un peu changé, et au lieu d’attention
expectante, on dirait autosuggestion, mais les mots
importent peu, quand on est d’accord sur le fond des
choses. Il est certain que chez les suggestibles,
l’imagination constructive est toujours en éveil, et
fonctionne de manière à duper tout le monde, le sujet
tout le premier ; car ce qu’il y a de spécial à ces
malades, c’est qu’ils sont les premières victimes du
travail de leur imagination ; ainsi que l’a dit si
justement Féré, ceux qu’on appelle des malades
imaginaires sont bien réellement malades, ce sont des
malades par imagination.
Il m’a semblé que l’étude de cette question rentre
dans notre sujet, bien qu’elle soit un peu distincte,
38
théoriquement, de la suggestibilité.
Il s’agit ici d’une disposition à imaginer, à inventer,
sans s’apercevoir qu’on imagine, et en attachant la
plus grande importance et tous les caractères de la
réalité aux produits de son invention. À ce trait
chacun peut reconnaître plus d’une de ses
connaissances, et Alphonse Daudet a dans un de ses
romans peint de pied en cap un de ces personnages,
qui est sans cesse la victime d’une imagination à la
fois trop riche et trop mal gouvernée.
Je me demande s’il ne serait pas possible de faire
une étude régulière de cette disposition mentale ; je
suis même très étonné qu’aucun auteur n’en ait
encore eu l’idée. Ce serait cependant plus utile que
beaucoup de chinoiseries auxquelles on a eu le tort
d’attribuer tant d’importance. Quelle méthode
faudrait-il prendre ? La plus simple vaudrait le mieux.
Je me rappelle qu’il y a une quinzaine d’années, M.
Ochorowicz, auteur qui a écrit un ouvrage plein de
fnesse sur la suggestion mentale, vint a la Salpêtrière
pour montrer à Charcot un gros aimant en forme de
bague, qu’il appelait l’hypnoscope ; il disait qu’il
mettait cet aimant au doigt d’une personne, qu’il
l’interrogeait ensuite sur ce qu’elle éprouvait, qu’il
recherchait si l’aimant avait produit quelque petit
changement dans la motilité ou la sensibilité du doigt
ou de la main, et qu’il pouvait juger très rapidement si
20
une personne était hypnotisable ou non . Dans le
cabinet de Charcot on ft venir, l’une après l’autre,
une vingtaine de malades, et M. Ochorowicz les
examina et déclara pour chacune d’elles s’il la croyait
hypnotisable ou non ; il était convenu qu’on prendrait
note de ses observations, et qu’on chercherait à les
20 M. Ochorowicz a décrit son procédé dans une communication
à la Soc. de Biologie, Sur un critère de la sensibilité
hypnotique. Soc. Biol., 17 mai 1884.
39
vérifer ; mais je doute fort que l’afaire ait eu une
suite quelconque, l’attention du Maître était ailleurs.
Je crois qu’on pourrait adopter, pour l’étude de
l’attention expectante, un dispositif analogue à celui
que je viens de signaler ; par exemple un tube dans
lequel le sujet devrait laisser son doigt enfoncé
pendant cinq minutes ; on prendrait des mesures pour
donner à l’expérience un caractère sérieux, et surtout
on réglerait d’avance les paroles à adresser au sujet ;
après quelques tâtonnements inévitables, il me paraît
certain qu’on arriverait très vite à un résultat.
De telles recherches montreraient surtout si l’état
mental de suggestibilité (c’est-à-dire d’obéissance
passive) a quelque analogie avec l’état mental
d’attention expectante (c’est-à-dire la disposition aux
erreurs d’imagination).
III – Inconscience, division de conscience
et spiritisme
Nous arrivons maintenant à une grande famille de
phénomènes, qui ont une physionomie bien à part, et
dont l’analogie avec des phénomènes d’hypnotisme et
de suggestion n’a été démontrée avec pleine évidence
que dans ces dernières années, par Gurney et Myers
en Angleterre, et par Pierre Janet en France ; je veux
parler des phénomènes auxquels on a donné les noms
d’automatisme, d’écriture automatique, et qui
prennent un grand développement dans les séances
de spiritisme.
Dans un tout récent et très curieux article qui vient
40
21
d’être publié par Psychological Review , G.T.W.
Patrick décrit longuement un cas typique
d’automatisme ; et comme ce cas n’est ni trop ni trop
peu développé et qu’il correspond assez exactement à
la moyenne de ce qu’on peut observer chaque jour, je
vais l’exposer avec détails, pour ceux qui ne sont pas
au courant de ces questions.
La personne qui s’est prêtée aux expériences est un
jeune homme de vingt-deux ans, étudiant à
l’Université, paraissant jouir d’une excellente santé,
ne s’étant jamais occupé de spiritisme, et n’ayant
jamais été hypnotisé. Cependant, ces deux assertions
ne sont pas tout à fait exactes ; s’il n’a pas fait de
spiritisme, il a cependant causé, quatre ans
auparavant, avec une de ses tantes, qui est spirite, et
il a lu probablement quelques livres de spiritisme ;
mais ces lectures n’ont fait aucune impression sur lui ;
et il a jugé tous les phénomènes spirites comme une
superstition curieuse. Pour l’hypnotisme, il a assisté à
deux ou trois séances données par un hypnotiseur de
passage, et il s’est ofert à lui servir de sujet ; on a
constaté qu’il était un bon sujet.
Un jour, ayant lu quelques observations sur les
suggestions post-hypnotiques, il en causa avec
l’auteur, M. W. Patrick, qui, sur sa demande,
l’hypnotisa et lui donna pendant le sommeil l’ordre
d’exécuter au réveil certains actes insignifants,
comme de prendre un volume dans une bibliothèque ;
ces ordres furent exécutés de point en point, et,
comme c’est l’habitude, ils ne laissèrent après eux
aucun souvenir.
Quelque temps après, le sujet, ‒ nous l’appellerons
Henry W. ‒ apprit à l’auteur que lorsqu’il tenait un
crayon à la main et pensait à autre chose, sa main
21 Some Peculiarities of the Secondary Personality, Psych.
Review, nov. 1898, vol. 5, n° 6, p. 555.
41
était continuellement en mouvement et traçait avec le
crayon des grifonnages dénués de sens. C’était un
rudiment d’écriture automatique. Patrick se décida à
étudier cette écriture automatique, et il le ft dans six
séances, dont les trois dernières furent séparées des
premières par deux ans d’intervalle. L’étude se ft de
la manière suivante : on se réunissait dans une pièce
silencieuse, le sujet tenait un crayon dans sa main
droite et appuyait le crayon sur une feuille de papier
blanc ; il ne regardait pas sa main, il avait la tête et le
corps tournés de côté, et il tenait dans sa main gauche
un ouvrage intéressant, qu’il devait lire avec
beaucoup d’attention. Naturellement, comme ces
expériences étaient faites en partie sur sa demande et
excitaient vivement sa curiosité, il se préoccupait
beaucoup de ce que sa main pouvait écrire, mais il
ignorait absolument ce qu’elle écrivait ; on lui permit
quelquefois, pas toujours, de relire ce que sa main
avait écrit ; il avait autant de peine que n’importe
quelle autre personne à déchifrer sa propre écriture.
Dans quelques cas, on le pria de quitter la lecture de
son livre et, de surveiller attentivement les
mouvements de sa main, sans la regarder ; il eut alors
conscience des mouvements qu’elle exécutait ; mais
sauf ces cas exceptionnels, l’écriture était tracée
automatiquement.
Maintenant, comment l’opérateur entrait-il en
communication avec cette main ? Je ne le vois pas
clairement dans l’article. Il est très probable que
Patrick a employé la méthode usuelle et la plus
commode ; il adressait à demi-voix les questions à
Henry W. ; celui-ci ne répondait pas, et n’entendait
pas, son attention étant distraite par la lecture du
livre ; mais sa main écrivait la réponse. C’est de cette
manière qu’on a pu obtenir toute une série de
demandes et réponses qui sont publiées dans l’article.
42
Il est important d’ajouter que le sujet est un jeune
homme dont la sincérité et la loyauté sont au-dessus
de tout soupçon, car il serait assez facile de simuler
des phénomènes de ce genre, feindre de lire, écouter
et répondre par écrit ; mais nous avons comme
garantie contre la fraude non seulement les
références données par l’auteur (ce qui serait peu de
chose) mais encore ce fait important que ces
dédoublements de conscience sont aujourd’hui bien
connus et ont été observés dans des conditions d’une
précision irréprochable par des auteurs dignes de
22
foi .
La première séance commença ainsi :
Question. ‒ Qui êtes-vous ?
Réponse. ‒ Laton.
Cette première réponse était illisible et Henry W.
fut autorisé à lire son écriture : il déchifra le mot
Satan et rit ; mais d’autres questions montrèrent que
la vraie réponse était Laton.
Q. ‒ Quel est votre premier nom ?
R. ‒ Bart.
Q. ‒ Quelle est votre profession ?
R. ‒ Professeur.
Q. ‒ Êtes-vous homme ou femme ?
R. ‒ Femme.
Cette réponse est inexplicable, car dans la suite
Laton a toujours manifesté le caractère d’un homme.
D. ‒ Êtes-vous vivant ou mort ?
R. ‒ Mort.
D. ‒ Où avez-vous vécu ?
22 Il y a déjà plusieurs années que j’ai traité longuement cette
question de la simulation, à propos du dédoublement de
conscience chez les hystériques, et que j’ai montré que
l’anesthésie de ces malades peut devenir une démonstration
expérimentale de ces phénomènes. Voir Altérations de la
personnalité. Bibliothèque scientifque internationale, Paris,
Alcan.
43
R. ‒ Illinois.
D. ‒ Dans quelle ville ?
R. ‒ Chicago.
D. ‒ Quand êtes-vous mort ?