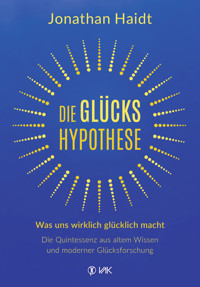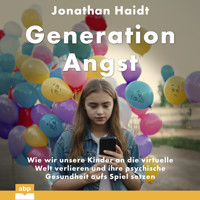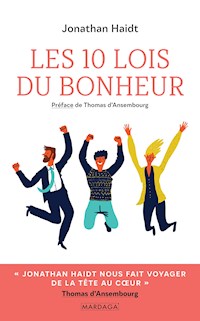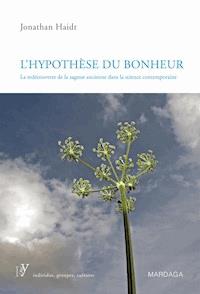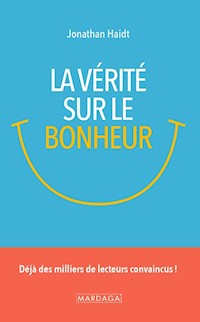
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mardaga
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Explorez l’équilibre entre sagesse ancienne, psychologie positive et neurosciences avec Jonathan Haidt. Des mythes fondateurs, des études modernes, des clés pour le bonheur. Un voyage, une méthode, un sens retrouvé.
À travers La vérité sur le bonheur, Jonathan Haidt interroge la quête universelle du bien-être, du sens de la vie et de la résilience. Alliant philosophie antique, sagesses orientales et découvertes de la psychologie positive, il éclaire les paradoxes de notre époque : confort matériel, solitude croissante, recherche effrénée de sens. Le livre offre un panorama fascinant des grandes idées qui ont façonné notre vision du bonheur, de Socrate à Bouddha, en passant par les neurosciences les plus récentes.
Ce récit se distingue par sa capacité à tisser des liens entre science, spiritualité et expérience humaine. Haidt propose une approche narrative vivante, illustrée d’exemples concrets, d’études marquantes et d’histoires personnelles. Parfait pour les lecteurs de Martin Seligman, Brené Brown ou Mihaly Csikszentmihalyi, ce livre s’adresse à ceux qui cherchent à comprendre, à ressentir et à appliquer la psychologie du bonheur au quotidien.
Laissez-vous surprendre par des révélations sur la nature humaine, l’influence de nos automatismes, la force des relations et le pouvoir de la pleine conscience. Découvrez comment transformer votre regard, vos habitudes et vos liens pour bâtir un bonheur durable. Un ouvrage essentiel pour quiconque souhaite explorer la psychologie positive, la résilience et la connaissance de soi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La vérité sur le bonheur
Jonathan Haidt
La vérité sur le bonheur
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Matthieu van Pachterbeke
Note sur la traduction
L’écriture de Jonathan Haidt est à la fois documentaire et émotionnelle. L’auteur se base sur de nombreuses études scientifiques, mais loin de prétendre à l’universalité de celles-ci, il présente leurs conclusions avec toute la prudence qui s’impose. Il relativise leur portée et leur application par l’usage fréquent de mots et expressions tels que « en général », « en moyenne » ou « souvent ». Nous avons peut-être omis certaines de ces marques de prudence dans la traduction. Le lecteur est invité à garder à l’esprit que les conclusions des recherches scientifiques ne peuvent s’appliquer à toute personne et en toutes circonstances, c’est certainement l’esprit dans lequel Haidt a rédigé son livre. L’écriture de Haidt montre également son enthousiasme intellectuel et ses sentiments par rapport à certaines expériences, parfois personnelles, qu’il partage. Nous espérons avoir pu les transmettre dans la traduction.
Jonathan Haidt fait référence à de nombreuses œuvres. Lorsqu’il s’agit d’œuvres écrites en français, nous vous en proposons le texte original. Nous renseignons également les références des traductions françaises utilisées, pour les œuvres littéraires anglo-saxonnes. Les notes de fin d’ouvrage ainsi que la bibliographie renvoient à la fois au texte employé par Haidt et à la version française présentée. Pour les œuvres dont l’original n’a pas été rédigé en français ou en anglais, nous avons traduit les extraits présentés par Haidt. Pour les livres de psychologie et de sciences humaines cités par Haidt, nous mentionnons les références de la traduction française, lorsqu’elle existe. Sinon, nous proposons une traduction du titre ; cette mention a pour seul but de donner une idée du propos de l’ouvrage.
Enfin, les notes de traduction sont annoncées par un astérisque.
Matthieu Van Pachterbeke
Préface
C’est au cœur de l’été le plus chaud jamais enregistré qu’il m’a été demandé d’écrire la préface de cette dernière édition française du célèbre ouvrage de Jonathan Haid : The Hapiness Hypothesis. Je ne peux m’empêcher de l’ancrer au cœur des transformations profondes que notre monde et notre société sont en train de subir. Je dis « subir » car force est de constater qu’il nous faudra du temps pour apprivoiser les diverses crises qui nous accompagnent déjà et pour les transformer en déclencheurs vers de nouveaux « nous » plus résilients, capables de prendre soin d’eux-mêmes, des autres et du Vivant.
Ce dérèglement climatique et cette fin de cycle sociétal reflètent à mes yeux le dérèglement intérieur que nous avons créé au fil des années, en parallèle avec un système où le profit prime sur tout le reste et où nous régnons en maîtres sur la Nature – au lieu d’en faire humblement partie. Un modèle de société dans lequel ce que j’aime appeler nos besoins fondamentaux invisibles (les liens aux autres et l’Amour, tous deux au cœur de cet ouvrage) ont été ignorés, lorsqu’ils n’étaient pas ridiculisés. Le résultat est à ce jour paradoxal et Jonathan Haidt nous le rappelle : notre bien-être matériel, notre confort et la qualité de nos systèmes de santé ont atteint des sommets et pourtant, depuis la seconde guerre mondiale, jamais le taux de dépression, de burn-out ou de suicide, ni la consommation d’antidépresseurs et de toutes formes de drogues plus ou moins dures, n’ont été aussi élevés.
Cette nouvelle édition arrive donc au moment où nous en avons le plus besoin, en quête avide de pistes pour percevoir la vie autrement que comme un terrible fardeau dénué de sens. Pour nous aider à naviguer plus ou moins sereinement, plus ou moins vaillamment, dans les eaux troubles de cet avenir incertain.
Ma maxime préférée en vue de cet objectif est aussi l’une des plus anciennes : le « Connais-toi toi-même » (GnothiSeauton) de Socrate. Se connaître soi-même, c’est dans un premier temps repérer les « pilotes automatiques » qui guident notre vie à notre place, c’est faire le bilan des blessures qui déforment la réalité, c’est « tirer le maximum des cartes qui nous ont été données ».
Et quelle meilleure façon de se connaître soi-même que de parcourir dans ce livre des siècles (des millénaires !) de sagesse et d’études scientifiques, mettant des mots, des résultats et des statistiques sur ce que nous sommes, ce plus petit dénominateur commun nous définissant tous et sur lequel, paradoxalement, nous nous penchons si rarement, sauf lorsque tout s’effondre. Quelle meilleure façon que de plonger la tête la première dans l’abysse de notre âme, nos conditionnements, nos peurs et nos envies, de comprendre une partie des infinis méandres de notre esprit, symbolisé tout au long de cet ouvrage par un énorme éléphant qu’un conducteur – la partie consciente de notre esprit – essaierait désespérément de dresser et diriger à sa guise. Et quel meilleur guide que cette bible du bonheur rassemblant les conclusions de tant d’autres qui ont entrepris ce chemin avant nous, tout en rappelant cette mise en garde – particulièrement pertinente à mes yeux en ces temps tourmentés qui cèdent parfois à une forme de « tyrannie du bonheur » : se mettre en chemin vers plus de sagesse et de connaissance de soi prend toute une vie. C’est le cheminement qui nous grandit, nous relie à nous-même et aux autres. Ou comme le disait le poète espagnol Antonio Machado dans ces vers magnifiques : « Le chemin n’existe pas, il se crée avec chacun de tes pas » (Caminante no hay camino, se hace camino al andar). C’est en tous cas ma conviction profonde, et j’ai trouvé jouissif de pouvoir parcourir dans ces lignes tant d’autres vies dévouées à ce cheminement.
J’ai été particulièrement captivé dans le texte par le tissage habile de ces myriades d’influences de natures aussi diverses que peuvent l’être des débats philosophiques, des préceptes spirituels ou des conclusions d’études scientifiques. Le miracle de la Vie et la conscience ont été étudiés et exprimés depuis des millénaires, et nous découvrons dans cet ouvrage les préceptes de Bouddha ou de Saint Paul entremêlés aux résultats d’études scientifiques en psychologie et neurosciences en passant par les pensées de Kant, Nietzsche, Socrate, Jung, Descartes ou Freud. Et pourtant, sans avoir aucunement l’intention de simplifier les multiples facettes du bonheur exprimées au fil des chapitres, tous ces points de fuite me semblent poindre vers un seul et même horizon : vers un message de lien, d’amour, de gratitude et de générosité. Nous nous efforçons en effet, depuis l’aube des temps, à nous différencier en cultures, nations, races, hiérarchies, classes, castes, strates, alors que notre essence, partout dans le monde et de tout temps, est invariablement la même, et d’une simplicité déconcertante : un élan d’union et d’entraide.
Quelle meilleure conclusion pour avancer ensemble, avec sérénité, les sourcils froncés par la détermination mais le sourire aux lèvres, vers cet avenir à (re)construire qui nous attend tous.
Pedro Correa Conférencier et auteur de Matins Clairs(L’Iconoclaste, 2020)
INTRODUCTION Trop de sagesse
Comment mener ma vie ? Qui devenir ? Comment devrais-je agir ? Nombre d’entre nous se posent ces questions. Dans notre monde moderne, on ne doit pas chercher trop longtemps pour trouver des réponses. La sagesse est commune et tellement abondante qu’elle nous inonde. On la trouve partout, des pages des calendriers aux e-mails collectifs envoyés par des amis bien intentionnés, en passant par les sachets de thé, voire même les sous-verre. D’une certaine manière, nous sommes comme les hommes de la Bibliothèque de Babel a de Jorge Luis Borges – une bibliothèque infinie dont les livres contiennent toutes les combinaisons possibles de lettres et par conséquent, quelque part, une explication de l’existence de la bibliothèque et de la manière de l’utiliser. Mais les bibliothécaires de Borges se doutent qu’ils ne trouveront jamais ce livre parmi les piles de galimatias et d’incohérences.
Nous avons plus de chance. Peu de nos sources potentielles de sagesse sont absurdes et un grand nombre d’entre elles sont totalement vraies. Cependant, notre bibliothèque est, elle aussi, infinie et chacun d’entre nous ne pourra donc en lire qu’une part infime. Nous sommes confrontés au paradoxe de l’abondance : la quantité diminue la qualité de notre engagement. Face à une bibliothèque aussi vaste et aussi extraordinaire, nous nous en tenons souvent à feuilleter les livres ou à ne lire que les critiques. Peut-être avons-nous déjà rencontré La Grande Idée, la révélation qui aurait transformé nos vies si nous l’avions seulement goûtée, prise à cœur et acceptée dans nos vies.
Ce livre porte sur dix de ces Grandes Idées. Chaque chapitre tente de nous faire goûter une idée découverte par différentes civilisations du monde, de la mettre en question à la lumière de nos connaissances scientifiques actuelles et d’en retirer les leçons qui s’appliquent encore aujourd’hui à nos vies modernes.
Je suis psychologue social. Je fais des expériences pour arriver à comprendre un aspect de la vie sociale des êtres humains : la moralité et les émotions morales. Je suis aussi Professeur. Je donne des cours d’introduction à la psychologie dans un grand auditoire à l’Université de Virginie. Je tente de résumer le champ entier de la psychologie à mes étudiants. Je dois leur expliquer des milliers de résultats de recherches sur à peu près tout depuis la structure de la rétine jusqu’aux mécanismes de l’amour, et espérer qu’ils comprennent et retiennent l’ensemble. Au cours de ma première année d’enseignement, je me suis rendu compte que certaines idées revenaient sans cesse au fil des cours et que souvent ces idées avaient déjà été énoncées dans le passé. Ainsi, pour résumer l’idée que nos émotions, nos réactions aux événements et certaines maladies mentales sont causées par des filtres mentaux aux travers desquels nous voyons le monde, je ne pourrais être plus concis que Shakespeare : « Rien n’est en soi bon ou mauvais, la pensée le rend tel1. » J’ai commencé à utiliser ce genre de citations pour aider mes étudiants à retenir les grandes idées de la psychologie et me suis demandé combien d’idées de ce type il pouvait y avoir.
Pour le découvrir, j’ai lu des tas de livres de sagesse ancienne. La plupart venaient des trois grandes zones de pensée classique : l’Inde (par exemple, les Upanishads, la Bhagavad Gita, les paroles du Bouddha), la Chine (les Entretiens de Confucius, le Tao te King, les écrits de Mencius et d’autres philosophes) et les cultures du bassin méditerranéen (l’Ancien et le Nouveau Testaments, les philosophes grecs et romains, le Coran). J’ai également lu une grande variété d’autres livres de philosophie et de littérature des cinq cents dernières années. Chaque fois que j’ai trouvé un avis psychologique (une déclaration sur la nature humaine ou sur le fonctionnement de l’esprit ou des émotions), j’en ai pris note. Quand je trouvais une idée qui revenait à différents endroits et à différentes périodes, je considérais que c’était potentiellement une Grande Idée. Mais plutôt que de me baser sur la fréquence et établir mécaniquement le Top Dix des idées psychologiques les plus répandues de l’humanité, j’ai opté pour la cohérence. Je voulais parler de quelques idées qui se compléteraient, s’appuieraient les unes sur les autres pour se construire. Je voulais ainsi raconter une histoire sur la découverte du bonheur et du sens de la vie.
Aider les gens à trouver le bonheur et à trouver du sens est précisément le but de la psychologie positive2, un domaine auquel j’ai contribué3. En un sens, ce livre porte donc sur le substrat de la psychologie positive, la sagesse ancienne, ainsi que sur les applications actuelles de cette psychologie. J’ai donc utilisé dix idées anciennes et de nombreuses découvertes issues de la recherche moderne pour résumer le mieux possible les causes de l’épanouissement humain et les obstacles au bien-être que nous dressons sur notre propre chemin.
Cette histoire commence par une explication du fonctionnement de l’esprit humain. Il ne s’agit pas d’une explication complète mais de deux vérités anciennes qu’il faut bien comprendre avant de pouvoir profiter de la psychologie moderne pour améliorer nos vies. La première vérité est l’idée de base de ce livre : l’esprit est divisé en deux parties qui sont parfois en désaccord. Tout comme un cornac sur le dos d’un éléphant, la partie consciente de l’esprit, celle qui raisonne, n’a qu’un contrôle limité sur le comportement de son éléphant. Nous connaissons aujourd’hui les causes de ces divisions ainsi que quelques trucs pour aider le conducteur et l’éléphant à travailler en équipe. La seconde idée est inspirée de Shakespeare : la pensée crée la réalité (on la retrouve aussi chez Bouddha4 : « Notre vie est une création de notre esprit »). Mais nous pouvons aujourd’hui développer cette idée ancienne en expliquant pourquoi chez la plupart des gens, l’esprit tend à voir des menaces et à s’inquiéter pour un rien. Pour être plus heureux, nous pouvons modifier cette tendance grâce à trois techniques, une ancienne et deux récentes.
La seconde étape de notre récit sera d’expliquer nos vies sociales. À nouveau, l’explication ne sera pas exhaustive ; elle abordera seulement deux vérités bien connues mais non reconnues à leur juste valeur. La première est la Règle d’Or. La réciprocité est l’outil le plus important pour s’entendre avec les gens. C’est aussi un indice pour nous aider à comprendre qui nous sommes, nous humains, et ce dont nous avons besoin. La seconde vérité (dans cette partie de l’histoire) est que nous sommes tous hypocrites par nature et que par conséquent, il nous est très difficile de suivre la Règle d’Or fidèlement. Des recherches récentes en psychologie ont montré les mécanismes mentaux qui nous font voir si facilement la paille dans l’œil de notre voisin et si difficilement la poutre dans le nôtre.
À ce point du récit, on peut se poser la question : « D’où vient le bonheur ? ». Il y a différentes hypothèses à ce propos. L’une est que le bonheur consiste à obtenir ce que l’on désire ; mais nous savons tous (et la science le confirme) qu’un tel bonheur est éphémère. Une autre hypothèse, prometteuse, est que le bonheur vient de l’intérieur et ne peut être atteint en conformant le monde à nos envies. Cette idée était bien connue dans le passé : Bouddha en Inde ainsi que les philosophes stoïciens de la Grèce et de la Rome antiques conseillaient de rompre les liens émotionnels avec les gens et les événements imprévisibles et incontrôlables. Ils prônaient une attitude d’acceptation. Cependant, les recherches récentes ont montré qu’il y a certaines choses pour lesquelles il vaut la peine de se battre. Certaines conditions de vie influencent favorablement notre bonheur ; et leur effet est durable. Les relations et les liens que nous avons besoin de nouer et que nous nouons avec les autres sont une de ces choses. Le bonheur vient à la fois de l’intérieur et de l’extérieur. Pour trouver le bon équilibre, nous devons suivre à la fois les conseils de la sagesse ancienne et ceux de la science moderne.
L’épisode suivant de l’histoire de l’épanouissement concerne les conditions de la croissance et du développement humain. On a tous entendu l’aphorisme « ce qui ne me tue pas me rend plus fort » ; il est dangereusement sommaire. Beaucoup des choses qui ne vous tuent pas peuvent vous perturber à vie. Nous avons tous été encouragés à cultiver la vertu en nous sur base de l’argument qu’elle constitue en quelque sorte sa propre récompense. Mais cette idée-là aussi est une simplification réductrice. Je montrerai l’évolution des concepts de vertu et de morale, comment ces concepts se sont spécifiés au fil des siècles et comment les anciennes idées sur la vertu et le développement moral peuvent tenir leurs promesses à notre époque. Je montrerai aussi la contribution de la psychologie positive à faire tenir cette promesse en offrant un moyen de déceler et de développer nos forces et nos vertus.
La conclusion de l’histoire est la question du sens : pourquoi certaines personnes trouvent-elles un sens, un but et de l’accomplissement dans leur vie alors que d’autres non ? Je commence avec l’idée répandue qu’il y a une dimension verticale, spirituelle dans l’existence humaine. Que Dieu existe ou pas, les gens perçoivent un caractère sacré, de la sainteté ou une bonté indéfinissable chez les autres ou dans la nature. Peu importe qu’ils l’appellent noblesse, vertu ou divinité. Je présenterai mes recherches sur des émotions morales comme le dégoût, le sentiment d’élévation ou celui de crainte teintée de respect. J’aborderai également ce que les gens veulent dire quand ils se demandent : « Quel est le sens de la vie ? ». Je donnerai à cette question une réponse qui s’inspire d’idées anciennes sur le fait d’avoir un but, mais qui utilisent des recherches récentes pour dépasser ces idées anciennes ou toute autre idée que vous pourriez avoir rencontrée. Ce faisant, je réviserai une dernière fois l’hypothèse du bonheur. Je pourrais dès maintenant formuler cette version finale en quelques mots, mais je ne pourrais l’expliquer dans cette brève introduction sans la réduire. Les paroles de la sagesse, le sens de la vie, voire la réponse cherchée par les hommes de la bibliothèque de Borges, nous pouvons les obtenir chaque jour. Mais cela nous est inutile tant que nous ne pouvons les savourer, les travailler, les mettre en question, les améliorer et les lier à nos vies. C’est le but que je poursuivrai dans ce livre.
a Cette nouvelle se trouve dans le recueil Fictions publié chez Gallimard (NdT).
CHAPITRE 1 Les divisions du Moi
Car la chair, en ses désirs, s’oppose à l’Esprit, et l’Esprit à la chair ; entre eux, c’est l’antagonisme ; aussi ne faites-vous pas ce que vous voulez.
Épître aux Galates 5 :1715
Si la passion vous guide, laissez laraison tenir les rênes.
Benjamin Franklin6
J’ai fait ma première promenade à cheval en 1991 dans le parc national des Great Smoky Mountains en Caroline du nord. J’étais déjà monté à cheval étant enfant, mais la monture était alors guidée par une corde tenue par un moniteur. Ainsi, c’était bien la première fois qu’il y avait juste moi et l’animal, sans corde. En fait je n’étais pas seul, il y avait autour de moi huit autres cavaliers, l’un d’entre eux était un des rangers du parc. Cette promenade n’était donc pas vraiment exigeante. Je connus toutefois un moment difficile. Nous suivions un chemin sur un coteau escarpé, deux par deux, mon cheval était à l’extérieur, à un mètre du bord. Plus loin, le chemin tournait brusquement vers la gauche et mon cheval se dirigeait tout droit vers le bord. Mon sang se glaça. Je savais qu’il me suffisait de rediriger mon cheval vers la gauche mais l’autre me bloquait le passage (et je ne voulais pas provoquer de collision). J’aurais pu appeler à l’aide ou crier « Attention », mais une partie de moi préférait le risque de tomber à la certitude d’être ridicule. Je me contentai donc de me crisper. Je ne fis rien durant les cinq secondes critiques pendant lesquelles mon cheval et celui à ma gauche tournèrent calmement et d’eux-mêmes.
La panique me quitta et je ris de ma peur ridicule. Le cheval savait parfaitement ce qu’il faisait. Il avait parcouru ce chemin cent fois et n’avait, pas plus que moi, l’envie de mourir dans une chute. Il n’avait pas besoin que je le guide et mes quelques tentatives de le faire me parurent sans effet. Je m’étais complètement trompé car j’avais passé les dix dernières années à conduire des voitures, non des chevaux. Si vous ne les maintenez pas sur la route, les voitures passent par dessus les bordures.
La pensée humaine repose sur la métaphore. Nous comprenons des choses nouvelles ou complexes en faisant des liens avec celles que nous connaissons déjà7. Il est, par exemple, difficile de considérer la vie en général, mais si on l’illustre par la métaphore « la vie est un voyage », nous en tirons plus facilement certaines conclusions : il faut reconnaître le terrain, choisir une direction, trouver de bons compagnons de voyage et profiter de la balade parce qu’il se peut qu’il n’y ait rien au bout du chemin. Il est également difficile de se faire une idée de ce qu’est l’esprit, mais une fois que l’on a choisi une métaphore, elle guide notre pensée. Tout au long de l’histoire, les gens ont vécu avec des animaux et ont essayé de les dominer. On retrouve d’ailleurs ces animaux dans d’anciennes métaphores. Ainsi, Bouddha comparait l’esprit avec un éléphant sauvage :
Il y a bien longtemps, mon esprit passait son temps à vagabonder où le désir et le plaisir le menaient. Aujourd’hui, il n’erre plus et a trouvé l’harmonie du contrôle, tel un éléphant sauvage maîtrisé par son dresseur8.
Platon utilisait une métaphore similaire dans laquelle le moi (ou l’âme) est un char dont la partie calme et rationnelle de l’esprit tient les rênes. L’aurige de Platon devait contrôler deux chevaux :
Le cheval de droite, le côté le plus noble, a fière allure, est musclé, tient son cou bien droit et a de majestueux naseaux ; … ses valeurs sont l’honneur, la modestie et la maîtrise de soi ; compagnon de la gloire, nul n’est besoin de fouet, la voix seule le commande. L’autre cheval est cagneux, un amas de membres tordus et entremêlés… compagnon de fanfaronnade et de débauche, il a les oreilles hirsutes, est sourd comme un pot et réagit à peine au fouet et aux éperons9.
Pour Platon, certaines émotions et passions sont bonnes (par exemple, l’amour de l’honneur) et poussent le moi dans la bonne direction, d’autres sont mauvaises (par exemple, les envies et les désirs). Le but de l’éducation platonicienne était d’aider l’aurige à obtenir le parfait contrôle des deux chevaux. Sigmund Freud nous donnait un modèle similaire 2 300 ans plus tard. Freud10 affirmait que l’esprit était divisé en trois parties : le moi (partie consciente et rationnelle), le surmoi (la conscience, un engagement parfois trop rigide envers les règles de la société) et le ça (le désir de plaisir, dès que possible). Lorsque je donne un cours sur Freud, j’utilise la métaphore de l’esprit vu en tant que cheval qui tire un fiacre dans lequel le conducteur (le moi) se bat désespérément pour contrôler un cheval affamé, lascif et désobéissant (le ça) alors que le père du conducteur (le surmoi) est assis à l’arrière et lui fait la leçon sur ce qu’il ne fait pas correctement. Pour Freud, le but de la psychanalyse était d’échapper à cet état pitoyable en renforçant le moi et en lui donnant donc plus de contrôle sur le ça et plus d’indépendance par rapport au surmoi.
Freud, Platon et Bouddha vivaient tous trois dans des environnements remplis d’animaux apprivoisés. Ce combat pour affirmer sa volonté sur une créature bien plus grosse qu’eux-mêmes leur était familier. Mais dans le courant du XXe siècle, les voitures remplacèrent les chevaux et la technologie augmenta le contrôle sur le monde physique. Lorsque les gens cherchaient des métaphores, ils voyaient l’esprit comme le conducteur d’une voiture ou comme un programme informatique. Il devint alors possible d’oublier l’inconscient de Freud et d’étudier les mécanismes de la pensée et de la prise de décision. C’est ce que les scientifiques sociaux ont fait dans la troisième partie du XXe siècle : les psychologues sociaux ont créé des théories du « traitement de l’information » pour tout expliquer, des préjugés à l’amitié. Les économistes ont créé des modèles de « choix rationnel » pour expliquer les comportements. Les sciences sociales se sont rassemblées derrière l’idée que les individus sont des agents rationnels qui se fixent des buts et les poursuivent de manière intelligente en utilisant les informations et les ressources à leur disposition.
Pourquoi alors les gens continuent-ils à faire des choses stupides ? Pourquoi perdent-ils le contrôle d’eux-mêmes et continuent-ils à faire ce qu’ils savent être mauvais pour eux ? En ce qui me concerne, je peux facilement trouver la volonté d’ignorer la carte des desserts. Mais si le dessert est posé sur la table, je ne peux y résister. Je peux prendre la résolution de me concentrer sur une tâche et de m’y atteler jusqu’à ce qu’elle soit terminée, mais je finis par me retrouver à flâner dans la cuisine ou à m’adonner à d’autres procrastinations. Je peux prendre la résolution de me lever à six heures du matin pour écrire, mais une fois le réveil éteint, j’ai beau me répéter « lève-toi », ça n’a aucun effet ; je comprends alors ce que Platon voulait dire quant il parlait de la surdité du mauvais cheval. Mais c’est lors de décisions plus importantes, celles qui concernent les rencontres amoureuses, que j’ai vraiment commencé à prendre conscience de l’étendue de mon impuissance. Je savais exactement ce que je devais faire, mais, alors même que j’annonçais à mes amis que j’allais le faire, une partie de moi devinait que ce ne serait pas le cas. La culpabilité, le désir et la peur se sont souvent révélés plus forts que la raison (alors qu’en même temps, je faisais la leçon à mes amis sur ce qui était bon pour eux dans de telles situations). Le poète latin Ovide dépeint parfaitement ma situation. Dans « Les métamorphoses », Médée est tiraillée entre son amour pour Jason et ses devoirs envers son père. Elle se lamente de la sorte :
Je suis entraînée par une force nouvelle et étrange. Le désir et laraison me tirent dans des directions opposées. J’aperçois le bon chemin, mais j’emprunte le mauvais11.
Les théories modernes sur le choix rationnel et le traitement de l’information n’expliquent pas correctement cette faiblesse de la volonté. Les vieilles métaphores sur le contrôle des animaux sont bien plus adéquates. Lorsque je m’étonnais de ma faiblesse, je m’imaginais sur le dos d’un éléphant. Je tiens les rênes et je peux les tirer de l’une ou l’autre manière pour indiquer à l’éléphant de tourner, de s’arrêter, ou d’avancer. J’ai le contrôle de la situation, mais seulement quand l’éléphant n’a pas d’envie personnelle. S’il tient vraiment à faire quelque chose, je ne suis pas de taille à lutter contre lui.
Je me suis personnellement servi de cette métaphore pendant dix ans, et quand j’ai commencé à écrire ce livre, j’ai pensé que l’image d’un conducteur d’éléphant serait utile dans ce premier chapitre sur le moi divisé. Mais la métaphore s’est révélée utile dans tous les chapitres car pour comprendre les idées principales de la psychologie, il faut comprendre que l’esprit est divisé en plusieurs parties qui entrent parfois en conflit. On suppose qu’il y a une seule personne dans chaque corps mais, dans un certain sens, chacun de nous ressemble davantage à un comité dont les membres ont été réunis pour travailler ensemble alors que ces membres poursuivent en fait des buts contraires. Notre esprit connaît quatre divisions. La quatrième est la plus importante car c’est la plus proche de l’image du conducteur d’éléphant ; mais les trois premières contribuent aussi à nos expériences de tentation, de faiblesse et de conflit interne.
Première division : le corps et l’esprit
On dit parfois que le corps a son propre esprit, mais le philosophe Michel de Montaigne va plus loin en suggérant que chaque partie du corps a ses émotions propres et son objectif personnel. Montaigne était surtout fasciné par l’indépendance du pénis.
On a raison de remarquer l’indocile liberté de ce membre, s’ingérant si importunément lors que nous n’en avons que faire, et défaillant si importunément lors que nous en avons le plus à faire : et contestant l’autorité, si impérieusement, avec nostre volonté12.
Montaigne observa aussi la façon dont les émotions faciales trahissent nos pensées secrètes : nos poils se dressent, notre cœur bat plus vite, notre langue fourche, nos intestins et sphincters subissent leurs propres dilatations et contractions, indépendantes de nos souhaits, et le plus souvent opposées à eux. On sait maintenant que certains de ces effets sont dus au système nerveux autonome, c’est-à-dire au réseau de nerfs qui contrôle les organes et glandes de notre corps. Ce réseau est indépendant et ne peut être contrôlé volontairement et intentionnellement. Dernier indicateur de la liste de Montaigne, l’intestin dépend d’un second cerveau. Nos intestins sont reliés à un réseau de plus de cent millions de neurones qui gère les opérations nécessaires à l’extraction et au traitement chimiques des nutriments de la nourriture13. Ce cerveau du ventre ressemble à un centre administratif régional qui a des occupations que le cerveau de la tête ne connaît point. On pourrait s’attendre à ce que ce cerveau du ventre reçoive et exécute les ordres du cerveau de la tête. Au contraire, il est très autonome et continue à fonctionner même si le nerf vague, qui relie les deux cerveaux, est sectionné.
Le cerveau du ventre manifeste son indépendance de deux manières. D’une part, il provoque le syndrome du côlon irritable lorsqu’il « décide » de faire évacuer les intestins. Et il déclenche de l’anxiété dans le cerveau de tête lorsqu’il détecte une infection dans les intestins, ce qui pousse à adopter des comportements plus prudents et plus appropriés en cas de maladie14. D’autre part, il réagit de façon inattendue à toute modification de ses neurotransmetteurs principaux comme l’acétylcholine et la sérotonine. Ainsi, les nombreux premiers effets secondaires du Prozac® et des autres inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine impliquent de la nausée et des perturbations de la digestion. En somme, essayer d’améliorer le fonctionnement du cerveau de tête peut avoir des effets directs sur le cerveau de ventre. Comme leurs homologues digestifs, les organes génitaux ont une nature autonome. Ces indépendances ont probablement contribué aux anciennes théories indiennes selon lesquelles l’abdomen contient les trois chakras inférieurs, ces centres d’énergie correspondant au côlon, aux organes génitaux, et au ventre. Le chakra du ventre est réputé être la source de sentiments et d’intuitions, ces idées qui semblent venir d’ailleurs que de l’esprit. Lorsque saint Paul décrivait la bataille de la chair et de l’entendement, il faisait sûrement référence aux mêmes divisions et frustrations que celles vécues par Montaigne.
Deuxième division : la gauche et la droite
Une deuxième division fut découverte par hasard dans les années 60, lorsqu’un chirurgien entreprit de couper les cerveaux humains en deux. Ce chirurgien, nommé Joseph Bogen tentait d’aider les gens qui souffraient de crises d’épilepsie fréquentes et importantes. Le cerveau humain est constitué de deux hémisphères reliés par une bande de nerfs appelée corps calleux. Les crises commencent toujours à un endroit précis du cerveau et s’étendent au tissu cérébral environnant. Si la crise traverse le corps calleux, elle peut s’étendre à tout le cerveau et provoquer pertes de conscience, chutes, et convulsions. Comme un chef militaire qui fait exploser un pont pour empêcher que l’ennemi ne le traverse, Bogen voulait sectionner le corps calleux pour empêcher la crise de s’étendre.
À première vue, ça ressemble à une tactique insensée. Le corps calleux représente le plus gros paquet de nerfs de tout le corps, il doit donc avoir une activité importante. C’est effectivement le cas : il permet aux deux parties du cerveau de communiquer et de coordonner leurs activités. Cependant, la recherche sur les animaux a montré que, quelques semaines après une opération de section du corps calleux, les animaux retrouvaient une vie normale. Bogen tenta donc sa chance avec des patients humains et cela fonctionna : l’intensité des crises fut grandement réduite.
Mais cette coupure n’entraîne-t-elle vraiment aucune déficience ? Pour le savoir, l’équipe de Bogen intégra un jeune psychologue nommé Michael Gazzaniga et lui donna pour rôle d’étudier les effets à long terme de l’opération. Gazzaniga s’appuya sur le fait que le cerveau répartit le traitement de l’information environnante entre ses deux hémisphères (le gauche et le droit). L’hémisphère gauche enregistre l’information de la moitié droite du monde (c’est-à-dire qu’il est connecté aux transmissions nerveuses du bras et de la jambe droits, de l’oreille droite et des moitiés gauches de chaque rétine qui elles-mêmes « aperçoivent » ce qui se passe dans la moitié droite du champ visuel) et dirige les mouvements des membres situés du côté droit du corps. L’hémisphère droit est le reflet du gauche : il encode l’information de la partie gauche du monde et contrôle les mouvements des membres situés sur la partie gauche du corps. Par ailleurs, les deux hémisphères sont spécialisés dans différentes tâches. L’hémisphère gauche est spécialiste du langage et du traitement analytique. Ainsi, il s’avère plus efficace pour détecter les détails dans les tâches visuelles. Quant à l’hémisphère droit, il est plus efficace dans le traitement des formes apparaissant dans l’espace, dont la forme capitale que représente le visage. Cette distinction est à l’origine de l’idée populaire et simpliste que, chez les artistes, c’est le cerveau droit, et, chez les scientifiques, c’est le cerveau gauche qui domine.
Gazzaniga profita de cette spécialisation du travail pour présenter des informations séparément à chaque moitié de cerveau. Il demanda aux patients de fixer un point sur un écran et fit apparaître très brièvement un mot ou une image juste à droite ou juste à gauche du point, si brièvement que le patient n’avait pas le temps de diriger son regard vers l’apparition. Si l’image d’un chapeau apparaît à droite du point, elle est captée par la partie gauche de chaque rétine (après passage et inversion dans la cornée) qui envoie l’information aux aires visuelles situées dans l’hémisphère gauche. Gazzaniga demandait alors « Qu’avez-vous vu ? ». L’hémisphère gauche est spécialiste du langage, le patient répondait donc rapidement et facilement « un chapeau ». Par contre, si l’image apparaît à gauche du point, elle n’est envoyée que dans l’hémisphère droit, qui lui ne traite pas le langage. Dans ce cas, quand Gazzaniga demandait : « Qu’avez-vous vu ? », l’hémisphère gauche du patient répondait : « Rien du tout ». Mais si Gazzaniga demandait au patient de pointer de la main gauche l’image correcte sur une carte représentant plusieurs images, l’hémisphère droit montrait le chapeau. Ainsi, bien que l’hémisphère droit eût vu le chapeau, il ne pouvait le communiquer verbalement puisque les centres du langage sont détenus par l’hémisphère gauche. Une intelligence séparée serait donc enfermée dans l’hémisphère droit et n’aurait pour moyen d’expression que la main gauche15.
Un phénomène encore plus étrange se manifesta lorsque Gazzaniga montra des images différentes aux deux hémisphères. Lors d’un test, il fit apparaître brièvement l’image d’une patte de poulet à droite et l’image d’une maison couverte de neige à gauche. Il montra ensuite une série d’images au patient et lui demanda de pointer celle qui était liée à ce qu’il venait de voir. De la main droite, le patient pointa l’image d’un poulet (qui correspond à la patte qu’il venait de voir) et de la gauche, il pointa celle d’une pelle (qui correspond à la neige vue par l’hémisphère droit). Quand le patient dut expliquer ses deux réponses, l’hémisphère gauche inventa immédiatement une histoire plausible. Le patient répondit donc sans hésiter : « Oh c’est évident, la patte de poulet va avec le poulet et la pelle sert à nettoyer le poulailler16. » Gazzaniga venait de découvrir que les gens inventent facilement des raisons à leurs comportements, c’est ce que l’on appelle de la « confabulation ». La confabulation est fréquente chez les patients qui ont des lésions dans le cerveau, en particulier chez ceux dont les deux hémisphères ne communiquent plus. Gazzaniga présenta les centres du langage situés dans l’hémisphère gauche comme un interprète dont le rôle est de commenter en direct tout ce que le moi est en train de faire ; et ce, même si cet interprète ignore les causes et motivations réelles de ce comportement.
Ces schismes impressionnants de l’esprit sont la conséquence de simples coupures dans le cerveau. La plupart des gens n’ont pas le cerveau séparé de la sorte. Mais l’étude de ces situations montre, avec un parfum de fantastique, que l’esprit est un ensemble de modules qui travaillent indépendamment et parfois à des fins contraires. Elle met également en évidence qu’un de ces modules peut inventer des explications cohérentes à notre comportement sans en connaître la cause réelle. Le module interprète de Gazzaniga correspond essentiellement au conducteur. On surprendra le conducteur en pleine confabulation dans les chapitres suivants.
Troisième division : l’ancien et le nouveau
Si vous vivez dans un quartier résidentiel récent, votre maison a sans doute été construite en moins d’un an, et ses pièces conçues par un architecte qui a essayé de satisfaire les besoins des gens. Dans ma rue, les maisons datent du début du XXe siècle, et depuis lors, elles se sont agrandies vers l’arrière. Les annexes ont été agrandies, puis murées et transformées en cuisines et en chambres. On a également ajouté des salles de bain. Le cerveau des vertébrés s’est développé de la même manière, mais vers l’avant. Au début, c’était un « trois-pièces » ; il comprenait trois bulbes de neurones : à l’arrière, le cortex occipital (connecté à la moelle épinière), au milieu, le cortex médian, et à l’avant, le cortex frontal (connecté aux organes sensoriels). Avec le temps, le corps et les comportements se sont complexifiés et c’est la partie frontale du cerveau, la plus éloignée de la colonne vertébrale, qui se développa le plus. Une nouvelle enveloppe extérieure apparut. Elle incluait l’hypothalamus (spécialisé dans la coordination des instincts et motivations de base), l’hippocampe (spécialisé dans la mémoire) et l’amygdale (spécialisée dans les réponses et l’apprentissage émotionnels). On appelle l’ensemble de ces structures le système limbique.
Quand la taille des mammifères a augmenté et que leurs comportements se sont diversifiés, la transformation a continué. Chez les mammifères les plus sociaux, en particulier les primates, une nouvelle couche de tissu neuronal s’est développée et étendue autour de l’ancien système limbique. Ce néocortex est de la matière grise, caractéristique du cerveau humain. La région frontale du néocortex est capable de faire de nouvelles associations et de s’engager dans de la réflexion, de la planification, et de la prise de décisions. Ces processus mentaux peuvent soulager la contrainte de ne pouvoir réagir qu’à la situation actuelle.
Cette croissance du cortex frontal semble constituer une explication prometteuse des divisions de l’esprit auxquelles nous sommes confrontés. Le cortex frontal pourrait être le siège de la raison, ce serait l’aurige de Platon, l’entendement de saint Paul. Il a pris, mais pas totalement, le contrôle du système limbique plus primitif, le mauvais cheval de Platon, la chair de saint Paul. Cette explication pourrait s’intituler « le scénario prométhéen de l’évolution humaine », d’après le nom du personnage qui, dans la mythologie grecque, vola le feu aux dieux et le donna aux humains. Dans cette histoire, nos ancêtres étaient de simples animaux guidés par les émotions et instincts primitifs venant du système limbique. Mais ils reçurent le don divin de la raison, logée dans le néocortex récemment construit.
Le scénario prométhéen est agréable car il nous place au-dessus de tous les autres animaux, justifiant notre supériorité par notre rationalité. Mais en même temps, il nous donne le sentiment que nous ne sommes pas encore des dieux, que d’une certaine manière, le feu de la raison est nouveau pour nous et que nous ne le maîtrisons pas encore. Le scénario prométhéen correspond à certaines découvertes sur le rôle du système limbique et du cortex frontal. Par exemple, en stimulant certaines régions de l’hypothalamus avec un petit courant électrique, on peut rendre un rat, un chat, ou d’autres mammifères gloutons, féroces, ou lubriques. Cela indique que le système limbique est à l’origine d’un grand nombre de nos comportements animaliers basiques17. Inversement, lorsque des gens subissent des lésions au cortex frontal, ils manifestent parfois une augmentation des comportements sexuels et agressifs. Le cortex frontal joue en effet un rôle important dans la suppression et l’inhibition des comportements impulsifs.
Il y a cependant un défaut dans le scénario prométhéen : il suppose que le siège de la raison est le cortex frontal et que les émotions sont retranchées dans le système limbique. En réalité, le cortex frontal permet une amplification des émotions humaines. Le tiers inférieur du cortex préfrontal s’appelle cortex orbitofrontal parce que cette partie du cerveau se trouve juste au-dessus des yeux. Cette région du cortex, particulièrement développée chez les humains et les autres primates, fait partie des zones cérébrales les plus actives lors des épisodes émotionnels18. Le cortex orbitofrontal joue un rôle central dans l’évaluation des récompenses et punitions potentielles d’une situation. Les neurones de cette partie du cerveau tournent à plein régime lorsqu’il y a un potentiel immédiat de plaisir ou de douleur, de gain ou de perte19. Lorsque vous êtes attiré par un bon repas, un paysage ou une personne séduisante, lorsque vous êtes dégoûté par un animal mort ou déçu par une très mauvaise chanson, votre cortex frontal est en train de travailler dur pour vous donner l’envie consciente de vous approcher ou de vous enfuir20. Le cortex orbitofrontal ressemblerait davantage au ça ou à la chair de saint Paul qu’au surmoi de l’esprit.
L’importance du cortex orbitofrontal a été davantage mise en évidence par l’étude des lésions cérébrales. Le neurologue Antonio Damasio a étudié des personnes qui avaient perdu plusieurs régions de leur cortex frontal suite à une tumeur, un accident vasculaire cérébral ou un choc physique violent. Dans le courant des années 90, Damasio a découvert que des personnes avaient perdu la majorité de leur vie émotionnelle suite à la lésion de plusieurs parties du cortex orbitofrontal. Elles racontaient que lorsqu’elles devaient ressentir de l’émotion, elles ne ressentaient rien. L’étude des réactions de leur système autonome (celles que l’on observe avec un détecteur de mensonge) confirme qu’elles ne vivaient pas les réactions émotionnelles instantanées que nous ressentons lorsque nous observons des scènes horribles ou splendides. Cependant, leur raisonnement et leurs capacités logiques étaient intacts. Elles obtenaient un score normal aux tests d’intelligence et n’ignoraient ni les règles sociales ni les principes moraux21.
Comment ces personnes réagissent-elles à leur environnement ? Puisqu’elles sont libérées des distractions émotionnelles, sont-elles hyperlogiques ? Peuvent-elles voir à travers le brouillard émotionnel qui nous dissimule la voie de la rationalité parfaite ? Bien au contraire ! Elles sont incapables de prendre des décisions simples ou de se fixer des objectifs ; leur vie est un désastre. Face à la question, « que devrais-je faire ? », elles perçoivent des dizaines de possibilités mais n’ont aucun sentiment qui permet d’en préférer certaines et d’en rejeter d’autres. Elles en sont réduites à examiner rationnellement les avantages et inconvénients de chaque possibilité. Mais en l’absence d’émotion, elles ne voient pas pourquoi opter pour l’une ou l’autre. Chez la plupart d’entre nous, cette même question anime le cerveau émotionnel. Il évalue les possibilités instantanément et automatiquement et, le plus souvent, l’une d’entre elles nous apparaît comme le choix évident. On n’utilise la raison pour jauger les avantages et inconvénients que lorsque qu’on n’arrive pas à départager deux ou trois possibilités.
La raison humaine repose donc sur le travail complexe des émotions. Notre raison ne fonctionne que parce que notre cerveau émotionnel est si efficace. L’image platonicienne de l’aurige qui dirige le canasson de la passion exagère à la fois l’influence de la sagesse et le pouvoir de l’aurige. La métaphore du conducteur d’éléphant correspond mieux aux découvertes de Damasio : la raison et l’émotion doivent travailler ensemble pour produire un comportement intelligent, mais l’émotion (qui correspond en grande partie à l’éléphant) accomplit la plus grande partie du boulot. Lorsque le néocortex apparut, le conducteur apparut également, mais l’éléphant devint aussi lui-même plus intelligent.
Quatrième division : le contrôlé et l’automatique
En 1990, alors que je réfléchissais à la métaphore de l’éléphant et du conducteur, la psychologie sociale arriva à une conception similaire de l’esprit. Après un long engouement pour les métaphores du modèle de traitement de l’information et de l’ordinateur, les psychologues commencèrent à réaliser que, dans l’esprit, deux systèmes de traitement sont constamment à l’œuvre : des processus contrôlés et des processus automatiques.
Imaginez que vous participiez à l’expérience suivante22 : l’expérimentateur vous donne d’abord quelques exercices de vocabulaire et vous demande de le prévenir quand vous aurez fini. Les exercices sont faciles ; il suffit de remettre dans l’ordre des groupes de cinq mots et de faire une phrase en utilisant quatre d’entre eux. Vous avez fini en quelques minutes et vous sortez dans le couloir à la recherche de l’expérimentateur. Vous le trouvez en pleine conversation avec quelqu’un et il ne vous regarde pas. Que faire ? Eh bien, si certaines des phrase à reconstruire dans l’exercice de vocabulaire contenaient des mots liés au thème de l’impolitesse (par exemple : déranger, éhonté, agressif), il y a de fortes chances que vous interrompiez l’expérimentateur après une minute ou deux pour lui dire : « Hé, j’ai fini, que dois-je faire maintenant ? » Par contre, si à la place des mots liés à l’impolitesse, les phrases à reconstruire contenaient des mots liés à la politesse, il y a davantage de chance que vous vous contentiez de vous asseoir docilement en attendant que l’expérimentateur vous fasse signe (ce qu’il fait au bout de dix minutes).
De même, l’exposition à des mots liés aux personnes âgées fait que l’on marche plus lentement, celle à des mots liés aux professeurs fait que l’on est plus intelligent dans des jeux comme le Trivial Pursuit, et l’exposition à des mots liés aux hooligans nous rend plus bêtes23. Pour obtenir de tels effets, il n’est même pas nécessaire qu’on lise les mots consciemment. Les effets se produisent également quand le mot est présenté de manière subliminale, c’est-à-dire présenté pour quelques centièmes de seconde à l’écran. Une telle présentation est trop rapide pour que notre conscience puisse enregistrer les mots, mais une certaine partie de l’esprit les voit et provoque des comportements que les psychologues peuvent mesurer.
John Bargh est le pionnier dans ce domaine de recherches. Selon lui, ces expériences montrent que la plupart des processus mentaux se déroulent automatiquement, sans recours à l’attention ni au contrôle conscients. La plupart des processus automatiques sont complètement inconscients, bien que certains soient partiellement accessibles à la conscience. Ainsi par exemple, nous sommes conscients du « flux de pensées24 » qui semble s’écouler de lui-même, suivant ses propres règles d’association, sans effort ni directive du moi. Bargh distingue les processus automatiques des processus contrôlés. Ces derniers nécessitent des efforts, procèdent par étapes, et se produisent toujours sur la scène de la conscience. Par exemple, pour répondre à la question « à quelle heure devez-vous partir de chez vous pour attraper le vol de 6 h 26 pour Londres ? », vous devez y réfléchir consciemment : choisir un moyen de transport pour l’aéroport, tenir compte du trafic aux heures de pointe, de la météo, et de la sévérité aléatoire des contrôles à l’aéroport. Vous ne pouvez donc pas partir sur un coup de tête. Mais en chemin vers l’aéroport, la plupart des choses que vous faites sont automatiques : respirer, cligner des yeux, rêvasser, garder une distance de sécurité avec la voiture qui vous précède, voire râler et insulter les conducteurs plus lents.
Le traitement contrôlé est limité, on ne peut penser consciemment qu’à une seule chose à la fois. Par contre, les processus automatiques peuvent se dérouler en parallèle et donc traiter plusieurs tâches en même temps. Quand l’esprit effectue des centaines d’opérations à chaque seconde, une seule peut ne pas être automatique. Quel est le lien entre processus automatiques et processus contrôlés ? Le traitement contrôlé serait-il le sage, le roi, le PDG qui traite les dossiers importants ? Celui qui prend les décisions avec prévoyance et laisse leur exécution à cet abruti de traitement automatique ? Non, cela nous ramènerait au scénario prométhéen et à l’image de la raison divine. Pour dissiper définitivement le mythe prométhéen, un petit voyage dans le passé nous aidera à comprendre pourquoi nous avons ces deux traitements, pourquoi nous avons un petit conducteur et un grand éléphant.
Lorsque, il y a six cent millions d’années, les premiers groupes de neurones ont formé les premiers cerveaux, ils ont forcément dû donner un avantage à l’organisme qui les hébergeait ; car depuis lors, les cerveaux se sont répandus. Avoir un cerveau facilite l’adaptation car il intègre l’information de différentes parties du corps et répond rapidement et automatiquement aux menaces et opportunités de l’environnement. Il y a trois millions d’années, la Terre était parcourue par une multitude d’animaux qui démontraient des habilités automatiques extraordinairement sophistiquées : les oiseaux se dirigeaient en fonction de la position des étoiles, les fourmis collaboraient pour faire la guerre ou cultiver des champignons, et plusieurs espèces d’hominidés avaient commencé à faire des outils. La plupart de ces créatures possédaient des systèmes de communication, mais aucune n’avait développé de langage.
Les processus contrôlés nécessitent le langage. On peut avoir des morceaux et des fragments de pensées par images, mais les mots sont nécessaires pour planifier les choses complexes, pour évaluer les avantages et inconvénients de possibilités ou pour analyser les causes de succès et d’échecs antérieurs. On ignore quand le langage est apparu chez les humains. On estime que c’était au plus tôt il y a environ deux millions d’années, quand le cerveau des hominidés a commencé à grossir significativement et au plus tard, il y a quarante mille ans, au temps des peintures rupestres et autres objets artisanaux qui révèlent immanquablement l’esprit humain moderne25. Peu importe le moment exact, le langage, le raisonnement et la planification consciente sont apparus lors du dernier battement de paupières de l’évolution. Ils ressemblent à de nouveaux programmes informatiques, ce sont des conducteurs d’éléphant version 1.0. Les éléments du langage fonctionnent bien mais il y a encore beaucoup de bugs dans les programmes relatifs au raisonnement et à la planification26. Par contre, les processus automatiques sont passés par des milliers de cycles de production et sont presque parfaits. Cette différence de maturité entre processus automatiques et contrôlés permet de comprendre pourquoi on a développé des ordinateurs qui peuvent résoudre des problèmes logiques, mathématiques ou jouer aux échecs bien mieux que nous (la plupart d’entre nous pataugent dans ces tâches), alors que le plus sophistiqué de nos robots ne parvient pas à se balader dans les bois avec autant d’aisance qu’un enfant de six ans (nos systèmes perceptuels et moteurs sont superbes).
L’évolution ne prévoit rien. Elle ne peut planifier la meilleure façon de passer d’un point A à un point B. Au lieu de cela, les formes existantes subissent des changements mineurs (par mutations génétiques) ; si ces derniers aident l’organisme à réagir plus efficacement à l’environnement existant, ils se répandent dans la population. Lorsque le langage évolua, le cerveau humain ne fut pas remodelé pour faire passer les commandes au conducteur d’éléphant (la pensée verbale consciente). Tout fonctionnait déjà très bien et les aptitudes langagières se répandirent dans la mesure où elles aidaient l’éléphant à faire plus correctement quelque chose d’important. C’est doncle conducteur qui a évolué pour se mettre au service de l’éléphant. Mais peu importe son origine, une fois acquis, le langage se révéla un outil puissant qui pouvait être utilisé de manière innovante. Et l’évolution sélectionna les individus qui l’utilisaient le mieux.
Un des avantages du langage est qu’il libère du « contrôle par les stimuli ». Les comportementalistes tels que B.F. Skinner décrivirent de nombreux comportements animaux comme un ensemble de connections entre des stimuli et des réponses. Certaines de ces connections sont innées ; par exemple, la vue ou l’odeur d’un aliment naturel déclenche chez l’animal une sensation de faim et le comportement de manger. D’autres connections sont apprises, comme celle des chiens de Pavlov qui salivaient en entendant le tintement d’une clochette qui annonçait auparavant l’arrivée de nourriture. Les comportementalistes considéraient les animaux comme des esclaves de leur environnement et de leurs expériences d’apprentissage ; esclaves qui réagissaient aveuglément aux récompenses offertes par tout ce qu’ils rencontraient. Les comportementalistes pensaient également que l’homme n’était pas différent des autres animaux. La lamentation de saint Paul pourrait donc être reformulée de la sorte : « Ma chair répond au contrôle des stimuli ». Ce n’est pas par hasard que ces plaisirs de la chair nous attirent tant. Comme ceux des rats, nos cerveaux sont configurés de sorte que la nourriture et le sexe nous procurent de petites poussées de dopamine, ce neurotransmetteur par lequel le cerveau nous fait apprécier les activités favorables à la survie de nos gènes27. Le mauvais cheval de Platon joue un rôle important dans notre attraction pour ces choses qui ont aidé nos ancêtres à survivre, et à devenir nos ancêtres.
Mais les comportementalistes n’avaient pas entièrement raison à propos de l’homme. Le système contrôlé permet à l’homme de penser à des buts à long terme et donc d’échapper à la tyrannie de l’instant présent, au déclenchement automatique de la tentation par la simple vue d’objets attirants. L’homme peut imaginer d’autres possibilités qui ne sont pas visuellement présentes ; il peut également mettre en balance les risques à long terme pour la santé et les plaisirs immédiats. Si les comportementalistes n’avaient pas entièrement raison, ils n’avaient malheureusement pas entièrement tort non plus. En effet, si le système contrôlé ne se conforme pas aux principes comportementalistes, il n’a que peu de pouvoir dans le déclenchement de comportements. Le système automatique a été formé par la sélection naturelle à déclencher des actions rapides et fiables. Il inclut des parties du cerveau (telles que le cortex orbitofrontal) qui nous font ressentir du plaisir et de la douleur et d’autres (telles que l’hypothalamus) qui déclenchent des motivations liées à la survie. Le système automatique a un doigt sur le bouton qui commande la libération de dopamine. Par contre, le système contrôlé ressemble à un conseiller. C’est un conducteur perché sur le dos de l’éléphant et qui aide celui-ci à faire de meilleurs choix. Le conducteur peut voir loin dans le futur et apprendre des informations précieuses en discutant avec d’autres conducteurs ou en lisant des cartes ; mais il ne peut rien ordonner à l’éléphant qui aille à l’encontre de la volonté de ce dernier. Je suis convaincu que le philosophe écossais David Hume était plus proche de la vérité que ne l’était Platon lorsqu’il disait : « La raison est, et elle ne peut qu’être, l’esclave des passions ; elle ne peut prétendre à d’autre rôle qu’à les servir et à leur obéir28. »
Finalement, le conducteur est un conseiller ou un servant ; et non un roi, un président ou un aurige tenant fermement les rênes. Le conducteur est le module interprète de Gazzaniga ; c’est la pensée consciente et contrôlée. L’éléphant est tout le contraire. Il représente les instincts, les réactions viscérales, les émotions et les intuitions qui composent le système automatique. L’éléphant et le conducteur ont chacun leur intelligence et lorsqu’ils collaborent, ils permettent le génie unique de l’esprit humain. Mais ils ne collaborent pas toujours. Voici trois caprices de la vie quotidienne qui illustrent la relation parfois complexe entre le conducteur et l’éléphant.
Les pertes de contrôle de soi
Imaginez que nous soyons en 1970 et que vous soyez un enfant de quatre ans impliqué dans une expérience de Walter Mischel de l’Université de Stanford. On vous conduit dans une pièce de votre école maternelle où un gentil monsieur vous donne des jouets et joue avec vous pendant un instant. Ensuite, le monsieur vous demande si vous aimez les biscuits (c’est le cas) et si vous préféreriez avoir cette assiette-ci sur laquelle se trouve un biscuit ou cette assiette-là sur laquelle se trouvent deux biscuits (vous préféreriez évidemment la seconde). Le monsieur vous dit alors qu’il doit quitter la pièce un instant et que si vous attendez qu’il revienne, vous pourrez avoir les deux biscuits. Si par contre, vous ne voulez pas attendre, vous pouvez agiter une clochette. Il reviendra immédiatement et vous donnera l’assiette avec un biscuit, mais dans ce cas, vous ne pourrez avoir celle avec les deux. Le monsieur quitte la pièce. Vous fixez les biscuits. Vous salivez. Vous en avez envie. Vous refrénez votre envie. Si vous ressemblez à la plupart des enfants de quatre ans, vous ne tiendrez que quelques minutes avant de sonner la cloche.
Faisons maintenant un bond jusqu’en 1985. Mischel a envoyé à vos parents un questionnaire rempli de questions sur votre personnalité, votre capacité à différer la satisfaction et à gérer la frustration ainsi que vos performances aux examens d’entrée à l’université (le Scholastic Aptitude Test b). Vos parents ont renvoyé le questionnaire. Mischel découvrit que le temps (mesuré en secondes) que vous aviez tenu avant de sonner la cloche en 1970 permettait de prédire non seulement la manière dont vos parents ont décrit l’adolescent que vous étiez, mais aussi la probabilité que vous soyez admis dans une université réputée. Les enfants capables de surmonter le contrôle par les stimuli et de différer la satisfaction quelques minutes de plus étaient devenus des adolescents plus aptes à résister à la tentation, à se concentrer sur leurs études et à se contrôler lorsque les choses n’allaient pas comme ils le voulaient29.
Quel était leur secret ? Ces enfants utilisaient stratégiquement leur contrôle mental limité afin de détourner leur propre attention. Mischel découvrit que les enfants qui réussissaient étaient ceux qui détournaient le regard de la tentation ou qui étaient capables de penser à d’autres activités agréables30. Ces facultés de la pensée sont un aspect de l’intelligence émotionnelle, la capacité de comprendre et de réguler ses propres sentiments et désirs31. Chez une personne dotée de cette intelligence, le conducteur sait comment distraire et persuader l’éléphant sans avoir à le combattre dans un duel de volontés.
Le système contrôlé peut difficilement vaincre le système automatique par le simple pouvoir de la volonté. Le premier est comme un muscle : il se fatigue32