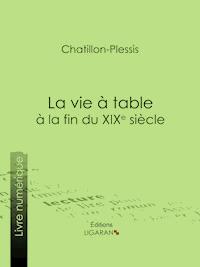
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Les coudes à l'aise. Un air tiède, libres d'arômes inquiétants. Des parfums de fleurs, discrets, invitant les nerf au repos, sans les paralyser. De la lumière. Une chaise large, robuste, sans étoffes. Nul excès d'appétit. L'appétit doit venir surtout par ce que l'on mange ; mais un sincère désir d'apprendre, de goûter, d'apprécier. Nous y sommes."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les coudes à l’aise. Un air tiède, libre d’arômes inquiétants. Des parfums de fleurs, discrets, invitant les nerfs au repos, sans les paralyser. De la lumière. Une chaise large, robuste, sans étoffes. Nul excès d’appétit. L’appétit doit venir surtout par ce que l’on mange ; mais un sincère désir d’apprendre, de goûter, d’apprécier.
Nous y sommes.
Aucune préoccupation d’ordre étranger aux plaisirs préparés. Le cerveau n’a plus à provoquer des sensations, à les rechercher, à les deviner : il n’a qu’à les attendre. À la porte de la salle à manger, les bruits du monde se sont éteints, évanouis. Ce n’est plus pour la société, pour la patrie, ou pour les affaires qu’on va doucement travailler ; c’est pour soi. Tâche sainte. Recueillons-nous.
Ainsi, c’est pour nous qu’ont fleuri ces roses, qui viennent expirer ici leur dernier souffle parfumé. Pour nous, que ces fruits ont mûri sur les lointains espaliers. Pour nous, que les prairies normandes ont été saupoudrées de sel, afin que les bœufs eussent la chair plus fine et plus saignante. Pour nous, que la terre de Périgord, immense pâté d’argile bourré de truffes, a fait surgir ces précieux tubercules, diamants noirs sur nos nappes blanches. Pour nous, que le raisin s’est gonflé d’une liqueur divine…
Là, quelle idée aiguë ! Quand, de partout, fruits et chairs nous préparent chaque jour la fête des repas, il suffirait de l’atrophie de quelques nerfs pour que nous ne puissions en apprécier les charmes éternels ?…
Et, de même que de ses yeux morts l’aveugle regarde sans voir, il se pourrait que notre bouche laissât passer tant de sucs sans en ressentir ni apprécier les essences ?…
Malheur immense ! plus grand encore que ne l’est la cécité pour le peintre, car il n’a ni compensation, ni atténuation.
Celui qui n’a pas le sens du goût ne peut, comme l’aveugle, deviner par le toucher, ni créer par l’imagination. Une cuillerée de purée de fraises n’impressionne pas plus les muqueuses qu’une cuillerée de terre glaise. La lacune est absolue, irrémédiable.
Le ciel nous préserve de calamité semblable, dont la pensée seule dessèche le palais et mortifie la langue !
Dans la bouche, boudoir au plafond grenat, aux meubles d’ivoire, dont les lèvres sont les rideaux opulents, elle est là, la charmante, étalée, rose entre les gencives roses, ainsi que sur les coussins d’une ottomane. Elle s’allonge, elle se replie, elle rêve, elle attend.
Et, quand les sucs amoureux arrivent, elle s’épanouit pour les recevoir, et ses papilles frissonnantes s’entrouvrent. Réceptacles mystérieux, par où les arômes se glissent, et, comme autant de parfums, montent jusqu’au cerveau par cent nervures.
Le siège de tous les plaisirs sûrs, réels, c’est elle. Sans elle, rien de vrai. Car les joies qu’elle donne sont compréhensibles, complètes, certaines. Elle touche au tangible, à l’ici-bas, par les satisfactions matérielles qu’elle procure. Elle touche à l’idéal, à l’en haut, par les satisfactions morales qu’elle appelle.
Elle ouvre les portes d’or, par où les autres sens se manifesteront à leur tour.
Que Brillat-Savarin me pardonne : il n’a pas tout pressenti.
S’il avait compté et classé les nerfs qui viennent s’attacher à la langue, racines tantôt grêles ou puissantes, il aurait sûrement remarqué que l’un des principaux d’entre eux est le nerf du tympan.
Le nerf du tympan aboutit au centre de l’organe dégustateur et s’en va vers le cerveau, vibrant à la fois des sensations goûtées et des sensations ouïes.
La relation est donc simultanée, et des mystères profonds s’expliquent.
Les rapports entre les joies gourmandes et les joies musicales sont démontrés. Lulli pâtissier, Verdi et Rossini, cuisiniers amateurs, sont expliqués. Les dîners à orchestre ont leur raison d’être physiologique. On comprend pourquoi la musique à jeun produit si peu d’effet. Et le proverbe populaire consacre définitivement la théorie, quand il proclame souverainement le principe :
« Ventre affamé n’a pas d’oreilles. »
Communion intime bien curieuse. Le sens le plus vague lié au sens le plus positif. L’ouïe et le goût allant de compagnie. Les saveurs s’harmonisant avec les sons, comme si sons et saveurs n’étaient que les notes dédoublées d’une même gamme !
Maintenant que nous savons les parce que satisfaisants de ces pourquoi inattendus, laissons notre fourchette, et, sans plus raisonner…
Eh !… Sommes-nous seuls à table ? y sommes-nous en compagnie ? Aimons-nous ceci ? Aimerons-nous cela ? Devons-nous aimer ceci ou cela ? Où sont nos devoirs ? Quels sont nos droits ? Il serait puéril de se mettre à manger sans connaître les justes limites des choses permises, défendues, ou tolérées, ou seulement tolérables.
Rappelons donc nos souvenirs, fouillons le dossier de nos impressions personnelles, rassemblons nos désirs et nos espérances, nos regrets et nos certitudes, – et codifions.
I.– Pour bien manger il faut être au moins deux, au plus douze.
Seul, à table, le dîneur souffre de ne pouvoir parler des satisfactions ressenties. En trop nombreuse compagnie, il risque d’être distrait des méditations que les mets doivent inspirer.
d’après Carle Vernet.
II.– Les repas entre hommes sont plus favorables à l’intelligente appréciation des mets, la compagnie d’une femme charmante étant désastreuse, à cause des devoirs absorbants que la politesse exige.
Toutefois, si cette femme est gourmande elle-même (ce qui constitue un charme double, et d’autant plus excitant en apéritivité), l’inconvénient s’atténue, et parfois même peut aller jusqu’à disparaître. En aucun cas, quel que soit son voisinage, un gourmand n’a le droit d’être amoureux pendant qu’il mange.
III.– Les hors-d’œuvre ne méritant presque jamais qu’on en cause, il serait pitoyable de s’écrier : Ces sardines sont délicieuses !… Toutefois, si, par suite d’une difformité du goût, on est passionné pour l’une ou l’autre de ces inutilités, on en sera quitte pour en prendre double part, à la dérobée.
IV.– Une conscience tranquille est presque indispensable à la saine pratique du repas.
L’homme honnête est celui qui mange en souriant.
V.– Jusqu’au troisième service, on ne doit parler que de ce que l’on mange, de ce que l’on a mangé et de ce que l’on mangera. L’esprit, entretenu de ces choses, ne risque pas ainsi de s’égarer vers d’autres sujets et de troubler le salutaire exercice des mâchoires.
VI. La pâtisserie est le fromage des dames.
Le plat dont on ne redemande pas est la leçon du cuisinier.
VII.– Les gens qui aiment le poisson ont généralement le caractère tranquille, à cause des arêtes. Mangez doucement toujours, peu à la fois. C’est le moyen de manger longtemps, agréablement.
VIII.– L’ivrogne boit pour avoir soif. L’inepte boit pour n’avoir plus soif. Le gourmet boit pour savoir s’il a soif. Humez, dégustez, buvez.
IX.– Avant de goûter aux mets chauds, il est bon d’en laisser le fumet monter doucement à soi. C’est se priver bénévolement d’un plaisir délicat que d’attaquer un plat sans en avoir d’abord apprécié le parfum.
X.– Un bon dîner est un idéal rêvé, qui se réalise jusqu’au rôti inclusivement. La salade est le coup de cloche du réveil, qui fait redescendre sur terre. À partir de ce mets, redevenez sociable, graduellement, puis, si possible, intéressant et brillant comme le repas lui-même, dont l’éclat de votre conversation est comme le reflet intellectuel, et le résultat moral immédiat.
C’est pourquoi ne parlez pas, au dessert, de tel sujet rebattu. Quand on a bien mangé, on a le devoir d’être spirituel.
XI.– L’appétit, qui n’est pas indispensable au commencement du repas, devient indispensable pour le terminer, car il doit résister à la dernière bouchée et se faire légèrement ressentir après elle.
Souvenir paisible, certes ; regret affectueux, sans doute. Mais aussi satisfaction, héroïque et douce à la fois, d’avoir su vaincre et vivre.
XII.– Mangez et buvez en songeant au repas d’après. Le dîner d’aujourd’hui ne doit pas nuire au déjeuner de demain.
C’est au plat de lentilles d’Ésaü que l’histoire de la cuisine commence.
À partir de ce moment, on peut compter les étapes.
Voici le vieux Noé, que nous laisserons à sa cuve, et voilà les merveilleux raisins de Chanaan, qui se montrent rutilants et énormes sur leurs ceps surchargés.
Traversons la mer Rouge avec les Hébreux, et prenons une légère collation avec les Pharaons, gens fort aimables à table, grands amateurs de sauterelles grillées à la sauce au miel. Puis retournons en Palestine, pour admirer la parfaite ordonnance des repas de Salomon. Ainsi très vivement, nous arrivons à ces temps bénis de la gastronomie antique qui signalent les six ou sept derniers siècles avant J.-C.
Ninive ! Babylone ! Nabuchodonosor ! Balthazar ! la décadence enfin ! la décadence pour toutes choses, excepté la Cuisine. Que de festins fameux à peine indiqués par l’histoire !
De son côté, l’Europe devenait gourmande. Athènes, puis Rome, suivaient l’exemple de l’Asie, Rome surtout.
À peine pouvons-nous regretter çà et là quelques déplorables symptômes de ladrerie gustative, telle, par exemple, cette pitoyable ordonnance de Lycurgue prescrivant le brouet noir aux Spartiates.
Nous jetterons des fleurs reconnaissantes sur la tombe de Lucullus, mort quarante-six ans avant l’ère nouvelle, en même temps que nous chanterons un hosanna pour fêter la naissance d’Apicius, contemporain de Jésus-Christ ; presque Messie lui-même, le Messie de la gourmandise !
À ce moment, l’art culinaire s’élève et plane à des hauteurs esculentes inconnues jusqu’alors, inconnues depuis, peut-être.
La découverte de Pompéi, cette ville romaine retrouvée tout entière dans son linceul de laves, comme une momie dans son tombeau, nous révèle des raffinements extraordinaires de la part des gourmets du temps. Nous y avons retrouvé, du reste, la plupart des instruments et ustensiles de cuisine encore en usage de nos jours.
Et ce n’est pas là la moindre surprise du philosophe que cette constatation d’où jaillit la vérité banale et lumineuse : à savoir que nous n’avons rien inventé…
UN SOUPER À POMPÉI
donné par le bourgeois Paratus (an 70).
Premier service.
Oursins de mer
Huîtres fraîches à discrétion
Huîtres épineuses
Mauviettes
Poulardes aux asperges
Huîtres et moules à la sauce
Tulipes de mer noires et blanches.
Deuxième service.
Spondyles. – Moules douces
Orties de mer
Becfigues
Côtelettes de chevreuil et de sanglier
Pâté de poulet
Becfigues aux asperges
Murex et pourpres.
Troisième service.
Tétines de truie au naturel Hure de sanglier
Tétines de truie au ragoût
Poitrines et cols de canards rôtis
Canards sauvages fricassés
Rôti de lièvre
Rôti de poulets de Phrygie
Crème d’amidon
Gâteaux de Vienne
Vin du Vésuve.
Course folle à travers le temps passé ! Quatorze siècles sans rien rencontrer ; car des brouillards persistants voilent l’histoire de la table, d’Apicius au Moyen Âge. Les grandes guerres politiques et religieuses ne furent pas favorables à la cuisine. Nos pères les Gaulois n’avaient des sauces que de très vagues notions et ne se doutèrent guère que leurs descendants deviendraient le peuple le plus gourmet du monde.
Avec la renaissance de tous les arts, devait coïncider la renaissance de la Cuisine, qui, – à jeun, – est l’art par excellence.
Aussi, est-ce de cette époque, surtout, qu’il faut dater les progrès dont nous bénéficions.
Les derniers Rois de France ont aidé puissamment à ces améliorations.
Les Valois et les Bourbons ont toujours eu le goût très délicat. François Ier, Henri II, Henri IV, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis XVIII même, Louis-Philippe ont laissé les plus excellents souvenirs sur ce point.
Entre tous, cependant, c’est encore Louis XIV, génie royal universel, qui laisse la trace la plus lumineuse. Ce Roi magnifique a droit à toutes les gloires.
L’éclat de sa table fut à la hauteur de toutes les autres splendeurs de son règne. Enfin, ce fut sous cette royauté que la fourchette, définitivement adoptée, prit dans le couvert la place maîtresse qu’elle occupe.
Il avait fallu près de soixante siècles à l’humanité la plus civilisée pour lui apprendre à ne pas manger avec les doigts.
La vie à table est une douce vie, mais de combien de conditions de bien-être elle se compose !
Il ne suffit pas au vrai gourmet d’avoir seulement de bons mets, il faut encore que ces mets lui apparaissent entourés et comme enveloppés dans un certain confort, et qu’il sache que ces merveilles culinaires ont été préparées avec l’aisance et la commodité nécessaires.
La salle à manger est un théâtre, dont la cuisine est la coulisse et la table, la scène. À ce théâtre, il faut un aménagement ; à cette scène, il faut des décors ; à cette cuisine, il faut une machination.
L’art de la table s’enrichit tous les jours d’une infinité de travaux et d’inventions originales, qu’elles viennent des particuliers ou des industriels. Nous mettre au courant de ce mouvement spécial, si utile, si indispensable à la vie universelle et à la vie parisienne en particulier, constitue à la fois un devoir et un plaisir.
Trop longtemps, il nous semble, les mangeurs sérieux ont gardé le silence. Qu’en est-il advenu ?… Les ministres du culte culinaire, restaurateurs et cuisiniers, se sont relâchés de leur vigilance. Devant l’indifférence des dîneurs, ils n’ont pas jugé utile de perfectionner ou, s’ils ont innové quelque chose, ce quelque chose est demeuré l’apanage exclusif d’un petit nombre d’intimes et d’initiés.
Et cependant, quel est celui qui ne voudrait savoir manger ? Donner l’appétit à ceux qui en manquent, aiguiser l’appétit de ceux qui en ont, quel but plus louable ?
On a dit quelque part, que les cuisiniers étaient les pourvoyeurs de la médecine.
Cette parole impie est surtout mensongère. Le vrai rôle de la vraie cuisine est d’appliquer savamment l’hygiène et de rendre par conséquent les médicaments inutiles en les remplaçant par d’ingénieuses combinaisons de produits naturels.
D’ailleurs, l’estomac est le moteur vrai du mouvement vital. Tout ce qui contribue à donner à ce moteur l’activité et la puissance doit donc être considéré comme un bienfait d’un prix inestimable.
Personne mieux que le Français, et que le Français de Paris, ne devrait être plus fier de sa table. C’est chez nous que se fait la meilleure cuisine. C’est en France qu’elle a pris le plus vif essor et donné les plus féconds résultats.
d’après un dessin de Myrbach.
Et, pas plus qu’il y a cinquante ou cent cinquante ans, les cuisiniers n’y manquent. Ce qui y fait défaut pour l’instant, ce sont les amphitryons.
On a parlé et l’on parle beaucoup du ventre de Paris, un maître ventre en effet. Mieux vaudrait peut-être s’intéresser à la façon dont il se garnit. La statistique des animaux de boucherie, des volailles, du gibier et des poissons engloutis par lui peut étonner à première vue. Elle ne tarde pas à affliger…
De tant de belles et bonnes choses quel parti une nation sagement et intelligemment gourmande ne pourrait-elle pas tirer !
C’est qu’on trouve tout, dans ce coin du monde où nous vivons. Il se promène dans quelque forêt de sapins, à deux cents lieues de vous, le gigot de chamois que vous avez décidé de manger la semaine prochaine. Je vois distinctement, avec un peu d’imagination, errer au milieu de roches alpestres l’ours dont le cuissot est promis à mes invités dans quinze jours, et la carpe que j’ai commandée pour cette date a beau fendre avec une majestueuse sérénité les eaux les plus profondes du Rhin, elle n’en est pas moins condamnée dès aujourd’hui à venir, à jour fixe, reposer sur le lit de thym, de truffes et de carottes que je lui destine, la paresseuse !
Ainsi du reste.
Avec de semblables ressources, nos cinq cent mille tables parisiennes devraient être, matin et soir, le rendez-vous incessant des plus exquises productions et la source de plaisirs aussi adorables qu’innocents.
Ah ! le beau spectacle, à ravir la pensée… et le goût que la vue de nos marchands de comestibles aux jours d’automne !
Et l’adorable promenade à faire dans Paris, avec ce seul objectif dans les jambes : visiter les étalages culinaires !
Ici et là, ce ne sont qu’avalanches de volailles et de gibier. De l’alouette à l’outarde, quelle gamme d’oiseaux exquis échelonnés sur le clavier des vitrines !
Au registre inférieur, voici les grosses pièces, formant la base de cette symphonie de saveurs : chevreuils, cerfs, biches, sangliers.
La noble compagnie !
Mon ami Henri Second, chroniqueur et poète comme Théophile Gautier, qu’il rappelle par le talent autant que par le physique, consacre nombre de ses matinées à une revue des nouveautés de bouche.
Comme ces amants de la bouteille qui ne peuvent voir un cabaret sans y entrer, Second ne peut rencontrer un étalage de comestibles sans être ému. Il s’arrête, inspecte, calcule, statistiquifie, – si j’ose ainsi m’exprimer. Toutes ces poulardes lui paraissent suer leur jus dans un alambic mystérieux dont son palais est le réceptacle.
Il mange avec ses yeux, vous dis-je, il mange réellement. Et la preuve, c’est qu’il a soif après vingt minutes de ce repas d’imagination.
En face, ou non loin de là, est un café quelconque. Il y entre et déguste lentement un fin bordeaux en regardant encore, à travers la vitrine, ce qui causa son altération. Il sort de là repu, satisfait, et, idéal à jamais enviable, dix minutes d’air pur suffisent à lui redonner l’appétit nécessaire au succulent déjeuner qui l’attend tout à l’heure.
S’il a rencontré dans sa promenade Fulbert-Dumonteil, l’écrivain exquis, comme lui gourmet et admirateur de toutes substantielles et savoureuses choses, le fin bordeaux, pris à deux, sera devenu prétexte aux plus excitantes discussions sur ces choses.
Et s’ils parlent et que j’écoute, moi, l’Homère distrait de ces héros, ce sera délices d’entendre et délices d’écrire. Beaux estomacs, nobles esprits, bons vivants, braves cœurs, chers amis !
Hareng frais, nous te saluons !
C’est en novembre que ta bedaine gonflée de laitance nous permet de savourer les jouissances les plus délicates de ton arôme ?
Sur le gril où tu te sacrifies, immobile et résigné, j’aime à te voir, ô noble victime de nos instincts gourmands. Certes, je le sais, tu aimes à cuire vivement, et malheur à qui t’oublie sur le feu plus que l’espace d’un Ave ! Ce courage te fait honneur. Fi des longues oraisons funèbres ! Sitôt flambé, sitôt cuit.
Une sauce au beurre, voilà ton corbillard. Tu t’y laisses rouler complaisamment jusqu’à la table, où t’attend la dernière fourchetée…
Point d’ambition, point de prétention, même à l’instant de la disparition finale.
Envies-tu seulement la gloire d’être désigné comme entrée ?… À peine ! On peut te qualifier de hors-d’œuvre : tu ne protesteras pas ! Tant d’abnégation ne valait-elle pas quelques paroles émues et sensibles ?…
Savoureux et léger, le hareng frais est un aliment facile à digérer. Au contraire, quand il est salé, il ne convient plus qu’aux estomacs robustes et son âcreté peut être funeste aux constitutions faibles. N’usez donc que modérément de cette dernière incarnation du hareng.
Cet aimable poisson est, en novembre, dans toute sa fraîcheur. Cependant, depuis la Sainte-Catherine, on y trouverait vainement ces laitances exquises dont nous parlons plus haut. Pourquoi cette coïncidence entre la situation… intéressante du hareng et la fête des vieilles filles ?…
C’est là un mystère comme la nature jalouse se plaît à en semer beaucoup dans l’étude de la science. Ne discutons pas, je vous prie, constatons simplement ; une paisible digestion est à ce prix.
Introduction, ouverture, préface, le potage est tout cela, et même davantage.
Beaucoup d’amphitryons semblent oublier la nécessité qu’il y a de soigner le potage, qu’ils classent vaguement dans les hors-d’œuvre, sous prétexte qu’il les précède. Quelques-uns même paraissent s’en soucier médiocrement, sans réfléchir à ceci, que le potage donne aux invités la première impression, c’est-à-dire la plus terrible.
Il y a plus.
C’est d’après sa composition, sa saveur et sa parfaite présentation qu’on juge de la suite du dîner.
Soignez donc votre potage avec la sollicitude d’un compositeur envers l’ouverture de son opéra. Si le dîner n’est qu’en trois actes, comme un opéra-comique, que le potage soit simple, bourgeois. Si le dîner est un opéra gastronomique, en cinq actes et dix tableaux, donnez un potage-introduction comme un avant-goût des splendeurs qui vont suivre.
Dans le premier cas, ne pensez pas qu’il soit si facile de réaliser un bon potage naturel. Il faut, pour y parvenir à souhait, une patience et une attention dont bien peu de personnes sont capables.
Dans le second cas, le travail est plus compliqué, sans doute, mais permet aussi plus de distractions et plus de fantaisie.
Juliennes, tapiocas, pâtes italiennes, chiffonnades, légères purées aux croûtons, etc…, le champ est vaste ; il s’étend à l’infini avec les potages liés aux purées de viandes, de gibier, de poissons, aux truffes, aux escargots. On connaît et l’on classe plus de dix mille variétés et combinaisons de potages ; et chaque jour, l’art de nos cuisiniers en découvre des centaines.
Pour peu que le repas soit important, on doit servir deux potages. Toutefois, cette observation ne devient une règle qu’au-dessus de douze couverts. Si l’on sert deux potages, l’un sera simple, dit potage clair, l’autre sera lié aux purées, crèmes, etc.
Le consommé, qui est la base de tous les potages, constitue, seul, ce qu’on appelle communément le pot-au-feu, joie des petits ménages et dîner du pauvre…
La viande la plus fraîche est celle qui produit le meilleur bouillon, et les morceaux de bœuf de tous temps préférés sont la tranche, la culotte, le bas de l’aloyau et le gîte à la noix.
Condition essentielle : le potage doit être servi très chaud, presque bouillant. Un véritable mangeur aime à brûler légèrement son palais aux vapeurs aromatiques du potage, ne fût-ce que pour humer avec plus de délices le coup d’après !
Quand décembre revient, la tomate s’en va. En quelques jours elle cesse d’être bonne.
Certes, je sais bien qu’on peut en tout temps trouver ce fruit, – comme tous les fruits d’ailleurs, – mais il ne s’agit pas ici de ce que peuvent donner seulement les conserves et les primeurs. Un légume dans sa force et à son époque de maturité naturelle vaut mieux qu’en toute autre occasion, – et coûte moins cher.
D’Espagne, son pays d’origine, la tomate fut acclimatée dans le Languedoc et la Provence. C’est même, disent les classiques gourmands, à l’inondation des gens du Midi, que la Révolution attira à Paris, que la capitale doit ses rapides succès en cuisine française.
Qui oserait, maintenant, médire des Méridionaux !
Il y a quelque cinquante ans, la tomate autour du bouilli tenait à celui-ci lieu de moutarde, qu’il était de bon ton d’écarter de quelques tables avant l’hiver.
Aujourd’hui, la moutarde a joliment fait du chemin dans l’estime des gourmets, puisqu’elle en est arrivée à s’imposer en toute saison.
La saveur aigrelette et fine de la tomate a le don de relever le plat le plus modeste en le rendant appétissant.
Avec un peu de mie de pain, de la chair à saucisses, rehaussée de persil, ciboule, estragon hachés, aiguisée d’une pointe d’ail, la tomate, troquant son ventre de pépins contre une farce habile, devient un entremets fort appréciable ; c’est la façon la plus commune, et aussi la plus exquise, de la présenter.
En sauces, en coulis, la tomate se prête aux transformations les plus variées et les plus excellentes. C’est, en somme, un de ces légumes bons enfants dont la société ne déplaît nulle part.
En d’autres termes, la tomate est un personnage culinaire qui ne manque jamais de tact, – vertu précieuse !
Tant de charmes dans le caractère, unis à de réelles grâces dans la physionomie, l’ont fait gratifier par le populaire du nom poétique de pomme d’amour. Les savants, eux, toujours revêches, se sont vengés de cette aimable appellation en l’inscrivant dans leurs archives poudreuses sous le vocable de lycopersicum ; barbarie gratuite, qui d’ailleurs n’a pas porté bonheur au baptême.
Je voudrais dire tout le bien que je pense du pain. C’est un sujet qui me tient particulièrement à… l’estomac. (L’estomac est le cœur des gens gourmands, ce qui n’empêche pas la gourmandise d’être le moindre défaut de bien des gens de cœur.)
Pour beaucoup de personnes ; parmi celles qui savent et peuvent le mieux manger, cet aliment constitue presque la moitié du repas. Cela suffirait, s’il en était besoin, à démontrer son importance.
Oh ! le bon pain, bien doré dessus, bien blanc à l’intérieur, croustillant, léger, quelle somme de jouissances aimables !
Remarquez la modestie exquise du pain : il est là, à côté de l’assiette, discret, généreux, ne fatiguant point les sens d’un arôme particulier pour attirer sur lui votre attention.
Il ne vous en veut pas, l’innocent, de l’indifférence avec laquelle vous le prenez et le coupez. Et cependant, il sait si vous lui revenez souvent !
Il se résout au rôle effacé d’accompagnateur, sans se plaindre jamais de cet effacement.
d’après une gravure sur bois du XVIe siècle.
Tel ce pianiste de grand mérite qui, toute une soirée, prodigue son talent au service des chanteurs qu’il soutient, aide, encourage et met en relief, sans que le public songe seulement à lui donner, dans ses bravos, la part à laquelle il aurait droit !
Pain, modeste et délicieux pain, violette des menus, où l’on ne te met jamais, mais où tu te trouves toujours, je t’aime et j’aime qui t’aime !
L’huître est un de ces aliments qui inspirent aussi facilement l’aversion que la passion. Entendez, Monsieur :
– Les huîtres ?… ah !…
Écoutez, Madame :
– Les huîtres ?… oh ! !
Et appréciez l’avis du sage :
– Les huîtres ?… eh ?…
N’insistons pas sur le sujet et continuons à ne le traiter qu’avec beaucoup de réserve, afin de ne pas nous attirer l’inimitié de ceux qui pensent autrement que nous.
Les haines engendrées par les différences de goût sont plus vivaces qu’on ne le croit ; il est en gourmandise, comme en tout, des « écoles » se détestant entre elles de la plus cordiale façon.
C’est pourquoi il ne faut pas s’étonner de voir, par exemple, des gens aimant les truites ne pas aimer ceux qui les exècrent.
C’est absurde, mais logique tout de même.
J’ai connu une fort hospitalière maison dont les maîtres, charmants sous tous les rapports, eussent dû vivre longuement dans la tranquillité et la joie paisible.
Qu’a-t-il fallu pour engendrer entre eux de perpétuelles discordes ?
Rien, moins que rien.
Monsieur ne pouvait supporter les carottes. La vue de ces légumes lui faisait presque autant de mal que leur goût (phénomène très compréhensible, l’aspect d’un aliment exécré communiquant, par réflexion, une sensation immédiate comparable à la déglutition même).
Madame, au contraire, les adorait et, ce qui est plus grave, ne voulait pas se résoudre à admettre l’aversion de Monsieur ! Elle ne croyait pas à cette antipathie, à cette « carottophobie » extraordinaire. Peut-être désirait-elle, tout au moins, que Monsieur, par amour pour elle, se décidât à les aimer.
Mais cette égoïste espérance ne se réalisa pas. Conséquence ? Monsieur n’aimait donc pas Madame ! ! !
Un autre résultat fâcheux de la situation ci-dessus indiquée fut de rendre impossible l’accès de cette maison, devenue petit à petit un nid de querelles.
Les dîners, les réceptions, sont des nécessités de la vie actuelle.
On invite bien souvent à sa table des gens auxquels on n’aurait guère songé à faire cet honneur ou à donner ce plaisir, « parce qu’il le faut ».
De toute façon, que l’on réunisse dans sa salle à manger des amis ou des ennemis, le premier devoir des amphitryons est de s’y montrer aimables, empressés et de ne laisser rien paraître qui puisse être de nature à troubler la digestion des invités.
Or, rien ne produit plus complètement la gêne parmi ceux-ci que la constatation d’un « froid » entre le maître et la maîtresse de maison.
Que dans la conversation ou dans les mille petites relations obligées du repas la moindre aigreur se manifeste entre eux, laissant entrevoir l’abîme de désaccords plus profonds, et voilà un dîner de perdu !
Chacun regardera sa montre à la dérobée, un silence de mauvais augure succédera au rôti, et les entremets sucrés perdront leur saveur.
La peste soit des modes romaines et de la ténacité avec laquelle certains amphitryons cherchent à nous y ramener !
Sous le prétexte excessif que le bon ton, sous le règne de Poppée, était d’arriver tard à table, pour se faire désirer, quelques personnes du « monde où l’on mange » essayent d’excuser leur inexactitude.
Il faut se dépêcher de protester, pendant qu’il en est temps, contre cette absurde coutume. Le premier devoir d’un invité qui respecte son hôte et se respecte lui-même est de se présenter chez son amphitryon, au plus tard dix minutes avant l’heure fixée.
Car, que l’amphitryon y songe bien, c’est faire une grave injure aux invités exacts que de leur faire attendre l’invité inexact !
Enfin, ce dernier doit comprendre que tout le personnel a travaillé, préparé, arrangé pour que les mille parties du festin soient prêtes au moment convenu.
Le moindre retard est une cause d’arrêt, c’est-à-dire de trouble et de préoccupations, dont les résultats seront des plus dangereux à tous les points de vue.
Au surplus, prenez des modes romaines ce que vous voudrez, pourvu que le rôti soit servi à point.
Mme de B… est une gourmande originale, dont la table a su se faire remarquer. Eh bien, Mme de B… a la « toquade » des mœurs antiques au plus haut degré. Son corsage de salle à manger (elle en a pour toutes les salles de son appartement) a fait le désespoir de trois couturières célèbres.
On m’assure même qu’il a fallu, pour lui donner la grâce historique qui le distingue, toute la haute compétence d’un de nos meilleurs costumiers de théâtre, – rayon de tragédie.
Imaginez une coupe de péplum dans des épaules, – qu’elle a très belles, – venant ensuite se fondre dans une taille à la Grévin.
Un camée superbe attache les croisures de ce demi-châle antique fait de satin à ramages pourpre et or.
Mme de B… porterait un anneau d’or aux orteils de ses pieds mignons que je n’en serais pas autrement étonné, quoique jusqu’ici ses invités, qui sont tous ses admirateurs, n’aient pas été encore à même de le constater de visu, – à leur grand regret sans doute.
Ici nous touchons directement à la question de la mode à table, qui a bien son importance, et nous voulons constater les légers indices qui semblent préparer la voie à une transformation des usages modernes relatifs à la vie gourmande.
Peut-être faisons-nous cette constatation avec une certaine inquiétude, persuadé que nous sommes de l’inanité et de l’inutilité d’une telle transformation.
Ce n’est pas, pensons-nous, en imitant les originaux qu’on prouve une véritable originalité, et notre temps est assez riche en fantaisistes pour n’avoir plus à emprunter au passé des coutumes surannées et le plus souvent incommodes.
On m’assure que la culture de l’olivier prend une importance exceptionnelle depuis ces dernières années. Cela étant, nous devons nous en montrer ravis, tant ce fruit délicat nous apporte de satisfactions.
Si, pour le moment, nous en exceptons l’huile délicieuse qu’elles nous fournissent, nous reconnaîtrons que les olives sont, en effet, d’un grand secours sur les tables et dans la cuisine.
Comme la figue et le melon, l’olive ne paraît jamais au dessert, mais seulement à l’entremets.
Elle entre avec grâce dans la confection des entrées de volaille et surtout de gibier.
Grâce à elle enfin, le canard devient estimable au point de mériter l’honneur du menu le plus recherché !
Honnête canard ! A-t-il jamais rêvé semblable destinée alors que, barbotant dans son humble mare, il ne voyait de la vie qu’une réalité bourbeuse !…
Ah ! que n’est-il parmi cette gent emplumée un canard prophète pour prédire à ses frères la grandeur de leur existence future, cet aspect du plat d’argent illuminé par les lustres, vrai paradis où, pendant un instant, reluiront pour eux seuls les regards de convoitise de vingt invités ! !
S’il est quelque part, en Provence, des mares ombragées d’oliviers, souhaitons qu’un nouveau La Fontaine y erre un jour, pour nous redire les idylles innocentes dont elles sont les mystérieux témoins.
Peut-être entendra-t-il, pour les traduire en vers doux comme elle, les soupirs de l’olive ! Peut-être notera-t-il les mélancoliques réponses du canard, par elle plus tard ennobli !
Mais non, ces deux âmes sœurs s’ignorent pendant leur vie et, comme tant d’âmes humaines, hélas ! ne doivent se retrouver pour s’apprécier l’une l’autre que… là-haut !
Mais le canard n’est pas, seul, un condamné à mort. Justement, à ce sujet, on m’a communiqué les menus de la Roquette.
C’est un régime que l’on peut culinairement classer ainsi :
DÉJEUNER : Bœuf découpé en morceaux ; pain découpé ; vin (un cinquième).
DÎNER : Soupe grasse ; côtelette de mouton (ou de veau) ; pain découpé ; vin.
DÎNER MAIGRE DU VENDREDI : Soupe maigre ; légumes ; vin.
Sans doute les menus de Lucullus étaient plus complets, mais ce gourmet avait peut-être quelques raisons d’être plus difficile. Enfin, certains mets ne peuvent décemment figurer dans l’ordinaire d’un condamné à mort. Je citerai, par exemple, la tête de veau… dont la vue seule suffirait à enlever au convive le peu d’appétit qui doit lui rester.
GRANDE COLÈRE D’UN MONSIEUR QUI A TOUTES SES DENTS.
Ne me demandez pas l’origine de la fête des Rois ; je n’en ai cure. Pour moi, c’est la fête du Pain, et le pain est roi, en effet, qu’il se présente en couronne ou autrement.
Il règne et n’a droit qu’à des bénédictions, car il a toutes les vertus. De quel roi en ce monde en pourrait-on dire autant ?
Les boulangers, artisans de cette royauté, éternelle comme l’humanité, sont donc en liesse et leur joie se traduit en gâteaux, naturellement.
Ici, je ne saurais trop élever la voix et montrer les dents.
C’est d’ailleurs pour elles que je m’indigne et me fâche.
Puisqu’on a conservé la tradition de la galette des Rois, pourquoi n’avoir pas conservé la fève ?… Depuis plusieurs années elle est, en effet, remplacée par de petits bonshommes, sujets ou bébés en porcelaine, qui sont bien la plus ridicule invention que je connaisse.
D’abord, leur présence ne signifie rien. Ensuite, grâce à eux, des centaines de mâchoires ont été démeublées lamentablement.
Un instant de distraction suffit au possesseur de la tranche royale pour le faire mordre à pleine force sur des objets que leur dureté même devait exclure d’un pareil endroit.
Je crois que le rétablissement des tours serait une excellente chose ; mais, en attendant je réclame de toutes mes forces le rétablissement de la fève. Il ne faut pour cela ni projets ni délibérations parlementaires. Un peu de bonne volonté et de bon sens suffisent. Je le dis tout net à messieurs les boulangers. Puissent messieurs les boulangers se le dire !
On fabrique malheureusement un peu trop de galettes pendant la semaine des Rois.
D’un autre côté, cette fabrication étant devenue pour les boulangers une occasion de faire à leurs clients le petit cadeau obligé des étrennes, il s’ensuit qu’on trouve difficilement à Paris de bonne galette, au moment où, justement, elle est le plus demandée.
Je me garderais de donner le moindre conseil relatif au moment où la galette doit paraître sur la table. C’est au maître de maison, qui veut sacrifier à la tradition, à en décider lui-même.
Toutefois, choisissez de préférence l’instant où la gaieté des convives, devenue expansive, semble le plus propice aux démonstrations bruyantes d’un plaisir commun.
Rien n’est puéril et misérable, je le sais, comme la gaieté de commande, et ceux qui se chatouillent pour rire donnent un spectacle qu’on a le droit de qualifier sévèrement. Mais la tristesse de commande n’est pas moins méprisable.
D’autant plus que la jeunesse ne demande pas mieux que de se distraire, rire, aimer, manger et boire.
Silence, empêcheurs de danser en rond ! Maugréez, geignez, grognez tant que vous voudrez, mais à l’écart, entre vous !
Et vous, jeunes gens… de tout âge, haussez les épaules devant ces attristés ennuyeux, et agitez vos jambes ! Dansez, sautez ferme ; que les bras pressent les tailles souples, que les lèvres effleurent les douces chevelures ! Du mouvement, du bruit, des éclats de rire, sous les bougies des salons illuminés !
Il est charmant ce tapage, elle est excellente cette gymnastique. Tout à l’heure, un peu lassés, main dans la main, les couples s’en iront s’asseoir autour des petites tables, garnies de mets appétissants et de vins généreux.
Car ce plaisir : la sauterie, aura été la meilleure préparation à cet autre plaisir : le souper.





























