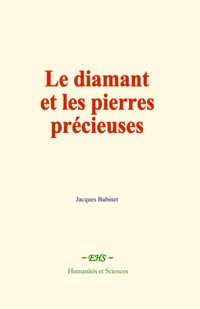Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Le titre de cette étude aurait dû être : « Du magnétisme en général et du magnétisme de la terre en particulier »; mais on a désigné aussi par le nom de magnétisme un ensemble de phénomènes physiologiques bien plus connus des gens du monde que le magnétisme proprement dit, qui est du ressort de la physique et de la météorologie. Or il ne s’agira ici que des propriétés physiques et de la théorie de l’aimant, enfin, de la terre considérée elle-même comme un vaste aimant dirigeant l’aiguille d’acier de la boussole, aimantant le fer et permettant d’observer une foule de phénomènes intimement liés à la constitution de notre globe, à son origine et aux curieux changements qui s’opèrent dans le cours des siècles tant à sa surface qu’à son intérieur…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 90
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
De l’aimant et du magnétisme terrestre
De l’aimant et du magnétisme terrestre
Chapitre I
Le titre de cette étude aurait dû être : « Du magnétisme en général et du magnétisme de la terre en particulier »; mais on a désigné aussi par le nom de magnétisme un ensemble de phénomènes physiologiques bien plus connus des gens du monde que le magnétisme proprement dit, qui est du ressort de la physique et de la météorologie. Or il ne s’agira ici que des propriétés physiques et de la théorie de l’aimant, enfin de la terre considérée elle-même comme un vaste aimant dirigeant l’aiguille d’acier de la boussole, aimantant le fer et permettant d’observer une foule de phénomènes intimement liés à la constitution de notre globe, à son origine et aux curieux changements qui s’opèrent dans le cours des siècles tant à sa surface qu’à son intérieur. Je répète donc que je parlerai seulement des propriétés de l’aimantation ou du magnétisme physique, et pas du tout de ce qu’on a appelé à la fin du dernier siècle le magnétisme organique ou le magnétisme animal. J’aurais voulu aussi me dispenser de rappeler tout ce qui se rapporte à l’aimant, à son action sur le fer, aux aimants artificiels en acier, à ceux que produit le courant de la pile de Volta, et de même à toute la théorie moderne du magnétisme ramené à l’électricité. Cependant, quoique chacune de ces notions soit très simple et même familière à plusieurs personnes, l’ensemble en est rarement possédé par un seul esprit, par une seule mémoire. Excepté la géographie, qui est à peu près sue communément, j’ai toujours éprouvé qu’avant de parler en météorologie de l’électricité, de la lumière, de la chaleur, des climats, enfin de tout le jeu des lois physiques dans la nature, il fallait commencer par préciser les notions générales que la physique a consacrées relativement à chacune des classes de phénomènes que l’on veut faire connaître et expliquer.
Plusieurs des auteurs qui ont eu ainsi à exposer des notions préliminaires ont fait de véritables traités sur chaque matière, ce qui revenait à peu près à forcer le lecteur à s’instruire à fond sur la science dont on voulait faire servir les théories pour l’explication des phénomènes de la nature. Il nous suffira ici de les rappeler sans démonstration, et en choisissant exclusivement les parties de la science qui ont des rapports avec les faits que nous observons, dont nous voulons savoir la cause et prédire la marche dans l’avenir.
Depuis les siècles anciens, où les métallurgistes de l’Asie-Mineure, suivant la fable et suivant la réalité, changeaient en fer, et par suite en or, la terre ocreuse qui sur tout le globe constitue la mine de fer, on sait qu’une pierre ferrugineuse, un véritable minerai de fer, a la propriété d’attirer et de retenir ce métal. Cette qualité, la plus occulte de toutes les propriétés physiques après celle qui produit la pesanteur, étant suivie d’âge en âge, nous offre le plus intéressant combat entre la science et l’ignorance, entre l’énigme proposée par la nature au génie de l’homme et la sagacité persévérante de celui-ci. Depuis quelques années seulement, le voile a été soulevé; on a vu que l’électricité agissait sur l’aimant, on a fait des aimants avec l’électricité, puis on a vu l’aimant agir, comme l’électricité, sur des métaux quelconques sans aimantation; puis enfin avec l’aimant on a fait de l’électricité et tous ses accessoires, le feu, la lumière, les actions physiques, les actions physiologiques, les actions chimiques, et jusqu’au télégraphe électrique lui-même. Dans une étude scientifique, je n’ose nommer Midas, qui était sans doute plus fort en métallurgie qu’en musique poétique; mais avec les progrès dus au présent siècle dans la science à laquelle la pierre de Magnésie, la pierre magnétique a donné son nom, ce serait être ingrat que de ne pas citer Oersted, Ampère, Arago et Faraday.
Ainsi, sans aborder la pénible tâche d’exposer, à l’occasion du magnétisme de la terre, toute la théorie de l’aimant et de l’électricité, nous n’en prendrons que ce qui sera relatif à l’aimantation électrique de notre globe, reconnue par toutes les analogies des faits observés avec les expériences de cabinet. En admettant les notions indispensables, nous élaguerons les autres, quelque curieuses qu’elles puissent être. Rien de moins que le nécessaire, mais rien de plus. Il y a trois sortes de définitions : la définition étymologique, la définition par énumération, et la définition théorique. La première cherche dans le nom de la chose à définir des notions sur sa nature; la deuxième énumère les diverses parties dont se compose la science à définir; enfin il y a la définition théorique, qui, en attribuant les faits à une cause hypothétique, a la hardiesse de les expliquer comme des effets de cette cause supposée admise. Ici l’hypothèse fondamentale, suivant la belle idée d’Huygens, se légitime par les explications qu’elle fournit des faits connus, et par les découvertes qu’elle provoque dans ces vastes contrées inexplorées qu’on appelle l’inconnu, c’est-à-dire le domaine de l’ignorance.
Le mot de magnétisme, ou science de l’aimant, vient originairement de celui de Magnésie, nom d’une contrée métallifère de l’Asie-Mineure : « l’aimant, dit Lucrèce, que les Grecs nomment ainsi du lieu qui est sa patrie »;
Quem magneta vocant patrio de nomine Graii.
L’île d’Elbe, en Europe, pourrait au même titre réclamer l’avantage de donner son nom, ilvaïsme, à ces morceaux de minerai de fer noir ou gris qui sont d’excellons aimants. On en tire aussi des Pyrénées. La pierre de Magnésie ou pierre d’Hercule a été connue de toute l’antiquité. Sa propriété d’attirer et de retenir le fer a excité l’étonnement de Thalès comme celui des savants de notre siècle. La définition étymologique de l’aimant ne nous apprend donc rien, sinon que l’aimant naturel est un minerai de fer attirant ce métal. Il est même quelques minerais magnétiques qui contiennent une certaine quantité de charbon, et qui par suite, outre leur propriété magnétique, se fondent en acier naturel, sans aucun procédé de cémentation ou autre manipulation équivalente. En choisissant certains échantillons de cette mine d’acier, on aurait des aimants blancs.
Buffon a déjà remarqué combien il était merveilleux que, même du temps d’Homère, la langue grecque possédât une si prodigieuse richesse de mots pour exprimer tous les êtres physiques ou métaphysiques que peut connaître l’intelligence humaine. On est encore, de nos jours, forcé de recourir à ce bel idiome pour nommer directement ou indirectement une foule d’objets nouveaux. Toutefois, quant au magnétisme et aux propriétés de l’aimant autres que celle de saisir le fer, les Grecs n’ont rien dans leur langue qui puisse nous éclairer.
Les anciens n’ont point fait agir deux aimants l’un sur l’autre, et n’ont point vu que si ces deux aimants s’attirent fortement par deux bouts, ils se repoussent de même par les deux autres. L’orientation que donne le globe aux aimants flottants leur a également échappé. Là comme ailleurs, ils ont fait de longues théories et de courtes expériences. Lucrèce convient que ces théories ont besoin de longs circuits :
Et nimiùm longis ambagibus est adeundum.
La définition par énumération a le grave inconvénient d’énoncer des choses provisoirement inconnues : nous éviterons cet écueil en substituant à cette énumération l’historique de la découverte de chaque propriété de l’aimant.
Outre la propriété d’attirer et de retenir le fer, reconnue par les Grecs, les Romains avaient vu que si un aimant enlève un anneau de fer, cet anneau lui-même en enlève un second, et ainsi de suite, en sorte, dit Lucrèce, qu’il se fait une chaîne d’anneaux suspendus l’un à la suite de l’autre. Il est fort douteux que ce peuple, très peu observateur, ait su qu’un aimant pouvait communiquer aux corps sur lesquels il agissait la vertu dont il était doué, soit que cette propriété acquise fût passagère, comme dans le fer doux, soit qu’elle devint permanente, comme dans les barreaux d’acier et dans les aiguilles de boussole, qui sont l’un et l’autre de vrais aimants artificiels. Je ne puis préciser l’époque où l’on a su aimanter l’acier pour la première fois, et, par des assemblages de barreaux, produire des aimants bien supérieurs en force à ceux que nous donne la nature dans les minerais de fer.
S’il est curieux de voir, sans cause apparente, un aimant naturel mettre en mouvement et soutenir contre son poids une masse considérable de fer, il est encore bien plus merveilleux de voir un barreau suspendu par son milieu à un fil, une aiguille mobile sur un pivot, tourner d’eux-mêmes leurs extrémités vers les régions polaires de la terre. C’est indubitablement aux Chinois que nous devons cette admirable découverte. Au moment où la puissance de la race tartare, pesant du nord sur le sud, tant dans l’Europe que dans l’Asie, écrasait à la fois les chrétiens d’Orient, les musulmans d’Asie, les bouddhistes et les Chinois, les envoyés des souverains d’Europe, et notamment ceux de France et d’Allemagne, se rencontrèrent à la cour du grand-khan avec ceux du Céleste-Empire, et l’Europe connut à cette époque, et par ces communications, la boussole, l’imprimerie et la poudre de guerre. Je supprime de curieux détails sur ces puissants dominateurs de l’Asie centrale, qui, dans l’orgueil de leur empire, avaient l’insolence de faire offrir au roi de France la charge de grand-fauconnier, et ne lui écrivaient que des lettres longues au plus de un ou deux pieds, tandis que, quand leur empire se fut affaibli en se divisant, ils recherchèrent l’alliance des souverains d’Europe pour faire diversion à des ennemis plus voisins, et envoyèrent plus courtoisement à nos rois des lettres qui avaient plusieurs mètres de long. Si ma mémoire est fidèle, ceci se passait au temps des Valois.
La boussole existe encore en Chine avec la même forme qu’au temps où elle a été importée en Europe. Je ne sais pas à quelle époque on a mis dans la boussole un barreau d’acier aimanté ou une aiguille légère à la place d’un lourd et faible aimant consistant en mine de fer magnétique. Peut-être est-ce là le perfectionnement qui fut mis en pratique à Amalfi, ville qui se vante de l’invention de la boussole, et qui sans doute n’est pas étrangère à l’adoption et à l’utilisation de cet instrument, pas plus que Faust et le moine Schwartz ne l’ont été à l’imprimerie et à l’emploi de la poudre de guerre. Notez que les Chinois n’ont point connu les armes à feu portatives, et ne les ont reçues que des Européens sous le nom d’armes franques. Il faut en dire autant de l’imprimerie avec des caractères isolés et non point en planche sculptée. Ces faits assurent les droits de ce peuple à ces trois grandes découvertes.