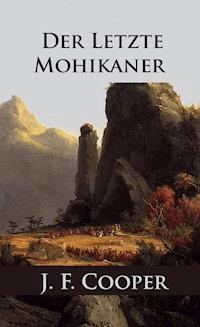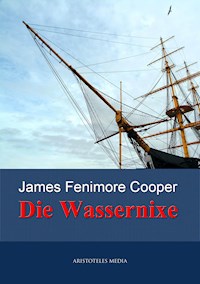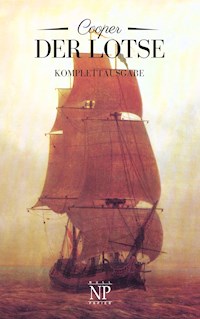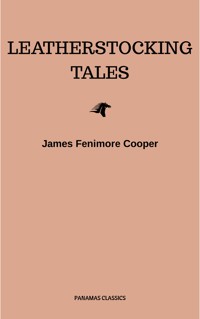Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CLAAE
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Les péripéties d'un jeune marin
Embarqué dès son plus jeune âge sur un navire marchand - pour échapper aux études et à la solitude - le jeune matelot apprend peu à peu les rudiments de la survie à bord et en mer. Il embarque sur des navires de commerce et navigue régulièrement entre l'Europe et l'Amérique. Il connaît les tempêtes, les accidents de mer, la misère, la prison. Il éprouve le feu de l'ennemi anglais et la captivité. Il fait de la contrebande de tabac puis part pour Canton et Calcutta, où il découvre le commerce de l'opium.
Un roman d'aventures passionnantes à travers les mers !
EXTRAIT
Mon goût pour la marine acquérait chaque jour de nouvelles forces, je saisissais les moindres occasions pour rôder sur les quais, observer les différentes espèces de vaisseaux, et les reconnaître à leur gréement. Un jour que je regardais un pavillon anglais, je m’entendis appeler par mon nom ; du premier coup d’œil je reconnus un habitant d’Halifax, et je m’enfuis à toutes jambes, dans la crainte qu’il ne m’appréhendât au corps pour me ramener chez M. Marchinton ; la peur d’être exposé de nouveau à de semblables rencontres et d’être trahi par le docteur me décida à chercher un navire. On m’envoyait au marché avec un domestique noir ; je me séparai de lui sous prétexte d’aller à l’école, et me promenai le long des quais jusqu’à ce que j’eusse aperçu un bâtiment à ma fantaisie. On l’appelait le
Sterling, et il y avait sur le pont un second d’une physionomie ouverte et prévenante. Le
Sterling était commandé par le capitaine John Johnston, de Wiscasset dans le Maine ; il en était propriétaire avec son père. Le second, nommé Irish, était natif de Nantucket.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Écrivain américain,
James Fenimore Cooper (1789-1851), est connu pour ses nombreux romans, dont
Le dernier des Mohicans. Engagé dans la Marine américaine à l’âge de dix-sept ans, il la quitte cinq ans plus tard.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JAMES
FENIMORE COOPER
LA VIE
D’UN MATELOT
CLAAE
2007
© CLAAE 2007
CLAAE
France
EAN ebook : 9782379110085
Chez le même éditeur :
_________________
Fournier Lucien
L’alimentation des équipages dans la marine - Esquisse historique
Ledru Jean-Pierre
A la recherche de La Pérouse (Deux sabots sur la mer)
Delaunay D.
Angenard, capitaine de corsaire
Vivez François
Autour du monde sous les ordres de Bougainville
Bougainville L.-A. de
Voyage autour du monde de Bougainville
Valentin F.
Voyages et aventures de La Pérouse
Exquemelin Alexandre
Aventuriers et boucaniers d’Amérique
Besson Maurice
Frères de la Coste
Maynard Félix
Les baleiniers chez les Maoris de Nouvelle-Zélande (L’Asia)
Margain Jean-Baptiste
Les baleiniers au large des îles Malouines et du Chili (La Fanny)
Loti Pierre
Matelot
Collonge Philippe
Un rescapé de La Méduse : mémoires du capitaine Dupont
Thiéry Maurice
James Cook, sa vie, ses voyages
Bligh William
Rescapés du Bounty
Nel Myers, le matelot.
LA VIE
D’UN MATELOT
En publiant la vie d’un matelot, je ne crois obéir à aucun sentiment de vanité. J’aime les mers ; c’est un plaisir pour moi d’en parler, de décrire les scènes dont j’ai été le témoin, les périls que j’ai affrontés en diverses parties du monde. Qui me blâmerait de vouloir raconter mes aventures ? Mon vieux compagnon Cooper, que j’ai eu le bonheur de retrouver, se charge de donner une forme convenable à mes écrits ; mon exemple peut être profitable et servir de leçon à ceux qui suivent la même carrière que moi : mon entreprise n’a donc point d’inconvénient, et il est même vraisemblable qu’elle produira de bons résultats.
Je ne connais ma famille que par mes souvenirs d’enfance et les détails que m’a donnés ma sœur. Je me rappelle un peu mon père ; mais j’ai complètement oublié ma mère, que j’ai perdue sans doute dès ma plus tendre enfance. Je vis souvent mon père jusqu’à ce que j’eusse atteint ma cinquième année. Il était officier dans le 1er régiment de ligne, au service du roi d’Angleterre. J’ai entendu dire qu’il était fils d’un ministre protestant hanovrien, ma mère à ce qu’on m’a dit, était également originaire d’Allemagne, mais les autres personnes de ma famille avaient peu de renseignements sur son compte. On me l’a dépeinte comme vivant séparée de mon père, ayant des occupations distinctes, et pleines d’aversion pour l’état militaire.
Je naquis à Québec en 1793, mais il me serait impossible de préciser la date de ma naissance.
Je fus baptisé dans la religion anglicane, et, si j’ajoute foi à ce qu’on m’a toujours raconté, je fus tenu sur les fonts par Son Altesse Royale le prince Edouard, colonel du 1er régiment, père de la reine Victoria. J’eus pour second parrain M. Walter major du 23e de ligne, et sa femme pour marraine. Mon baptême se fit à Québec, et l’on me donna les prénoms d’Edouard-Robert. Je suis connu dans la marine sous le nom d’Edouard Meyers, ou, par abréviation, Ned Myers.
Avant d’être assez âgé pour que mes impressions fussent durables, le régiment partit pour Halifax. Mon père le suivit, emmenant à la Nouvelle-Ecosse ses deux enfants, ma sœur Henriette et moi. Nous y séjournâmes longtemps. Le prince Edouard avait une résidence en ville et une maison hors des murs, où demeurait avec lui une dame inconnue. Le prince me témoignait de l’intérêt, me prenait dans ses bras et m’embrassait. Quand il passait devant notre maison, je courais à lui, et il m’emmenait promener. Plus d’une fois il envoya chercher le tailleur du régiment, et commanda des habits pour moi. C’était un homme d’une haute taille, d’une physionomie imposante, et qui portait une croix sur la poitrine.
Ma mère mourut probablement pendant que j’étais à Halifax, que mon père quitta quelque temps avant le prince. Le major Walter partit aussi pour l’Angleterre, laissant sa femme à la Nouvelle-Ecosse. Depuis je n’ai plus revu mon père. Ma sœur reçut un jour une lettre d’un ami de Québec, par laquelle on lui mandait que monsieur Meyers était mort dans un combat, et que nous devions faire valoir nos droits à son héritage. Néanmoins, nous n’avons jamais donné de suite à cette ouverture, et mon vieux compagnon Cooper pense que nos réclamations auraient été inutiles. Avant son départ, mon père nous avait mis en pension, Henriette et moi, chez M. Marchinton, ministre anglican, qui prêchait dans une chapelle dont il était propriétaire. Il prit soin de nous, et nous envoya tous deux à l’école.
J’étais encore en 1805 sous la tutelle de monsieur Marchinton ; ayant peu de goût pour le travail, mais en revanche une inclination prononcée pour la vie oisive et indépendante, je supportais impatiemment le joug du maître d’école et de l’homme auquel mon père m’avait confié. Sans avoir de légitimes griefs contre M. Marchinton, je trouvais sa discipline trop rigoureuse, sa morale trop sévère, ses ordres trop absolus. On ne pouvait me reprocher ni vices ni duplicité ; mais j’aimais à faire mes volontés, et tout enseignement religieux m’était à charge. Enclin à jouer et à courir les rues, je détestais M. Marchinton pour cela seul qu’il me retenait à la maison. Peut-être me traita-t-il avec trop de rudesse ; mais je crois devoir avouer que la nature m’avait doué d’une humeur inconstante et vagabonde.
À cette époque les croiseurs anglais envoyaient à Halifax un grand nombre de bâtiments américains qu’ils avaient capturés. Notre maison était située près du rivage, et je rôdais volontiers sur les quais toutes les fois que l’occasion s’en présentait. Je retrouvai un de mes condisciples du nom de Bowen, un peu plus âgé que moi ; il était aspirant à bord d’une frégate et chef de prise d’un brick chargé de café. Aussitôt que je sus l’arrivée de Bowen, je m’empressai de lui rendre visite. Il encouragea mes désirs naissants de devenir marin ; j’écoutai avec avidité le récit de ses aventures, et je sentis en moi s’éveiller une émulation juvénile. M. Marchinton semblait s’opposer à mes vœux, dont la ferveur redoublait en proportion des obstacles apparents qui s’opposaient à leur réalisation. Bientôt je commençai à grimper sur les gréements du brick et à monter jusqu’au haut des mâts. Un jour M. Marchinton m’aperçut à l’extrémité de la hune, et, m’ordonnant de descendre, il me tança vertement de mon agilité. Les punitions produisent parfois un résultat tout opposé à celui qu’on en attend ; c’est ce qui arriva en cette occasion. Les coups que m’avait administrés mon tuteur augmentèrent mes inclinations maritimes, et je me mis en tête de fuir, tant pour aller en mer que pour me soustraire à une réclusion qui me paraissait intolérable.
Mon projet d’évasion fut mis à exécution dans l’été de 1805 ; j’avais alors onze ans à peine. Un jour, au marché, j’entendis des matelots américains parler d’un schooner qui était sur le point de mettre à la voile pour New-York. Je jugeai l’occasion favorable, et me rendis immédiatement à bord du bâtiment. Le second était seul, et rassemblant mes forces, je lui demandai s’il avait besoin d’un mousse. Mon costume et mon extérieur étaient contre moi, car mes habits, qu’aucun travail n’avait détériorés, indiquaient une classe supérieure à la mienne. Le second se mit à rire, me plaisanta sur ma prétendue vocation, et m’interrogea sur mes connaissances. Voyant que j’avais produit peu d’effet, je recourus à la séduction. Le prince Edouard, avant de quitter Halifax, m’avait fait présent d’un beau petit fusil de chasse ; je dis au maître que je le lui donnerais s’il consentait à m’embarquer secrètement sur le schooner et à me conduire à New-York. Il mordit à l’hameçon, et me dit de lui faire voir cet objet ; je le lui apportai le soir même, et il en fut si enchanté, qu’il conclut le marché sur-le-champ. Je revins au gîte et réunis mes hardes. Je savais que ma sœur Henriette me faisait des chemises ; je me glissai dans sa chambre, j’en trouvai deux et je les emportai. Ma garde-robe n’était pas considérable ; j’en déposai les pièces une à une dans un tonneau vide, puis j’en fis un paquet que je portai à bord. Le second nettoya un équipet rempli de pommes de terre, et m’avertit qu’il fallait me résoudre à passer quelques heures dans cette étroite armoire.
Trop irréfléchi pour soulever des objections, j’y consentis avec joie, et pris congé de lui après m’être engagé à revenir le lendemain matin.
Au moment de me coucher, je priai un nègre, domestique de M. Marchinton, de me réveiller à la pointe du jour, sous prétexte que je voulais sortir et aller cueillir des fraises. Grâce à mon exactitude, je fus debout et habillé de pied en cap avant qu’aucun membre de la famille eût bougé. Sans perdre de temps, je quittai la maison et me rendis résolument à bord du schonner. Tout l’équipage dormait, et ce fut moi qui me chargeai d’éveiller le second. Il avait envie de rompre son engagement, et il me fallut employer toute mon éloquence pour le sommer de tenir sa parole. Il aurait voulu pouvoir rester maître du fusil de chasse sans favoriser ma fuite. Enfin il céda, et me cacha dans l’équipet sous un amas de pommes de terre.
Je demeurai longtemps dans ma désagréable position, avant que le bâtiment fît le moindre mouvement pour s’éloigner du quai. J’étais déjà las de ma réclusion, et l’amour du changement se ranimait en moi sous une nouvelle forme. Les pommes de terre me pesaient lourdement sur le corps, et le manque d’air m’exposait à l’asphyxie. J’allais sortir de ma prison, quand le bruit qui se faisait sur le pont m’annonça les préparatifs du départ. Au bout d’un intervalle qui me parut un siècle, je sentis au balancement du navire qu’il avait mis à la voile.
Il était midi lorsqu’on me délivra. En montant sur le pont, je vis le schooner en mer, et dans le lointain, le faîte de quelques édifices d’Halifax. A ce moment, je l’avoue, je me repentis de ma démarche, et si j’avais pu débarquer, mes dispositions à la vie errante se seraient assurément modifiées. Toutefois il était trop tard, et j’étais forcé de suivre le sentier épineux et difficile où je m’étais si aveuglément fourvoyé.
J’ai appris plus tard que M. Marchinton m’avait longtemps cherché ; il me croyait noyé, et fit draguer le port en plusieurs endroits pour y retrouver mon cadavre : ses inquiétudes furent dissipées par les nouvelles qu’il reçut de New-York.
A mon apparition sur le pont, le capitaine du schooner et le second échangèrent une multitude de plaisanteries. On se moqua de moi, mais sans me maltraiter. On me confia le soin de la cuisine et la préparation des aliments. La tâche n’était pas difficile, car le dîner se composait de bœuf ou de porc bouilli ; dans la cabine, on prenait du sassafras en guise de thé. Le premier jour, le mal de mer me dispensa d’entrer en fonctions ; mais le lendemain matin je me mis activement à l’œuvre. Pourtant notre traversée fut longue et peu agréable pour moi. Le schooner aborda vis-à-vis Fly-Market ; il était séparé du quai par deux ou trois autres bâtiments. L’heure du déjeuner était passée ; je me hâtai de faire les préparatifs du dîner, qui eut lieu comme de coutume, à midi. N’ayant rien à faire pendant que l’équipage prenait sa nourriture, je descendis à terre et débarquai pour la première fois dans ma nouvelle patrie. Je n’avais ni chapeau, ni habit, ni souliers ; mes pieds avaient été endurcis par l’habitude de marcher au milieu des lattes. Il y avait sur le quai plusieurs jeunes galopins occupés à voler adroitement de la mélasse dans des tonneaux. Je me mêlai à leur bande, et je partageai leurs ébats durant une heure entière, avant de songer que mon devoir me réclamait à bord. Je cherchai des yeux le schooner ; il était parti ! Le capitaine, me croyant à la cambuse, ne s’était pas inquiété de moi, et, trouvant le navire mal placé, il avait cherché un autre mouillage. Si j’avais bien assez su mon chemin pour suivre les quais, j’aurais infailliblement rejoint le schooner ; mais avec mon indifférence habituelle, je me contentai d’une courte recherche, et retournai bientôt à mes nouveaux camarades et à la mélasse.
Je ne me voyais pas sans une certaine émotion au milieu d’une ville étrangère, sans chapeau, sans habit, sans souliers, sans un sou vaillant ; mais on ne saurait s’imaginer à quel point j’étais exempt d’alarmes. Tout en savourant de la mélasse, je fis aux gamins un tableau de ma situation, et j’excitai au plus haut degré leur sympathie. Tous apprirent bientôt qu’un pauvre petit Anglais avait perdu son navire, et ne savait où passer la nuit. L’un d’eux me promit à souper ; et quant au logement, d’après l’opinion générale, j’en devais trouver un très commode sur un étal de boucher dans le marché voisin.
J’avais d’autres projets en tête. J’avais fréquenté à Halifax une famille du nom de Clark, qui habitait alors New-York ; peu de jours avant mon départ, j’avais entendu ma sœur Henriette parler des Clark, et dire qu’ils demeuraient près de Fly-Market. Je priai mes camarades de m’indiquer le domicile de cette famille ; mais elle était étrangère, et personne ne la connaissait. Je résolus de profiter des dernières clartés du jour pour la chercher dans la ville. Je marchais le long du marché, lorsqu’une voix de femme s’écria :
— Bah ! voilà Edouard Meyers à moitié nu !
Au même instant, Suzanne Clark, la fille aînée, s’élança dans la rue et m’entraîna dans la maison.
La famille m’accabla de questions, et je dis la vérité. Les Clark me traitèrent avec bonté, m’offrirent des habits, et voulurent me garder auprès d’eux ; mais je refusai. J’avais eu à Halifax plusieurs querelles avec les enfants, et j’avais à me plaindre du père, qui m’avait un jour injustement accusé d’avoir volé des fruits. M. Clark était en quelque sorte mon ennemi, et je n’étais venu chez lui que pour demander l’adresse d’un certain docteur allemand, nommé Heizer, qui avait servi dans le 23e régiment. Je savais qu’il était à New-York ; j’avais confiance en lui, et j’étais décidé à implorer sa protection.
Je pris congé des Clark, et, sans changer de costume, je me mis en quête de la maison du docteur. Je m’aventurai dans les rues, au clair de la lune, avec une hardiesse juvénile. On m’avait recommandé de suivre la Grand’rue jusqu’à ce que je rencontrasse un pont. Là, je pris des renseignements, et je n’eus plus que quelques pas à faire pour arriver à ma destination.
La famille Heizer fut stupéfaite de me voir ; je ne cachai au docteur aucune particularité de mes aventures. Je savais que la dissimulation serait inutile ; j’étais naturellement franc, et je commençais à sentir le besoin de me faire des amis. On me donna à manger, et le soir même le docteur et sa femme me menèrent chez un fripier et m’achetèrent un équipement complet. Au bout d’une semaine on m’envoya régulièrement à l’école. Le docteur Heizer, à ce qu’il paraît, ne communiqua point ce qui me concernait à son ami M. Marchinton ; ma sœur Henriette m’a dit depuis qu’on avait eu de mes nouvelles longtemps après et par une autre voie. Quoi qu’il en soit, je fus traité affectueusement et considéré sous tous les rapports comme un membre de la famille. M. Heizer, n’ayant point d’enfant, semblait me regarder comme le sien.
Je passai dans cette maison l’automne de 1805 et l’hiver et le printemps de 1806. Je ne tardai pas à me lasser de l’étude, et me mis à faire l’école buissonnière ; les quais étaient ma promenade favorite, et je restais des heures entières en contemplation devant les navires. Le docteur Heizer en fut averti, me surveilla, et reconnut que mon goût pour la marine n’avait en rien diminué. Assisté de sa femme, il me prit à part et tenta de me déterminer à retourner à Halifax ; mais je ne croyais pas devoir reculer ; plein de sombres pressentiments, je voyais en perspective des reproches, des coups, un long et rigoureux esclavage ; si la sévérité agit fructueusement sur certains caractères, il en est d’autres avec lesquels elle ne réussit jamais ; le mien était de ce dernier genre, car je crois plus facile de me mener que de m’entraîner ; je fus sourd à toutes les propositions du docteur, et après d’inutiles efforts il prit le parti de me laisser suivre mes penchants.