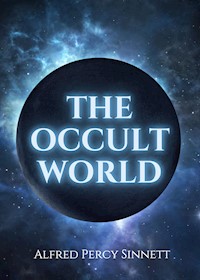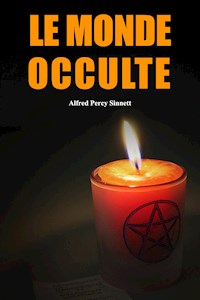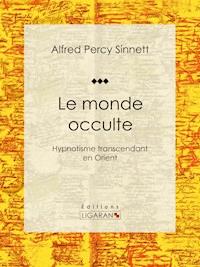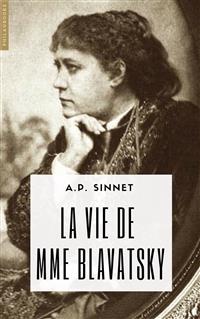
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Un biographie de Mme Blavatsky par un adepte de ses enseignements.
Alfred Percy Sinnett (1840-1921) a été un auteur anglais, très connu dans le monde de l’ésotérisme pour ses deux ouvrages principaux Le Monde occulte et Le Bouddhisme ésotérique, qui reprennent et synthétisent les enseignements qu’il dit avoir reçus des Maîtres de Sagesse entre 1880 et 1885 alors qu’il était journaliste aux Indes.
Mme Blavatsky et le colonel Olcott,rencontrèrent A.P. Sinnet en 1880.Ce dernier fut rapidement conquis par les idées de la Société théosophique et y obtint rapidement une certaine notoriété.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
La vie de Mme H.P. Blavatsky
Alfred Percy Sinnett
philaubooks
Table des matières
Préface
Introduction
1. Enfance
2. Mariage et voyage
3. Retour en Russie, 1858
4. Récit de Madame de Jelihowsky
5. Récit de Madame de Jelihowsky (suite)
6. Récit de Madame de Jelihowsky (suite)
7. De l’apprentissage à l’œuvre
8. Séjour en Amérique
9. Installation en Inde
10. Voyage en Europe
11. Appendice
12. Note de l’édIteur (édition Adyar, Paris, 1931)
Préface
Il y a, dans les pages qui vont suivre, tant de choses susceptibles de heurter les théories conventionnelles sur ce qui est possible, ou croyable, que je m’attends avec confiance à voir ce récit en butte aux railleries des écrivains qui attribuent aux ressources de la Nature les limites de leur propre expérience, et qui croient pouvoir mesurer les pouvoirs accessibles à l’humanité d’après le niveau d’un examen universitaire. Tout autour de nous, à Londres même, il se passe actuellement des phénomènes psychiques qui dépassent cette conception de la vie, et qui sont connus directement par des centaines de personnes — nous pourrions même dire des milliers, en comptant l’Angleterre entière. Ces personnes s’assemblent en groupes et en Sociétés, et s’amusent, ou s’affligent, selon les cas, de voir la multitude ignorante et obstinée ; celle-ci croit être à l’avant-garde de la civilisation et de la culture, et s’éloigne avec dédain de cette Connaissance, encore à son aurore pendant notre génération, qui est certainement, pour tous ceux qui savent l’apprécier, la plus sublime que puisse acquérir l’intelligence humaine. Cette attitude dédaigneuse peut venir de plusieurs tendances qui ne sont que trop répandues à notre époque : soit le matérialisme épais, qui ne peut voir dans la conscience qu’une fonction de la chair et du sang auxquels aboutissent tous ses rêves de plaisir et ses craintes de douleur ; ou l’aveuglement de l’intellect prosterné devant les succès de la science physique, très séduisants certes dans leur champ restreint ; ou enfin, une basse préférence à se laisser porter par le courant au lieu d’affronter le ridicule et les mépris de la foule, un désir humain de crier toujours comme la majorité.
Mais, pendant qu’ils affirment joyeusement leur supériorité en insultant les représentants du parti psychique, les partisans de l’incrédulité orthodoxe semblent négliger une pensée qui devrait pourtant, croirait-on, se présenter à leur esprit. Bien qu’ils évitent d’être raillés par la majorité, à quel point leur attitude doit-elle sembler absurde à cette minorité qui possède une connaissance personnelle de la vérité dont ils se rient.
Et à mesure que la révélation occulte fait des progrès, les rieurs s’embourbent de plus en plus. Ils s’endettent toujours plus envers la connaissance qui grandit ; et leur banqueroute finale n’en sera que plus humiliante. Au début, on leur demandait seulement de reconnaître qu’il s’était réellement passé des faits anormaux qui avaient besoin d’être expliqués. C’était une pluie qui ne tombait pas sur tous, justes et injustes, comme la pluie du ciel, mais pourtant si abondante qu’un esprit sensé, réunissant les témoignages de ceux qui en recevaient les gouttes, aurait vite dû être sûr, qu’en tout cas, elle tombait vraiment par endroits. Mais l’incrédulité était de mode, malgré sa sottise. C’était la profession de foi des opportunistes et des matérialistes et de tous ceux pour qui la religion est, par-dessus tout, une question de respectabilité. L’averse tomba plus pressée, mais de telles opinions, n’étant pas basées sur la raison, ne sont pas ébranlées par les faits. Le parti de découvertes psychiques devint plus fort chaque jour ; mais le grand public continuait à se laisser duper par ses chefs à l’esprit borné et vaniteux, incapables de reconnaître leur erreur. Jusqu’à ce jour, l’orgueil de tous ceux qui ont adopté une attitude d’incroyance envers les phénomènes psychiques les oblige à demeurer dans une position intellectuelle absurde : ils exigent des expériences personnelles, comme si à cette seule condition ils voulaient bien accepter d’étudier les observations faites par d’autres. Ils ont l’air de se figurer qu’ils sont les derniers représentants de leur propre folie, que lorsqu’ils se seront fait une conviction, les problèmes en jeu seront résolus, et que personne ne sera plus jamais aussi déraisonnable qu’ils le furent en leur temps.
Si les phénomènes isolés et irréguliers qui, pendant les trente dernières années, ont annoncé la découverte du psychisme, avaient été examinés avec le soin qu’ils méritaient, on aurait mieux compris les frappantes preuves de pouvoirs psychiques données par la vie de Mme Blavatsky pendant le dernier tiers de cette période. Quoi qu’il en soit, les livres sibyllins offerts au monde moderne, sans diminuer en nombre, augmentent de valeur, si cette valeur peut être mesurée d’après l’humiliation rétrospective qui doit accompagner leur acceptation finale. Mais certes, je n’ai pas la présomption de croire que les adeptes railleurs du système triomphant seront assez sages pour saisir l’occasion qui leur est offerte de trouver un terrain d’entente.
Ils vont encore railler, et traiter le récit sincère des incidents auxquels ce volume est consacré de... Mais je ne leur rendrai pas le service de chercher comment ils pourront traiter ce livre, et je veux appeler l’attention des lecteurs impartiaux sur une ou deux considérations importantes. Si ce récit est accueilli avec scepticisme, je défie n’importe quel critique d’expliquer par une hypothèse plausible le concours de témoignages sur lequel il s’appuie. Nous voyons les amis et les parents de Mme Blavatsky, pendant sa jeunesse, raconter les expériences continuelles de prodiges psychiques qui accompagnèrent son enfance. Nous voyons des amis de diverses nationalités avec qui elle fut en contact à des époques différentes, dans des parties du monde différentes, se porter garants des merveilles inouïes dont ils furent témoins. Nous retrouvons l’histoire de ses pouvoirs prodigieux dans les journaux russes, américains et hindous. Il serait enfantin de dire que tous ces témoins sont unis dans une conspiration de mensonge ; il serait frivole de penser qu’ils aient été victimes d’une hallucination, d’un sortilège jeté sur eux par l’héroïne de ce livre ; car il faudrait pour cela lui accorder des pouvoirs psychiques anormaux aussi grands que ceux qui seraient niés par cette théorie. Que faire dans cette impasse ?
Le problème est là, devant nous, dans ce livre — cet aperçu de la vie de Mme Blavatsky, appuyé sur de multiples garanties. Les critiques peuvent ne pas s’en occuper, passer à côté sans un regard, s’en moquer sans un effort de discussion — comme s’ils étaient ces pies rieuses des forêts d’Australie, bien connues des naturalistes.
Mais ils ne peuvent pas l’affronter loyalement sans admettre que la limite des choses possibles dans la Nature n’a rien à voir avec les codes de lois naturelles qui ont reçu l’imprimaturde l’opinion orthodoxe jusqu’à l’an 1886. La conviction que ce récit est vrai, dans l’ensemble, et même en faisant la part de l’erreur et de l’exagération, devrait s’imposer à n’importe quelle intelligence compétente. Et quant aux autres, lorsque la situation réelle sera reconnue, lorsque le monde entier aura appris que le plan psychique, avec ses lois et ses forces merveilleuses, est dans la Nature une grande et prodigieuse réalité — les pies rieuses d’alors riront toujours, et toujours avec la majorité ; mais pour changer, c’est l’absurde incrédulité de leurs prédécesseurs qu’elles railleront.
Londres, 1886
Introduction
Il est fort embarrassant de publier l’histoire de quelqu’un qui vit encore. Les événements d’une vie encore active sont forcément mêlés à ceux d’autres vies. Il faut à chaque instant tenir compte des susceptibilités, raisonnables ou non ; certains passages que l’on voudrait expliquer dans tous leurs détails, pour respecter les grands intérêts en jeu, doivent parfois être traités avec réserve, simplement parce qu’il faudrait pour cela parler de gens qui se refusent à toute publicité, ou qui veulent éviter les critiques auxquelles ils seraient exposés si l’on voulait rendre pleinement justice au personnage principal du tableau. Puis, si ce personnage principal lui-même, pour une raison quelconque, tient une place importante dans le monde, il peut déjà exister à son sujet des impressions hostiles. Il ou elle peut être tenu en grand respect par certains, et jugé par d’autres d’une façon toute différente ; et, dans ces conditions, il est difficile au biographe de rester neutre, comme le demande son rôle.
D’un autre côté, il est pénible de voir des êtres, devenus ainsi l’objet de discussions générales, continuer à être mal compris, alors que l’ensemble de leur vie, raconté avec impartialité, réfuterait abondamment les erreurs d’interprétation. Pourtant, on peut admettre aussi que ceux qui se consacrent au service d’une cause ou d’une idée vivent pour leur travail — qu’ils soient honorés toute leur vie, ou insultés par l’opinion publique ; — il leur suffit de savoir que leur œuvre vivra après eux ; et cette remarque s’applique pleinement à Mme Blavatsky. Parmi ceux qui ont joué un rôle dans le monde, il en est peu dont l’espoir personnel et les aspirations aient tendu à un tel point vers un but qui n’a rien de commun avec les applaudissements de leur époque. Mais, d’autre part, il en est un peu qui aient été en butte à des attaques aussi persistantes et aussi malveillantes que celles qui, depuis plusieurs années, se sont acharnées sur elle.
Peut-être, à voir les choses de haut, semble-t-il moins nécessaire d’essayer de prendre la défense de cette vie si remarquable, que lorsque des considérations humaines seules sont en jeu : en effet, elle a marqué d’une influence bienfaisante trop de cœurs et d’esprits pour rester longtemps noircie par l’hostilité de certains accusateurs, ou par les erreurs innocentes, mais stupides, des autres. Pourtant, un effort en ce sens en est d’autant plus justifié. D’abord, j’ai des raisons de croire que cet essai répondra au désir de tous ceux qui, en Angleterre et à l’étranger, sont profondément indignés par les attaques continuelles contre Mme Blavatsky. Une vie qui a pu attirer l’attention bien au-delà du cercle, déjà grand, de ceux qui s’intéressent aux pouvoirs psychiques anormaux, a été surveillée de près, on le comprendra facilement, dans ce cercle même. Depuis douze ans, Mme Blavatsky a vécu dans bien des pays et a connu personnellement bien des gens. Les uns l’ont mal comprise et mal jugée. D’autres, et j’ose affirmer qu’ils sont beaucoup plus nombreux, ont été profondément influencés par la hauteur de son idéal, par son dévouement à son œuvre, et par les pouvoirs qu’elle a acquis... Tous, j’en suis sûr, penseront que le moment est venu de faire connaître au public le récit de sa vie que contient ce volume. Enfin, soit par ses propres écrits, soit par ceux qu’elle a provoqués indirectement, Mme Blavatsky a exercé, sur les courants de pensée concernant les phénomènes hyperphysiques de la Nature, une influence qui s’est fait sentir bien au-delà du cercle où sa personnalité a été connue et discutée.
Ainsi, il est devenu nécessaire à tout étudiant des mystères de la Nature, à n’importe quel degré dans les recherches occultes, d’apprécier avec justice son caractère et l’histoire de sa vie ; et, en m’efforçant de contribuer à ce résultat, je sers des intérêts beaucoup plus importants que celui de sa justification personnelle.
De plus, il est utile de consigner dans un livre certains faits de l’existence de Mme Blavatsky pendant la vie de ceux qui peuvent parler avec autorité des événements de ses premières années, de la situation de sa famille et de sa vie privée. Les mémoires que je vais faire connaître sont fragmentaires et incomplètes, mais indiscutables en tant que documents. La plupart sont basés sur une intimité de toute la vie avec Mme Blavatsky ; les autres sont dus à des amis qui ont vécu et travaillé avec elle pendant de nombreuses années. En dehors des controverses irritantes, ce récit, j’en suis convaincu, excitera un intérêt durable, car il jette une grande lumière sur une carrière originale et remarquable, mêlée, pour ne pas dire plus, à certaines spéculations qui prennent une part de plus en plus importante dans la pensée mondiale. Et je crois avec confiance qu’en même temps ce livre prouvera l’absurdité ou la malveillance de bien des accusations qui furent répandues contre Mme Blavatsky dans la presse, ou par des scandales privés. Quelques-unes ont été ridicules au point de faire naître plus d’amusement que d’indignation parmi sa famille de Russie, et les amis intimes de ses dernières années. Mais d’autres, tout aussi mal prouvées, lui ont causé une douleur et une angoisse que méritait peu sa vie, errante peut-être, mais désintéressée au plus haut point, ardente et dévouée inlassablement à la recherche du plus haut idéal spirituel.
Les matériaux dont on se servira pour préparer le récit qui va suivre sont, on le verra, des déclarations orales et des lettres écrites par de proches parents de Mme Blavatsky qui la connaissent depuis son enfance, ou par d’autres personnes à qui il fut particulièrement facile d’entrer dans son intimité pendant ces dernières années. J’ai beaucoup puisé aussi, dans des articles parus pour la première fois, il y a quatre ou cinq ans, dans un périodique russe, et dus à la plume de la sœur de Mme Blavatsky, Mme Véra de Jelihowsky, écrivain russe bien connu, veuve d’un fonctionnaire civil qui fit autrefois partie du gouvernement de Tiflis. Elle avait épousé auparavant un officier de la Garde, à Saint-Pétersbourg, et s’appelait alors Mme de Yahontoff — nom qui paraîtra souvent dans les pages suivantes. Les articles que je mettrai à contribution étaient intitulés : « La Vérité sur H. P.Blavatsky », sur qui on racontait déjà des histoires extraordinaires. Ils contiennent un récit détaillé de ce qui se passa pendant deux années vécues par Mme Blavatsky chez Mme de Jelihowsky, et prouvé par différents témoins. Ces articles ont été récemment remis et corrigés par l’auteur, dans le but de servir à la publication que j’entreprends.
Le périodique russe dans lequel ces articles parurent, le Rébus, tenait beaucoup à certaines conceptions intransigeantes, en ce qui concerne l’origine et la cause des phénomènes qui y étaient étudiés. Pour cette raison le récit avait été abrégé à l’époque de sa publication ; mais l’auteur s’est efforcé cette fois de lui rendre autant que possible sa première forme, grâce au manuscrit original qu’elle avait conservé, et dont elle a pu tirer les passages qui manquent dans le périodique.
Le nom de Mme Blavatsky a été connu du public de langue anglaise pour la première fois en 1877 lorsqu’elle publia son très remarquable ouvrage Isis Dévoilée, appelé sur la couverture : « Clef des Mystères de la Science et de la Théologie anciennes et modernes ». Je parlerai plus tard de ce livre ; pour le moment je puis seulement remarquer que ce titre un peu trop sensationnel n’était pas celui que Mme Blavatsky lui avait d’abord destiné. Il devait s’appeler « Le Voile d’Isis, » titre incomparablement meilleur, et une grande partie de l’ouvrage fut imprimé avec ce nom en haut des pages. Mais avant que le livre entier ait été publié, on s’aperçut qu’un petit volume de peu d’importance avait porté le même titre quelques années plus tôt ; il fallut donc que Mme Blavatsky changeât le sien pour respecter les droits du premier auteur, et qu’elle en choisît un autre à la place, qui ne soit pas trop différent du titre déjà imprimé sur les pages du livre. Ainsi fut créé celui sous lequel son ouvrage fut connu, et dont le ton a choqué les critiques délicats.
Ce livre attira l’attention dans tous les milieux où l’intérêt envers les mystères psychiques s’élevait au-dessus du niveau, matérialiste ou conventionnel, et les journaux de New York à cette époque s’occupèrent beaucoup de la personnalité de l’auteur, d’autant plus qu’elle avait, peu de temps avant, fondé la Société Théosophique à laquelle son livre donna une nouvelle importance. Les débuts de cette Société en Amérique ne pouvaient guère faire prévoir l’extension remarquable qu’elle prendrait plus tard dans d’autres pays. Comme le but des articles qui furent écrits à cette époque dans les journaux américains sur Mme Blavatsky était simplement d’exploiter, en le raillant avec plus ou moins de sympathie, l’intérêt qu’éprouvait le public pour quelqu’un qui écrivait sur « La Magie », et sur le compte de qui circulaient d’étranges histoires, — ils exagérèrent tout ce qui pouvait donner une atmosphère merveilleuse, et, sans doute, ils sont responsables de bien des histoires absurdes sur l’âge de Mme Blavatsky, et sur ses dernières aventures. Mais, en vérité, il aurait été difficile à Mme Blavatsky de faire croire à son histoire sincère et sans fard. Le monde ne connaît pas grand-chose sur les initiations occultes actuellement, et encore moins il y a dix ou douze ans. La Société qu’elle créa était, en elle-même, un essai prudent pour faire connaître ces choses au public. Son but, du moins à un point de vue, était de faire comprendre peu à peu que la nature humaine contient réellement certaines possibilités de développement ; et, pour comprendre l’histoire que Mme Blavatsky y aurait racontée, si elle avait été absolument sincère sur son propre compte, aux premiers temps de son activité en Amérique, il aurait fallu reconnaître que ce but a été pleinement atteint par des hommes aux pouvoirs extraordinaires, comme ceux dont elle s’efforçait d’exécuter les ordres. Il est bien facile maintenant, lorsqu’on se reporte à la façon dont Mme Blavatsky lança son œuvre dans le monde, de critiquer ses actes. Nous voyons tous, grâce à l’expérience acquise depuis, que de nombreuses erreurs forment une longue chaîne ininterrompue jusqu’à une date très récente. Mais elles seront étudiées plus tard, autant qu’il sera nécessaire de le faire pour la clarté du récit. Notre premier but est de faire connaître au lecteur l’œuvre et la vie de Mme Blavatsky afin qu’il puisse mieux comprendre dès maintenant certains faits, qui seuls expliquent ce qu’il y a de troublant et d’inexplicable dans sa conduite.
Dans l’Inde, où alla Mme Blavatsky en 1879, accompagnée par le Colonel Olcott, elle fut rapidement célèbre. Souvent les journaux racontèrent ses exploits psychiques extraordinaires, vus par de nombreux témoins. La création de sa revue, le Theosophist, contribua à grandir la renommée de sa Société ; bien des Anglais, qui s’étaient consacrés de façon quelconque aux recherches psychiques ou spirites de l’époque, s’intéressèrent vivement à ses progrès ; et, en 1881, la publication de mon livre, Le Monde Occulte, donna une forte impulsion à la curiosité qui avait été soulevée autour d’elle. Pourtant, sa jeunesse et ses aventures restaient enveloppées d’un profond mystère qu’elle ne pouvait dissiper, soit qu’elle ne le voulût pas, soit qu’elle en fût empêchée par une autorité à laquelle elle obéit toujours implicitement.
L’aperçu à peu près complet de sa vie, qui va suivre, servira peut-être à faire comprendre les derniers épisodes qui ont attiré l’attention du public, mieux que des explications qui ne pourraient pas donner une vue d’ensemble ; et certes, les résultats de ses efforts pendant les dix dernières années sont tels qu’il faudrait ne pas connaître les faits pour refuser de voir dans sa vie une force qui a influencé le monde d’une façon assez remarquable pour justifier une étude sérieuse. Quelques mots sur la situation actuelle de la Société Théosophique dans l’Inde le montreront bien. La dixième fête anniversaire, ou Convention de la Société, eut lieu à Madras, en décembre dernier. À cette date, il existait cent dix-sept branches de cette Société, cent six dans l’Inde, à Burmah et à Ceylan, une en Angleterre, une en Écosse, une en France, une en Allemagne, six en Amérique, une en Australie, une en Grèce, une en Hollande, une en Russie, une dans les Indes Occidentales. Un Anglais, qui était présent, écrivait à un ami à Londres « Il y avait là environ quatre-vingts délégués, dont les uns avaient parcouru des milliers de kilomètres pour venir. Je fus très frappé par le caractère représentatif de ces hommes. Il y avait plusieurs juges, des avocats, des professeurs, des vice-présidents de Collège, et il y en avait peu qui ne possèdent pas des titres universitaires, semblables à ceux de l’Université de Londres. Presque tous les délégués conservent leur caste, et se marquent le front en conséquence. Si nous songeons que ces différentes castes ne se seraient jamais rencontrées sur aucune estrade avant l’arrivée de la Théosophie, nous pourrons apprécier l’action accomplie par la Société dans l’Inde. »
Ces grands résultats, sans doute, sont dus en grande partie à l’énergie inlassable du Président de la Société, le Colonel Olcott, mais il serait le dernier à refuser de reconnaître que tout vient, directement ou indirectement, de l’initiation de Mme Blavatsky ; et cela seul suffirait à donner de l’intérêt à sa vie, si elle n’avait pas par elle-même la valeur remarquable que nous lui trouvons. Mais en vérité, l’histoire que je vais raconter, sans parler des résultats philanthropiques qui lui sont attachés, est tellement pleine d’incidents merveilleux qu’aucun observateur sérieux des mystères de la Nature ne peut se permettre de passer outre. Parmi les mille et un faits extraordinaires qui ont suivi partout Mme Blavatsky, beaucoup ont été discutés dans des livres et des revues, et souvent, on s’est inconsidérément efforcé de supprimer les difficultés intellectuelles qu’ils entraînaient, en les attribuant à de la sorcellerie ou à une imposture. Les témoins n’ont jamais manqué ; et pour eux de telles hypothèses étaient intenables. En tout cas, lorsqu’on examine la vie de Mme Blavatsky à l’aide des documents que j’ai pu me procurer pour écrire ce volume, l’hypothèse d’imposture paraît insuffisante à expliquer l’histoire dans son ensemble, appuyée par un tel nombre de témoins, et n’est plus qu’un refuge pour les critiques de Mme Blavatsky dénués d’arguments.
C’est surtout pour cette raison qu’il m’a semblé nécessaire de faire paraître cette histoire sans délai. De courts passages, connus seuls, ont peut-être fait naître des idées fausses. Il est temps que le public puisse se demander à quel point ces idées sont possibles, à la lumière du récit relativement complet que je suis en mesure de lui présenter.
1
Enfance
L’oncle de Mme Blavatsky, le général Fadeef, me fit la déclaration suivante, sur ma demande, en 1881, à l’époque où il était Secrétaire d’État au Département de l’Intérieur, à Saint-Pétersbourg :
« Mme H. P.Blavatsky (exactement, Helena Petrowna Blavatsky), est, dit-il, du côté de son père, fille du colonel Peter Hahn, et petite-fille du général Alexis Hahn von Rottenstern Hahn (noble famille de Mecklembourg, en Allemagne, fixée en Russie) ; et, du côté de sa mère, elle est fille d’Hélène Fadeef et petite-fille du conseiller privé André Fadeef et de la princesse Hélène Dolgorouky. Elle est veuve du Conseiller d’État Nicéphore Blavatsky, anciennement vice-gouverneur de la province d’Erivan, Caucase. »
Mlle Hahn (nous emploierons ce nom en parlant de son enfance), naquit à Ekatérinoslav, dans le sud de la Russie, en 1831. La forme allemande exacte de son nom serait von Hahn, et les Russes, lorsqu’ils l’emploient en écrivant ou en parlant français, en font de Hahn, mais en russe la particule était généralement supprimée.
Je dois les détails suivants sur sa famille à quelques-uns des membres actuels de cette famille, qui se sont intéressés à cette étude :
« La famille von Hahn est bien connue en Allemagne et en Russie. Les comtes von Hahn appartiennent à une ancienne lignée du Mecklembourg. Le grand-père de Mme Blavatsky était un cousin de la comtesse Ida Hahn-Hahn, auteur fameux, dont les œuvres sont bien connues en Angleterre. Il se fixa en Russie où il obtint le titre de général, et mourut au service de ce pays. Il avait épousé la comtesse Proèbstin qui, après sa mort, se maria avec Nicolas Wassiltchikoff, frère du fameux prince du même nom. Le père de Mme Blavatsky quitta l’armée avec le rang de colonel après la mort de sa première femme. Il avait épousé en premières noces Mlle H. Fadeef, connue comme écrivain dans le monde littéraire, entre 1830 et 1840, sous le nom littéraire de Zénaïda R… C’est la première romancière qui ait écrit en russe ; et, bien qu’elle soit morte avant d’avoir vingt-cinq ans, elle laissa pourtant une douzaine de romans de l’école romantique, dont la plupart ont été traduits en allemand. En 1846, le colonel Hahn épousa sa seconde femme, la baronne von Lange ; elle lui donna une fille, appelée par Mme de Jelihowsky « la petite Lisa », dans les extraits suivants de ses écrits, publiés à Saint-Pétersbourg. Du côté de sa mère, Mme Blavatsky est la petite-fille de la princesse Dolgorouky, à la mort de qui la branche aînée de cette famille fut éteinte en Russie. Ses ancêtres maternels appartiennent donc aux plus vieilles familles de l’empire, puisqu’ils sont les descendants directs du prince (ou grand-duc) Rurik, premier souverain de la Russie. Plusieurs dames de cette famille appartenaient à la maison impériale, et sont devenues tzarines (czaritza) par mariage. En effet, une princesse Dolgorouky (Maria Nikitishna) épousa le grand-père de Pierre le Grand, le Czar Michel Fédorovitch, le premier des Romanof qui monta sur le trône ; une autre, la princesse Catherine Alexéevna, était sur le point de se marier avec le Czar Pierre II quand il mourut soudainement avant la cérémonie.
Une étrange fatalité semble avoir toujours poursuivi cette famille dans ses rapports avec l’Angleterre ; et ses plus grands malheurs sont liés d’une façon ou d’une autre à ce pays. Plusieurs de ses membres moururent, d’autres tombèrent en disgrâce politique, pendant qu’ils étaient en route pour Londres. La dernière de ces tragédies et la plus intéressante est celle qui arriva au prince Sergéey Gregoreevitch Dolgorouky, grand-père de la grand-mère de Mme Blavatsky, alors ambassadeur en Pologne. Lorsque l’archiduchesse Anne de Courlande monta sur le trône de Russie, plusieurs nobles des plus grandes familles furent emprisonnés ou exilés, pour avoir lutté contre son favori d’infâme mémoire, le chancelier Biron ; d’autres furent mis à mort, et leurs fortunes confisquées. Le prince Sergéey Dolgorouky eut un sort semblable. Il fut envoyé en exil à Berezof, en Sibérie, sans aucune explication, et sa fortune personnelle, de 200 000 serfs, fut confisquée. Ses deux enfants furent condamnés, l’aîné à être placé comme apprenti chez un forgeron de village, et le cadet à être envoyé à Azôf pour devenir simple soldat. Huit ans plus tard, Anne Iaxnovna rappela d’exil le père, lui pardonna, et l’envoya à Londres comme ambassadeur. Le prince, qui connaissait trop bien Biron, envoya à la Banque d’Angleterre 100 000 roubles qui devaient rester intacts pendant un siècle, capital et intérêts accumulés, pour être distribués après cette période à ses héritiers directs. Ses pressentiments ne l’avaient pas trompé. Il était en route pour l’Angleterre, et n’était pas encore arrivé à Novgorod lorsqu’il fut pris et écartelé (coupé en quatre). Lorsqu’ensuite l’impératrice Élisabeth, fille de Pierre le Grand, monta sur le trône, son premier soin fut de réparer les cruelles injustices commises par la dernière souveraine avec l’aide de son dur et rusé favori, Biron. Parmi d’autres exilés, les deux fils et héritiers du prince Sergéey furent rappelés, et leur fortune leur fut rendue. Mais au lieu de 200 000 serfs, il ne leur en restait plus que 8 000. Le cadet, après une jeunesse d’extrême misère et de souffrances, devint moine et mourut jeune. L’aîné épousa une princesse Romadanovsky et son fils, le prince Paul, bisaïeul de Mme Blavatsky, fut nommé colonel de la Garde par l’empereur, dès son enfance. Il épousa une comtesse du Plessy, fille d’un noble huguenot français, qui avait émigré en Russie. Son père avait eu un poste à la Cour de l’Impératrice Catherine II, et sa mère était la dame d’honneur favorite.
Au bout de la période de cent années, les 100 000 roubles avaient atteint de formidables proportions, le reçu de la Banque d’Angleterre pour cette somme avait été confié par un ami du prince assassiné par politique, au petit-fils de ce dernier, le prince Paul Dolgorouky. Celui-ci le conserva, avec d’autres documents de famille, à Marfovka, grand domaine familial dans le gouvernement de Penja, où le vieux prince vécut et mourut en 1837. Mais, après sa mort, ses héritiers cherchèrent le document en vain : il fut impossible de le trouver. Après bien des recherches, ils comprirent avec horreur qu’il avait été brûlé, en même temps que le château, dans un grand incendie qui avait détruit presque tout le village quelque temps auparavant. On avait laissé ignorer la perte du plus important de ses documents au vieux prince octogénaire, malade, et qui avait perdu la vue dans un accès de paralysie, quelques années avant sa mort. C’était un désastre, qui privait les héritiers des millions sur lesquels ils comptaient. Ils s’efforcèrent, à plusieurs reprises, de s’entendre avec la Banque, mais une erreur de nom avait été commise, et, naturellement, la Banque demanda le reçu qu’elle avait délivré vers le milieu du siècle précédent. En un mot, les millions furent perdus pour les héritiers russes. Ainsi, Mme Blavatsky avait dans les veines le sang de trois races : slave, allemande et française. »
L’année de la naissance de Mlle Hahn, 1831, fut une année terrible pour la Russie, comme pour toute l’Europe : c’est alors qu’apparut le choléra, ce terrible fléau qui, de 1830 à 1832, décima l’une après l’autre presque toutes les villes du continent, emportant une grande partie de la population. Sa naissance fut hâtée par plusieurs morts dans la maison. Elle entra dans le monde au milieu des cercueils et des larmes. Le récit suivant est tiré de souvenirs de sa famille.
« Son père était alors à l’armée, car la période paisible après la guerre russo-turque de 1829, était occupée à des préparatifs pour une nouvelle lutte. L’enfant, qui naquit pendant la nuit du 30 au 31 juillet, était faible, et ne semblait pas devoir vivre. On eut recours à un baptême hâtif, pour que l’enfant ne meure pas l’âme souillée du péché originel.
« La cérémonie du baptême dans la Russie « orthodoxe » est encombrée de tout un attirail de cierges allumés ; il y a des couples de parrains et de marraines, et chacun des spectateurs et des acteurs doit tenir des flambeaux de cire consacrée pendant tout le temps que durent les rites. De plus, chacun doit rester debout pendant le baptême, car nul ne doit s’asseoir durant la cérémonie religieuse, dans le culte grec, comme le font les catholiques romains ou protestants. On avait choisi une grande pièce dans la demeure familiale, mais la foule des fidèles qui tenaient à voir la cérémonie était encore plus grande. Derrière le prêtre, officiant au centre de la pièce, avec ses assistants aux robes dorées et aux longs cheveux, se tenaient les trois couples de parrains, tous les vassaux et les serfs de la maison. La plus jeune tante du bébé — qui avait seulement quelques années de plus que sa nièce, âgée de vingt-quatre heures — remplaçait une parente absente ; elle se tenait sur le premier rang, juste derrière le vénérable proto-pope. Comme elle était fatiguée d’être debout depuis près d’une heure, la petite fille s’installa par terre sans qu’on s’en aperçût, et, sans doute, s’assoupit par cette chaude journée d’été, et dans cette pièce pleine de monde. La cérémonie touchait à sa fin. Les parrains et marraines allaient renoncer à Satan et à ses œuvres ; et dans l’Église grecque, on accomplit cette renonciation en crachant trois fois sur l’ennemi invisible ; à ce moment, la petite fille, qui jouait avec son cierge allumé aux pieds de la foule, mit le feu par inadvertance aux longues robes flottantes du prêtre. On s’en aperçut trop tard. Il en résulta une conflagration immédiate ; plusieurs personnes, et surtout le vieux prêtre, furent gravement brûlées. C’était un deuxième mauvais présage, selon les croyances superstitieuses de la Russie orthodoxe ; et la future Mme Blavatsky, qui en était la cause innocente fut vouée, depuis ce jour, de l’avis de toute la ville, à une vie tourmentée, pleine de vicissitudes et de malheurs.
« C’est peut-être grâce à cette même appréhension que l’enfant fût choyée par ses grands-parents et par ses tantes ; elle fut très gâtée, et ne connut d’autre autorité que ses caprices et sa volonté. Dès ses premières années, elle vécut dans une atmosphère de légendes et d’imagination populaire.
« Aussi loin que peut remonter sa mémoire, elle crut fermement à l’existence d’un monde possible d’esprits superterrestres et subterrestres, et d’êtres mêlés inextricablement à la vie de chaque mortel. Le « Domovoy » (lutin de la maison) n’était pas imaginaire pour elle, pas plus que pour ses nourrices et ses bonnes russes. Ce propriétaire invisible, qui s’attache à chaque maison et à chaque bâtiment, qui veille sur les habitants endormis, qui se tient tranquille, qui travaille activement pour la famille pendant toute l’année, nettoyant les chevaux chaque nuit, brossant et nattant leurs queues et leurs crinières, protégeant les vaches et le bétail contre la sorcière, avec qui il est éternellement en lutte — ce bon lutin s’acquit les affections de l’enfant, de très bonne heure. Le Domovoy est à craindre seulement le 30 mars, le seul jour de l’année où, pour une raison mystérieuse, il devient malfaisant et excité ; il agace les chevaux, il frappe les vaches, les effraie et les disperse ; tout le monde dans la maison laisse tomber et brise tout, trébuche et tombe toute la journée, malgré toutes les précautions possibles. Les assiettes et les verres mis en miettes, la disparition inexplicable du foin et de l’avoine dans l’étable, les événements désagréables pour la famille, tout cela est mis sur le compte de l’agitation du Domovoy. »
« Seuls, ceux qui sont nés la nuit du 30 au 31 juillet sont à l’abri de ses fantaisies. Grâce à cette philosophie de la nursery russe, Mlle Hahn sut pourquoi ses serfs l’appelaient Sedmitchka, terme intraduisible, qui signifie « voué au nombre sept », et dans son cas, faisant allusion à ce fait que l’enfant était né le septième mois de l’année, la nuit du 30 au 31 juillet, date très remarquable en Russie dans les annales des croyances populaires aux sorcières et à leurs méfaits. C’est pourquoi on lui divulgua les mystères d’une certaine cérémonie faite en grand secret pendant des années par les nourrices et les autres domestiques, dès qu’elle sut comprendre l’importance de cette initiation. Elle sut, dès son enfance, pourquoi, ce jour-là, elle était transportée dans les bras de sa nourrice dans toute la maison, les étables et la laiterie, et pourquoi on lui faisait asperger d’eau les quatre coins elle-même, pendant que la nourrice répétait des phrases mystiques. On peut trouver tout cela, encore aujourd’hui, dans les lourds volumes de Sacharof : La Démonologie russe, ouvrage laborieux qui demanda trente années de voyages et de recherches scientifiques dans les vieilles chroniques des pays slaves, et qui valut à son auteur le titre du « Grimm de Russie1 ».
Née au cœur même du pays que la Roussalka (l’Ondine) a choisi pour habitation depuis le début de la Création, élevée sur les bords du bleu Dnieper, qu’un cosaque de l’Ukraine du Sud ne traverse jamais sans se préparer à la mort, l’enfant crut fermement aux belles nymphes à chevelure verte avant de connaître un autre enseignement. Le catéchisme de ses nourrices ukrainiennes pénétra jusqu’au fond de son âme ; et toutes ces croyances étranges et poétiques lui furent prouvées par ce qu’elle vit ou qu’elle crut voir autour d’elle dès sa plus tendre enfance. Dans sa famille, les plus vieux serviteurs se rappelaient des légendes en rapport avec ces croyances ; et elle exerça sur les siens une véritable tyrannie aussitôt qu’elle comprit le pouvoir que lui attribuaient ses nourrices. Les rives sablonneuses du rapide Dnieper, qui encercle Ekaterinoslav, et qui est bordé de saules, étaient sa promenade favorite. Une fois là, elle voyait une Roussalka dans chaque arbre, souriant et lui faisant signe d’approcher ; et, forte de son invulnérabilité grâce aux contes de ses nourrices, elle était la seule qui osât sans crainte aller près de ces rives. L’enfant connaissait sa supériorité et en abusait. Cette petite fille de quatre ans obligeait sa nourrice à lui obéir sans discussion, sinon elle la menaçait de se sauver au loin, et de laisser la nourrice, sans protection, risquant d’être chatouillée jusqu’à la mort par la belle et cruelle Roussalka, qui ne serait plus retenue par la présence de celle qu’elle n’osait pas approcher. Naturellement ses parents ne surent rien de l’éducation qui était donnée à ce sujet à leur aînée ; lorsqu’ils furent au courant, il était trop tard pour déraciner ces croyances dans son esprit. On songea à lui donner une gouvernante étrangère seulement après un événement tragique qui aurait pu passer inaperçu dans sa famille.
Un jour qu’elle était au bord de la rivière, un garçon de quatorze ans qui tirait sa voiture, lui déplut par une légère désobéissance. Elle cria : « Je vais vous faire chatouiller jusqu’à la mort par une Roussalka ! En voilà une qui descend de cet arbre... La voilà... Regardez, regardez ! » Quoi que l’enfant ait pu voir, il se mit à courir, et, malgré les ordres furieux de la nourrice, il disparut le long des rives sablonneuses vers la maison. La vieille nourrice, tout en grommelant, fut obligée de revenir seule avec sa jeune maîtresse, bien décidée à faire punir « Pavlik ». Mais on ne revit jamais vivant le pauvre garçon. Il courut jusqu’à son village, et, plusieurs semaines plus tard, son corps fut retrouvé par des pêcheurs dans leurs filets. On porta le verdict : « noyé par accident ». On pensa qu’en essayant de traverser des étangs peu profonds causés par les inondations du printemps, il était tombé dans un trou au milieu du sable, transformé en gouffre par le Dnieper rapide. Mais les nourrices et les domestiques de la maison, horrifiés, ne virent pas là une mort accidentelle ; ils déclarèrent que cela était arrivé parce que l’enfant avait retiré sa puissante protection au jeune garçon, et l’avait ainsi livré à quelque Roussalka qui le guettait. L’ennui de la famille devant ces contes fut aggravé par la coupable, qui confirmait gravement cette accusation, et qui déclarait qu’elle avait elle-même donné son serf désobéissant à ses servantes fidèles, les nymphes du fleuve. C’est alors qu’une gouvernante anglaise entra en scène.
Miss Augusta Sophia Jeffries ne croyait ni aux Roussalkas ni aux Domovoys ; mais ces qualités négatives ne suffisaient pas à lui conférer le pouvoir de diriger l’élève intraitable qui lui était confiée. Elle renonça à sa tâche, de désespoir, et l’enfant fut de nouveau abandonnée à ses nourrices jusqu’à l’âge de six ans, époque où elle alla vivre chez son père, avec sa plus jeune sœur. Pendant les deux ou trois années suivantes, ce furent surtout des soldats, les ordonnances de leur père, qui prirent soin des petites filles ; l’aînée, en tout cas, les préférait de beaucoup à ses servantes. Elles allaient voir les soldats de leur père, et partout on les choyait comme des : enfants du régiment.
Mlle Hahn perdit sa mère pendant son enfance, et à l’âge de onze ans environ, elle fut entièrement confiée à sa grand-mère, et alla vivre à Saratov, où son grand père était gouverneur civil après avoir exercé la même charge à Astrakan. Elle raconte qu’à cette époque elle était alternativement dorlotée et punie, et qu’un système uniforme n’y aurait pas suffi. De plus, sa santé était faible pendant son enfance ; comme elle le dit elle-même, elle était « toujours malade et mourante » ; elle était somnambule, et elle avait déjà des pouvoirs psychiques. Ses nourrices, fidèles orthodoxes de l’Église grecque, la croyaient possédée par le démon, si bien que pendant son enfance, comme elle le raconte souvent, l’eau bénite dont on l’inonda aurait pu faire flotter un vaisseau, et les prêtres qui l’exorcisèrent produisirent sur elle autant d’effet que s’ils avaient raisonné avec le vent.
Quelques notes sur son enfance m’ont été données, pour cet ouvrage, par sa tante qui, ainsi que Mme de Jelihowsky, m’est connue personnellement, à moi et à d’autres amis de Mme Blavatsky, en Europe. Son caractère, étrangement excitable encore maintenant, se fit jour dès son enfance. Dès cette époque elle fut en proie à des accès de colère désordonnés, et elle montra une vive disposition à se révolter contre toute sorte d’autorité. Mais elle avait des mouvements impulsifs de chaude affection qui lui gagnèrent le cœur de ses proches pendant son enfance, et qui, plus tard, devaient calmer ses amis lorsqu’ils étaient irrités par son manque de sang-froid dans la vie pratique. L’auteur du mémoire que j’ai sous les yeux dit avec raison : « Elle n’a aucune malveillance, aucun ressentiment durable même envers ceux qui lui ont fait du mal, et la profonde bonté de son cœur efface les traces de son trouble d’un instant. »
« Mme, Nous qui connaissons bien Mme Blavatsky », écrit sa tante, parlant d’elle-même, et d’une autre parente qui l’aida à préparer les notes que je cite, « Nous qui la connaissons maintenant qu’elle est âgée, nous pouvons parler d’elle avec autorité, et non par ouï-dire. Dès sa première enfance, elle fut différente des autres.