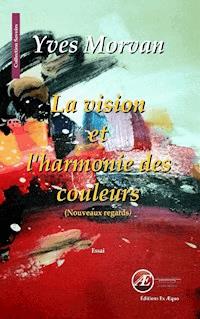
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Ex Aequo
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Savoirs
- Sprache: Französisch
Contestation et défense de la tyrannique " loi des complémentaires".
Il semble que la question de l’harmonie colorée, pour les théoriciens, les enseignants et les spécialistes des sciences humaines, ait été réglée, une fois pour toutes, par Chevreul au XIXème siècle. Du moins, pour la plupart d’entre eux, car quelques auteurs contestent, à juste titre, la validité de la tyrannique « loi des complémentaires » de Chevreul, tandis que d’autres la défendent. Cet essai tente d’en finir avec les différentes opinions en proposant un modèle unique d’harmonie. Valable dans tous les cas d’associations de couleurs, ce nouveau modèle est basé sur la dualité des couleurs complémentaires.
Découvrez un essai qui, pour en finir avec les différentes opinions concernant la loi de Chevreul, propose un modèle unique d'harmonie.
EXTRAIT
Puisque chacun de nous est à la fois semblable et différent des autres, que vaut-il mieux développer en nous ? Les qualités qui nous rapprochent, ou bien celles qui nous éloignent ? Voilà posée la question de l’artisanat et de l’art.
Le domaine des inventions plastiques, qui est celui de l’artiste créateur, restera, en principe, hors du propos de cette étude. Cependant, il sera parfois abordé pour mieux faire comprendre ce qui sépare l’artiste de l’artisan, l’œuvre d’art de l’œuvre artisanale ; quoiqu'en réalité, les critères de l’artisanat et de l’art soient, le plus souvent, associés et complémentaires.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Professeur agrégé d’Arts Plastiques, Yves Morvan, né le 13 janvier 1932 à Uzel (22) est également restaurateur d’œuvres d’art, agréé par les Monuments Historiques (médaillé de l’Académie d’Architecture de Paris) et auteur de nombreuses publications.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Résumé
La vision et l’harmonie des couleurs
Résumé
Il semble que la question de l’harmonie colorée, pour les théoriciens, les enseignants et les spécialistes des sciences humaines, ait été réglée, une fois pour toutes, par Chevreul au XIXème siècle. Du moins, pour la plupart d’entre eux, car quelques auteurs contestent, à juste titre, la validité de la tyrannique « loi des complémentaires » de Chevreul, tandis que d’autres la défendent.
Cet essai tente d’en finir avec les différentes opinions en proposant un modèle unique d’harmonie. Valable dans tous les cas d’associations de couleurs, ce nouveau modèle est basé sur la dualité des couleurs complémentaires.
Professeur agrégé d’Arts Plastiques, Yves Morvan, né le 13 janvier 1932 à Uzel (22) est également restaurateur d’œuvres d’art, agréé par les Monuments Historiques (médaillé de l’Académie d’Architecture de Paris) et auteur de nombreuses publications.
Yves Morvan
La vision
Et
l’harmonie des couleurs
(Nouveaux regards)
Essai
ISBN : 978-2-35962-7267-5
Collection : Les savoirs
Dépôt légal mai 2015
© couverture Ex Aequo
© 2015 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays. Toute modification interdite.
Éditions Ex Aequo
6 rue des Sybilles
88370 Plombières les bains
www.editions-exaequo.fr
SOMMAIRE
PRÉFACE11
INTRODUCTION13
PREMIÈRE PARTIE17
LA VISION DES COULEURS17
Chapitres de 1 à 617
CHAPITRE 1 / L’HOMME STANDARD ET L’ARTISTE19
1.1 - ESPÈCE HUMAINE ET OBSERVATEUR STANDARD20
1.2 - ART ET SCIENCES - ARTISTES ET ARTISANS21
CHAPITRE 2 / LA LUMIÈRE BLANCHE25
2.1 - LA LUMIÈRE AVANT LA VISION26
Les courbes de sensibilité de l’œil humain : voir planche I27
2.2 - LUMIÈRE INCIDENTE ET LUMIÈRE RÉFLÉCHIE30
2.3 – LE PRINCIPE DE COMPLÉMENTARITÉ31
2.4 BUT DE LA VISION32
CHAPITRE 3 / VISION ET PERCEPTION34
3.1 - DIFFÉRENCE ENTRE VISION ET PERCEPTION34
3.2 - VISION COURANTE ET VISION FIXE36
Vision courante38
Vision fixe39
3.3 – LES LIMITES DU SYSTÈME VISUEL40
3.4 - UNITÉ ET DOMINANCE43
3.5 – AUTRES PRINCIPES DU VIVANT46
CHAPITRE 4 / LA COULEUR49
4.1 - DUALITÉ DE LA COULEUR50
Le principe de rétroaction négative54
4.2 - DIRE QU’UNE FLEUR EST ROUGE…56
4.3 - COULEUR ET SENSATION COLORÉE58
Surfaces et sensations colorées61
Vitesse et sensation colorée63
Couleurs chaudes et couleurs froides64
4.4 – SATURATION ET DÉSATURATION65
4.5 - COULEURS BLANCHES ET COULEURS NEUTRES67
Jokers, fatigue et zone de repos71
4.6 - COULEURS EN SOI (IN SE) ET COULEURS EN SITUATION (IN SITU)73
4.7 – LES COULEURS NÉGATIVES75
CHAPITRE 5 / LES VOIES OPTIQUES77
5.1 - DE L’ŒIL AU CERVEAU78
5.2 - L’ŒIL79
La rétine80
Les pigments photosensibles83
La fovéa84
Les ganglionnaires85
Le nerf optique86
5.3 - LE CERVEAU87
Spécificités du cerveau89
5.4 – LES LIMITES DU CERVEAU ET PRINCIPE D’UNITÉ90
CHAPITRE 6 / LES MÉCANISMES DE LA VISION93
6.1 - ÉQUILIBRE - ÉGALITÉ - ÉQUITÉ94
6.2 - SIMULTANÉITÉ ET SUCCESSION96
6.3 – FATIGUE, RÉGULATION ET CONFORT VISUEL98
6.4 - L’ŒIL COMPARE101
6.5 - ACCOMMODATION ET ACUITÉ VISUELLE102
6.6 – LES MOUVEMENTS OCULAIRES108
Le micronystagmus109
DEUXIÈME PARTIE111
L’HARMONIE DES COULEURS111
CHAPITRES DE 7 À 12111
CHAPITRE 7 /PLAISIR ESTHÉTIQUE113
ET PLAISIR ARTISTIQUE113
7.1 - PLAISIR ESTHÉTIQUE114
7.2 - PLAISIR ET BEAUTÉ115
7.3 - ART ET HARMONIE115
Le décalage117
7.4 - BONHEUR ET LIBERTÉ118
7.5 - INTENSITÉ DU PLAISIR119
7.6 - GOÛTS ET MODE121
CHAPITRE 8 / LE MÉLANGE DES COULEURS125
8.1 – NOTIONS ET TECHNIQUES DE BASE126
8.2 – COULEURS PRIMAIRES ET BINAIRES126
8.3 - COULEURS COMPLÉMENTAIRES128
Les complémentaires indirectes131
8.4 – TRICHROMIE ET TETRACHROMIE133
Cercle et étoile chromatiques135
8.5 - MÉLANGES DES COULEURS138
Synthèses additive, soustractive et mixte138
Mélange et juxtaposition140
Mélange pigmentaire140
Mélange optique140
Glacis et transparence142
8.6 - DIVISIONNISME ET PIXÉLISATION144
8.7 - LE GRISAILLEMENT DES IMPRESSIONNISTES145
CHAPITRE 9 / DÉFI ET DÉFINITIONS DE L’HARMONIE149
9.1 - DÉFINITIONS CLASSIQUES150
9.2 - NOTRE DÉFINITION DE L’HARMONIE COLORÉE153
9.3 - LE DÉFI – RECHERCHE DE L’UNITÉ155
L’unité nécessaire156
La variété nécessaire et variation157
9.4 - SOLUTION : LA DOMINANCE158
9.5 - TRIADE PRIMAIRE, INTERVALLES ET DÉCALAGE160
CHAPITRE 10 / SOLUTIONS DU PEINTRE ET RECETTES D’ATELIER165
10.1 - CONTRASTE ET UNITÉ166
10.2 - CONTRASTE ET SURFACES167
10.3 - CONTRASTE ET SATURATIONS168
10.4 - CONTRASTE DE TEINTES170
10.5 - CONTRASTE DE TONS171
10.6 – CONTRASTE, NEUTRALITÉ ET JOKERS172
10.7 - CONTRASTE ET IMAGES SUBJECTIVES175
10.8 - CONTRASTE CHAUD ET FROID177
10.9 - CONTRASTE ET ÉGALISATION178
10.10 - CONTRASTE ET MODÉRATION180
CHAPITRE 11 / LA CLÉ DE L’HARMONIE COLORÉE185
11.1 - NOTRE PARADIGME186
11.2 - LA GÉNIALE FORMULE DE SAINT AUGUSTIN189
11.3 - SOLUTIONS DU PEINTRE191
11.4 - LE RÔLE DU PEINTRE194
11.5 - POURQUOI NOUS AIMONS LES IMAGES202
CHAPITRE 12 / HARMONISATION PRATIQUE205
12.1 - GÉNÉRALITÉS - LE SENTIMENT D'HARMONIE206
12.2 - CAS D’UNE COULEUR ISOLÉE208
12.3 - HARMONISATION DE DEUX COULEURS ET PLUS212
12.4 - HARMONISATION DES CONTRAIRES216
12.5 - HARMONISATION DES SEMBLABLES217
12.6 - HARMONISATION DES BINAIRES220
12.7 - POLYHARMONIE222
TROISIÈME PARTIE223
HISTOIRE DES ERREURS223
CHAPITRES 13 ET 14223
CHAPITRE 13 / LES « ERREURS COMPÉTENTES »225
13.1 - « ERRARE HUMANUM EST… »226
13.2 - POUR EN FINIR AVEC LES IMAGES NÉGATIVES227
Nature de l’image négative227
Observation N°1 : un carré rouge sur fond blanc (pl. III)228
Observation N°2 : un carré rouge sur fond vert (pl. III)228
Observation N°3 : un carré blanc sur fond rouge (pl. III)230
Formation du halo : (fig. 3 et fig. 6)231
Le rôle de l’image négative235
L’affaire Delorme237
Micronystagmus et acuité visuelle238
13.3 - POUR EN FINIR AVEC LES COMPLÉMENTAIRES241
Le paradigme de Chevreul247
13.4 - RAPPEL DE QUELQUES AUTRES ERREURS250
Hommage à Sutter253
CHAPITRE 14 / LUMIÈRE BLANCHE ET LUMIÈRE NOIRE257
14.2 - RECHERCHE DE LA LUMIÈRE BLANCHE260
14.3 - L’ERREUR FONDAMENTALE : LA LUMIÈRE NOIRE265
14.4 - RAPPEL DU VRAI BUT DE LA VISION269
14.5 - LES ERREURS FÉCONDES272
CONCLUSION GÉNÉRALE274
PRÉFACE
La couleur est double en elle-même. Elle comporte une partie dominante visiblement colorée et une partie opposée minoritaire et invisible, en complément. L’harmonie est l’accord parfait entre ces deux parties asymétriques. Le rôle joué par la partie minoritaire par rapport à la partie dominante est au cœur du sentiment d’harmonie.
D’après et depuis Chevreul, le modèle type dit « harmonie des couleurs complémentaires » exige la présence simultanée de deux couleurs opposées et de forces égales, capables, en théorie, de reconstituer la lumière blanche. Ce modèle d’harmonie, dont la validité n’a jamais pu être établie malgré les efforts des théoriciens et des peintres, est pourtant toujours enseigné.
Nous proposons un nouveau modèle d’harmonie valable dans tous les cas de couleurs (isolées ou associées), modèle basé non plus sur la reconstitution de la lumière blanche, mais sur la dualité de la couleur.
L’étude présente trois parties :
La première partie traite des problèmes de vision des couleurs (chapitres de 1 à 6).
La deuxième traite du problème d’harmonisation des couleurs (chapitres de 7 à 12).
La troisième, qui précède une brève conclusion générale, analyse les causes des erreurs commises principalement par Chevreul et ses suiveurs (chapitres 13 et 14).
INTRODUCTION
« Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l’une et l’autre dispensent de réfléchir ».(H. Poincaré, « La Science et l’Hypothèse » 1902).
« Le vrai point d’honneur n’est pas d’être toujours dans le vrai. Il est d’oser, de proposer des idées neuves, et ensuite de les vérifier ». (Pierre-Gilles de Gennes).
* * *
Des scientifiques, des artistes et des théoriciens ont émis des idées sur les associations des couleurs, agréables ou non.
Leurs points de vue ne sont que partiels ou contradictoires, ce qui les conduit souvent à la conclusion qu’il est impossible de trouver une clé universelle de l’harmonie colorée.
Pourtant, « tout en niant la possibilité des lois et des règles d’harmonie, tous ont essayé de les découvrir » (Borissavliévitch, « Les théories de l’architecture ». Paris. Payot. 1951. p. 354).
Mais, « la neurophysiologie progresse à pas de géant (…). Des aspects subtils de la vision (…) commencent à trouver des explications scientifiques satisfaisantes, sinon complètes et définitives ». (Libero Zuppiroli, « Traité des couleurs » Lausanne. 2011. p. 196).
« Pourquoi une certaine combinaison des couleurs nous plaît-elle et pourquoi telle disposition nous laisse-t-elle froids ou même nous choque-t-elle un peu ? Voilà des questions auxquelles nous ne pouvons pas toujours répondre ». (Rood, « Théorie scientifique des couleurs ». Paris. Alcan. 1895. p. 246).
Les scientifiques ne répondent pas à toutes nos questions et encore moins si ces questions touchent les problèmes de l’harmonie des couleurs. Il faut avouer que la démarche esthétique qui s’attaque depuis toujours à ces problèmes n’a guère avancé. Les nombreuses recettes d’atelier et les multiples définitions qui tentent de cerner la question de l’harmonie colorée sont toujours discutées parce que discutables. Elles sont peu claires, dogmatiques, voire contradictoires, malgré un certain consensus sur quelques points précis.
Le but de cette étude est de faire en sorte que la construction d’une harmonie colorée puisse s’enseigner en devenant une science autant qu’un art.
* * *
Nous ne nous attarderons pas sur les problèmes de vision des couleurs déjà développés dans de nombreux traités techniques mais nous insisterons sur les points restés flous ou simplement négligés.
En effet, trop de questions sont restées jusqu’ici sans réponse, trop d’explications pourtant pertinentes sont restées sans explication scientifique. Trop de « il serait préférable de… », « il est conseillé de… », ou bien « fiez-vous à votre intuition ou à votre instinct ». Trop de théories et trop peu de théorèmes, trop de bonnes intentions qui conduisent à l’enfer du découragement. C’est pourquoi, au cours de cette étude, certaines idées reçues, héritées d’enseignements académiques anciens ou de théories dépassées datant du XIXe siècle seront examinées sous un nouvel angle. Certaines seront nuancées, d’autres condamnées, d’autres encore seront approuvées et expliquées.
Pourtant, la plupart des connaissances scientifiques sont fiables et abondantes. Elles constituent les éléments d’un puzzle à reconstituer. Mais de nombreuses pièces font encore défaut ou sont inutilisables, car provenant de tradition d’atelier sans valeur scientifique. En effet, trop de recettes ont indûment acquis force de loi, tandis que de judicieuses observations sont encore considérées comme sans grand intérêt, voire comme des curiosités de la vision. Ici, certaines « bizarreries » ou « anomalies » du système visuel injustement écartées retrouveront toute l’importance qu’elles méritent. D’autres phénomènes aux conséquences exagérément valorisées reprendront leur juste place.
C’est le propre des théoriciens d’émettre des hypothèses de travail. On ne peut donc leur en vouloir de se tromper quelques fois. Mais les erreurs sont faites pour être corrigées. C’est ainsi que les théories opposées finissent par s’accorder. Sans avoir ni la rigueur du savant, ni l’intuition et l’expérience du peintre, le théoricien est parfois amené à émettre des avis qui ne satisfont ni le savant ni le peintre.
C’est pourquoi nous nous abstiendrons d’entrer dans le dédale de nombreuses théories et nous ne retiendrons que les propositions pour lesquelles une justification scientifique ou logique existe.
L’histoire nous confirme que bien souvent avant les théoriciens, les peintres avaient raison. C’est pourquoi nous avons privilégié l’avis des peintres plutôt que celui des théoriciens. « Depuis les temps les plus reculés, les véritables professionnels de la couleur ne furent jamais les scientifiques, mais les artisans et les artistes ». (Libero Zuppiroli, op. cit. p. 149).
Pour arriver à proposer des règles indiscutables d’harmonie colorée, il nous reste, concernant l’appareil visuel et ses mécanismes, à éclaircir quelques points, à exploiter quelques faits d’observation et aussi, à corriger quelques erreurs.
* * *
Tout comme le disait Alexandre Vialatte, à propos d’un autre sujet, « j’ai l’immense avantage de ne pas faire autorité ». Il nous fallait donc nous entourer de toutes les précautions scientifiques, à travers de nombreuses citations d’auteurs compétents, afin d’assurer la validité de chacune des pièces de notre puzzle.
* * *
Dans la première partie de cette étude, nous emploierons le mot harmonie dans le sens général et unanimement approuvé de sensation ou sentiment agréable à l’œil et à l’esprit, sans autre précision.
Loin d’adhérer aux suggestions de la plupart des auteurs, nous refusons d’envisager des règles d’harmonie colorée spécifiques pour les cas simples et d’autres règles pour les cas complexes ; des règles pour les artisans, et d’autres pour les artistes ; des règles pour les couleurs opposées, et d’autres pour les couleurs semblables, etc.
Plus d’exceptions, plus de tabous ou d’interdits. Toutes les couleurs pourront s’harmoniser entre elles, grâce à une seule formule, un seul principe pour une infinité de solutions. Le tout exprimé en des termes simples, pour être compris de tous, l’écolier, l’étudiant, l’enseignant, l’artisan et l’artiste.
Nous envisageons un seul et unique modèle valable pour tous les cas d’association de couleurs quelles qu’elles soient. C’est le but ambitieux que nous nous sommes fixé.
PREMIÈRE PARTIE
CHAPITRE 1 / L’HOMME STANDARD ET L’ARTISTE
« Il y a peu de différences entre un homme et un autre, mais c’est cette différence qui est tout » (W. James. Philosophe).
1.1 - ESPÈCE HUMAINE ET OBSERVATEUR STANDARD
« L'espèce humaine est l’une des plus homogènes qui soit (…). D’un humain à l’autre, il existe peu de diversité génétique. Nous sommes semblables à 99,5% ». (B. Jourdan. Sciences et Avenir Avril 2008).
Nous avons tous le même bagage génétique et le même système visuel. D’un individu à l’autre, les écarts sont considérés par les spécialistes comme pratiquement négligeables. La notion d’homme - espèce, opposée à celle d’homme - individu, conduit à la notion d’homme - moyen qui autorise les études scientifiques basées sur les statistiques. Mais les sciences exactes ne s’intéressent qu’à l’homme normal ou normalisé, privé de sa part de différences, et dont le système visuel est réduit à l’aspect objectif, physique et mesurable. Tandis que les sciences humaines s’intéressent davantage à la part psychologique, subjective, difficilement mesurable, qui découle de la différence qui existe entre l’homme - genre ou espèce, et l’homme – individu ; car si tous les hommes voient de la même façon, tous ne voient pas la même chose.
Cette notion d’œil moyen conduit à la notion d’homme standard ou observateur de référence, personnage fictif représentant la moyenne des sujets normaux.
De petites différences permettent d’évoquer la notion du goût, donc des préférences individuelles qui, éminemment subjectives, ne condamnent cependant en rien les conclusions objectives des sciences exactes, ni les conclusions statistiques des sciences humaines.
Il faut donc distinguer la vision de l’observateur standard, qui est celle du plus grand nombre, de la vision extra-ordinaire qui constitue la part variable, fonction de la personnalité, de la sensibilité et du vécu socioculturel des individus. Cette part est loin d’être négligeable. Car « ce 0,5% rapporté à trois milliards d’instructions contenues dans notre ADN, représente 15 milliards de différences ». (Jourdan, ibidem). Ces 15 milliards de différences représentent un espace de liberté dont l’artiste créateur saura profiter.
Mais l’artisan dont la clientèle est surtout composée d’individus moyens ou standards, tout comme lui-même, restera plus ou moins attaché aux lois biologiques du plus grand nombre et prisonnier des limites physiologiques de son système visuel, limites dont l’artiste cherche précisément à se libérer.
* * *
« Le biologique, c’est ce qui est universel dans l’homme. Le psychique, c’est ce qui est individuel (…) votre psychisme est différent du mien. Le psychisme c’est ce qui est subjectif. (Mais) les dimensions du subjectif ne sont pas appréciables par des machines. (Et pourtant), la science voudrait bien s’approprier l’étude de la subjectivité avec ses outils et ses techniques ». (E. Zarifian. Sciences et Avenir Juillet 2005).
1.2 - ART ET SCIENCES - ARTISTES ET ARTISANS
« Je crois que l’art est la seule forme d’activité par laquelle l’homme en tant que tel se manifeste comme véritable individu ». (Marcel Duchamp).
« Un art neuf ne peut naître que de la destruction et de la provocation ». (Max Ernst).
« L’art naît de contraintes, vit de luttes et meurt de liberté ». (André Gide).
« Mais non, Monsieur Monet (…) les ombres dans la nature ne sont pas bleues, les gens ne sont pas violets … et votre grand mérite est justement de les avoir peints ainsi. » (Signac).
* * *
Puisque chacun de nous est à la fois semblable et différent des autres, que vaut-il mieux développer en nous ? Les qualités qui nous rapprochent, ou bien celles qui nous éloignent ? Voilà posée la question de l’artisanat et de l’art.
Le domaine des inventions plastiques, qui est celui de l’artiste créateur, restera, en principe, hors du propos de cette étude. Cependant, il sera parfois abordé pour mieux faire comprendre ce qui sépare l’artiste de l’artisan, l’œuvre d’art de l’œuvre artisanale ; quoiqu'en réalité, les critères de l’artisanat et de l’art soient, le plus souvent, associés et complémentaires.
Il serait dangereux de réduire l’artisanat à la répétition de modèles inventés par les artistes. La réalité appartient aux deux catégories et permet à l’artisan d’être parfois artiste. De même, un artiste qui ne se renouvelle pas devient son propre artisan, répétant tout au long d’une carrière le même modèle à succès devenu à la mode.
Il est vrai que pour l’artisan qui doit séduire le plus grand nombre de futurs clients, la recherche du beau - tel qu’il est perçu par la majorité de ses contemporains - est essentielle à la réussite de son entreprise. Les critères de succès de l’artisan, beauté, rendement, utilité éventuelle, respect du contexte social, sont des notions complètement étrangères à l’artiste. Ces critères de réussite commerciale posent des limites à l’artisan. Celui-ci est-il donc condamné à rester prisonnier du contexte socioculturel de son époque ?
Non, heureusement, car « au-delà du corps (…) le cerveau humain peut s’extraire du déterminisme biologique ». (E. Sender. Sciences et Avenir septembre 2007). L’homme peut repousser, voire abolir complètement ces limites. Et c’est ce qui permet à l’artiste de découvrir d’autres mondes.
L’artisan s’en tient à ses facultés d’homme - espèce, d’homme moyen. Qu’il soit artisan, artisan d’art, ou même Meilleur Ouvrier de France, il copie, adapte, reproduit. Il ne fait que répéter, souvent en virtuose d’ailleurs, ce qui a déjà été découvert par les artistes qui l’ont précédé. Il reste un élève, un suiveur, un épigone. L’artisan qui vit de son travail cherche à satisfaire le goût de ses semblables. C’est de l’art sur mesure, de l’art de tout repos. Son domaine est celui des arts appliqués, des arts dits « mineurs » et de la décoration sous toutes ses formes.
Ce que l’artisan attend de la part des théoriciens, ce sont des règles sûres, susceptibles de répondre aux goûts de la grande masse des citoyens. Cela suppose l’apprentissage d’un métier dont l’artiste créateur peut se passer.
Car l’artiste est libre. Contrairement à l’artisan confiné à l’intérieur des limites physiologiquement et socialement correctes, qui sont communes au plus grand nombre. Le propre de l’art est de dépasser ces bornes. Celles du commun des mortels, celles du raisonnable et de la modération. L’artiste n’a besoin ni des techniciens ni des théoriciens, ni des savants ni même de la logique ou du bon sens, encore moins de règles ou de garde-fous.
L’erreur est de confondre l’art savoir-faire de l’artisan qui par principe imite, copie, adapte, et l’art de l’artiste créateur qui invente même s’il est privé de savoir-faire. Il importe de distinguer les principes de l’un, de l’absence de principes de l’autre.
Si le but de l’artisan est de communiquer, de commercer avec ses semblables au moyen d’œuvres susceptibles de les séduire, il fera en sorte que celles-ci soient agréables aux yeux de ses clients potentiels.
L’artisan cherche à être rassuré par des principes et des recettes, pourvu qu’ils soient justifiés. Car il veut vivre de son savoir-faire, ici et maintenant, dans ce monde qu’il connaît et qui le reconnaît. Il sera rassuré par les solutions harmoniques aux caractères rigoureux et aux résultats reproductibles et, si possible, mesurables. Sans qu’il lui soit interdit pour autant de s’en libérer quelquefois et de passer de son monde aux autres mondes de l’artiste créateur.
L’artiste se moque absolument de la vertu des grands principes, même s’il lui arrive d’en user. Mais ce sont ces principes que, justement, recherche l’artisan. Proposer aux artistes des règles et des lois, c’est n’avoir rien compris à leur besoin de liberté. Mais ceci est bon pour l’artisan qui a trop tendance à rester enfermé dans le monde conventionnel de la vision commune, uniforme, mesurée. L’artiste préfère le risque, l’avant-garde, la démesure.
La satisfaction ou le plaisir que l’artisan trouve dans les « tranquilles produits » de son travail valent bien les émotions plus fortes mais perturbantes procurées par les œuvres de certains artistes, et qui sont souvent obtenues au prix d’inconfort, d’angoisse, ou même de souffrance.
Au risque du scandale, de la persécution et de la misère, les véritables artistes ont presque toujours défié les forces de l’ordre établi par l’académisme ou les modes. Quand l’art dépasse les bornes, il n’a plus d’autres limites que la folie ou la mort.
« Il est inutile qu’on dresse ici la liste de tous les peintres novateurs qui ont été conspués en ce siècle et qui ont ensuite imposé leur vision particulière. Ces injustices, cette lutte, ces triomphes, c’est l’histoire de l’art ». (Signac. « D’Eugène Delacroix au Néo-impressionnisme ». Paris. Hermann. 1964. p. 127).
« L’art est une libération totale qui fait les saints, les héros et les fous. C’est un état extrémiste ou seuls quelques créateurs (…) peuvent se maintenir ». (Michel Seuphor. « La peinture abstraite » Flammarion. 1964. p. 33).
« D’où le phénomène (…) qui fait de l’histoire de l’art, à la fin du XIXe siècle, un véritable martyrologe : misère, folie, suicides ; il suffit d’évoquer les noms de Soutine, Gauguin, Modigliani, Van Gogh, etc. ». (Régine Pernoud. « Pour en finir avec le Moyen-âge. ». Seuil. 1977. p. 29).
CHAPITRE 2 / LA LUMIÈRE BLANCHE
« L’univers (…) contient toutes les structures préexistantes du monde à venir ». (Sciences et Avenir n°118. 1999. p. 80).
« La longueur d’onde de la lumière est une réalité indépendante de l’observateur ». (Libero Zuppiroli. Op. cit. p. 151).
2.1 - LA LUMIÈRE AVANT LA VISION
L’appellation lumière blanche est purement conventionnelle et désigne la lumière du jour dans laquelle nous baignons en permanence mais que nous ne voyons pas. Il a fallu attendre Newton pour que la composition en soit scientifiquement connue.
Avant de chercher à percer les secrets de la vision, efforçons nous de percer les secrets de la lumière.
Alors que les scientifiques disent « tout vient du corps » ou bien « d’abord, il y a l’homme », on peut rappeler que ce n’est pas l’homme qui a fait la lumière mais la lumière qui a fait ce que l’homme est devenu. En effet, quand l’homme apparut sur terre, tout était déjà réglé dans la nature. L’œil n’eut rien à exiger d’elle. Il n’eut d’autre choix que de s’y adapter au mieux.
La lumière que nous étudions est la lumière du jour directement ou indirectement réfléchie. C’est la lumière du soleil, tamisée par l’atmosphère. Elle est invisible, c’est-à-dire qu’elle n’offre aucune sensation de couleur.
C’est la lumière naturelle à laquelle l’homme s’est adapté depuis l’origine de l’humanité. C’est elle qui permet les meilleures performances du système visuel, et aussi celle qui le fatigue le moins.
Cette lumière est complexe. Elle se compose d’un grand nombre de radiations électromagnétiques qu’un prisme ou les gouttes d’eau de l’arc-en-ciel peuvent décomposer. Des particules ou grains d’énergie appelés photons ou quanta composent l’onde lumineuse. On dit que la lumière est quantique. Elle possède, comme Janus, un double visage, à la fois onde et particule. Elle est de nature duale. La lumière est une et multiple à la fois.
Les couleurs qui la composent, celles de l’arc-en-ciel, sont noyées les unes dans les autres, et deviennent invisibles, sans que l’on ait encore pu expliquer ce phénomène. Sans couleur apparente, la lumière est dite « blanche », par analogie avec son équivalent plastique qui est la couleur blanche pigmentaire.
Il est important de souligner ici que l’idée de lumière blanche est théorique. En fait, la lumière du jour est loin d’être pure. Car elle varie toujours, plus ou moins, en fonction des heures de la journée, des saisons, des climats, etc.
La lumière dite blanche, en effet, est le résultat du mélange des différentes couleurs spectrales dont elle est composée et qui, même quand elles sont étalées par le prisme restent visiblement liées entre elles par des fusions marginales. Car même si ces couleurs spectrales émergent de la même lumière primordiale, et peuvent être identifiées séparément, on peut dire qu’elles sont sœurs, dépendantes les unes des autres. Elles sont solitaires et solidaires à la fois.
C’est ce que résument les scientifiques en disant qu’il n’existe pas dans la nature de couleur spectralement pure.
Ce fait scientifiquement établi et confirmé par des mesures spectrométriques, met en évidence le fait que d’autres longueurs d’ondes, outre celle de la teinte principale ou dominante, sont également réfléchies. Un rayon de couleur rouge, par exemple, contient aussi un peu des autres rayons, donc un peu de jaune et un peu de bleu, ou si l’on préfère, un peu de vert.
Chevreul, qui aurait du s’en souvenir à propos de ses recherches sur l’harmonie colorée, a écrit : « Il ne faut pas croire qu’un corps rouge, qu’un corps jaune, etc. ne réfléchisse, outre la lumière blanche, que des rayons rouges, que des rayons jaunes, chacun de ces corps réfléchit, en outre, toutes sortes de rayons colorés, mais les rayons qui nous le font juger rouge ou jaune, étant en plus grand nombre que les autres, produisent plus d’effets que ceux-ci ; cependant ces derniers ont une influence incontestable pour modifier l’action des rayons rouges, des rayons jaunes, sur l’organe de la vue ». (Chevreul. « De la loi du contraste simultané, etc. ». Paris. 1839. § 7).
Les courbes de sensibilité de l’œil humain : voir planche I
Ces courbes nous montrent clairement que les couleurs ne sont pas indépendantes les unes des autres. Elles fusionnent partiellement mais assez largement. Les trois couleurs principales, bleu, jaune et rouge apportent cependant une réponse dominante accompagnée d’une réponse plus faible des deux autres couleurs.
Elles représentent la sensibilité caractéristique de chacun des types de cônes spécifiques d’une famille de longueurs d’ondes : courtes, moyennes ou longues ; lesquelles représentent la totalité des longueurs d’ondes du spectre solaire.
Ces courbes, dont le sommet n’est pas un pic mais un dôme, traduisent un maximum de sensibilité de l’œil pour, non pas trois couleurs précises, monochromatiques, mais pour trois familles regroupant les bleus, les rouges et les verts. C’est pourquoi elles sont dites « courbes à large bande spectrale ».
Le sommet en forme de dôme de ces courbes nous explique pourquoi la possibilité de choix des trois couleurs dites primaires est relativement large et arbitraire.
On y voit encore que les couleurs ont pour origine la couleur blanche figurée par la fusion de leurs bases très larges occupant la largeur totale du spectre. Ainsi les expressions « couleurs filles de la lumière » ou «la lumière mère de toutes les couleurs » sont parfaitement justifiées. Les courbes se confondent de plus en plus, au fur et à mesure qu’elles se rapprochent de leur racine commune, avant de se fondre totalement dans la neutralité de la lumière blanche. La lumière blanche est l’alpha et l’oméga de la couleur qui naît d’elle et s’éteint avec elle.
Les courbes de sensibilité évoquent des vagues qui émergent de la mère primordiale et y retournent sans avoir jamais pu s’en libérer totalement. Ce fond blanc, qui correspond à la fusion de toutes les couleurs et dont la répartition spectrale s’étend sur la totalité du spectre visible, représente le maximum de désaturation commun à toutes les couleurs.
* * *
Les différentes radiations qui composent la lumière blanche semblent s’annuler mutuellement pour donner à l’esprit une absence de sensation colorée que nous appelons invisibilité ou neutralité.
Par contre, un faisceau de lumière réfléchie se compose d’éléments différents qui peuvent être discriminés par le système rétinien des cellules photosensibles. Quand ces éléments se recomposent après le passage par le nerf optique, la sensation perçue est celle d’une couleur.
COURBES DE SENSIBILITÉ
Spectre de la lumière blanche
PLANCHE I
Courbes théoriques montrant que les cônes réagissent surtout aux rouges, aux verts et aux bleus ; cst-tà-dire en fonction des différentes longueurs dndes qui composent le spectre de la lumitère blanche.
2.2 - LUMIÈRE INCIDENTE ET LUMIÈRE RÉFLÉCHIE
La réflectivité qui correspond au « rapport de l’énergie réfléchie à l’énergie incidente totale » (Le Robert), conduit à la réflexion. Exception faite des matériaux transparents comme le verre, qui laissent passer entièrement la lumière, ou les matériaux polis, comme le métal ou les miroirs qui la réfléchissent tout entière, les matériaux opaques absorbent une partie de la lumière qui les frappe.
La partie absorbée fait subir aux matériaux des transformations physiques, chimiques, thermiques, biologiques, électriques, etc., que nous appelons photosynthèse, échauffement, vieillissement, etc. le reste, non absorbé par les matériaux, est renvoyé dans l’atmosphère. Et c’est ce reste qui est à l’origine des sensations que nous appelons couleur.
Une couleur est donc toujours le résultat d’une absorption partielle de la lumière incidente qui éclaire l’objet. La sensation de couleur qui en résulte ne peut donc pas être aussi intense que la lumière qui frappe une surface réfléchissante. C’est pourquoi une couleur pigmentaire est toujours plus ou moins désaturée. Nous reviendrons sur ce point afin de préciser la nature des radiations qui en diminuent la pureté (voir § 4.4).
* * *
Ainsi, la lumière réfléchie est la seule partie de la lumière du jour qu’il nous est possible de voir grâce aux images qu’elle a imprimées sur notre rétine.
Sans le passage par notre œil, une couleur n’existe pas. C’est notre système visuel qui nous en fait voir de toutes les couleurs en rendant visible le rayonnement réfléchi. De même que le prisme de Newton ou les gouttes d’eau de la pluie sont capables de les rendre visibles, en séparant les différents rayons colorés qui forment la lumière blanche ; de même la lumière réfléchie nous est rendue visible grâce aux cellules de la rétine qui jouent le même rôle que le prisme ou les gouttes d’eau de l’arc-en-ciel.
Le rôle de notre système visuel sera d’analyser le contenu de cette lumière réfléchie, pour établir l’identité de l’objet observé, aidé en cela par d’autres indices venant des autres sens.
2.3 – LE PRINCIPE DE COMPLÉMENTARITÉ
De la connaissance de ce qui existait avant la venue de l’homme sur terre, dépend la compréhension de ce qu’est la complémentarité.
La complémentarité des couleurs est un concept issu de la lumière naturelle qui n’implique nullement l’égalité des rayonnements complémentaires. En revanche, la notion de couleurs complémentaires qui implique, contrairement à la complémentarité, l’égalité de deux couleurs en présence, a été vulgarisée par Chevreul au XIXème siècle.
Il importe donc de faire clairement la différence entre complémentarité des couleurs et couleurs complémentaires.
Le terme « complémentarité » est un substantif de sens large et général. Le qualificatif « complémentaire » est attribut de complémentarité. Il est restrictif quand il qualifie des couples de couleurs contraires et de forces égales. C’est le cas de la définition des couleurs complémentaires pigmentaires, donnée par Chevreul. Car tandis que les lumières complémentaires ne sont pas forcément d’égale énergie, selon lui, les couleurs complémentaires des peintres doivent être d’égales énergies pour reconstituer la lumière blanche.
Il conviendrait de faire le distinguo entre l’adjectif « complémentaire » pris au sens restreint, et pris au sens large. Au sens restreint, le mélange à égalité donne le blanc, résultat neutre. Alors qu’au sens large, le mélange inégal des parties donne la couleur.
Il y a donc un sens restrictif, étriqué, de l’adjectif « complémentaire » attribut du substantif « complémentarité » qui a aussi un sens plus large, plus ouvert et plus souple, adaptable à bien d’autres cas que celui des couples de couleurs contraires et de forces égales capables, par leur mélange, de produire la sensation de blanc, conformément à la définition destinée aux peintres par Chevreul.
Les rayons de la lumière blanche absorbés par un corps et ceux qui sont réfléchis sont complémentaires, au sens physique du terme, puisque ces deux parties se complètent pour former l’ensemble lumière blanche. De même, les couples de couleurs (bleu et orange, jaune et violet, vert et rouge) qui sont capables, théoriquement, de reconstituer par mélange en forces égales la couleur blanche, peuvent être dits complémentaires.
Pour reformer de la lumière blanche à partir des rayons colorés du spectre visible, il faut remélanger la totalité des radiations séparées par le prisme. Si l’on isole un seul rayonnement de ceux qui forment la lumière blanche, ce seul élément qu’il faudrait rendre au reste pour reformer la lumière blanche est dit complémentaire de ce reste ; ou bien, ce reste est dit complémentaire du rayonnement isolé.
On comprend l’importante de savoir, lorsque l’on parle de couleurs, s’il s’agit de couleurs-lumières ou de couleurs-pigments
2.4 BUT DE LA VISION
« Toute structure organique doit être pensée dans le contexte de la lutte pour l’existence ». (G. Caponi. Science et Vie. Hors série 2000).
« La vie est l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort. ». (Bichat cité par le Robert).
* * *
Dès l’aube de l’humanité, le rôle basique de l’acte visuel consistait à explorer et surveiller l’environnement pour en retirer des informations liées à des problèmes d’intérêt et de survivance. Comme celle de tout animal, la vision de l’homme, en association avec les autres sens, est un moyen de sauvegarde de l’espèce : détection d’un danger, recherche de nourriture, d’un ami ou d’un partenaire sexuel, etc. Telles sont alors les priorités de l’homme évoluant dans un milieu plus ou moins hostile. Voir, c’est explorer son environnement immédiat pour le sécuriser.
La vision, est donc un acte de communication, entre le monde physique extérieur et le monde psychologique intérieur de l’homme. L’œil en est l’intermédiaire. Les informations recueillies par l’œil sont interprétées par le cerveau sous forme d’impressions psychiques : sensations, sentiments, idées, etc. Ces informations vont permettre au cerveau-ordinateur de se constituer une sorte de carte d’identité des couleurs observées.
Immédiatement exploitées sous la forme de réactions, réflexes de protection ou de défense, liées à sa sauvegarde, ou bien mises en mémoire, ces cartes d’identité comporteront les multiples indices spécifiques de l’objet observé : forme, mouvement, distance, structure… et bien sûr la couleur, aux nuances près de teinte, de ton et de saturation. Tout comme l’ADN est le support de l’information génétique, cette fiche signalétique des couleurs rend compte de leur nature profonde.
En vision courante, rapide et sommaire, l’œil capte d’abord la partie chromatique des objets, ce qui en permet une première approche. L’identification plus précise des nuances de ces couleurs se fera ultérieurement. Tel est le rôle de la vision : identifier les éléments qui composent son environnement.
Concernant la couleur, le but de la vision est de la décrypter, de comprendre ce qui se cache derrière les apparences, c’est-à-dire derrière ce qui se voit. En effet, une couleur peut en cacher une autre car tout comme la lumière, la couleur est une et diverse à la fois.
Décrypter, c’est percevoir. Percevoir, du latin « per » qui signifie voir à travers les informations reçues par l’œil. Voir celles qui sont évidentes mais aussi sentir celles qui le sont moins, et surtout celles qui sont imperceptibles…
Toutes les couleurs contiennent une partie de la totalité de la lumière d’où elles sont nées. C’est cette parenté avec la lumière blanche que l’œil cherche à analyser.
CHAPITRE 3 / VISION ET PERCEPTION
« Dans la vision, le passage des données sensorielles à la perception, c’est-à-dire leur interprétation, s’effectue selon certaines règles déjà présentes dans le monde extérieur. Découvrir comment le système exploite ces règles contribuera à nous faire mieux comprendre (…) comment (…) le système établit avec le monde extérieur un rapport correct et non arbitraire ». (Agostini. « Les jeux visuels ». France Loisirs. 1986. p. 140).
« L’étranger ne voit que ce qu’il sait ». (Proverbe africain – Dogon).
« Sentir n’est pas la même chose que percevoir. Les yeux et le système nerveux opèrent la sensation, et l’esprit la perception ». (A. Huxley. « L’art de voir ». Payot. 1950. p. 31).
3.1 - DIFFÉRENCE ENTRE VISION ET PERCEPTION
« L’homme est la mesure de toutes choses ». (Protagoras, Ve siècle av. J-C). À sa mesure, au moyen de ses œuvres, le peintre peut créer ou recréer chez ses semblables des sensations colorées. Connaître les causes de l’effet produit par tel ou tel agencement coloré ne peut que lui être bénéfique.
« Il faut donc, pour connaître l’homme, savoir d’où vient qu’il a besoin d’air pour subsister ; et pour connaître l’air, savoir par où il a ce rapport avec la vie de l’homme, etc. (…). Pour connaître l’un, il faut connaître l’autre ». (Blaise Pascal « Les pensées » H. Massis. Grasset. 1935. p. 119). Pour résoudre le problème que pose la vision des couleurs, il faudra en rechercher la solution, à la fois dans la nature de la lumière et dans la nature de l’homme.
* * *
Il est très difficile de savoir ce que voit exactement notre voisin et donc ce qu’il retient placé en face du même paysage que nous.
Pourtant, chacun d’entre nous est pourvu du même système visuel. Nos yeux sont conformés de la même façon. Mais personne n’a exactement le même cerveau. Or, l’acte de voir se fait en deux étapes : d’abord au niveau de l’œil, puis à celui du cerveau.
La plupart des phénomènes qui se déroulent en nous sont inconscients. Ainsi en est-il des mécanismes réflexes et toutes les opérations de capture, de sélection, et de transmission des informations qui frappent notre rétine. Les parties optiques et de transmission de notre système visuel fonctionnent de façon autonome. Les images de l’extérieur s’impriment automatiquement sur notre rétine ; mais ensuite nous les voyons, ou ne les voyons pas, selon que notre esprit choisit de les percevoir ou non, c’est-à-dire décide d’en prendre conscience ou bien de les classer sans suite, ou encore de les mettre en mémoire.
« Voir, ce n’est donc qu’enregistrer ce qui s’impose à notre vue ; mais percevoir, c’est le résultat d’une déduction consciente ». (Helmholtz, physicien fin XIXe). La vision est passive, la perception est active : c’est un acte de l’esprit qui a une dimension intellectuelle.
« La perception est la sensation à laquelle de l’intelligence, de l’intérêt, de la culture, de la réflexion auront été ajoutées ». (C. Godin. « Bac philo ». First édit.).
La vision est l’ensemble des opérations optico-physiologiques qui conduisent l’information jusqu’aux centres nerveux supérieurs où les sensations brutes sont élaborées et deviennent perception.
Les spécialistes décrivent trois niveaux principaux dans l’acte perceptif. Ces niveaux correspondent à trois disciplines différentes mais corrélées : l’optique, qui conduit les rayons lumineux jusqu’à la rétine ; la physiologie, qui s’occupe de la formation des messages et de leur transmission au cerveau ; enfin la psychologie, qui concerne les représentations mentales des informations et la prise de conscience du message.
La perception est donc une construction mentale, elle n’est en aucun cas la copie d’une réalité physique objective. L’impression de voir le monde « tel qu’il est » est une illusion. L’œil n’est pas un appareil photographique. La comparaison s’arrête au niveau de la rétine qui n’enregistre pas une image fixe, mais une multitude d’instantanés qui se fondent entre eux, se superposent et se heurtent dans un chaos indescriptible. Ce qui fait que l’image finale, unique et illusoire que nous appelons à tort « image mentale » n’a, en fait, plus rien à voir avec l’objet observé. Nous l’imaginons quasiment photographique, comme un portrait peint parfaitement ressemblant, alors qu’elle est beaucoup plus proche des tableaux de « belles femmes exécutées par des soi-disant artistes complètement braques, et qui peignent à la Picasso » comme dit ma concierge !
Pourtant, si l’on voulait donner une idée de ce qu’il se passe - du moins dans un premier temps - au niveau cérébral, on pourrait proposer pour l’illustrer, ces essais de transcription plastique du chaos rétinien que sont un tableau du peintre Braque, ou un portrait de Jacqueline par Picasso ; plutôt que le portrait de la Joconde par Léonard De Vinci.
3.2 - VISION COURANTE ET VISION FIXE
Comme nous l’avons déjà dit, le rôle premier de la fonction visuelle est d’assurer la survie de l’espèce.
Le moindre mouvement suspect, une couleur ou une silhouette inhabituelle, qui apparaissent dans le champ visuel, déclenchent une réaction réflexe : geste de protection, fuite, etc.
À cet effet, il existe un « fast brain », un « cerveau rapide », autonome (voir § 4.3), susceptible d’apporter des réponses fulgurantes aux problèmes de coordination de la vision et de la motricité.
Cette réaction subite et subie est purement instinctive. C’est une activité musculaire inconsciente et nerveuse dont le stimulus court-circuite les voies de la transmission des informations au cerveau. Celui-ci, directement informé, commande les actions réflexes en retour.
En outre, ce type de vision, que les spécialistes désignent par le vocable « vision-action », ne capte ni les formes, ni les couleurs, mais seulement le mouvement. Cette vision-action est à distinguer nettement de la vision-perception où la couleur va jouer un rôle primordial.
Cette vision-perception comporte deux étapes. L’œil agit en deux temps. D’abord une vision rapide, d’exploration générale. Toujours en mouvement, les images enregistrées restent imprécises mais suffisantes pour une vision routinière faite davantage de connaissance mémorisée du milieu que de découverte. Ensuite, l’œil se fixe pour mener à bien une analyse lente et précise des détails avant de revenir à une vision routinière.
Ces deux aspects de la vision doivent être impérativement distingués bien que dans la pratique ils soient associés et complémentaires. Ceci afin d’éviter les ambiguïtés d’interprétation de certains phénomènes dues aux différences de perception des images.
En effet, les problèmes de la perception visuelle sont différents selon que l’on considère la vision rapide, instantanée, impressionniste, globale, qui suppose toujours le mouvement des yeux ou de l’objet observé et la vision lente et fixe, qui est celle de la contemplation ou de l’observation précise.
La distinction entre vision dynamique et vision fixe permet d’éclairer certaines contradictions apparentes et de démystifier l’image conventionnelle et caricaturale de l’amateur d’art planté devant une œuvre et plongé dans de longues méditations, l’œil figé, le regard perdu… Cette conception donne lieu à des mots et de belles phrases souvent à cent lieues de l’œuvre…
De nombreuses erreurs en matière de théorie scientifique ou esthétique tiennent essentiellement au fait que les spécialistes de la vision, adeptes des sciences exactes, ont toujours considéré la vision fixe comme la seule forme de vision digne d’intérêt. Ils savent pourtant qu’il existe d’autres formes : la rêverie, les hallucinations, et naturellement, la vision dynamique en mouvement. L’on est même en droit de penser que la vision contemplative n’est pas forcément la seule, ni peut-être même la meilleure façon d’aborder un tableau.
La vision rapide, celle du premier coup d’œil, qui a produit tant de chefs-d’œuvre impressionnistes, est, en effet, plus courante et moins fatigante que la vision statique.
Vision courante
Les mouvements oculaires concernent essentiellement la première phase du processus visuel, celle du premier contact avec notre environnement. C’est celle de la routine exploratrice du champ visuel ; celle de la vision naturelle quand l’œil, toujours en mouvements, effectue des balayages en toutes directions, avec des changements brusques, à la recherche d’éventuels centres d’intérêts.
C’est la vision en mouvements qu’il nous plaît d’appeler vision courante parce que ce terme évoque à la fois les mouvements rapides du regard, ainsi que son côté habituel, ordinaire, quotidien, routinier.
Elle se distingue nettement de la vision fixe qui vient la compléter en lui apportant la précision qui fait défaut aux informations globales de la vision courante.
Ce premier stade capte les informations colorées reçues de l’extérieur à l’aide des trois types de cellules photosensibles (les cônes). Cette vision est globale et synthétique. L’analyse, opération inverse de la synthèse, sera réservée à la vision fixe.
Cette vision de la première impression, celle qui saute immédiatement aux yeux, est la vision normale et la seule qui n’entraîne pratiquement aucune fatigue. Elle est reposante, parce que supportant un certain flou, elle est exempte des fatigues de l’accommodation trop poussée.





























