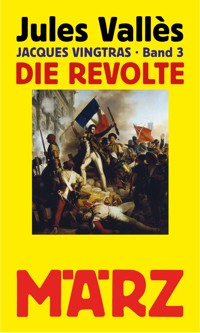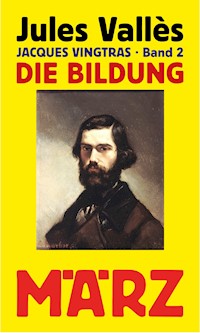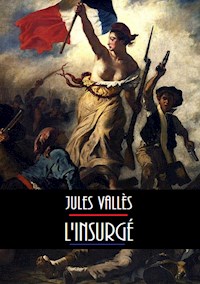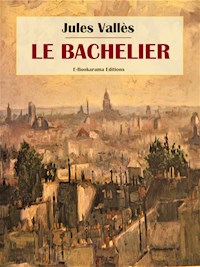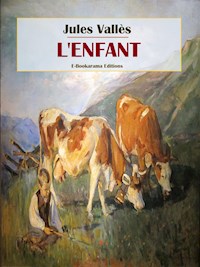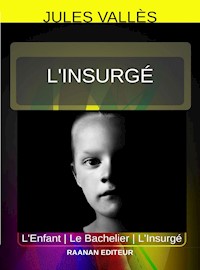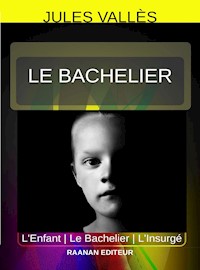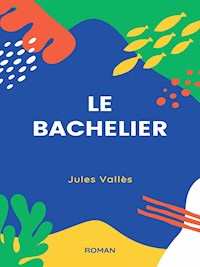
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Second tome de la trilogie «Jacques Vingtras». Ayant obtenu son bac, Jacques peut enfin s'installer à Paris avec l'accord de ses parents. Avec cinq cents francs en poche reçus d'un héritage et quarante francs mensuels promis par son père, il cherche un logement et un premier emploi. L'argent lui file entre les doigts...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Le Bachelier
Le BachelierDÉDICACE1. En route2. Matoussaint ?3. Hôtel Lisbonne4. L’avenir5. L’habit vert6. La politique7. Les écoles8. La revanche9. La maison Renoul10. Mes colères11. Le comité des jeunes12. 2 Décembre13. Après la défaite14. Désespoir15. Legrand16. Paris17. Les camarades18. Le garni19. La pension Entêtard20. Ba be bi bo bu21. Préceptorat. Chausson22. L’épingle23. High life24. Le Christ au saucisson25. Mazas26. Journaliste27. Hasards de la fourchette28. À marier29. Monsieur, Monsieur Bonardel30. Sous l’Odéon31. Le duel32. Agonie33. Je me rendsPage de copyrightLe Bachelier
Jules Vallès
DÉDICACE
À CEUX
QUI
NOURRIS DE GREC ET DE LATIN
SONT MORT DE FAIM
JE DÉDIE CE LIVRE.
Jules VALLÈS.
1. En route
J’ai de l’éducation.
« Vous voilà armé pour la lutte – a fait mon professeur en me disant adieu. – Qui triomphe au collège entre en vainqueur dans la carrière. »
Quelle carrière ?
Un ancien camarade de mon père, qui passait à Nantes, et est venu lui rendre visite, lui a raconté qu’un de leurs condisciples d’autrefois, un de ceux qui avaient eu tous les prix, avait été trouvé mort, fracassé et sanglant, au fond d’une carrière de pierre, où il s’était jeté après être resté trois jours sans pain.
Ce n’est pas dans cette carrière qu’il faut entrer ; je ne pense pas ; il ne faut pas y entrer la tête la première, en tout cas.
Entrer dans la carrière veut dire : s’avancer dans le chemin de la vie ; se mettre, comme Hercule, dans le carrefour.
Comme Hercule dans le carrefour. Je n’ai pas oublié ma mythologie. Allons ! c’est déjà quelque chose.
Pendant qu’on attelait les chevaux, le proviseur est arrivé pour me serrer la main comme à un de ses plus chers alumni. Il a dit alumni.
Troublé par l’idée du départ, je n’ai pas compris tout de suite. M. Ribal, le professeur de troisième, m’a poussé le coude.
« Alumn-us, alumn-i », m’a-t-il soufflé tout bas en appuyant sur le génitif et en ayant l’air de remettre la boucle de son pantalon.
« J’y suis ! Alumnus…. cela veut dire « élève », c’est vrai. »
Je ne veux pas être en reste de langue morte avec le proviseur ; il me donne du latin, je lui rends du grec :
« (ce qui veut dire : merci, mon cher maître). »
Je fais en même temps un geste de tragédie, je glisse, le proviseur veut me retenir, il glisse aussi ; trois ou quatre personnes ont failli tomber comme des capucins de cartes.
Le proviseur (impavidum ferient ruinae) reprend le premier son équilibre, et revient vers moi, en marchant un peu sur les pieds de tout le monde. Il me reparle, en ce moment suprême, de mon éducation.
« Avec ce bagage-là, mon ami… »
Le facteur croit qu’il s’agit de mes malles.
« Vous avez des colis ? »
Je n’ai qu’une petite malle, mais j’ai mon éducation.
Me voilà parti.
Je puis secouer mes jambes et mes bras, pleurer, rire, bâiller, crier comme l’idée m’en viendra.
Je suis maître de mes gestes, maître de ma parole et de mon silence. Je sors enfin du berceau où mes braves gens de parents m’ont tenu emmailloté dix-sept ans, tout en me relevant pour me fouetter de temps en temps.
Je n’ose y croire ! j’ai peur que la voiture ne s’arrête, que mon père ou ma mère ne remonte et qu’on ne me reconduise dans le berceau. J’ai peur que tout au moins un professeur, un marchand de langues mortes n’arrive s’installer auprès de moi comme un gendarme.
Mais non, il n’y a qu’un gendarme sur l’impériale, et il a des buffleteries couleur d’omelette, des épaulettes en fromage, un chapeau à la Napoléon.
Ces gendarmes-là n’arrêtent que les assassins ; ou, quand ils arrêtent les honnêtes gens, je sais que ce n’est pas un crime de se défendre. On a le droit de les tuer comme à Farreyrolles ! On vous guillotinera après ; mais vous êtes moins déshonoré avec votre tête coupée que si vous aviez fait tomber votre père contre un meuble, en le repoussant pour éviter qu’il ne vous assomme.
Je suis LIBRE ! LIBRE ! LIBRE !…
Il me semble que ma poitrine s’élargit et qu’une moutarde d’orgueil me monte au nez… J’ai des fourmis dans les jambes et du soleil plein le cerveau.
Je me suis pelotonné sur moi-même. Oh ! ma mère trouverait que j’ai l’air noué ou bossu, que mon œil est hagard, que mon pantalon est relevé, mon gilet défait, mes boutons partis – C’est vrai, ma main a fait sauter tout, pour aller fourrager ma chair sur ma poitrine ; je sens mon cœur battre là-dedans à grands coups, et j’ai souvent comparé ces battements d’alors au saut que fait, dans un ventre de femme, l’enfant qui va naître…
Peu à peu cependant l’exaltation s’affaisse, mes nerfs se détendent, et il me reste comme la fatigue d’un lendemain d’ivresse. La mélancolie passe sur mon front, comme là-haut dans le ciel, ce nuage qui roule et met son masque de coton gris sur la face du soleil.
L’horizon qui, à travers la vitre me menace de son immensité, la campagne qui s’étend muette et vide, cet espace et cette solitude m’emplissent peu à peu d’une poignante émotion…
Je ne sais à quel moment on a transporté la diligence sur le chemin de fer[1] ; mais je me sens pris d’une espèce de peur religieuse devant ce chemin que crèvent le front de cuivre de la locomotive, et où court ma vie… Et moi, le fier, moi, le brave, je me sens pâlir et je crois que je vais pleurer.
Justement le gendarme me regarde – du courage. Je fais l’enrhumé pour expliquer l’humidité de mes yeux et j’éternue pour cacher que j’allais sangloter.
Cela m’arrivera plus d’une fois.
Je couvrirai éternellement mes émotions intimes du masque de l’insouciance et de la perruque de l’ironie…
J’ai eu pour voisine de voyage une jolie fille à la gorge grasse, au rire engageant, qui m’a mis à l’aise en salant les mots et en me caressant de ses grands yeux bleus.
Mais à un moment d’arrêt, elle a étendu la main vers une bouquetière ; elle attendait que je lui offrisse des fleurs.
J’ai rougi, quitté ce wagon et sauté dans un autre. Je ne suis pas assez riche pour acheter des roses !
J’ai juste vingt-quatre sous dans ma poche : vingt sous en argent et quatre sous en sous… mais je dois toucher quarante francs en arrivant à Paris.
C’est toute une histoire.
Il paraît que M. Truchet, de Paris, doit de l’argent à M. Andrez, de Nantes, qui est débiteur de mon père pour un M. Chalumeau, de Saint-Nazaire ; il y a encore un autre paroissien dans l’affaire ; mais il résulte de toutes ces explications que c’est au bureau des Messageries de Paris, que je recevrai de la main de M. Truchet la somme de quarante francs.
D’ici là, vingt-quatre sous !
Vingt-quatre sous, dix-sept ans, des épaules de lutteur, une voix de cuivre, des dents de chien, la peau olivâtre, les mains comme du citron, et les cheveux comme du bitume.
Avec cette tournure de sauvage, une timidité terrible, qui me rend malheureux et gauche. Chaque fois que je suis regardé en face par qui est plus vieux, plus riche ou plus faible que moi ; quand les gens qui me parlent ne sont pas de ceux avec qui je puis me battre et dont je boucherais l’ironie à coups de poing, j’ai des peurs d’enfant et des embarras de jeune fille.
Ma brave femme de mère m’a si souvent dit que j’étais laid à partir du nez et que j’étais empoté et maladroit (je ne savais pas même faire des 8 en arrosant), que j’ai la défiance de moi-même vis-à-vis de quiconque n’est pas homme de collège, professeur ou copain.
Je me crois inférieur à tous ceux qui passent et je ne suis sûr que de mon courage.
J’ai de quoi manger avec des provisions de ma mère. Je ne toucherai pas à mes vingt-quatre sous.
La soif m’ayant pris, je me suis glissé dans le buffet, et derrière les voyageurs, j’ai tiré à moi une carafe, j’ai rempli mon gobelet de cuir. Je l’achetai au temps où je voulais être marin, aventurier, découvreur d’îles.
Il me faut bien de l’énergie pour sauter au cou de cette carafe et voler son eau. Il me semble que je suis un de ces pauvres qui tendent la main vers une écuelle, aux portes des villages.
Je m’étrangle à boire, mon cœur s’étrangle aussi. Il y a là un geste qui m’humilie.
Paris, 5 heures du matin.
Nous sommes arrivés.
Quel silence ! tout paraît pâle sous la lueur triste du matin et il y a la solitude des villages dans ce Paris qui dort. C’est mélancolique comme l’abandon : il fait le froid de l’aurore, et la dernière étoile clignote bêtement dans le bleu fade du ciel.
Je suis effrayé comme un Robinson débarqué sur un rivage abandonné, mais dans un pays sans arbres verts et sans fruits rouges. Les maisons sont hautes, mornes, et comme aveugles, avec leurs volets fermés, leurs rideaux baissés.
Les facteurs bousculent les malles. Voici la mienne.
Et le personnage aux quarante francs ? l’ami de M. Andrez ?
J’accoste celui des remueurs de colis qui me paraît le plus bon enfant, et, lui montrant ma lettre, je lui demande M. Truchet, – c’est le nom qui est sur l’enveloppe.
« M. Truchet ? son bureau est là, mais il est parti hier pour Orléans.
– Parti !… Est-ce qu’il doit revenir ce soir ?
– Pas avant quelques jours ; il y a eu sur la ligne un vol commis par un postillon, et il a été chargé d’aller suivre l’affaire. »
M. Truchet est parti. Mais ma mère est une criminelle ! Elle devait prévoir que cet homme pouvait partir, elle devait savoir qu’il y a des postillons qui volent, elle devait m’éviter de me trouver seul avec une pièce d’un franc sur le pavé d’une ville où j’ai été enfermé comme écolier, rien de plus.
« Vous êtes le voyageur à qui cette malle appartient ? fait un employé.
– Oui, monsieur.
– Voulez-vous la faire enlever ? Nous allons placer d’autres bagages dans le bureau. »
La prendre ! Je ne puis la mettre sur mon dos et la traîner à travers la ville… je tomberais au bout d’une heure. Oh ! il me vient des larmes de rage, et ma gorge me fait mal comme si un couteau ébréché fouillait dedans…
« Allons, la malle ! voyons ! »
C’est l’employé qui revient à la charge, poussant mon colis vers moi, d’un geste embêté et furieux.
« Monsieur, dis-je d’une voix tremblante… J’ai pour M. Truchet… une lettre de M. Andrez, le directeur des Messageries de Nantes… »
L’homme se radoucit.
« M. Andrez ?… Connais ! Et alors c’est d’un endroit où aller loger que vous avez besoin ?… Il y a un hôtel, rue des Deux-Écus, pas cher. »
Il a dit « pas cher » d’un air trop bon. Il voit le fond de ma bourse, je sens cela !
« Pour trente sous, vous aurez une chambre. »
Trente sous !
Je prends mon courage à deux mains et ma malle par l’anse.
Mais une idée me vient.
« Est-ce que je ne pourrais pas la laisser ici ? je viendrais la reprendre plus tard ?
– Vous pouvez… Je vais vous la pousser dans ce coin… Fichtre ! on ne la confondra pas avec une autre, dit-il en regardant l’adresse. J’espère que vous avez pris vos précautions. »
C’est ma mère qui a cloué la carte sur mon bagage :
Cette malle, souvenir
de famille, appartient à
VINGTRAS (Jacques-Joseph-Athanase), né le jour de la
Saint-Barnabé, au Puy (Haute-Loire), fils de Monsieur
Vingtras (Louis-Pierre-Antoine), professeur de sixième, au
collège royal de Nantes. Parti de cette ville, le 1er mars,
pour Paris, par la dili-
gence Laffitte et Gail-
lard, dans la Rotonde,
place du coin. La ren-
voyer, en cas d’acci-
dent, à Nantes (Loire-
Inférieure), à l’adresse
de M. Vingtras, père,
quai de Richebourg, 2,
au second, dans la mai-
son de Monsieur Jean
Paussier, dit « Gros
Ventouse ».
Veillez sur elle !
C’est arrangé comme une épitaphe de cimetière sur une croix de village. Le facteur me regarde de la tête aux pieds, et moi je balbutie un mensonge :
« C’est ma grand-mère qui a fait cela. Vous savez, les bonnes femmes de village… »
Il me semble que je me sauve du ridicule, en attribuant l’épitaphe à une vieille paysanne.
« Elle a un serre-tête noir, et sa cotte en l’air par-derrière, je vois ça, » dit le facteur d’un air bon enfant.
S’il avait vu le chapeau jaune, avec oiseaux se becquetant, qui était la coiffure aimée de ma mère !… ma mère que je viens de renier…
Enfin, on a remisé la malle. – Je salue, tourne le bouton et m’en vais.
Me voilà dans Paris.
C’est ainsi que j’y entre.
Je débute bien ! Que sera ma vie commencée sous une pareille étoile ?
Je sors de la cour ; je vais devant moi… Des voitures de bouchers passent au galop ; les chevaux ont les naseaux comme du feu (on dit en province que c’est parce qu’on leur fait boire du sang) ; la ferblanterie des voitures de laitier bondit sur le pavé ; des ouvriers vont et viennent avec un morceau de pain et leurs outils roulés dans leur blouse ; quelques boutiques ouvrent l’œil, des sacristains paraissent sur les escaliers des églises, avec de grosses clefs à la main ; des redingotes se montrent.
Paris s’éveille.
Paris est éveillé.
J’ai attendu huit heures en traînant dans les rues.
[1] En 1851, cela se faisait ainsi.
2. Matoussaint ?
Que faire ?
Je n’ai qu’une ressource, aller trouver Matoussaint, l’ancien camarade qui restait rue de l’Arbre-Sec. S’il est là, je suis sauvé.
Il n’y est pas !
Matoussaint a quitté la maison depuis un mois, et l’on ne sait pas où il est allé.
On l’a vu partir avec des poètes, me dit le concierge… des gens qui avaient des cheveux jusque-là.
« C’est bien des poètes, n’est-ce pas ? et puis pas très bien mis ; des poètes, allez, monsieur, fait-il en branlant la tête. »
Oh ! oui, ce sont des poètes, probablement !
Dans les derniers temps, Matoussaint faisait la cour à la nièce d’une fruitière qui demeurait rue des Vieux-Augustins.
N’avait-elle pas aussi, à ce que m’a confié Matoussaint, un oncle qui avait pris la Bastille ? Il avait gardé un culte pour la place et il était toujours au mannezingue[1] du coin, d’où il partait tous les soirs soûl comme la bourrique de Robespierre, en insultant la veuve Capet. Je le trouverai peut-être le nez dans son verre, et il me mettra, en titubant, sur la trace de mon ami.
Hélas ! le marchand de vin est démoli. C’est tombé sous la pioche, et je ne vois qu’un tireur de cartes qui m’offre de me dire ma bonne aventure.
« Combien ?
– Deux sous, le petit jeu. »
Je tire une carte – par superstition – pour avoir mon horoscope, pour savoir ce que je vais devenir. Deux ou trois personnes en font autant.
Au bout de cinq minutes, l’homme nous racole, une bonne, deux maçons et moi, et nous fait marcher comme des recrues que mène un sergent, jusqu’au mastroquet voisin. Là, nous regardant d’un air de dégoût :
« L’as de cœur !
– C’est moi qui ai l’as de cœur.
– Monsieur, me dit le sorcier en m’attirant à lui, voulez-vous le grand ou le petit jeu ? »
Je sens que si je demande le petit jeu il me prédira le suicide, l’hôpital, la poésie, rien que des malheurs ; je demande le grand.
« Quinze centimes en plus. »
Je donne mes vingt-cinq centimes.
« Payez-vous un verre de vin ? »
Je suis sur la pente de la lâcheté. Il me demanderait une chopine, j’irais de la chopine, je roulerais même jusqu’au litre.
On apporte des verres.
« À la vôtre ! »
Il boit, s’essuie les lèvres, renfonce son chapeau et commence :
« Vous avez l’air pauvre, vous êtes mal mis, votre figure ne plaît pas à tout le monde ; une personne qui vous veut du mal se trouvera sur votre chemin, ceux qui vous voudront du bien en seront empêchés, mais vous triompherez de tous ces obstacles à l’aide d’une troisième personne qui arrivera au moment où vous vous y attendrez le moins. Il faudrait pour connaître son nom, regarder dans le jeu des sorciers. C’est cinq sous pour tout savoir. »
L’homme se dépêche de m’expédier.
« Vous tirerez le diable par la queue jusqu’à quarante ans ; alors, vous songerez à vous marier, mais il sera trop tard : celle qui vous plaira vous trouvera trop vieux et trop laid, et l’on vous renverra de la famille. »
Il me pousse dans le corridor et appelle le dix de trèfle.
Il n’y a plus qu’à aller du côté de l’amoureuse à Matoussaint.
Je ne connais malheureusement que sa figure et son petit nom. Matoussaint l’avait baptisée Torchonette.
Je bats la rue des Vieux-Augustins en longeant les trottoirs et cherchant les fruitières : il y en a deux ou trois. Je me plante devant les choux et les salades en regardant passer les femmes ; toutes me voient rôder avec des gestes de singe, car je fais des grimaces pour me donner une contenance et je me tortille comme quelqu’un qui pense à des choses vilaines… je dois tout à fait ressembler à un singe.
Je ne puis pas aller vers les fruitières et leur dire :
« Avez-vous une nièce qui s’appelle Torchonette et qui aimait M. Matoussaint ? Avez-vous un parent qui se soûlait tous les jours à la Bastille ? »
Je ne puis qu’attendre, continuer à marcher en me traînant devant les boutiques, avec la chance de voir passer Torchonette.
J’ai eu cette bêtise, j’ai eu ce courage, comptant sur le hasard, et je suis resté des heures dans cette rue, toisé par les sergents de ville ; mon attitude était louche, ma rôderie monotone, inquiétante.
Il y avait justement une boutique d’horloger et des montres à la vitrine voisine. Si dans la soirée on s’était aperçu d’un vol dans le quartier, on m’aurait signalé comme ayant fait le guet ou pris l’empreinte des serrures. J’étais arrêté et probablement condamné.
À l’heure du déjeuner, j’ai eu vingt alertes, croyant vingt fois reconnaître l’amoureuse à Matoussaint, et vingt fois faisant rire les filles sur la porte de l’atelier ou de la crémerie.
« Quel est donc ce grand dadais qui dévisage tout le monde ? »
Elles me montraient du doigt en ricanant et je devenais rouge jusqu’aux oreilles.
Je m’enfuyais dans le voisinage, j’enfilais des ruelles sales qui sentaient mauvais ; où des femmes à figures violettes, à robes lilas, à la voix rauque, me faisaient des signes et me tiraient par la manche dans des allées boueuses. Je leur échappais en me débattant sous une averse de mots immondes et je revenais, mourant de honte et aussi de fatigue, dans la rue des Vieux-Augustins.
Il y en a qui m’ont pris pour un mouchard.
« C’en est un, ai-je entendu un ouvrier dire à un autre.
– Il est trop jeune.
– Va donc ! Et le fils à la mère Chauvet qui était dans la Mobile, n’est-il pas de la rousse maintenant ? »
Il faisait chaud. Le soleil cuisait l’ordure à la bouche des égouts et pourrissait les épluchures de choux dans le ruisseau. Il montait de cette rue piétinée et bordée de fritures une odeur de vase et de graisse qui me prenait au cœur.
J’avais les pieds en sang et la tête en feu. La fièvre m’avait saisi et ma cervelle roulait sous mon crâne comme un flot de plomb fondu.
Je quittai mon poste d’observation pour courir où il y avait plus d’air et j’allai m’affaisser sur un banc du boulevard, d’où je regardai couler la foule.
J’arrivais de la province où, sur dix personnes, cinq vous connaissent. Ici les gens roulent par centaines : j’aurais pu mourir sans être remarqué d’un passant !
Ce n’était même plus la bonhomie de la rue populeuse et vulgaire d’où je sortais.
Sur ce boulevard, la foule se renouvelait sans cesse ; c’était le sang de Paris qui courait au cœur et j’étais perdu dans ce tourbillon comme un enfant de quatre ans abandonné sur une place.
J’ai faim !
Faut-il entamer les sous qui me restent ?
Que deviendrai-je, si je les dépense sans avoir retrouvé Matoussaint ? Où coucherai-je ce soir ?
Mais mon estomac crie et je me sens la tête grosse et creuse ; j’ai des frissons qui me courent sur le corps comme des torchons chauds.
Allons ! le sort en est jeté !
Je vais chez le boulanger prendre un petit pain d’un sou où je mords comme un chien.
Chez le marchand de vin du coin, je demande un canon de la bouteille.
Oh ! ce verre de vin frais, cette goutte de pourpre, cette tasse de sang !
J’en eus les yeux éblouis, le cerveau lavé et le cœur agrandi. Cela m’entra comme du feu dans les veines. Je n’ai jamais éprouvé sensation si vive sous le ciel !
J’avais eu, une minute avant, envie de me retraîner jusqu’à la cour des Messageries, et de redemander à partir, dussé-je étriller les chevaux et porter les malles sous la bâche pour payer mon retour. Oui, cette lâcheté m’était passée par la tête, sous le poids de la fatigue et dans le vertige de la faim. Il a suffi de ce verre de vin pour me refaire, et je me redresse droit dans le torrent d’hommes qui roule !
Un accident vient d’arriver. On court. Je m’approche. Un cheval s’est abattu, une charrette cassée. Il faut relever un timon, hue-ho ! Ils n’y arrivent pas. Je m’avance et me glisse sous le timon. Il m’écrase, je vais tomber broyé. Tant pis je ne lâcherai pas ! – et la charrette se relève.
Ce qu’il m’est revenu de confiance en moi pour avoir eu le courage de ne pas lâcher quand je croyais que j’allais être tué sur place sans bruit, sans gloire, je ne puis l’écrire et quand à côté de moi ensuite on eut l’air de croire que c’était mon coup d’épaule qui avait enlevé le morceau, alors quoique je singeais la modestie et fisse l’hypocrite, je crus que j’allais étouffer d’orgueil.
Il me reste douze sous. Il est deux heures de l’après-midi.
J’ai les pieds qui pèlent, je n’ai pas aperçu Torchonette chez les fruitières.
Que devenir ?
Dans l’une des ruelles que j’ai traversées tout à l’heure, j’ai vu un garni à six sous pour la nuit. Faudra-t-il que j’aille là, avec ces filles, au milieu des souteneurs et des filous ? Il y avait une odeur de vice et de crime ! Il le faudra bien.
Et demain ? Demain, je serai en état de vagabondage.
Encore un verre de vin !
C’est deux sous de moins, ce sera mille francs de courage de plus !
« Un autre canon de la bouteille », dis-je au marchand d’un air crâne, comme s’il devait me prendre pour un viveur enragé parce que je redoublais au bout d’une halte d’une heure ; comme s’il pouvait me reconnaître seulement !
Je donne dix sous pour payer – une pièce blanche au lieu de cuivre ; quand on est pauvre, on fait toujours changer ses pièces blanches.
« Cinquante centimes : Voilà six sous. » L’homme me rend la monnaie.
« Je n’ai pris qu’un verre.
– Vous avez dit : Un autre…
– Oui…. oui… »
Je n’ose m’expliquer, raconter que je faisais allusion au verre d’avant ; je ramasse ce qu’on me donne, en rougissant, et j’entends le marchand de vin qui dit à sa femme :
« Il voulait me carotter un canon, ce mufle-là ! »
Je ne puis retrouver Matoussaint !
Si je frappais ailleurs ?
Est-ce que Royanny n’est pas venu faire son droit ? Il doit être en première année, je vais filer vers l’École, je l’attendrai à la porte des cours.
Allons ! c’est entendu.
Je sais le chemin : c’est celui du Grand concours, au-dessus de la Sorbonne.
M’y voici !
Je recommence pour les étudiants ce que j’ai fait pour les fruitières. Je cours après chacun de ceux qui me paraissent ressembler à Royanny ; je m’abats sur des vieillards à qui je fais peur, sur des garçons qui tombent en garde, je m’adresse à des Royanny, qui n’en sont pas ; j’ai l’air hagard, le geste fiévreux.
Ce qui me fatigue horriblement, c’est mon paletot d’hiver que j’ai gardé pour la nuit en diligence et que j’ai porté avec moi depuis mon arrivée, comme un escargot traîne sa coquille, ou une tortue sa carapace.
Le laisser aux Messageries c’était l’exposer à être égaré, volé. Puis il y avait un grain de coquetterie ; ma mère a dit souvent que rien ne faisait mieux qu’un pardessus sur le bras d’un homme, que ça complétait une toilette, que les paysans, eux, n’avaient pas de pardessus, ni les ouvriers, ni aucune personne du commun.
J’ai jeté mon pardessus sur mon bras avec une négligence de gentilhomme.
Ce pardessus est jaune – d’un jaune singulier, avec de gros boutons qui font un vilain effet sur cette étoffe raide. Cet habit a l’air d’avoir la colique.
On ne le remarquait pas, ou du moins je ne m’en suis pas aperçu, dans la rue des Vieux-Augustins ou sur les boulevards, mais ici il fait sensation. On croit que je veux le vendre ; les jeunes gens se détournent avec horreur, mais les marchands d’habits approchent.
Ils prennent les basques, tâtent les boutons, comme des médecins qui soignent une variole, et s’en vont ; mais aucun ne m’offre un prix. Ils secouent la tête tristement, comme si ce drap était une peau malade et que je fusse un homme perdu.
Et il pèse, ce pardessus !
Avec mes courses vers l’un, vers l’autre, le grand air, et ce poids d’étoffe sur le bras, j’en suis arrivé à l’épuisement, à la fringale, à l’ivrognerie !
J’ai déjà mangé un petit pain, bu deux canons de la bouteille, et j’ai encore soif et j’ai encore faim ! La boulimie s’en mêle !
Pas de Matoussaint, pas de Royanny !
Je me suis décidé à entrer dans les amphithéâtres. J’ai produit une émotion profonde, mais n’ai pas aperçu ceux que je cherchais.
Les salles se vident une à une. Un à un les élèves s’éloignent, les professeurs se retirent. On n’a vu que moi dans les escaliers, dans la cour, – moi et mon paletot jaune.
Le concierge m’a remarqué, et au moment de faire tourner la grosse porte sur ses gonds, il jette sur ma personne un regard de curiosité ; il me semble même lire de la bonté dans ses yeux.
Il a dû voir bien des timides et des pauvres depuis qu’il est dans cette loge. Il a entendu parler de plus d’une fin tragique et de plus d’un début douloureux, dans les conversations dont son oreille a saisi des débris. Il me renseignerait peut-être.
Je n’ose, et me détourne en sifflotant comme un homme qui a mené promener son chien ou qui attend sa bonne amie, et qui a pris un pardessus jaune, parce qu’il aime cette couleur-là.
La porte tourne, tourne, elle grince, ses battants se rejoignent, ils se touchent – c’est fini !
Elle me montre une face de morte. Je ne sais où est Matoussaint, je n’ai pu retrouver Royanny. J’irai coucher dans la rue où est le garni à six sous.
Je montre le poing à cette maison fermée qui ne m’a pas livré le nom d’un ami chez lequel je pourrais quêter un asile et un conseil.
Pourquoi n’ai-je pas parlé à ce portier qui me semblait un brave homme ? Poltron que je suis !
Ah ! s’il sortait !…
Il sort.
Je l’aborde courageusement ; je lui demande – qu’est-ce que je lui demande donc ? – Je ne sais, j’hésite et je m’embrouille ; il m’encourage et je finis par lui faire savoir que je cherche un nommé Royanny et que l’École doit avoir son adresse, puisque Royanny est étudiant en droit.
« Allez voir le secrétaire de la Faculté, M. Reboul. »
Il rentre dans l’École avec moi et m’indique l’escalier.
M. Reboul m’ouvre lui-même – un homme blême, lent, l’air triste, la peau des doigts grise.
« Que désirez-vous ? Les bureaux sont fermés… Vous avez donc quelqu’un avec vous ? »
Il regarde au coin de la porte. C’est que j’ai planté là mon paletot jaune qui a l’air d’un homme ; M. Reboul a peur et il me repousse dans l’escalier.
Le gardien me recueille, je ressaisis mon paletot comme on lève un paralysé et je m’en vais, tandis que M. Reboul se barricade.
« Écoutez, me dit le concierge, je vais prendre sur moi de regarder dans les registres, en balayant. Faites comme si vous étiez domestique et descendez dans la salle des inscriptions. »
Je fais comme si j’étais domestique. Je mets ma coiffure dans un coin et je retrousse mes manches. Ah ! si j’avais un gilet rouge au lieu d’un paletot jaune !
Nous entrons dans la salle du secrétariat et l’on cherche à l’R.
Ro… Ro… Royanny (Benoît), rue de Vaugirard, 4.
Le concierge s’empresse de fermer le registre et de le remettre en place.
Je le remercie.
« Ce n’est rien, rien. Mais filez vite ! M. Reboul va peut-être venir et il est capable de crier au secours s’il voit encore votre paletot ! »
[1] Marchand de vin.
3. Hôtel Lisbonne
4, rue de Vaugirard… Hôtel Lisbonne ? C’est au coin de la rue Monsieur-le-Prince.
Je demande M. Royanny.
« Il n’y est pas. Qu’est-ce que vous lui voulez ? Vous êtes de Nantes, peut-être ?… »
La concierge qui est une gaillarde me questionne brusquement et d’affilée.
« Je ne suis pas de Nantes, mais j’ai été au collège avec lui.
– Ah ! vous avez été à Nantes ? Vous connaissez M. Matoussaint ?
– M. Matoussaint ? oui. »
Je lui conte mon histoire. C’est justement après M. Matoussaint que je cours depuis cinq heures du matin !…
« En voilà un qui est drôle, hein ! Il demeure en haut, à côté de M. Royanny – qui répond pour lui, vous sentez bien – Matoussaint n’a pas le sou… c’est un pané… ça écrit. »
Les concierges m’ont l’air tous du même avis pour les écrivains.
« Et Matoussaint est chez lui ?
– Non, mais il ne ratera pas l’heure du dîner, allez ! vous le verrez rentrer avec sa canne de tambour-major et son chapeau de jardinier quand on sonnera la soupe. »
Je vois, en effet, au bout d’un instant, par la cage de l’escalier, monter un grand chapeau sous lequel on ne distingue personne – les ailes se balancent comme celles d’un grand oiseau qui emporte un mouton dans les airs.
« C’est toi ?…
– Matoussaint !
– Vingtras ! »
Nous nous sommes jetés dans les bras l’un de l’autre et nous nous tenons enlacés.
Nous sommes enlacés.
Je n’ose pas lâcher le premier, de peur de paraître trop peu ému, et j’attends qu’il commence. Nous sommes comme deux lutteurs qui se tâtent – lutte de sensibilité dans laquelle Matoussaint l’emporte sur Vingtras. Matoussaint connaît mieux que moi les traditions et sait combien de temps doivent durer les accolades ; quand il faut se relever, quand il faut se reprendre. Il y a longtemps que je crois avoir été assez ému, et Matoussaint me tient encore très serré.
À la fin, il me rend ma liberté : nous nous repeignons, et il me demande en deux mots mon histoire.
Je lui conte mes courses après Torchonette.
« Il n’y a plus de Torchonette : celle que j’aime maintenant se nomme Angelina. Je vais t’introduire. Suis-moi. » – Et il m’emmène devant mademoiselle Angelina.
« Je te présente un frère – un second frère, Vingtras, dont je t’ai parlé souvent, et qui vient rompre avec nous le pain de la gaieté, (se tournant vers moi), tu viens pour ça, n’est-ce pas ?
« Notre avenir doit éclore
Au soleil de nos vingt ans.
Aimons et chantons encore,
La jeunesse n’a qu’un temps !
« Tous au refrain, hé, les autres !
« Aimons et chantons encore,
La jeunesse n’a qu’un temps ! »
Angelina est une grande maigre, pâle, au nez pointu, mais aux lèvres fines.
« Ah ! tu sais, dit-elle, après être allée au refrain, le boulanger est venu, et il a dit qu’il ne monterait plus de jocko[1] si on ne lui payait pas la dernière note.
– Et Royanny ?
– Royanny ! il est sorti pour voir si on voudrait lui prendre son pantalon au clou de la Contrescarpe, on n’en a pas voulu au Condé. »
Matoussaint, qui vient d’accrocher son chapeau immense à une patère dans le mur (comme un Grec accroche son bouclier), Matoussaint se gratte le front.
« Tu vois, frère, la misère nous poursuit. »
Frère ? – Ah ! c’est moi ! – Je n’y pensais plus. Je n’ai jamais eu de frère et je ne puis pas me faire à cette tendre appellation, du premier coup.
« Mais, dis-donc, fait-il en changeant de ton, tu débarques ? Tu dois avoir de l’argent ? Les arrivants ont toujours le sac. »
Je dépose mon bilan.
Angelina me regarde d’un air de mépris.
« Et ça, dit Matoussaint en se précipitant sur ce qui me suit et qu’on a pris tour à tour, depuis ce matin, pour un malade et pour un voleur ; ça, ça peut se mettre au clou. »
Angelina hausse les épaules jusqu’au plafond.
« On peut le vendre, toujours ! Veux-tu le vendre ? Tiens-tu à cette jaunisse ?
– Non… »
Un « non » hypocrite.
Pauvre vieux paletot ! il est bien laid et il m’a valu aujourd’hui bien des humiliations, mais j’étais habitué à lui comme à un meuble de notre maison. Il m’a tenu trop chaud et il était trop lourd sur mon bras toute cette après-midi, mais la nuit il m’a empêché de grelotter. J’aurai encore des nuits froides dans la vie ! Les hivers qui viendront, il pourrait me servir de couverture si mon lit n’en a qu’une. Puis, il a été sur le dos de mon père, le professeur, avant de m’être abandonné ! Les élèves en ont ri, mais c’était une gaieté d’enfants ; ce n’était pas la brutalité d’une vente au rabais, ni la mise à l’encan d’une vieille chose, qui, toute ridicule qu’elle fût, avait son odeur de relique…
Cela n’a duré qu’un instant. C’est bien mauvais signe, si j’ai de ces sensibilités-là, à l’entrée de la carrière !
« Pstt, pstt, ho ! hé ! marchand d’habits ! »
Le marchand d’habits est monté et nous a donné quarante sous de la relique.
Ces quarante sous, ajoutés aux huit sous qui me restent, apportent la gaieté dans la mansarde.
Du pain, un litre, et des côtelettes à la sauce : il y a tout cela dans nos quarante-huit sous !
C’est moi qui irai commander. – Je dirai : « Des côtelettes avec beaucoup de cornichons », et, quand le garçon viendra avec la boîte en fer-blanc, je lui donnerai deux sous de pourboire ; je lui donnerai même trois sous au lieu de deux, j’ai le droit de faire des folies au péril de mon avenir.
Nous avons bien dîné, ma foi !
On a tiré au sort à qui aurait la dernière rondelle de cornichon, on a trouvé encore de quoi acheter un gros pain, de quoi prendre son café, et l’on a braillé, ri et chanté, jusqu’à ce qu’Angelina ait dit qu’il était temps de chercher où me coller pour la nuit.
La concierge à qui l’on a parlé de l’affaire Truchet me logerait bien s’il y avait de la place, et me ferait crédit d’une demi-semaine. Mais tout est pris.
Elle se rappelle heureusement que les Riffault lui ont parlé d’un cabinet qui est libre. Les Riffault tiennent un hôtel rue Dauphine, 6, près du café Conti.
Elle écrit avec son orthographe de portière un mot pour les Riffault qu’elle connaît, et qui ont été concierges, comme elle, avant de s’établir.
Avec ce mot, gras comme les doigts du charcutier qui a vendu les côtelettes, je vais en compagnie de Matoussaint, rue Dauphine, et quoiqu’il soit minuit, on m’ouvre et l’on me conduit au cabinet libre.
J’y arrive par une espèce d’échelle à marches pourries qui a pour rampe une corde moisie et graisseuse ; au sommet, entre quatre cloisons, une chaise dépaillée, une table cagneuse, un lit tout bas, en bois rouge, recouvert d’une couverture de laine poudreuse – poudreuse comme quand la laine était sur le dos du mouton ; – l’air ébranle la fenêtre disjointe et passe par un carreau brisé.
Matoussaint lui-même semble effrayé ; il a failli se casser les reins en descendant l’échelle.
« Tu es tombé ?
– Non. »
Mais je sais que Matoussaint n’aime pas à avouer qu’il est tombé, et il riait toujours (bien jaune) quand il lui arrivait de prendre un billet de parterre au collège ; il disait que c’était exprès.
JE SUIS CHEZ MOI !
Ce cabinet est misérable, mais je n’ouvrirai cette porte qu’à qui il me plaira, je la fermerai au nez de qui je voudrai ; j’écraserais dans la charnière les doigts de ceux qui refuseraient de filer, je ferais rouler au bas de cette échelle le premier qui m’insulterait, dussé-je rouler avec lui, si je ne suis pas le plus fort, ce qui est possible, mais on dégringolerait tous les deux.
JE SUIS CHEZ MOI !
Je rôde là-dedans comme un ours, en frottant les murs…
JE SUIS CHEZ MOI !
Je le crierais ! Je suis forcé de mettre ma main sur ma bouche pour arrêter ce hurlement d’animal…
Il y a deux heures que je savoure cette émotion.
Je finis par m’étendre sur mon lit maigre, et par les carreaux fêlés je regarde le ciel, je l’emplis de mes rêves, j’y loge mes espoirs, je le raye de mes craintes ; il me semble que mon cœur – comme un oiseau – plane et bat dans l’espace.
Puis, c’est le sommeil qui vient… le songe qui flotte dans mon cerveau d’évadé…
À la fin mes yeux se ferment et je m’endors tout habillé, comme s’endort le soldat en campagne.
Le matin, au réveil, ma joie a été aussi grande que la veille.
Il venait justement un soleil tout clair d’un ciel tout bleu, et des bandes d’or rayaient ma couverture terne ; dans la maison une femme chantait, des oiseaux piaillaient à ma fenêtre.
On m’a fait cadeau d’une fleur. C’est la petite Riffault à qui l’on avait donné plein son tablier d’œillets rouges, et qui, voyant ma porte ouverte, m’a crié du bas de l’échelle : « Veux-tu un œillet, monsieur ? »
Je l’ai mis dans un gros verre qui traînait sur la table boiteuse.
C’eût été une fiole de mousseline, une coupe de cristal, que j’aurais été moins heureux : dans le fond de ce verre je relisais les pages de ma vie de campagne et j’entendais vibrer des refrains d’auberge.
On avait de ces gros verres-là dans les cabarets de la Haute-Loire…
Quand je quitte la maison Riffault, lorsque je sors de cet hôtel, ce chez moi, je trouve la rue bourrée, pleine de monde et pleine de vie.
Je regarde l’heure dans une boutique, deux heures. Je me suis réveillé à huit, j’ai entendu l’horloge. Mais depuis lors, le bruit des horloges a été couvert par le bourdonnement de mes pensées et de mes rêves.
J’arrive chez Matoussaint. On me croyait mort, ou reparti, on ne savait que penser ! « Qu’as-tu fait tout ce temps-là ?
« Et tu n’as pas faim ?
– Non. »
Et c’est vrai, je n’ai pas faim. Une fièvre de liberté nouvelle m’a nourri et soutenu. Je consens pourtant à rompre le pain béni de la gaieté, si pain il y a. Il n’y a pas que la gaieté, et l’appétit.
Mais Truchet est peut-être revenu ! Allons voir Truchet ! Comme Mercadet[2] dit : « Allons voir Godeau ! »
Truchet est peut être revenu. Il a peut-être retrouvé le postillon. Il y a peut-être quarante francs qui attendent aux Messageries ! Quarante francs, et ici nous n’avons pas de pain !
On reste pourtant jusqu’au soir dans le quartier parce qu’il y a quelqu’un qui doit apporter cinq francs. On atteint la nuit en l’attendant.
On est allé voir si Truchet était de retour.
– Dans trois jours.
Comment on a fait pour manger ces trois jours-ci, je ne sais pas. Mais on a mangé ; seulement il a fallu du temps pour trouver, c’est un travail comme un autre de recueillir son dîner dans la bohème et qui finit par être payé comme tout travail mais on ne peut faire autre chose et l’estomac ne passe à la caisse qu’à des heures irrégulières. La vie de nous tous passe à cela. Et il a fallu courir, engager, emprunter !
Ce n’est pas assez pour moi – et déjà je souffre de ce tapage en l’air, de ces courses pour du saucisson, de ces haltes devant les bocaux de prunes ; je souffre de plus, encore… et je n’ose leur dire.
Il me semble qu’on ressemble un peu à des mendiants, sur notre carré.
Enfin j’ai touché mon argent ! M. Truchet est revenu.
J’ai gardé six francs pour les Riffault. Mon chez moi me coûte six francs ; il faut ce qu’il faut !
J’ai donné le reste à Angelina pour la pot-bouille.
Dès le premier jour on a détourné de la caisse à pot-bouille six autres francs pour aller au théâtre. Après un bon dîner, on est descendu sur la Porte-Saint-Martin où se joue la pièce qu’on veut voir : la Misère, par M. Ferdinand Dugué.
On boit en route et Matoussaint est très lancé.
Le rideau se lève.
Le héros (c’est l’acteur Munié) arrive avec un pistolet sur la scène.
Il hésite : « Faut-il vivre honnête ou assassiner ? Sera-ce la vie bourgeoise ou l’échafaud ? »
Matoussaint crie : « L’échafaud ! l’échafaud ! »
Les quarante francs y ont passé.
On s’est bien amusé pendant dix jours, et je n’ai pas songé une minute au moment où l’on n’aurait plus le sou.
Ce moment est arrivé ; il ne reste pas cinquante centimes à partager entre l’hôtel Lisbonne et l’hôtel Riffault.
Je viens de remonter mon échelle, de fermer ma porte. Je n’ai mangé que du bout des dents à dîner, il y avait trop peu, mais j’ai acheté un quignon de pain bis pour le croquer dans mon taudis.
Il n’est que huit heures.
La soirée sera longue dans ce trou, mais j’ai besoin d’être seul ; j’ai besoin d’entendre ce que je pense, au lieu de brailler et d’écouter brailler, comme je fais depuis huit jours. Je vis pour les autres depuis que je suis là ; il ne me reste, le soir, qu’un murmure dans les oreilles, et la langue me fait mal à force d’avoir parlé ; elle me brûle et me pèle à force d’avoir fumé.
Ce verre d’eau, tiré de ma carafe trouble, me plaît plus que le café noir de l’hôtel Lisbonne ; mes idées sont fraîches, je vois clair devant moi, oh ! très clair !
C’est la misère demain.
Matoussaint assure que ce n’est rien.
Est-ce que Schaunard, Rodolphe, Marcel, n’en ont pas de la misère, et est-ce qu’ils ne s’amusent pas comme des fous en ayant des maîtresses, en faisant des vers, en dînant sur l’herbe, en se moquant des bourgeois ?
Je n’ai pas encore dîné sur l’herbe ; je n’ai presque pas dîné même, pour bien dire.
Pauvre mère Vingtras, elle m’a prédit que je regretterais son pot-au-feu ! Peut-être bien…
Je lui ai écrit pour lui annoncer mon installation à l’hôtel Riffault, dans une chambre très propre. J’avais ajouté que j’avais fait connaissance de gens qui pourraient m’être très utiles ( !).
Je veux parler de Matoussaint, d’Angelina, de Royanny. – Ils m’ont été utiles, en effet, pour le paletot jaune, et ils peuvent me donner l’adresse de tous les monts-de-piété du quartier.
Ma mère m’a répondu.
Il tombe de sa lettre un papier rouge. Bon pour quarante francs, écrit en travers. C’est un mandat de poste !
Un mot joint au mandat :
« Ton père t’enverra quarante francs tous les mois. »
Quarante francs tous les mois !
Je n’y comptais pas, je croyais que les quarante francs du père Truchet étaient quarante francs une fois pour toutes.
Quarante francs !…
On peut payer son loyer, acheter bien du pain et des côtelettes à la sauce, et même aller voir la Misère à la Porte-Saint-Martin avec quarante francs par mois !…
J’ai eu de l’émotion, en présentant mon mandat rouge à la poste.
J’avais peur qu’on me prît pour un faussaire.
Non ! j’ai reçu huit belles pièces de cinq francs !…
Je les ai emportées dans mon grenier, et toute la journée, j’ai fait des comptes.
J’ai établi mon bilan.
Revoyons cela !
TABAC. – Trois sous à fumer par jour.
JOURNAUX. – Le Peuple, de Proudhon, tous les matins.
CABINET DE LECTURE. – Si je rayais cet article, ce ne serait pas seulement 3 francs, ce serait 4 fr. 50 c. que j’économiserais, puisque je compte trente sous de chandelle pour pouvoir lire, en rentrant chez moi, les ouvrages de location. Mais non ! C’est là le plus clair de ma joie, le plus beau de ma liberté, sauter sur les volumes défendus au collège, romans d’amour, poésies du peuple, histoires de la Révolution ! Je préférerais ne boire que de l’eau et m’abonner chez Barbedor ou chez Blosse.
BLANCHISSAGE. – Mon blanchissage de gros ne me coûtera rien. Tous les dix jours, je confierai mon linge au conducteur de la diligence de Nantes, qui se charge de le remettre sale à ma mère et de le rapporter propre à son fils. Mais je consacre un franc à mes faux cols ; je voudrais qu’ils ne me fissent qu’une fois, mes parents voudraient deux. Vingt sous pour le fin, ce n’est pas trop.
ENTRETIEN. – Je puis me raccommoder avec un sou de fil et un sou d’aiguilles.
CHAMBRE. – C’est six francs.
NOURRITURE. – 21 francs. C’est assez.
Il me reste 1 fr. 25 cent. pour dépenses imprévues. Il faut toujours laisser quelque chose pour les dépenses imprévues. On ne sait pas ce qui peut arriver.
J’étouffe de joie ! j’ai besoin de boire de l’air et de fixer Paris. Je tends le cou vers la croisée. Je la croyais ouverte : elle était fermée, et je casse un carreau. Comme j’ai bien fait d’ouvrir un compte pour le casuel !
Je suis allé changer mes pièces de cent sous pour faire des petits tas, sur lesquels je pose une étiquette : Tabac, savon de Marseille, Entretien.
Il faut de l’ordre, pas de virements.
J’ai filé chez Barbedor, passage du Pont-Neuf. C’est lui qui a le plus de pièces et de romans.
« Je veux un abonnement.
– C’est trois francs.
– Les voilà.
– Et cent sous pour le dépôt. »
Malheureux, je n’avais pas songé au dépôt !
J’ai dû balbutier, me retirer… Faut-il remonter chez moi et prendre sur les autres tas ?
J’entrerais là dans une voie trop périlleuse ! Mieux vaut attendre et tâcher d’amasser pour ce petit cautionnement.
Ces cent sous me firent bien faute ! Je dus vivre sur mon propre fonds, pendant que les autres, qui avaient cent sous de dépôt, avaient à leur disposition tous les bons livres. Il est vrai que j’eus trois francs de plus à consacrer à ma nourriture ou à mes plaisirs ; j’économisais aussi sur la chandelle ; mais je ne pénétrai dans la littérature contemporaine que tard, faute de ce premier capital.
[1] Suite au succès de la pièce de théâtre « Jocko ou le Singe du Brésil » en 1825, toutes sortes de choses reçurent le nom de Jocko : robes, éventails, coiffures, couleurs et un pain.
[2] Personnage d’une pièce de Balzac. « Allons voir Godeau » est la réplique qui termine la pièce.
4. L’avenir
Et maintenant, Vingtras, que vas-tu faire ?
Ce que je vais faire ? Mais le journaliste, que j’ai connu avec Matoussaint, n’est-il pas là, pour me présenter comme apprenti dans l’imprimerie du journal où il écrivait ?
Je cours chez lui.
Il me rit au nez.
« Vous, ouvrier !
– Mais oui ! et cela ne m’empêchera pas de faire de la révolution – au contraire ! J’aurai mon pain cuit, et je pourrai parler, écrire, agir comme il me plaira.
– Votre pain cuit ? Quand donc ? Il vous faudra d’abord être le saute-ruisseau de tout l’atelier ; à dix-sept ans, et en en paraissant vingt ! Vous êtes fou et le patron de l’imprimerie vous le dira tout le premier ! Mais c’est bien plus simple, tenez ! Passez-moi mon paletot, mettez votre chapeau et allons-y ! »
Nous y sommes allés.
Il avait raison ! On n’a pas voulu croire que je parlais pour tout de bon.
L’imprimeur m’a répondu :
« Il fallait venir à douze ans.
– Mais à douze ans, j’étais au bagne du collège ! Je tournais la roue du latin.
– Encore une raison pour que je ne vous prenne pas ! Par ce temps de révolution, nous n’aimons pas les déclassés qui sautent du collège dans l’atelier. Ils gâtent les autres. Puis cela indique un caractère mal fait, ou qu’on a déjà commis des fautes… Je ne dis point cela pour vous qui m’êtes recommandé par monsieur, et qui m’avez l’air d’un honnête garçon. Mais, croyez-moi, restez dans le milieu où vous avez vécu et faites comme tout le monde. »
Là-dessus, il m’a salué et a disparu.
« Que vous disais-je ? a crié le journaliste. Vous vous y prenez trop tard, mon cher ! Des moustaches, un diplôme !… Vous pouvez devenir cocher avec cela et avec le temps, mais ouvrier, non ! Je suis forcé de vous quitter. À bientôt. »
Je suis resté bête et honteux au milieu de la rue.
Eh bien non ! je n’ai pas lâché prise encore ! et dans ce quartier d’imprimerie j’ai rôdé, rôdé, comme le jour où je cherchais Torchonette.
J’ai attendu devant les portes, les pieds dans le ruisseau ; dans les escaliers, le nez contre les murs ; il a fallu que deux patrons imprimeurs m’entendissent !
Ils m’ont pris, l’un pour un mendiant qui visait à se faire offrir cent sous ; l’autre pour un poète qui voulait être ouvrier pendant quatre jours afin de ressembler à Gilbert ou à Magut.
Il ne faut pas songer au bonnet de papier et au bourgeron bleu !
Quel autre métier ? – Celui de l’oncle menuisier, celui de Fabre cordonnier ? Je me suis gardé d’en rien dire au journaliste ni à Matoussaint, ni à sa bande, mais je suis allé dans les gargotes m’asseoir à côté de gens qui avaient la main vernissée de l’ébéniste ou le pouce retourné du savetier. J’ai lié connaissance, j’ai payé à boire, j’ai dérangé mon budget, crevé mon bilan, quitte à ne pas manger les derniers du mois !
Tous m’ont découragé.
L’un d’eux, un vieux à figure honnête, les joues pâles, les cheveux gris, m’a écouté jusqu’au bout, et puis, avec un sourire douloureux, m’a dit :
« Regardez-moi ! Je suis vieux avant l’âge. Pourtant je n’ai jamais été un ivrogne ni un fainéant. J’ai toujours travaillé, et j’en suis arrivé à cinquante-deux ans, à gagner à peine de quoi vivre. C’est mon fils qui m’aide. C’est lui qui m’a acheté ces souliers-là. Il est marié, et je vole ses petits enfants. »
Il parlait si tristement qu’il m’en est venu des larmes.
« Essuyez ces yeux, mon garçon ! Il ne s’agit pas de me plaindre, mais de réfléchir. Ne vous acharnez pas à vouloir être ouvrier !
« Commençant si tard, vous ne serez jamais qu’une mazette, et à cause même de votre éducation, vous seriez malheureux. Si révolté que vous vous croyiez, vous sentez encore trop le collège pour vous plaire avec les ignorants de l’atelier ; vous ne leur plairiez pas non plus ! vous n’avez pas été gamin de Paris, et vous auriez des airs de monsieur. En tous cas, je vous le dis : au bout de la vie en blouse, c’est la vie en guenilles… Tous les ouvriers finissent à la charité, celle du gouvernement ou celle de leurs fils…
– À moins qu’ils ne meurent à la Croix-Rousse !
– Avez-vous donc besoin d’être ouvrier pour courir vous faire tuer à une barricade, si la vie vous pèse !… Allons ! prenez votre parti de la redingote pauvre, et faites ce que l’on fait, quand on a eu les bras passés par force dans les manches de cet habit-là. Vous pourrez tomber de fatigue et de misère comme les pions ou les professeurs dont vous parlez ! Si vous tombez, bonsoir ! Si vous résistez, vous resterez debout au milieu des redingotes comme un défenseur de la blouse. Jeune homme, il y a là une place à prendre ! Ne soyez pas trop sage pour votre âge ! Ne pensez pas seulement à vous, à vos cent sous par jour, à votre pain cuit, qui roulerait tous les samedis dans votre poche d’ouvrier… C’est un peu d’égoïsme cela, camarade !… On ne doit pas songer tant à son estomac quand on a ce que vous semblez avoir dans le cœur ! »
Il s’arrêta, il m’étreignit la main et partit.
Il doit être depuis longtemps dans la tombe. Peut-être mourut-il le lendemain. Je ne l’ai pas revu.
C’est lui qui a décidé de ma vie !
C’est ce vieillard me montrant d’abord le pain de l’ouvrier sûr au début, mais ramassé dans la charité au bout du chemin, puis accusant ma jeunesse d’être égoïste et lâche vis-à-vis de la faim ; c’est lui qui me fit jeter au vent mon rêve d’un métier. Je rentrai parmi les bacheliers pauvres.
…………………
J’ai été triste huit grands jours, mais c’est l’automne ! Le Luxembourg est si beau avec ses arbres dorés sur bronze, et les camarades sont si insouciants et si joyeux ! Je laisse rire et rêver mes dix-sept ans !
Nous arrosons notre jeunesse de discussions à tous crins, de querelles à tout propos, de soupe à l’oignon et de vin de quatre sous !
Le vin à quat’ sous,
Le vin à quat’ sous.
« Comme il est bon ! » disait Matoussaint en faisant claquer sa langue.
Matoussaint le trouvait peut-être mauvais, mais dans son rôle de chef de bande il faisait entrer l’insouciance du jeûne, comme des punaises, et la foi dans les liquides bon marché.
Il n’était pas à jeter après tout, ce petit vin à quatre sous !
Comme j’ai passé de bonnes soirées sous ce hangar de la rue de la Pépinière, à Montrouge, où il y avait des barriques sur champ, et qui était devenu notre café Procope ; où l’on entendait tomber le vin du goulot et partir les vers du cœur ; où l’on ne songeait pas plus au lendemain que si l’on avait eu des millions ; où l’on se faisait des chaînes de montre avec les perles du petit bleu roulant sur le gilet ; où, pour quatre sous, on avait de la santé, de l’espoir et du bonheur à revendre. Oui, j’ai été bien heureux devant cette table de cabaret, assis sur les fûts vides !
Quand on revenait, la mélancolie du soir nous prenait, et nos masques de bohèmes se dénouaient ; nous redevenions nous, sans chanter l’avenir, mais en ramenant silencieusement nos réflexions vers le passé.
À dix minutes du cabaret on criait encore, mais un quart d’heure après, la chanson elle-même agonisait, et l’on causait – on causait à demi-voix du pays ! – On se mettait à deux ou trois pour se rappeler les heures de collège et d’école, en échangeant le souvenir de ses émotions. On était simples comme des enfants, presque graves comme des hommes, on n’était pas poète, artiste ou étudiant, on était de son village.
C’était bon, ces retours du petit cabaret où l’on vendait du vin à quatre sous.
Nous avons fait une folie une fois, nous avons pris du vin fin, un muscat qu’on vendait au verre, un muscat qui me sucre encore la langue et qu’on nous reprocha bien longtemps.
Nous tenions la caisse, cette semaine-là, Royanny et moi. Boire du muscat, c’était filouter, trahir !
Nous fûmes traîtres pour deux verres.
Si toutes les trahisons laissent si bon goût, il n’y a plus à avoir confiance en personne.
Voilà le seul extra, la seule folie, le seul luxe de ma vie de Paris, depuis que j’y suis.
Il y a aussi l’achat d’un géranium et d’un rosier, puis d’une motte de terre où étaient attachées des marguerites. Chaque fois que j’avais trois sous que je pouvais dérober à la colonie – sans voler (c’était assez du remords du muscat) – chaque fois, j’allais au Quai aux fleurs cueillir du souvenir. Pour mes trois sous j’emportais la plante ou la feuille qui avait le plus l’odeur du Puy ou de Farreyrolles ; j’emportais cela en cachette, entre mon cœur et ma main, comme si je devais être puni d’être vu ! tant j’avais envie – et besoin aussi – dans cette boue de Paris, de me réfugier quelquefois dans les coins heureux de ma première jeunesse !
Un malheur !
Mon petit cabinet de l’hôtel Riffault m’a été pris un mois après mon arrivée. Les propriétaires ont fait rafraîchir la maison, et l’on a renversé mon échelle, profané ma retraite ; on a fait un grenier de ce qui avait été mon paradis d’arrivant… J’ai dû partir, chercher ailleurs un asile.
Je n’ai rien trouvé à moins de dix francs. Les loyers montent, montent !
J’ai fait toutes les maisons meublées de la rue Dauphine, chassé de chacune par l’odeur des plombs ou le bruit des querelles. Je voulais le calme dans le trou où j’allais me nicher. Je suis tombé partout sur des enfants criards ou des voisins ivrognes.
Je n’ai eu un peu de sérénité que dans une maison où ma chambre donnait sur le grand air ! J’étais bien seul et je voyais tout le ciel ; mais il y avait au rez-de-chaussée un café par où je devais passer pour rentrer : ce qui m’obligeait à revenir le soir avant que l’estaminet fermât, et me privait des chaudes discussions avec les camarades. Elles étaient bien en train et dans toute leur flamme au moment où il fallait partir. C’était une véritable souffrance, et deux ou trois fois je préférai ne pas regagner mon logis, sortir de l’hôtel Lisbonne à deux heures du matin, et m’éreinter à battre le pavé jusqu’à ce que le café ouvrît l’œil et laissât tomber ses volets.
J’étais bien las de ma rôderie nocturne, et j’avais la tristesse pesante et gelée de la fatigue. J’avais, en plus, à soutenir le regard de la patronne qui m’avait attendu un peu, malgré tout – qui attendait même ma quinzaine quelquefois !…
Elle avait l’air de me dire, quand je rentrais grelottant, fripé et traînant la jambe, que je trouvais bien de l’argent pour passer les nuits, que je ferais mieux d’en trouver pour payer ma chambre.
Elle avait l’habitude de me jeter mes bouquets dans les plombs, si je me permettais d’avoir des bouquets lorsque je restais à devoir encore 4 ou 5 francs.
Son mari était malheureusement un brave homme.
Malheureusement ! Oui, car je l’aurais battu s’il avait été comme elle et je lui aurais fait payer à coups de bottes mes bouquets jetés dans les plombs.
Notre avenir doit éclore ! etc., etc.
Je ne voyais pas éclore mon avenir, et je voyais pourrir mes fleurs.
J’aurais pu prendre du crédit, aller dans des hôtels où étaient les étudiants, à qui on demandait le nom de leurs pères plutôt que la couleur de leur argent. Mon père avait été jugé bon pour une chambre de vingt francs. Tous les camarades faisaient ainsi, mais je ne me croyais pas le droit d’engager le nom de mon père pour avoir quelques punaises de moins, un peu de bonheur de plus !
Si petite qu’elle fût, j’ai pourtant partagé une de mes chambres de dix francs.
Matoussaint avait fait connaissance, je ne sais où, d’un ancien cuirassier – qui attendait de l’argent. C’était sa profession ; il devait nous faire des avances à tous avec cet argent ; il avait promis à Matoussaint d’éditer son Histoire de la Jeunesse à laquelle il avait semblé prendre un intérêt puissant.
« C’est écrit avec des balles », avait-il dit.
Il avait achevé de séduire Matoussaint en lui fournissant des détails militaires, des mots techniques, pour rendre émouvante une attaque de barricade en Juin trente-neuf.
Aussi était-il du bivouac et mangeait-il à notre cantine, au hasard de notre fourchette.
Il manqua de logement à un moment – il lui en fallait un cependant – pour faire adresser l’argent.
« Tu comprends, c’est à toi de le prendre, m’a dit Matoussaint. Royanny et les camarades ont tous des femmes… ils ne peuvent pas faire coucher le cuirassier avec eux. Moi, j’ai Angelina. Mets-toi à ma place. »
À sa place, non. – Angelina était trop maigre !
C’était donc moi, le célibataire, qui devais rendre ce service à la communauté : je n’ai pas osé refuser.
Oh ! quel supplice ! Toujours ce grand cuirassier avec moi ! Il a dit au propriétaire qu’il était mon frère, pour expliquer notre concubinage.
Que dirait ma mère chargée d’un autre fils ? – accusée d’avoir un enfant que mon père ne connaît pas !
Oui, c’est du concubinage ! Ce cuirassier se mêle à mes pensées, entre dans ma vie, m’empêche de dormir, si j’en ai envie, de marcher si ça me prend ; ses jambes tiennent toute la place ! Il a une pipe qui sent mauvais et un crâne qui me fait horreur, dégarni du milieu comme une tête de prêtre ou un derrière de singe. Il me tourne le dos pour dormir, je vois cette place blanche… je me suis levé plusieurs fois pour prendre l’air ; j’avais envie de l’assassiner !
Mais, un beau matin, je n’ai plus senti son grand cadavre près de moi. Il était parti ! parti en emportant mes bottines. J’ai dû attendre la nuit noire pour remonter, en chaussettes, à l’hôtel Lisbonne, j’avais l’air d’un pèlerin, – d’un jeune marin qui avait promis dans un naufrage de porter un cierge, pieds nus ou en bas de laine, à sainte Geneviève.
J’étais le seul célibataire de la bande. Il y a eu bien des raisons !