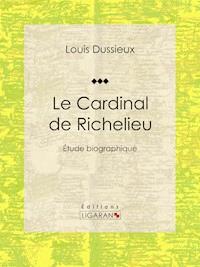
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Armand-Jean du Plessis, cardinal-duc de Richelieu, la terreur de l'Europe, le fléau de la Maison d'Autriche, et le plus grand homme d'État de notre siècle, et peut-être même de la monarchie, dit Sauval, naquit à Paris en 1585."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335050103
©Ligaran 2015
« D’autres hommes, dit Henri Martin, ont aimé la France autant que Richelieu ; aucun ne l’a peut-être si complètement et si profondément comprise ». Pour être en plein dans la vérité, il n’y a qu’à supprimer ce « peut-être ».
C’est la biographie de ce grand Français que je mets sous les yeux du public. On s’y plaît à étudier l’homme qui a donné à la France le rang qu’elle a longtemps occupé dans le monde, qui lui a donné une armée admirable, celle de Rocroi et de Fribourg, une marine également énergique, une administration puissante, une diplomatie habile, ses colonies, qui a développé toutes les forces du pays, qui enfin a créé le grand siècle de la France auquel on aurait dû donner le nom de Richelieu plutôt que celui de Louis XIV, qui y avait moins droit. C’est en effet sous le règne de Louis XIII et par l’influence du Cardinal que paraissent les plus grands esprits du XVIIe siècle. C’est une loi : quand la direction des affaires, le pouvoir, est aux mains d’un homme de haute intelligence, les hommes de valeur se développent librement, facilement, dans ce milieu intelligent ; dans le cas contraire, les hommes de valeur, en tout genre, sont étouffés par le milieu dans lequel ils vivent ; il n’y a de place que pour les intrigants, les médiocrités et les flatteurs.
C’est Richelieu qui a formé la génération des grands diplomates : Mazarin, Servien, Lionne, et celle des grands capitaines : Harcourt, Fabert, Gassion, Guébriant, Turenne, Condé. Nos premiers marins illustres sont de ce temps : M. de Sourdis, le duc de Brézé, les deux Duquesne, le père et le fils. Tous les hommes célèbres qui commencent les diverses séries de nos grands hommes remontent à cette époque : Descartes, Gassendi, Pascal, Fermat, le P. Mersenne, l’illustre Peiresc, dont on imprima, à Rome, l’éloge en quarante langues, – nos plus grands écrivains, ceux qui ont créé la prose française, Pascal, et le théâtre, Corneille et Molière, – nos grands artistes, Poussin, Lesueur, Philippe de Champagne, Claude Lorrain, les Lenain, Callot, les sculpteurs Sarrazin et les deux Anguier, le graveur de médailles Varin, l’architecte Lemercier, – tous ces forts administrateurs civils et militaires, intendants des généralités et des armées, conseillers d’État, Michel Le Tellier entre autres, – tous ces prêtres qui ont donné au clergé une impulsion toute particulière de charité, d’études et de réformes, le cardinal de Bérulle, saint Vincent de Paul, M. Olier. C’est aussi pendant cette époque, à laquelle Louis XIII et Richelieu donnent l’exemple de mœurs sévères, que se forme la société polie qui a été l’honneur et la gloire de notre France avant que le naturalisme, le réalisme et la sotte imitation du sans-gêne américain aient changé nos habitudes, alourdi ou gâté l’esprit français.
Louis XIII et Richelieu sont morts dans un âge peu avancé, en 1642 et 1643. Leur œuvre, qui n’était pas achevée, se continua pendant la régence d’Anne d’Autriche et les premières années de Louis XIV. Mais quand la grande génération fut éteinte et que le vrai règne de Louis XIV commença avec la génération louisquatorzienne, il y eut un arrêt et une baisse très appréciable. L’orgueil du Roi, son omnipotence, son luxe n’étaient pas suffisants pour remplacer la haute intelligence de Richelieu et le bon sens éclairé de Louis XIII. Mais la flatterie n’hésita pas à donner au Roi le nom de Grand, et au siècle le nom du Roi, ce que l’histoire routinière a scrupuleusement conservé.
Plusieurs ouvrages parus dans ces dernières années ont apporté à l’histoire de Louis XIII et à la biographie de son ministre de nombreux et importants documents inédits. M. Avenel a publié la correspondance complète du Cardinal ; M. Marius Topin a fait connaître plus de deux cent cinquante lettres inédites de Louis XIII à Richelieu ; MM. Zeller et Geley, dans de précieuses monographies, nous ont appris des faits jusqu’alors inconnus. Il m’a paru utile de refaire, à l’aide de ces documents nouveaux et des meilleurs documents anciens, une biographie exacte du Cardinal ; de raconter l’histoire si nouvelle de ses débuts dans la vie politique, ce qui ne constitue pas la plus belle page de sa biographie ; d’exposer rapidement l’histoire de son ministère ; de faire connaître les relations réelles et si amicales qui ont existé entre Louis XIII et son ministre ; l’histoire des conspirations continuelles ourdies contre Richelieu par la faction espagnole et les restes de la Ligue, encore très puissants en France et à la Cour ; son caractère, sa vie privée, ses résidences, ses précieuses collections, ses relations avec les gens de lettres, ses ouvrages, ses fondations littéraires, l’usage qu’il sut faire de la publicité et du journalisme qu’il créa ; enfin de mettre sous les yeux du lecteur les détails relatifs à cette santé si débile, qui n’empêcha jamais cet homme toujours malade, mais qui avait une volonté de fer, de se livrer pendant dix-huit ans à un prodigieux travail de jour et de nuit, de diriger la guerre, la diplomatie et l’administration générale, de sortir la France de l’anarchie, de vaincre l’Espagne et l’Autriche, et de laisser sa patrie, à sa mort, la première puissance de l’Europe.
(1585-1616)
« Armand-Jean du Plessis, cardinal-duc de Richelieu, la terreur de l’Europe, le fléau de la Maison d’Au triche, et le plus grand homme d’État de notre siècle, et peut-être même de la monarchie », dit Sauvai, naquit à Paris en 1585.
On lisait dans les registres de la paroisse de Saint-Eustache de Paris :
Le cinquième jour de mai fut baptisé Armand-Jean, fils de messire François du Plessis, seigneur de Richelieu, chevalier des ordres du Roi, conseiller au Conseil d’État, prévôt de son hôtel et grand prévôt de France, et de dame Suzanne de la Porte, sa femme, demeurant en la rue du Bouloy, et ledit enfant fut né le neuvième jour de septembre 1585, les parrains, Messire Armand de Gontaut de Biron, chevalier des ordres du Roi, capitaine de cent hommes d’armes de ses ordonnances et maréchal de France, et messire Jean d’Aumont, aussi maréchal de France, chevalier des ordres du Roi, conseiller en son Conseil d’État, capitaine de cent hommes d’armes desdites ordonnances, et la marraine dame Françoise de Rochechouart, dame de Richelieu, mère dudit François de Richelieu.
François du Plessis, seigneur de Richelieu, père de l’enfant qui venait de naître, était un serviteur dévoué de Henri III, qui lui avait donné la charge de grand-prévôt de France et le collier de l’ordre du Saint-Esprit. Il servit Henri IV avec le même zèle, déploya une grande bravoure à Arques et à Ivry, et devint l’un des capitaines des gardes du Roi. François du Plessis mourut en 1590, laissant trois fils et deux filles : Henri du Plessis, seigneur de Richelieu, devenu maréchal de camp et qui fut tué en duel en 1619, – Alphonse du Plessis, d’abord évêque de Luçon, puis cardinal de Lyon, – Armand-Jean, évêque de Luçon, devenu cardinal et premier duc de Richelieu, – Françoise du Plessis, mariée en secondes noces à René de Vignerot, seigneur du Pont-de-Courlay, – Nicole du Plessis, mariée à Urbain de Maillé, marquis de Brézé, capitaine des gardes de la Reine-Mère, puis des gardes du Roi, et maréchal de France.
Quand Armand du Plessis perdit son père, il n’avait que cinq ans. Sa mère l’éleva sérieusement, et après lui avoir fait commencer ses études sous la direction du prieur de Saint-Florent, elle le mit au collège de Navarre, à Paris, et lui fit faire sa philosophie au collège de Lisieux.
Destiné aux armes, le jeune seigneur du Chillou, tel était le nom que portait alors le futur cardinal de Richelieu, entra à l’académie pour s’y instruire dans les exercices militaires, tout en continuant cependant l’étude des lettres qu’il aimait déjà. Tout à coup, des évènements de famille lui firent abandonner l’épée, et il devint évêque de Luçon. Mais il conserva toujours un goût prononcé pour les choses militaires, et plus d’une fois on verra le Cardinal commander en personne les armées avec une allure qui attestait que le gentilhomme se souvenait encore de ses études à l’académie.
L’évêché de Luçon, auquel Armand du Plessis fut nommé en 1606, semble avoir été, à cette époque, une sorte de propriété de sa famille. Jacques du Plessis, aumônier de Henri III, grand-oncle d’Armand, avait été pourvu de cet évêché et remplacé, à sa mort, par Alphonse du Plessis, frère puîné d’Armand. Mais le mépris des grandeurs et le besoin de la solitude ayant décidé Alphonse du Plessis à abandonner son évêché et à se faire chartreux, la famille du Plessis obtint d’Armand qu’il renonçât à la carrière des armes et à se faire évêque, afin de conserver cet évêché dans la famille.
Dès lors, Armand du Plessis se livra aux études théologiques avec l’ardeur et la volonté qui faisaient déjà le fond de son caractère ; ses efforts opiniâtres et le travail d’esprit furent tels que sa santé commença à s’altérer et resta depuis fort délicate. Ce travail excessif dura deux années, au bout desquelles Henri IV nomma le jeune Armand à l’évêché de Luçon (1606).
La cour de Rome ne se hâtait pas de confirmer le nouvel évêque, à cause de sa jeunesse. Henri IV pressait le cardinal du Perron et son ambassadeur à Rome d’obtenir du Pape la dispense d’âge nécessaire à Armand du Plessis pour tenir son évêché. Las d’attendre, Armand alla à Rome et mit tant de grâce à sa demande que le pape Paul V la lui accorda. Tel fut le succès de la harangue latine qu’il fit au Saint-Père, enchanté de la capacité et de la maturité du jeune prélat, qu’il fut sacré à Rome par le cardinal de Givry, le 17 avril 1607. Il avait alors vingt-deux ans. Revenu en France, il prit avec éclat ses degrés en Sorbonne, et fut reçu docteur le 29 octobre 1607.
Henri IV l’aimait beaucoup et ne l’appelait que « mon évêque » ; il aimait à l’entendre prêcher ; il causait avec lui volontiers, de l’exécution du maréchal de Biron, par exemple. Richelieu aurait pu rester à la Cour, mais il comprit qu’il était trop jeune pour y jouer un rôle important ; il quitta Paris à la fin de 1608 et alla prendre possession de son évêché. Il y remit l’ordre, releva les églises détruites pendant les guerres de religion, menant une vie sévère, que sa pauvreté rendait assez dure, et réfléchissant aux moyens qui lui permettraient de revenir à la Cour et d’y faire fortune.
Il avait été précédé à Luçon par sa réputation de théologien fort savant et de prédicateur distingué. En prenant possession de son évêché, le 21 décembre 1608, il fit cette « petite harangue au peuple » :
Messieurs, venant pour vivre avec vous et faire ma demeure ordinaire en ce lieu, il n’y a rien qui me puisse être plus agréable que de lire en vos visages et reconnaître par vos paroles que vous en ressentez de la joie ; je vous remercie du témoignage que vous me rendez de votre bonne volonté, que je tâcherai de mériter par toutes sortes de bons offices, n’y ayant rien que j’aie en plus grande affection que de vous pouvoir être utile à tous en général et en particulier.
Je sais qu’en cette compagnie il y en a qui sont désunis d’avec nous quant à la croyance ; je souhaite en revanche que nous soyons unis d’affection ; je ferai tout ce qui me sera possible pour vous convier à avoir ce dessein, qui leur sera utile aussi bien qu’à nous et agréable au Roi (Henri IV), à qui nous devons tous complaire.
Le temps vous donnera plus de connaissance de l’affection que je vous porte que mes paroles ; c’est ce qui fait que je me réserve aux effets pour vous faire paraître que toutes mes intentions ne tendent qu’à ce qui est de votre bien.
Nous venons de dire que Richelieu était alors fort pauvre. Les détails authentiques publiés par M. Avenel nous le montrent réellement pauvre, sans maison, sans carrosse, sans meubles convenables à sa position, sans vaisselle plate, sans autres vêtements sacerdotaux que des tuniques et des dalmatiques en mauvais état. Cette pauvreté devait être pénible à un prélat de vingt-cinq ans, qui écrivait en 1610 : « Étant un peu glorieux, je voudrais bien, étant plus à mon aise, paraître davantage ». Pour arriver à Luçon dans un équipage convenable, il avait été obligé d’emprunter à un ami voiture, chevaux et cocher. On le voit bientôt acheter « de rencontre » le lit de velours de sa tante. Il ne peut se procurer une tapisserie de Bergame qu’en donnant en échange la pente du lit de défunt M. de Luçon, de soie et d’or. Il mettra cinq années à se procurer la vaisselle d’argent dont il a envie « pour relever sa noblesse ».
On a de lui plusieurs lettres adressées à une Madame de Bourges, amie de la famille, qui faisait ses affaires à Paris. C’est avec cette correspondance adressée à une amie, et écrite en toute franchise, que l’on peut pénétrer dans l’intérieur du futur cardinal, qui mourra au milieu d’une splendeur capable de satisfaire son « besoin de paraître ».
Voici une lettre écrite par l’évêque de Luçon à Madame de Bourges, à la fin d’avril 1609 :
Madame, j’ai reçu les chappes que vous m’avez envoyées, qui sont venues extrêmement à propos. Elles sont extrêmement belles et ont été reçues comme telles de la compagnie à qui je les devais. Je vous ai un million d’obligations, non pour cela seulement, comme vous pouvez penser, mais pour tant de bons offices, que ce papier n’en peut porter le nombre. Je suis maintenant en ma baronnie, aimé, ce me veut-on faire croire, de tout le monde, mais je ne puis que vous en dire encore, car tous les commencements sont beaux, comme vous savez. Je ne manquerai pas d’occupation ici, je vous assure, car tout y est tellement ruiné qu’il faut de l’exercice pour le remettre. Je suis extrêmement mal logé, car je n’ai aucun lieu où je puisse faire du feu, à cause de la fumée ; vous jugez bien que je n’ai pas besoin de grand hiver, mais il n’y a remède que la patience. Je vous puis assurer que j’ai le plus vilain évêché de France, le plus crotté et le plus désagréable, mais je vous laisse à penser quel est l’évêque. Il n’y a ici aucun lieu pour se promener, ni jardin, ni allée, ni quoi que ce soit, de façon que j’ai ma maison pour prison.
Quelque temps après, il lui écrit encore :
Nous sommes tous gueux en ce pays, et moi le premier, dont je suis bien fâché, mais il y faut apporter remède si on peut.
Un curieux document publié récemment nous apprend ce qui se passait alors dans l’esprit de Richelieu. C’est un mémoire, écrit de sa main en 1610, un peu avant la mort de Henri IV, dont le titre est : Instructions et maximes que je me suis donné (sic) pour me conduire à la Cour. De bonne heure, Richelieu eut l’habitude de rédiger ses pensées, ses projets, de leur donner le corps et la durée que seuls ont les écrits, de composer un mémoire complet sur telle ou telle affaire qu’il voulait mener à bonne fin. Il songeait alors à se fixer à la Cour et à y faire son chemin, en obtenant une charge, par exemple celle de premier aumônier du Roi, charge qui le conduirait un jour à prendre part aux affaires, but qu’il poursuivait évidemment dès cette époque. Il faut lire ce précieux mémoire, où l’homme se révèle tout entier ; je ne puis cependant qu’en donner l’analyse. On y verra toutefois comment Richelieu se propose de gagner le Roi. Il ira faire sa cour au maître tous les jours jusqu’à ce qu’il connaisse l’effet produit par son assiduité ; après, une fois par semaine suffira. Quand le Roi sera à table, il aura soin de cesser de lui parler quand Sa Majesté boira. « Les mots les plus agréables au Roi sont ceux qui élèvent ses royales vertus. Il ne goûte point ceux qui ne parlent hardiment, mais il y faut du respect. Bon de toujours tomber sur cette cadence que ça a été par malheur que jamais on ne lui a pu faire service qu’en petites choses, et qu’il n’y a rien de grand ni d’impossible à une bonne volonté pour un si bon maître et un si grand roi ». – « L’importance est de considérer quel vent tire, et de ne le prendre point sur des humeurs auxquelles il ne se plaît de parler à personne, se cabre à tous ceux qui l’abordent ».
Puis il étudie la manière de se conduire avec les seigneurs et autres qui sont en crédit et faveur envers le maître : il les faut visiter, « et se souvenir qu’il y a des sacrifices pour les dieux nuisibles et favorables : à ceux-ci, afin qu’ils aident ; à ceux-là, afin qu’ils ne fassent point de mal ».
Sur toutes choses, les plus petits détails de cette vie de courtisan sont étudiés, et la manière de faire, de parler, d’écrire, d’écouter est formulée en règles précises. « Parler peu et seulement de ce que l’on sait, et à propos, avec ordre et discrétion ». – « N’avoir point l’esprit distrait, ni les yeux égarés, ni l’air triste ou mélancolique quand quelqu’un parle, et y apporter une vive attention ainsi que beaucoup de grâce, mais plus par l’attention et le silence que par la parole et l’applaudissement ». On le voit, tout est préparé de longue main ; ce manuel de l’homme de Cour recommande de cultiver les gens qui peuvent être utiles : les commis de la poste spécialement, parce que « les lettres sont rendues plus fidèlement et envoyées avec soin et diligence ». Quant aux lettres reçues, « le feu doit garder celles que la cassette ne peut garder qu’avec péril ». Il examine ensuite l’utilité et l’usage de la dissimulation et du silence ; bref, il était prêt à se lancer à la Cour quand Henri IV fut assassiné le 14 mai 1610.
Richelieu dut venir aussitôt à Paris pour prêter le serment de fidélité à la régente, Marie de Médicis. Il accomplit cet acte solennel, le 22 mai 1610, dans la forme suivante :
Nous, Armand-Jean du Plessis de Richelieu, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège apostolique, évêque et baron de Luçon, et les doyen, chanoines, chapitre et clergé dudit lieu, protestons, sur la foi que nous devons au premier auteur de toutes choses, de nous comporter tout le cours de notre vie envers le roi Louis treizième, à présent régnant, tout ainsi que les très humbles, très affectionnés et très fidèles sujets doivent faire envers leur légitime seigneur et roi. En outre, nous certifions que, bien qu’il semble qu’après le funeste malheur qu’une homicide main a épandu sur nous, nous ne puissions plus recevoir de joie, nous ressentons toutefois un contentement indicible de ce qu’il a plu à Dieu, nous donnant la Reine pour régente de cet État, nous départir ensuite de l’extrême mal qui nous est arrivé, le plus utile et nécessaire bien que nous eussions su souhaiter en nos misères, espérant que la sagesse d’une si vertueuse princesse maintiendra toutes choses au point où la valeur et la prudence du plus grand roi que le ciel ait jamais couvert (sic) les ont établies ; nous jurons, sur la part qui nous est promise en l’héritage céleste, de lui porter toute obéissance, et supplions Dieu qu’il nous envoie plutôt la mort que de permettre que nous manquions à la fidélité que nous devons et jurons maintenant au Roi son fils et à elle, que nous désirons avec dévotion être comblés des grâces du Père de bénédictions, afin que nous puissions vivre et mourir sous les lois de ceux qui, obéissant à la souveraine loi, gouverneront heureusement le premier État de l’univers, conduits par la main du Roi des rois du monde.
Richelieu resta à Paris jusqu’en 1611, prêchant plusieurs fois, et avec beaucoup de succès, devant la Cour, en l’église de Saint-André-des-Arcs. Revenu à Luçon, il y résida jusqu’en 1614.
En l’absence de leur évêque, les deux grands vicaires étaient entrés en lutte, et l’un d’eux ayant écrit à Richelieu, celui-ci lui répondit :
Monsieur, j’ai vu la lettre que vous m’écrivez touchant les différends qui sont entre le sieur de la Coussaye et vous. Je ne puis que je ne les blâme, désirant que ceux qui manient les affaires de ma charge vivent paisiblement les uns avec les autres. Je le mande au sieur de la Coussaye et vous en avertis afin que vous vous disposiez l’un et l’autre à vivre en paix. Vous êtes tous deux mes grands vicaires, et, comme tels, vous devez n’avoir autre dessein que de faire passer toutes choses à mon contentement, ce qui se fera, pourvu que ce soit à la gloire de Dieu.
Il semble par votre lettre que vous étiez en mauvaise humeur lorsque vous avez pris la plume ; pour moi, j’aime tant mes amis, que je ne désire connaître que leurs bonnes humeurs, et il me semble qu’ils ne m’en devraient point faire paraître d’autres. Si une mouche vous a piqué, vous la deviez tuer, et non tâcher d’en faire sentir l’aiguillon à ceux qui se sont, par la grâce de Dieu, jusques ici garantis de piqûre. Je sais, Dieu merci, me gouverner, et sais davantage comme ceux qui sont sous moi se doivent gouverner. Vous me mandez qu’il ne vous chaut de ce qui se passe, disant que l’affaire me touche plus qu’à vous. Je trouve bon que vous m’avertissiez des désordres qui sont en mon diocèse ; mais il est besoin de le faire plus froidement, n’y ayant point de doute que la chaleur piquerait en ce temps-ci ceux qui ont le sang chaud comme moi, s’ils n’avaient quelques moyens de s’en garantir.
Vous dites que vous renonceriez volontiers au titre que je vous ai donné ; je l’ai fait pour vous obliger, vous croyant capable de rendre du service à l’Église. Si je me suis trompé en ce faisant, vous désobligeant au lieu de vous gratifier, j’en suis fâché ; mais je vous dirai qu’à toute faute il n’y a qu’amende : je ne force personne de recevoir du bien de moi. Vous prêchez aux autres le libéral arbitre ; il vous est libre de vous en servir.
Quant à ce que vous me témoignez ne trouver pas bon que je ne désire pas mécontenter le sieur de la Coussaye, j’aime mieux que vous soyez mécontent de ce que je veux rendre tout le monde content, que content du mécontentement que je pourrais donner à tout le monde. Je vous écris cette lettre non en l’humeur que vous étiez quand vous m’écrivîtes ; mais je ne laisse pas de rendre mon style conforme au vôtre afin de vous complaire. Au reste, je vous assure que l’affection que je vous ai toujours portée ne diminuera jamais, tandis que vous me témoignerez vouloir vivre avec moi selon que j’ai toujours espéré de vous. J’ai recherché les occasions de vous témoigner ma bonne volonté ; je crois que vous reconnaissez en avoir reçu des témoignages, lesquels je vous rendrais encore si c’était à recommencer, ne regrettant que de n’avoir pas eu le moyen de vous faire paraître quel ami je suis en chose qui vous fût utile. Vous le devez croire, puisque je vous assure que je suis
Votre bien affectionné à vous servir.
En 1613, l’évêque de Luçon était encore dans la gêne et vendait ses tapisseries pour se procurer de l’argent. En mai 1613, il écrivait à Madame de Bourges :
Je vous rends mille grâces de la peine que vous avez eue de vendre ma tapisserie ; par là, vous connaîtrez la misère d’un pauvre moine qui est réduit à la vente de ses meubles et à la vie rustique, ne faisant pas sitôt état de quitter ce séjour pour prendre celui de la ville.
En 1614 cependant l’évêque de Luçon, l’un des députés aux États-Généraux convoqués par Marie de Médicis, revint à Paris et fut chargé par le clergé de remettre au Roi le cahier de son ordre, le jour de la clôture des États (23 février 1615). Il adressa à Louis XIII une harangue, qui lui fit une réputation d’orateur et surtout d’homme politique, et à l’aide de laquelle il s’attira les bonnes grâces de la Reine-Mère. Dès ce moment il est évident que l’ambition commence à le dominer, et il faut convenir qu’il ne fut pas difficile dans le choix du chemin qu’il prit pour parvenir à son but, le pouvoir. La noblesse, la France entière pour mieux dire étaient soulevées contre le gouvernement de Marie de Médicis et de son favori, Concini. Les États s’étaient plaints du désordre général, de la ruine des finances ; la politique espagnole suivie par Marie de Médicis mécontentait tout le monde. Ce fut justement Marie de Médicis à qui Richelieu adressa les éloges les plus grands et les plus immérités. On lit avec étonnement dans le discours que Richelieu adressa au Roi ce qui suit :
Entre une infinité de grâces que V.M. a reçues du ciel, une des plus grandes dont vous lui soyez redevable, est le don et la conservation d’une telle mère ; et entre toutes vos actions, la plus digne et la plus utile au rétablissement de votre État est celle que vous aurez faite, lui en commettant la charge.
Car que ne devez-vous attendre, et que ne devons-nous espérer d’elle, sous les heureux auspices de votre majorité, après qu’en la faiblesse d’une minorité, à la merci de mille orages et d’autant d’écueils, elle a heureusement conduit le vaisseau de l’État dans le port de la paix, où elle l’a fait voir à V.M. avant que lui remettre entre les mains ?
Toute la France se reconnaît, Madame, obligée à vous départir tous les honneurs qui s’accordaient anciennement aux conservateurs de la paix, du repos et de la tranquillité publique.
Elle s’y reconnaît obligée, non seulement à cause qu’avec tant de merveilles, vous nous avez jusqu’à cette heure conservés au repos que les armes invincibles de ce grand Henri nous ont acquis ; mais, en outre, parce que vous avez voulu comme attacher pour jamais la paix à cet État, du plus doux et du plus fort lien qui se puisse imaginer, étreignant par les nœuds sacrés d’un double mariage, dont nous souhaitons et requérons l’accomplissement, les deux plus grands royaumes du monde, qui n’ont rien à craindre étant unis, puisque, étant séparés, ils ne peuvent recevoir de mal que par eux-mêmes.
Vous avez beaucoup fait, Madame ; mais il n’en faut pas demeurer là : en la voie de l’honneur et de la gloire, ne s’avancer et ne s’élever pas, c’est reculer et déchoir. Que, si après tant d’heureux succès, vous daignez encore vous employer courageusement à ce que ce royaume recueille les fruits qu’il se promet, et qu’il doit recevoir de cette assemblée, vous étendrez jusqu’à l’infini les obligations qu’il vous a, attirerez mille bénédictions sur le Roi pour vous avoir commis la conduite de ses affaires ; sur vous, pour vous en être si dignement acquittée ; sur nous, pour la supplication très humble et très ardente que nous faisons à S.M. de vous continuer cette administration. Et lors, vos mérites ajoutant mille couronnes de gloire à celle qui entoure votre chef, pour comble de récompense, le Roi ajoutera aussi au titre glorieux que vous avez d’être sa mère, celui de mère de son royaume, afin que la postérité, qui lira ou entendra proférer votre nom, y aperçoive et reconnaisse les marques de votre piété envers son État, et de la sienne envers vous, voyant que votre zèle envers la France ne vous aura pas plutôt fait mériter un titre de gloire immortelle, que l’amour filial qu’il vous porte ne vous l’ait donné.
Nous croyons, Madame, que vous n’oublierez rien pour faire que cette assemblée, mise en pied par vos conseils, réussisse à notre avantage : les maux qui nous pressent vous y convient ; votre affection envers nous vous y porte ; votre honneur et celui du Roi, qui vous est si cher, le requièrent, et l’intérêt de vos consciences vous y oblige tous deux.
Quinze ans plus tard le cardinal de Richelieu ne tenait plus ce langage et se montrait implacable envers celle qu’il encensait alors. Quoiqu’il en soit, cette harangue « dura une grande heure et fut ouïe de LL. MM. et de toute l’assemblée avec une grande attention », et fut le point de départ de la carrière politique de l’évêque de Luçon. C’est donc à une assemblée représentative, à l’intervention du pays dans ses affaires, que la France doit ce grand ministre, qui commença par être un grand orateur. La langue dans laquelle est écrit ce discours est en effet très remarquable pour l’époque ; elle est claire et forte, et souvent la pensée se détache nettement.
Marie de Médicis ne tarda pas à récompenser son apologiste, et le talent de l’évêque de Luçon justifiait le choix de la Reine-Mère. Dès le commencement de l’année 1616, il est nommé grand-aumônier de la jeune reine Anne d’Autriche. Il réside à Paris, où il a acheté, en 1615, une maison devant l’église des Blancs-Manteaux. Le cardinal de Bérulle figure en tête de ses protecteurs. Il est bientôt nommé, toujours en 1616, conseiller d’État et secrétaire des commandements de Marie de Médicis, dont il devient le favori. Honoré de cet emploi de confiance et employé dans plusieurs missions difficiles, il obtient une pension de six mille livres, « afin de lui donner moyen de supporter la grande dépense » que ses fonctions le forcent à faire. On voulut l’envoyer ambassadeur en Espagne ; il refusa, et, au milieu de l’anarchie, des révoltes des princes et des grands, il entra au ministère, en novembre 1616, avec ses amis Mangot et Barbin, ce dernier intendant de Marie de Médicis. Le chef du pouvoir, le premier ministre, sous les ordres duquel allait se trouver Richelieu, était Concini, maréchal d’Ancre.
L’évêque de Luçon était chargé de la Guerre et des Affaires étrangères, avec 17 000 livres, de « gages et entretènements », y compris les 2 000 livres qu’il avait comme conseiller d’État.
(29 novembre 1616. – 24 avril 1617)
Personne ne se doutait alors que le nouveau ministre serait plus tard le redoutable adversaire de l’Espagne que nous connaissons. C’était la faction espagnole qui le portait au pouvoir ; il pensait alors comme ses protecteurs Marie de Médicis et Concini, et l’ambassadeur d’Espagne à Paris le présentait à son maître, Philippe III, comme l’un des personnages de la cour de France les plus sincèrement attachés aux intérêts de l’Espagne. Rentré au ministère en 1624 et adoptant une politique absolument contraire à celle de Marie de Médicis, la politique française de Louis XIII, devenant l’adversaire déclaré de l’Espagne et résolu à défendre contre elle, et d’accord avec le Roi, les intérêts de la France, Richelieu devait trouver, et trouva en effet jusqu’à sa mort, une opposition formidable dans Marie de Médicis et sa coterie, qui ne lui pardonnèrent jamais d’être devenu leur adversaire après avoir été leur instrument.
Nommé secrétaire d’État, il adressa au premier ministre, Concini, la lettre suivante pour le remercier :
Monsieur, votre départ ayant sitôt suivi la nouvelle obligation qu’il vous a plu d’ajouter à tant d’autres dont je vous suis redevable, il me fut impossible de vous témoigner alors, comme j’eusse désiré, l’extrême ressentiment que j’en ai. C’est, Monsieur, ce qui me fait vous chercher en Normandie par ce gentilhomme que j’envoie exprès pour tâcher de satisfaire à une partie de mon devoir, dont je me fusse acquitté moi-même si les affaires auxquelles vous m’aviez attaché me l’eussent permis. Si, en cela, votre absence m’a donné du désavantage, au moins en tirai-je ce bien d’avoir occasion de vous envoyer cette lettre comme un litre authentique de la reconnaissance que j’ai, de ce que je vous dois et de mon affection inviolable à votre service ; vous étant, Monsieur, du tout acquis par vos premiers bienfaits, qui n’ont eu autre fondement que votre bonté, je n’ai plus rien à vous offrir qui ne soit déjà vôtre ; d’ailleurs, l’honneur dont il a plu au Roi et à la Reine me favoriser en votre seule considération m’oblige, contre mon naturel, à être nécessairement ingrat, pour ne le pouvoir pas seulement reconnaître de paroles. Je ne prétends pas pouvoir jamais me décharger de la moindre de ces obligations que vous avez acquises sur moi, mais bien de vous faire paraître par la suite de toutes mes actions que j’aurai perpétuellement devant les yeux les diverses faveurs que j’ai reçues de vous et de Madame la Maréchale, comme autant de divers titres à raison de chacun desquels je me sens obligé plus que personne du monde à demeurer éternellement, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.
On regrette que le futur grand ministre ait écrit une pareille lettre à un Concini, mais l’ambition et la soif des grandeurs ne soupçonnent pas ces regrets ou ne s’en inquiètent pas.
Incontinent que je fus en cette charge, dit Richelieu dans ses Mémoires, le maréchal d’Ancre me pressa fort de me défaire de mon évêché, qu’il voulait donner au sieur du Vair. Mais considérant les changements qui pouvaient arriver, tant par l’humeur changeante de ce personnage, que par les accidents qui pouvaient arriver à sa fortune, jamais je n’y voulus condescendre, ce dont il eut du mécontentement, quoique sans raison. Je lui représentais qu’il était bien raisonnable que, quoi qu’il arrivât, je me trouvasse en l’état où j’étais entré en cette charge, où, ne voulant rien profiter, il était plus que juste que je me misse en hasard de perdre tout.
Je lui représentais encore que, si je me défaisais de mon évêché, il semblerait que j’eusse acheté et me fusse acquis l’emploi de la charge où il me mettait, au prix d’un bénéfice, ce qui ne se pouvait en conscience, et ne serait pas honorable ni pour lui ni pour moi. Mais toutes ces raisons ne le contentèrent point, et le sieur Barbin, qui était plus pratique de son humeur que moi, me dit que, quoi que je pusse faire, il ne serait pas satisfait s’il ne venait à ses fins, parce que son intention était, en me dépouillant de ce que j’avais, de me rendre plus nécessairement dépendant de ses volontés. En quoi il témoigna être véritablement mon ami, en me fortifiant sous main dans la résolution que j’avais prise de ne me défaire pas de mon évêché.
Ce premier ministère, d’ailleurs fort court, a peu d’importance. Le Roi avait alors trois armées sur pied, mais dans le plus grand désordre, la discipline y étant inconnue ; ces armées manquaient de tout, à ce point que Richelieu, la veille de sa chute (23 avril 1607), envoyait à l’intendant de Poitou 1 500 livres de son argent pour payer les troupes.
Comme ministre des Affaires étrangères, Richelieu fut surtout préoccupé de rattacher les princes protestants d’Allemagne et les Hollandais à l’alliance du Roi, pour empêcher les rebelles de France, protestants ou catholiques, de trouver des secours à l’étranger et les forcer ainsi de se soumettre à l’autorité royale. C’est surtout dans la dépêche adressée à M. de Schomberg, ambassadeur en Allemagne, que se trouvent exposées ces idées, fort sages, il est vrai, mais qui ne font pas encore présager le rôle que le futur cardinal jouera pendant la guerre de Trente-Ans. On lit dans cette dépêche quelques phrases fort graves à l’endroit des protestants, dans lesquelles le ministre reste fidèle à son discours de Luçon, dont les idées seront toujours conservées par lui. La politique de Henri IV et de l’Édit de Nantes lui faisait dire :
Autres sont les intérêts d’État qui lient les princes, et autres les intérêts du salut de nos âmes, qui, nous obligeant pour nous-mêmes à vivre et mourir en l’Église en laquelle nous sommes nés, ne nous astreignent au respect d’autrui (envers les autres) qu’à les y désirer, mais non pas à les y amener par la force et les contraindre.
Sa pensée se trouve complétée par la phrase suivante, dans laquelle il fait allusion à la guerre que le Roi soutient contre les protestants français révoltés :
Il n’est pas question de religion, mais de pure rébellion le Roi veut traiter ses sujets, de quelque religion que ce soit, également ; mais il veut aussi, comme la raison le requiert, que les uns et les autres se tiennent en leur devoir.
Sur ce point fondamental Richelieu n’a jamais varié.
Le 24 avril 1617, Louis XIII faisait tuer Concini par son capitaine des gardes, M. de Vitry, enlevait le pouvoir à sa mère et à ses ministres, sauvait sa vie menacée par Concini, devenait roi et donnait le pouvoir à M. de Luynes, dont la politique, d’accord avec celle du Roi, était exactement opposée à celle de Marie de Médicis. Revenu au ministère en 1624, Richelieu devait être l’intelligent et habile continuateur du connétable de Luynes, mais c’est le connétable qui, avec Louis XIII, a eu l’honneur de reprendre la tradition et la politique de Henri IV.
(Avril 1617. – Avril 1624)
Après la mort de Concini, Richelieu n’avait pas hésité à se réunir aux nouveaux ministres ; mais il reçut du Roi l’ordre de se retirer et de ne plus « s’entremettre de ses affaires ». Il dut se résigner à suivre la Reine-Mère dans son exil à Blois, attendant avec sa protectrice des temps meilleurs pour eux.
La présence d’un homme de la valeur de Richelieu auprès de Marie de Médicis inquiéta bientôt Louis XIII et M. de Luynes ; aussi l’évêque de Luçon reçut-il l’ordre de quitter Blois et de se retirer dans son diocèse. Il alla passer quelque temps dans son prieuré de Coussay, et s’occupa activement de controverse. Quatre ministres protestants ayant publié un ouvrage sous le titre de : la Défense de la confession des églises réformées de France, en réponse à un sermon prononcé devant le Roi par le P. Arnoux, Richelieu répondit à l’ouvrage des protestants par un livre intitulé : les Principaux Points de la foi de l’Église catholique défendus contre l’écrit adressé au Roipar les quatre ministres de Charenton, lequel livre plaça l’évêque de Luçon au premier rang des controversistes En septembre 1617, il écrivit au Roi :
Sire, je ne manquerai pas d’observer religieusement les commandements de V.M. ; je les ai reçus en ce lieu, où j’ai été retenu jusqu’à présent par un travail que j’ai entrepris contre l’hérésie. En quelque part que je sois, V.M. recevra des preuves de mon affection et de ma fidélité, n’ayant jamais eu ni ne pouvant avoir autre but devant les yeux que son service. Je sais bien, Sire, que quelques-uns qui me veulent moins de bien que la sincérité de mes intentions ne le requiert, tâchent de vous persuader le contraire ; mais je suis assuré que, V.M. daignant considérer mes actions, ils ne viendront pas à bout de leur dessein.
Lors, Sire, qu’il vous plut prendre le gouvernement de votre État, V.M. me fit l’honneur de rendre de moi les témoignages qu’un fidèle serviteur devait attendre de son maître. Ensuite elle me commanda de suivre la reine sa mère, pour demeurer près d’elle. Y étant, quelques-uns qui avaient dessein de m’éloigner de la confiance qu’elle me faisait l’honneur de me témoigner, tâchèrent de lui persuader qu’elle se devait défier de moi, parce, disaient-ils, que j’étais trop passionné pour le service de V.M. et pour ceux qu’elle aime le plus ; mais tant s’en faut qu’ils pussent parvenir à leurs fins, qu’au contraire la reine votre mère, n’ayant autre intention que de vivre en repos sous votre obéissance, s’affermit davantage par cette rencontre à me vouloir du bien et à se confier en moi.
Quelque temps après, ces personnes eurent recours à d’autres moyens et entreprirent de me rendre suspect à ceux qui sont auprès de V.M. , pour par après me mettre en votre disgrâce. Dès lors, par leurs artifices, divers bruits s’épandirent que V.M. n’avait pas agréable que je fusse davantage près de la reine votre mère ; ce qu’ayant entendu je la suppliai de me permettre de faire un tour chez moi pour quelques jours, afin d’avoir lieu d’apprendre particulièrement votre volonté.
Depuis ce temps-là, Sire, j’ai vécu en ma maison, priant Dieu pour la prospérité de V.M. , et recherchant parmi mes livres une occupation convenable à ma profession. On m’a toujours témoigné que la volonté de V.M. était que dedans quelque temps je retournasse près de la reine votre mère, même il lui a plu me mander qu’elle en était assurée de bonne part ; sur cela, j’ai attendu l’honneur de vos commandements. Je croyais, Sire, qu’en me gouvernant de la façon, non seulement demeurerai-je exempt de blâme en la bouche de tout le monde, mais même que mes actions seraient approuvées de ceux qui me voudraient le moins de bien. N’ayant pas eu ce bonheur que je me promettais, je tâcherai de l’acquérir à si bien faire, que ceux qui me rendent de mauvais offices se ferment la bouche d’eux-mêmes. C’est, Sire, le but que je me propose, suppliant Dieu ne me point faire de miséricorde si j’ai jamais eu aucune pratique ni pensée contraire à votre service, et s’il y a chose au monde que j’aie en plus particulière recommandation que de vous donner sujet, par toutes mes actions, de me tenir de V.M. , Sire, le plus obéissant et fidèle sujet et serviteur.
Malgré ses protestations de fidélité, on continuait d’accuser Richelieu de donner des conseils dangereux à Marie de Médicis et de recevoir chez lui de fréquentes visites qui attestaient la part secrète qu’il prenait encore aux affaires de la Reine-Mère, toujours en lutte contre son fils. Aussi, le 7 avril 1618, il recevait l’ordre de se retirer à Avignon, c’est-à-dire de quitter la France, et de partir sans délai, « sans quoi il y aurait sujet d’y pourvoir par autre voie ».
En 1619, Marie de Médicis, internée à Blois, se sauva à Angoulême et rassembla une armée dont le commandement fut donné au duc d’Épernon. La guerre civile allait recommencer, quand le P. Joseph engagea Louis XIII et le duc de Luynes à rappeler d’Avignon Richelieu, et à le charger de réconcilier Marie de Médicis et son fils. L’évêque de Luçon fit faire la paix, mais elle dura à peine un an, et la guerre recommença. L’armée de la Reine vaincue aux Ponts-de-Cé (1620), Richelieu fit enfin conclure une paix durable (10 août), qui se fortifia par le mariage de la nièce de Richelieu avec le neveu du duc de Luynes, M. de Combalet. En même temps, Louis XIII, satisfait des services de Richelieu, consentait à demander au pape Paul V le chapeau de cardinal pour le protégé de sa mère.
Le mariage de M. de Combalet fut célébré (26 novembre) dans la chambre de la reine Anne d’Autriche ; le contrat avait été signé dans le cabinet de la Reine-Mère, au Louvre ; Marie de Médicis et le Roi avaient donné de très grosses sommes aux nouveaux mariés. L’accord semblait être établi solidement entre le Roi et sa mère, et entre leurs ministres, Luynes et Richelieu, qui était devenu une puissance avec laquelle il fallait compter.
En 1621, Marie de Médicis donna à l’évêque de Luçon un témoignage public de la faveur dont elle l’honorait. Toute la Cour avait suivi Louis XIII allant attaquer Montauban, où les Huguenots s’étaient soulevés. Marie de Médicis se sépara du Roi pendant quelques jours (commencement de juin) et alla visiter l’évêque de Luçon dans son prieuré de Coussay.
La mort du connétable (15 décembre 1621) allait ramener bientôt Marie de Médicis au pouvoir. Richelieu, surintendant de sa Maison et son conseiller, avait lié sa destinée à celle de la Reine-Mère ; avec elle, après quelques années de patience et d’intrigues, il allait rentrer au Conseil, et cette fois devenir premier ministre.
Luynes étant mort, le prince de Condé devint le chef du ministère, et Marie de Médicis resta encore écartée du gouvernement. Mais Condé se perdit bientôt par son caractère altier et son peu de ménagements envers le Roi. Marie de Médicis, bien dirigée par l’évêque de Luçon, reprit peu à peu quelque crédit auprès de Louis XIII, et finit par obtenir le chapeau de cardinal pour Richelieu, qui fut promu le 5 septembre 1622. Le 23 du même mois, le nouveau cardinal écrivait au Roi, pour le remercier, la lettre suivante :
Sire, Dieu comblant ses créatures de ses grâces, non pour en recevoir aucune chose, puisque de soi-même il possède tout, mais seulement pour les rendre plus parfaites et plus capables d’accomplir ses volontés, V.M. , qui en est la vive image, ne trouvera pas étrange si, pour actions de grâces de l’honneur auquel sa bonté m’a élevé, je ne puis autre chose que protester une entière et religieuse obéissance à ses commandements, et l’assurer que j’aimerais beaucoup mieux ne vivre pas que de manquer à employer à son service et ma vie et la dignité dont je reconnais lui être redevable, comme de tout ce que je possède. Je supplie Dieu qu’il me fasse la grâce d’être si heureux en ce dessein, que mes actions me signalent encore plus que la pourpre dont il vous a plu m’honorer. Lors, Sire, le contentement que je commence à recevoir sera parfait, puisque la seule passion qui me reste au monde est de vous faire plutôt voir que croire que je suis, de V.M. , Sire, le très humble, très obligé et très obéissant sujet et serviteur,
LE CARDINAL DE RICHELIEU.
La réputation que Richelieu s’était faite comme homme politique était déjà si bien établie, que Balzac lui écrivait, à propos de sa promotion au cardinalat : « C’est de gens sages et capables de gouverner les États que la stérilité est grande ; et, sans mentir, pour en voir encore un pareil à vous, il est besoin que toute la nature travaille et que Dieu le promette longtemps aux hommes avant que de le faire naître ». Le Cardinal répondit à ces flagorneries :
Monsieur, l’une et l’autre des lettres que j’ai reçues de votre part en même temps sont telles qu’en faisant paraître l’affection que vous avez pour moi et la bonté de votre esprit, elles étaient aussi capables de donner de la vanité à une personne qui ne se connaîtrait pas ; mais moi, qui n’ignore pas quel je suis, je me suis contenté de lire en icelles, et souhaiter quand et quand les qualités qui me sont nécessaires pour m’acquitter dignement de l’honneur qu’il a plu au roi et à la reine me procurer. Je les demande à Dieu à cette fin, et si, en servant son Église et ceux à qui je dois cette dignité, il se présente occasion de vous témoigner combien j’estime et la bonne volonté que vous avez en tout ce qui me touche, et votre mérite, vous avouerez que je suis plus d’effet que de paroles votre, etc.
Devenu cardinal, Richelieu se démit de son évêché de Luçon, en 1623, en faveur d’Émery de Bragelogne, et écrivit au chapitre de Luçon :
Messieurs, ç’a été à mon grand regret que je me suis démis de mon évêché pour ne pouvoir y rendre en personne l’assiduité que mon devoir désirait de moi ; mais les lois de ma conscience m’y ayant obligé, je me suis étudié à transporter cette dignité à une personne dont vous pussiez recevoir de la consolation, et qui pût apporter quand et quand, en l’exercice de la charge, le soin et la vigilance nécessaires. Une chose me suis réservée, que je conserverai inviolablement, savoir, le contentement d’avoir été longtemps chef d’une compagnie au bien et aux mérites de laquelle j’ai, dès le commencement, voué mon cœur et mon affection ; et de plus la volonté immuable de vous servir ès occasions avec autant de zèle que jamais, désirant vous faire ressentir de ce transport cet avantage, que pour un évêque vous soyez assuré d’en avoir deux : et celui qui vous assistera par sa présence, et moi qui, bien qu’absent, aurai toujours le même esprit de charité pour vous et la même passion à rechercher vos intérêts que j’ai ci-devant témoignés. L’inclination que vous avez de tout temps montrée à m’aimer vous conviera, je m’assure, à me rendre la pareille et à vous souvenir de moi en vos prières et publiques et privées, comme je vous en supplie d’affection. Pour vous y convier, je donne à votre église la chapelle entière avec laquelle j’avais accoutumé de vous assister. Je vous ai aussi obtenu une décharge des décimes, que je vous envoie pour preuve assurée de ce que je désirerais faire pour vous en plus importantes occurrences, et du désir que j’ai qu’ayant place en vos cœurs, vous vous souveniez de moi au chœur de votre église, et que je suis très certainement, Messieurs, votre, etc.
Les ministres étaient fatigués de la hauteur du prince de Condé. La Reine-Mère rechercha leur amitié, leur promit son appui, et, par leur influence, elle rétablit son crédit auprès de son fils, et chercha dès lors à faire entrer Richelieu au Conseil. Condé avait perdu toute autorité par les fautes qu’il avait commises dans la guerre contre les huguenots, surtout à l’attaque de Montpellier ; aussi, dès la fin de décembre 1622, la réconciliation du Roi avec sa mère était à peu près complète, et Marie de Médicis, toujours bien dirigée par Richelieu, était redevenue assez puissante dans le Conseil.
Elle s’était engagée avec les principaux ministres du moment, le chancelier Brulart et M. de Puisieux, à ne rien confier au Cardinal, dont Puisieux avait une extrême appréhension ; mais, ajoute l’ambassadeur de Venise, qui nous met au courant de toutes ces intrigues, « Richelieu étant l’âme de toutes les actions de la Reine, il est impossible qu’il soit séparé de sa confidence ».
Pendant que Condé achevait de se perdre dans l’esprit du Roi (1623), Madame de Puisieux avait la prétention de régenter Louis XIII, qui regimbait contre ce nouveau joug qu’on cherchait à lui imposer, et qui finit par le trouver intolérable.
La Cour et le Conseil étaient le théâtre des plus misérables intrigues, au milieu desquelles la Reine-Mère et le Cardinal gagnaient sans cesse du terrain. Pour se maintenir au pouvoir, Brulart et Puisieux donnèrent la haute main à Marie de Médicis, pendant que Richelieu s’effaçait autant qu’il le pouvait. « Les ministres, dit l’ambassadeur florentin, font tout leur possible pour ne pas être sous la dépendance des manières superbes et indépendantes de ce cardinal, qu’ils craignent en même temps qu’ils l’amadouent ».
La cause principale des craintes que Richelieu inspirait aux ministres n’était pas sa hauteur, mais sa valeur personnelle, qu’ils connaissaient bien.
De son côté, la Reine-Mère, obéissant à son habile conseiller, ménageait Louis XIII, se tenait retirée et évitait surtout d’éveiller la susceptibilité de son fils, qui par-dessus toute chose détestait ceux qui voulaient le gouverner.
Les ministres étaient attaqués de toutes parts : pour se donner quelque force, Brulart et Puisieux firent entrer au Conseil le marquis de La Vieuville, personnage de peu de valeur, qui n’eut rien de plus pressé que de décider Louis XIII à les renvoyer. Leur chute fut décidée dans une entrevue intime entre Louis XIII, Marie de Médicis, Richelieu et La Vieuville. Ces faibles ministres n’avaient jamais résisté à l’Espagne et lui avaient, au scandale des « bons Français », laissé le champ libre en Europe.
Le chancelier Brulart et MM. de Puisieux et de Sillery furent chassés du ministère et exilés (février 1624). Sans entrer dans les détails, disons cependant que leur faiblesse envers l’Espagne et leurs malversations justifiaient la dureté de Louis XIII envers eux. La Vieuville devint premier ministre, mais Richelieu n’entra pas encore au Conseil. L’explication de cette exclusion nous est donnée par l’ambassadeur de Florence.
Le Roi, dit-il, voudrait bien que la Reine sa mère acceptât que le cardinal de Richelieu s’en allât un peu à Rome et qu’elle voulût bien se servir pour principal ministre de M. de Brèves ou d’un personnage semblable. Si elle y consentait, il n’est pas douteux qu’elle en viendrait à avoir une autorité plus grande que maintenant, parce que le bon prélat est redouté de tous les ministres comme un homme trop fin, et qu’ils pensent n’être pas bon de l’avoir trop à côté de soi. Et c’est là, sans doute, la raison qui met encore quelque obstacle à une entente complète entre le Roi et sa mère ; car il est très certain qu’aujourd’hui il n’y a plus de mésintelligence entre eux ; aussi le Roi voudrait bien qu’on ne pût pas lui mettre en tête certains scrupules relatifs non pas à la fidélité, mais à l’esprit altier et dominateur du Cardinal.
Pendant ce temps, les affaires à l’intérieur et à l’extérieur allaient de mal en pis. Le gouvernement n’avait pas l’air de se douter qu’il s’accomplissait de grands évènements en Allemagne ; il abandonnait l’Allemagne, l’Italie, à la maison d’Autriche. Le Pape, dominé par l’Espagne, réglait l’affaire de la Valteline contre les alliés de la France et au profit du cabinet de Madrid.
Louis XIII voyant enfin que La Vieuville était incapable de servir utilement l’État, se décida à faire entrer Richelieu au Conseil (26 avril 1624).
On répète sans cesse que Louis XIII n’avait pas de volonté et qu’après avoir subi l’influence de Marie de Médicis et celle du connétable, il subit passivement et par paresse l’autorité de Richelieu : c’est une erreur démentie par les documents les plus authentiques. Sa volonté et sa fermeté étaient grandes, et plus d’une fois Richelieu fut obligé d’y céder. Or, depuis qu’il était devenu vraiment roi à la mort de Concini, il entendait rendre à la France son indépendance absolue et la soustraire complètement à l’autorité de l’Espagne et de ses affidés français. Fils de Henri IV, qu’il avait adoré étant enfant, il voulait continuer la politique de son père, et nul homme dans son royaume n’était plus que lui anti-espagnol et bon Français.
À ce moment, Louis XIII, décidé à reprendre les traditions et la politique de Henri IV, voulait donner le pouvoir à Sully et le rappelait à Paris, où il demeura un instant à l’Arsenal, célébrant son retour par des salves d’artillerie. Mais bientôt Sully dut retourner dans sa retraite, et le pouvoir, ainsi que la mission de relever la France, fut donné à un autre.
L’ambassadeur de Florence raconte ainsi l’entrée de Richelieu au ministère :
Le Cardinal, dès qu’il a eu la barrette rouge, a toujours été dans le désir d’entrer au Conseil ; mais le chancelier et Puisieux, adversaires de la Reine, craignant la dextérité et l’esprit dominateur de cet homme, l’ont toujours écarté. Quand ils furent tombés par le fait de la Reine, celle-ci redoubla d’efforts vis-à-vis du Roi, particulièrement depuis deux mois ; mais, d’après ce que j’ai pu comprendre, le Roi, tout désireux qu’il était de faire plaisir à sa mère, dans la poursuite de cette affaire, ne prenait aucune résolution, refroidi sans doute aussi par les ministres actuels, parce que cet homme est redouté de chacun comme en sachant trop et comme trop habile.
La Reine, pendant ce temps, se montrant peu satisfaite de ces irrésolutions, se tenait à Paris, sans aller à la Cour. On jugea bon de la contenter, et comme le Roi y inclinait fort, ce qui était le principal, on prit la résolution de faire entrer le Cardinal au Conseil ; mais la jalousie des autres ministres doit être la cause d’une limitation qui a été faite, à savoir que le Cardinal entrera au Conseil pour y dire son avis sur les matières courantes ; mais il ne pourra point, en qualité de ministre du Roi, négocier dans sa maison ni y traiter avec personne des affaires de S.M. ; et la raison en est qu’on ne veut point le laisser parvenir à cette autorité et à ce crédit, que, pour être cardinal et d’une intelligence naturellement supérieure, il obtiendrait bien vite ; et, par contre, les autres ministres veulent rester seuls en possession de l’autorité.
Je considère comme une confirmation de tout cela un discours que voulut bien me tenir le Cardinal sur son nouvel emploi. Sa façon de parler, ses gestes montraient évidemment une grande contrariété intérieure ; il me représenta que cet honneur lui était arrivé sans qu’il l’eût recherché ni désiré, mais du propre mouvement de S.M. , et qu’il aimait mieux une vie facile et tranquille que les travaux et les dangers auxquels les jalousies et la malignité des hommes exposent ceux qui entrent dans les grandes affaires. Pour cette raison et à cause de son peu de santé, n’ayant pu obtenir du Roi d’être déchargé d’un si grand poids, bien qu’on lui fit un grand honneur, il avait, me disait-il, fait entendre franchement à S.M. qu’il ne pouvait la servir, si ce n’est en allant écouter ses résolutions au Conseil, quand sa propre santé le lui permettrait. Quant à négocier dans sa maison, où le repos lui était nécessaire, il ne pouvait le faire, ni recevoir chez lui l’affluence du peuple, il ne pouvait se soumettre à cette obligation, ses forces ne le lui permettant pas. En conséquence, le Roi lui avait fait cette seconde grâce.
L’ambassadeur ne fut pas dupe des paroles de Richelieu ; il ne crut pas que le Cardinal n’acceptait que malgré lui les honneurs que lui offrait le Roi ; il devina bien qu’on ne lui avait offert que ce qu’il avait accepté et qu’il arrangeait les choses comme il voulait qu’on le crût, et il ajoute :
Quiconque sait que le Cardinal n’est pas aussi mal portant, et qu’il est d’un caractère profondément ambitieux, jugera que, dans cette affaire, cette prétendue préférence pour un genre de vie tranquille a été une nécessité qui provient d’autres causes.
L’ambassadeur voyait juste dans le présent et aussi dans l’avenir :
Il lui suffit, ajoute-t-il, d’avoir été porté là ; car, avec le temps, on acquiert beaucoup, et surtout quand on a son esprit. Sur ce sujet, voici ce que l’on pronostique : ou le cardinal de Richelieu trouvera bientôt le joint pour devenir le maître de tous les autres ministres, ou, resté exclu de toutes choses, il sera bientôt ruiné lui et sa maîtresse. Mais ce qui est un signe favorable, c’est que le plus grand nombre est du premier avis.
La Vieuville, n’osant rien faire contre l’Espagne ou l’Autriche, mécontentait Louis XIII, qui voulait agir. Un pamphlet, la Voix publique au Roi, précipita la chute du ministre, qui, de plus, était coupable de malversations, d’abus de pouvoir et d’avoir donné des ordres contrairement à la volonté du Roi. Louis XIII le fit arrêter et enfermer au château d’Amboise. Enfin, le 13 août 1624, Richelieu devenait le ministre principal du roi de France, sans en avoir officiellement le titre, titre qu’il n’eut qu’en 1629.
« On ne sait ni comment, ni à quelle époque précise Richelieu a acquis la confiance du Roi », dit M. le duc de Broglie.





























