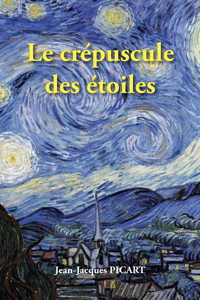
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
L’intrigue de ce livre se déroule entre les années précédant la seconde guerre mondiale et l’année 1967. Elle se situe dans les Ardennes, la Bourgogne et le sud-ouest de la France.
André, brillant militaire, héros de la résistance, tombe amoureux de Lucienne, une belle et douce jeune femme vivant en zone libre. De leur magnifique histoire d’amour, naît leur petite fille, Jacqueline. Hélas, la guerre d’Indochine sépare la famille pour deux longues années. Mais, à son retour, André a beaucoup changé. Il semble porter un très lourd secret.
Peu après la naissance de Jean-Jacques, leur deuxième enfant, et le narrateur de cette histoire, la famille est frappée par un évènement tragique. C’est grâce à l’amour, la persévérance et la lucidité de sa grand-mère maternelle que Jean-Jacques réussira à échapper aux griffes d’un père tyrannique qui le voue à un destin misérable. Jean-Jacques pourra compter sur les merveilleuses rencontres faites au sein de l’école de la république qui lui redonneront confiance en l’avenir
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Mentions légales
Publishroom Factorywww.publishroom.com
ISBN : 978-2-38713-056-3
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Page de Titre
Jean-Jacques PICART
Le crépuscule des étoiles
Je vous devais bien ce livre…
C’est toi et toi seul qui choisis le chemin que tu empruntes et, à tout moment, tu as le droit de changer de direction.
C. G Jung
Chapitre 1
Dans les années trente, Signy-l’Abbaye, petit village des Ardennes à peine peuplé de trois mille âmes est le modèle même de ces bourgades un peu tristes dans lesquelles personne ne voudrait passer une vie entière. Pourtant, depuis plusieurs générations, ma famille paternelle vit dans ce lieu qui semble avoir été oublié par la République.
Une filature, reconnaissable par son toit en dents de scie, ainsi que des propriétés agricoles grises et sales forment l’essentiel du paysage. Les rues étroites sont souvent encombrées par les vaches qui entrent et sortent de leur étable, conduites aux pâturages par des ouvriers agricoles dont on peut douter qu’ils se soient lavés au cours du mois précédent. La seule perspective qui semble offerte aux habitants de ce village est de travailler pour échapper à la pauvreté. Aucun jardin fleuri ne vient égayer les rues du village pour offrir un peu de rêve dans le regard des passants, comme si cela était totalement surfait et définitivement inutile. Les habitants préfèrent utiliser les jardins de leurs maisons pour planter des pommes de terre plutôt que des massifs de fleurs qui ne serviraient à rien.
Le village n’est pourtant pas dénué d’agréments. Chaque rue est vivante et tout le monde se connaît. Le paysage vallonné donne du relief aux ruelles qui traversent les pâtés de maisons de manière un peu désordonnée. La place centrale, qui réunit la population à chaque fête laïque ou religieuse, ressemble en plus petit à la place Ducale de Charleville-Mézières. Elle regroupe au même endroit l’église, la mairie et le marché couvert, quelques magasins de première nécessité et quelques bistrots. De cette place centrale, partent les rues qui mènent aux écoles, au cimetière et à la filature du village.
L’enfance et l’adolescence d’André ne sont pas cousues de fil d’or. Mes grands-parents paternels, Georges et Marceline, appartiennent au milieu ouvrier et n’ont pas d’autre ambition que de pouvoir survivre à peu près dignement. Aucune place n’est laissée aux loisirs et à la culture. Aucun livre n’a jamais été déposé là, à part l’almanach que le facteur apporte chaque année, ainsi que le catalogue de Manufrance qui propose, à chaque édition, de nouvelles armes à feu, des cannes à pêche, des vélos et des outils de jardin. Mais le catalogue est là pour le rêve. Mes grands-parents n’ont pas assez d’argent pour acheter quoi que ce soit, même pas un vélo dont le prix en fait un objet inaccessible. Il est de bon ton de marcher à pied.
La maison familiale fait partie de ces habitations ouvrières mitoyennes, totalement dénuées de confort, sans toilettes ni salle de bains. Le seul point d’eau de la maison se trouve au-dessus de l’évier de la cuisine. Cet évier en ciment permet à chacun d’effectuer une toilette rudimentaire, généralement à chaque fin de semaine, mais il est aussi utilisé pour le lavage des légumes qui composent la soupe hebdomadaire. Un vieux miroir taché, flanqué dans un cadre en bambou, suspendu par un bout de ficelle usagé, permet à chacun d’apercevoir son reflet, mais personne ne s’attarde à contempler son image, préférant baisser les yeux devant des traits tirés et fatigués par la vie quotidienne. Seul mon futur père s’attarde parfois devant le vieux miroir. Il observe, tel un Narcisse sur sa flaque d’eau, l’impression mystérieuse que renvoient ses yeux bleus comme de l’acier. Il sait que la nature l’a doté d’une arme de séduction redoutable.
À l’extérieur de la maison, les murs en torchis sont enduits d’un ciment de mauvaise qualité qui se détache par plaques. Ils peinent à protéger de la rigueur du froid lorsque vient l’hiver. À l’étage, les deux seules chambres sont éclairées par de toutes petites fenêtres construites ainsi dans l’espoir que l’air glacial ne puisse y pénétrer. La maison n’est chauffée que par le poêle de la cuisine qu’il faut laborieusement recharger toutes les heures. Mais l’hiver, lorsque la nuit tombe et que toute la famille va se coucher, le poêle s’éteint lui aussi. Le froid pénètre alors lentement mais sûrement dans chaque recoin de la maison.
Georges et Marceline dorment dans la chambre du fond, légèrement en surplomb car la maison épouse la courbe du terrain sur lequel elle a été construite. André et Cécile, sa sœur, dorment tous les deux dans la chambre de l’étage située en contrebas. Celle-ci donne sur la petite cour commune qui permet d’accéder au jardin potager et aux dépendances. C’est dans ce jardin que se trouvent les toilettes, constituées d’une petite cabine en bois rudimentaire équipée d’une planche et d’un seau destiné à recueillir les excréments. Une bougie et une grosse boîte d’allumettes, posées sur une étagère, permettent aux visiteurs du soir de se soulager sous la lumière fragile et vacillante d’une petite flamme hésitante qui ne demande qu’à s’éteindre au moindre courant d’air, les soirs où le vent souffle un peu trop fort.
Tous les matins, Georges vide le seau de déjections sur le tas de fumier qui se trouve à proximité de la cabane. Il en émerge parfois la silhouette longue et visqueuse d’une couleuvre qui y a élu domicile. André observe parfois les allées et venues de son père depuis la fenêtre de sa chambre. Il est pris de dégoût et de crainte à l’idée de devoir un jour vider ce seau que personne n’a jamais nettoyé et qui est devenu, au fil du temps, un modèle de puanteur absolue. Le seau du jardin est devenu la représentation symbolique de tout ce à quoi André veut échapper.
Celui qui deviendra mon père a toujours été un garçon modèle. Né en 1922, il a plutôt brillamment réussi son parcours scolaire dans les trois écoles du village.
L’école primaire tout d’abord, constituée d’une classe unique de garçons et d’une classe unique de filles, l’école élémentaire ensuite, qui constitue le summum à atteindre pour la plupart des élèves issus des milieux paysans et ouvriers. Elle permet de savoir lire, d’écrire sans faute, puis d’effectuer les calculs simples nécessaires à la vie courante. Elle conduit à l’obtention du certificat d’études. Quelques rudiments d’histoire, de géographie et de sciences naturelles permettent aux jeunes garçons et aux jeunes filles d’aborder leur vie future avec un minimum de bon sens et de connaissances élémentaires. On y enseigne aussi l’instruction civique et la morale, l’importance de la famille, les valeurs d’abnégation et de courage, le sens de la patrie et du devoir. André fait partie des meilleurs élèves. Il dévore, sans jamais être rassasié, toutes les connaissances que son maître d’école, jeune combattant ayant réchappé aux massacres de la Première Guerre mondiale, s’emploie à lui transmettre. Il s’imagine un destin de héros, libérateur du peuple opprimé.
Le certificat d’études sonne la fin de l’enfance. Les jeunes gens précocement conditionnés rejoignent alors prématurément le monde des adultes. Ils constituent une main-d’œuvre captive et bon marché pour le patronat local qui alimente un système industriel et capitaliste en plein essor, prêt à se tourner vers une économie de guerre dès lors que l’état français en ferait la demande.
Selon leur inspiration, les jeunes garçons partent parfois servir les riches propriétaires des fermes avoisinantes, à moins que leurs parents ne soient déjà à la tête d’une exploitation familiale. Les jeunes filles, quant à elles, rejoignent le domicile de leurs parents, en attendant d’être « engrossées » par un ouvrier de passage, rencontré au hasard d’un bal du samedi soir. Elles perpétuent ainsi leur filiation en restant fidèles à leur devoir et à une longue tradition familiale.
Son certificat d’étude en poche, André refuse de se mettre au service d’un cultivateur ou d’un éleveur de bestiaux. Il n’envisage pas non plus de se faire recruter par le directeur autoritaire de la filature locale dans laquelle travaille Georges, son père. Il ne veut pas de cet engrenage qui pourrait définitivement sceller son sort, avec pour seule perspective une vie de travail épuisante et dénuée de sens. Les Ardennes et le village de Signy-l’Abbaye en particulier restent des territoires pauvres et oubliés. André voit combien son père est exploité. Il constate la fatigue, l’épuisement et l’état de tristesse dans lesquels il rentre chaque soir. Il n’est pas question pour lui de suivre le même chemin.
Les avancées du Front populaire de 1936 n’ont pas changé les conditions de vie. Les congés payés sont accueillis avec un certain enthousiasme, mais les travailleurs et leurs familles constatent très rapidement qu’ils ne peuvent pas en profiter pleinement. Ils ne peuvent pas voyager car ils n’ont pas de voiture. Ils n’ont pas non plus l’argent nécessaire pour descendre la mythique nationale 7. Ils en sont réduits à rêver de soleil et d’amour sur les chansons de Charles Trenet, diffusées en boucle par la vieille TSF de la cuisine. Georges et Marceline font partie de ce monde-là.
André, âgé de quatorze ans, est un garçon modèle. Il ne peut s’empêcher d’éprouver pour son père une sorte de dédain. Il lui témoigne du respect, mais il tient à distance cet homme auprès duquel il se sent étranger. Georges manque singulièrement d’ambition et n’a pas réussi à s’élever socialement.
André décide de poursuivre sa scolarité, passant outre la contrariété de ses parents qui auraient préféré qu’il s’arrête au certificat d’études primaires. Il impose sa volonté d’entrer au collège afin de pousser plus loin son niveau d’études. André est un élève aussi studieux que brillant. Il obtient deux ans plus tard le brevet élémentaire, ce qui, à cette époque et dans ce lieu, lui donne instantanément le statut d’intellectuel de la famille.
Georges et Marceline finissent par le regarder avec une certaine admiration, étonnés l’un et l’autre que leur fils ait pu s’élever aussi haut.
Mais ils n’envisagent pas de lui offrir des études plus poussées. Dans leur esprit, le baccalauréat est un diplôme réservé aux riches. Ils n’appartiennent pas à la classe sociale qui convient. André, pensent-ils, n’a pas sa place dans les hautes sphères intellectuelles auxquelles ils ne comprennent rien. Ils auraient tous les deux vécu la poursuite des études d’André comme une trahison de leur condition et de leur famille.
L’excuse est toute trouvée. Le lycée le plus proche qui prépare au baccalauréat se situe à Charleville-Mézières et il est impossible de s’y rendre autrement qu’en autobus. D’autre part, Georges ne possède pas de voiture et n’a jamais passé son permis de conduire. André, peu tenté par l’internat, décide donc que ses études s’arrêtent là et que le niveau qu’il a acquis sera alors suffisant pour lui permettre de s’élever socialement. Il a compris que les moyens financiers de ses parents ne l’autorisent pas à aller plus haut. Il ne supporterait pas d’être un jour redevable du sacrifice de sa famille. Il est trop fier pour cela. André a envie de liberté.
Parvenu à l’âge de seize ans, André se sent de plus en plus sûr de lui. Les yeux clairs hérités de son père Georges, une allure élancée, un visage fin et bien fait créent un magnétisme dont il peut constater les effets sur toutes les jeunes filles qu’il croise. De plus, il se découvre un certain talent pour interpréter avec justesse le répertoire du bel canto. Il chante à merveille quelques chansons d’amour. Ce don vient à point enrichir sa panoplie de séducteur attitré. Les jeunes filles qu’il croise tombent amoureuses de lui, tandis que les jeunes gens de sa classe d’âge éprouvent pour lui un sentiment mêlé d’admiration et de jalousie.
André est prêt à dévorer la vie. Il ne se donne aucune limite et s’imagine un destin radieux. Le désir de quitter son environnement triste et monotone le tenaille chaque jour davantage. Ses relations distendues et dénuées de tendresse avec ses parents ainsi qu’avec sa petite sœur Cécile l’y poussent chaque jour davantage. Il n’attend plus que le moment opportun pour partir et s’engager dans une nouvelle existence dont il ne sait pas encore de quoi elle sera faite.
C’est vers la fin de l’année 1938 qu’André décide de ce que sera sa destinée. Les rumeurs d’une nouvelle guerre vont bon train. Selon les journaux et les nouvelles transmises par la radio, celle-ci semble inévitable. La montée du national-socialisme en Allemagne, la défiance envers les juifs qui se propage comme une traînée de poudre dans toute l’Europe, les velléités d’expansion de l’Allemagne qui entretient la haine et veut prendre sa revanche sur les deux guerres perdues précédemment, tout cela est inquiétant.
Les Allemands font peur car chacun garde en mémoire les tueries et les atrocités commises lors du conflit de 14-18, lequel a totalement dévasté la région. Chacun prend conscience de la montée inexorable du nazisme et tous redoutent, dans les campagnes comme dans les villes, l’imminence d’une nouvelle guerre. La France est encore affaiblie par la grande guerre et plus personne ne se sent prêt à partir au combat, ni à subir le spectacle et la douleur des civils assassinés. Chacun garde en mémoire les familles endeuillées, les militaires gravement estropiés ramassés sur le front. Ces événements ont laissé des plaies béantes dans toutes les familles. Les Ardennais vouent une haine sans nom aux « boches », ceux-là mêmes qui ont déjà massacré leurs proches vingt ans plus tôt.
André, lui, n’a pas peur. Il veut s’engager au service de cette France qu’il vénère comme une déesse mythologique. Il s’enflamme en écoutant les discours nationalistes de Jean-Louis Tixier-Vignancourt, avocat et pape de l’éloquence, qui vient d’être triomphalement élu à l’Assemblée nationale, après une première élection invalidée pour fraude électorale. Tixier-Vignancourt exalte les valeurs du patriotisme, de l’identité française et la force de l’armée au service de la nation. André est totalement conquis par cet homme qui élève au plus haut niveau, du moins le croit-il, les valeurs viriles du courage, de l’abnégation et de la détermination. Tixier-Vignancourt est tout le contraire de Georges, travailleur silencieux au dos courbé, qu’André considère désormais avec pitié.
Chapitre 2
Né en 1898, Georges n’avait que 16 ans lorsque la grande guerre de 14-18 avait éclaté. Il avait ainsi échappé de peu à la mobilisation générale. Lorsqu’il fut mobilisable, deux ans plus tard, il avait profité de la désorganisation des armées pour passer au travers des mailles du recensement et fut complètement oublié.
Puis, lorsque Georges fut rattrapé pour de bon par le recensement de mai 1919, la grande guerre était terminée. Il n’en fut pourtant pas inquiété. L’état-major se contenta de camoufler le retard en inscrivant sur son livret militaire « Non recensé en temps utile par suite d’un cas de force majeure ». Réformé pour le combat, Georges fut néanmoins affecté à la réserve des travailleurs au service de l’armée. C’est ainsi qu’il ne toucha jamais un fusil de sa vie. Il avait eu de la chance. André, qui sait tout cela, ne porte pas son père en estime.
En ce début d’année 1938, conscient de sa singularité et compte tenu de l’imminence de la guerre, Georges prend garde de ne pas se précipiter la fleur au fusil et de ne pas se faire enrôler dans un régiment d’infanterie. Il vient tout juste d’avoir 40 ans. Il est rongé par l’angoisse. Il redoute par-dessus tout que son stratagème d’évitement pour échapper à la guerre soit publiquement mis à jour et qu’il ne soit incorporé de force dans les rangs de l’armée française. C’est une perspective effrayante à laquelle il ne s’est jamais préparé. Il se fait le plus discret possible, allant même jusqu’à sacrifier sa vie sociale. Au fond, Georges est peu fier de lui. Il se coupe progressivement des hommes de sa classe d’âge car il craint d’être mal jugé. Il s’invente une maladie chronique qui lui sert d’alibi.
André perçoit la peur qui tenaille les entrailles de son père. Elle le dégoûte autant que le seau de merde que ce dernier transporte tous les matins. Finalement, pense André, « il n’a que ce qu’il mérite ». Puis, il se ravise et tente de calmer son ressentiment.
Georges n’est pourtant qu’un homme simple qui tente d’oublier qu’il passe à côté de sa vie. Il s’efface devant Marceline, sa femme, qui ne lui témoigne aucune tendresse ni aucun amour. Si elle en avait eu les moyens, elle l’aurait quitté pour tenter de vivre ailleurs une autre existence. Georges a fini par ne plus s’aimer et par ne plus aimer personne. Il ne ressent pour lui-même aucune fierté, ni aucune considération. Sa vie se résume à son métier de bonnetier à la filature du village dans laquelle il travaille depuis l’âge de ses 15 ans. Faute d’instruction, il n’a pas eu d’autre choix que d’embrasser ce métier qui ne demandait aucune qualification à l’embauche et qui est devenu au fil du temps sa seule raison de vivre.
Georges trouve cependant dans l’atelier de son usine un peu de l’esprit de camaraderie qui le sort de sa solitude. Mais ses conversations ne sont ni recherchées, ni appréciées. Il se contente de vivre par procuration en laissant parler les autres à sa place. Son niveau culturel est quasi-inexistant. Rien de ce qui fait le monde, rien de ce qui se construit autour de lui ne l’intéresse. Il n’est impliqué dans aucun mouvement syndical ni politique et finalement, il s’accommode assez bien de n’avoir aucun projet et de devenir invisible. L’isolement dans lequel il se trouve limite à presque rien ses interactions sociales et personne ne voit jamais un seul ami franchir le seuil de sa maison. Georges sait tout juste lire et compter. Il ne se penche jamais sur un journal et le monde entier lui est étranger. Seule lui importe la croissance des légumes qu’il plante dans son jardin et qu’il passe des heures à regarder pousser.
Georges n’est pas totalement responsable de cette situation. Marceline, qui compte jusqu’au dernier sou, n’a pas d’argent à dépenser dans les distractions qu’elle juge inutiles. Ainsi, on ne parle jamais de vacances ni même de spectacles, encore moins de cinéma et cela tombe bien car le village de Signy-l’Abbaye n’en possède pas. Pour avoir accès à des événements culturels, il faudrait prendre l’autobus jusqu’à Charleville, ce qui est totalement inenvisageable. Les seuls journaux qui passent par la maison sont ceux donnés par madame Mignot, la voisine dont le fils est curé. Mais, avant même d’être lues, les feuilles de journal sont immédiatement découpées en huit pour alimenter le crochet de boucher qui fait office de distributeur de papier dans les toilettes du jardin.
Pourtant et pour autant qu’il s’en souvienne, Georges avait éprouvé une grande fierté à la naissance d’André. Il avait accueilli ce fils comme un accomplissement de sa vie d’homme et ressentait le bonheur du devoir accompli.
Mais cette joie n’a pas duré. Qu’a-t-il à transmettre à cet enfant, sinon la résignation qu’il éprouve à vivre sa propre existence ? Il manque de courage pour entreprendre quoi que ce soit qui pourrait le sortir de la situation médiocre dans laquelle il entraîne sa famille. Il s’oblige à supporter les dures conditions d’un travail épuisant qu’il vit comme le châtiment du tonneau des Danaïdes.
Georges ne sait pas comment se comporter avec André. Il s’écarte petit à petit de son rôle de père et se sent incapable de lui donner le moindre conseil. Il laisse à Marceline le soin de l’éduquer. Elle endosse cette charge de manière autoritaire. André n’éprouve plus alors pour son père qu’une vague indifférence. En ce début de 1938, Georges est devenu, aux yeux de tous, un être taiseux et inexistant. Il ne parle plus à Marceline qu’il a fini par détester et Marceline le lui rend bien.
Mais cette année-là, juste avant que la France n’entre de nouveau en guerre, Georges éprouve pourtant un grand soulagement. En cas de conflit avéré, il sera finalement affecté à un régiment de travailleurs au service des armées. Il sera tenu éloigné des armes et des combats à venir. Un « planqué » pense alors André qui, presque parvenu à l’âge adulte, aurait préféré que son père meure sur le front plutôt que de le voir errer dans le village à la recherche d’un verre de vin à boire dans les bistrots restés ouverts.
Chaque soir en effet, après sa journée de travail, Georges annonce qu’il va faire un tour. Mais où va-t-il dans ce village perdu ? Georges n’a pas de bicyclette et ne peut guère s’éloigner du domicile. Marceline décide un jour de le suivre. Elle découvre qu’il passe tous les soirs par les quatre cafés du village, et qu’il s’arrête dans chacun d’entre eux pour en ressortir quelques dizaines de minutes plus tard, un peu plus ivre que dans le précédent. Avec les quelques sous que Marceline lui donne à regret afin de se débarrasser de lui, Georges recommence quotidiennement ce que Marceline appelle « La tournée des grands ducs »
Georges oublie dans le gros rouge des bistrots la bonneterie dans laquelle il travaille plus de cinquante heures par semaine. Avant même d’avoir bu le premier verre, il est déjà saoulé d’avoir répété toute la journée le même geste sur sa monstrueuse machine à tisser, dont le vacarme a fini par le rendre sourd.
Le temps de sa tournée des grands ducs, il oublie le regard de son directeur et des autres ouvriers qui le ramènent à chaque instant à son inexistence sociale, lui le traître qui a pu échapper à la grande guerre.
Marceline range chaque mois dans la grande armoire de la salle à manger l’enveloppe marron qui contient le minuscule salaire de Georges. Cette armoire, dans laquelle on trouve indifféremment du linge de maison et de la vaisselle, le livret de famille et le livret militaire, ainsi que quelques photographies empilées dans une boîte en fer blanc, représente ce que la famille a de plus précieux. Ce salaire est le seul argument qui donne à Georges le droit d’exister et de s’asseoir à la table familiale.
En face de la maison, séparée des habitations par la cour commune, Georges possède une partie de grange qu’il a aménagée en atelier de menuiserie.
À l’arrière de cette grange, une porte donne sur un minuscule bout de terrain clôturé qui abrite les clapiers protégés de la pluie par un mille-feuille de tôles ondulées posées les unes sur les autres.
Les lapins sont une source de revenus importante pour tous les habitants de la commune. Tout le village mange de la viande de lapin. Ils ne coûtent rien à élever. Un peu d’herbe fraîche et quelques épluchures de pommes de terre suffisent à les nourrir. Une fois les bêtes dépecées, les peaux sont soigneusement conservées dans l’attente du passage d’un homme énigmatique et sans âge qui arpente une fois par semaine toutes les rues de la commune en criant « Peau de Lapin » Peau de lapin ! ». Dès qu’il active la sonnette de sa bicyclette lourdement chargée, tous les habitants se précipitent vers cet homme qui ramasse ses trésors pour les attacher ensuite sur son porte-bagage. Chaque peau de lapin rapporte dix centimes. C’est le prix du verre de vin au bistrot, pense Georges, qui ne manque pour rien au monde le passage du chineur. Dès lors, les peaux de lapin collectées sont revendues à des chapeliers qui s’en servent comme matière première pour la fabrication des chapeaux de feutres.
Dans son atelier de menuiserie, Georges passe son temps à tailler des planches rectilignes dans des bois mal dégrossis. Il aménage les plates-bandes de son jardin et utilise ces planches pour les délimiter. Nul ne voit jamais sortir de cette grange mal éclairée et mal équipée une quelconque création un tant soit peu belle ou sophistiquée. Georges n’éprouve aucune envie de fabriquer quelque meuble que ce soit qui aurait pu égayer l’univers un peu maussade de son habitation. Cela aurait été une perte de temps et il n’en a pas envie. Faire plaisir, à qui ? Pour quoi faire ? La grange un peu sombre représente principalement un refuge lorsqu’il souhaite s’isoler. Cet atelier lui sert souvent d’espace de répit lorsqu’il rentre saoul de sa tournée journalière. Il prend alors le temps de s’asseoir par terre et attend de ne plus tituber avant de franchir la porte de la maison, à l’heure du souper.
Quelques années plus tôt, en juillet 1925, Georges avait appris que Marceline était enceinte de son deuxième enfant. Pourtant, il ne se souvenait plus avoir eu de rapports sexuels avec elle. Cela faisait deux ans déjà qu’ils faisaient chambre à part. Leur mariage avait fini de se consumer à la naissance d’André, trois ans plus tôt.
Georges avait très vite compris qu’il n’était pas le géniteur de l’enfant que sa femme attendait. Il n’avait eu guère de mal à découvrir qui était l’amant de sa femme. Il s’était aperçu avec dégoût qu’il était le seul à ne pas le savoir. Ses acolytes de bistrot prirent alors un malin plaisir à lui offrir, dans un immense éclat de rire, le nom de l’amant et lui offrirent la tournée du cocu. C’est ainsi que Georges apprit l’existence de Monsieur Meier. Ce dernier, célibataire sans enfants, vivait seul en bas de la petite ruelle menant au centre du village. Marceline l’empruntait chaque jour pour faire quelques courses. La maison de Monsieur Meier était toujours fermée. Seuls des volets entrebâillés lui permettaient d’épier les allées et venues des habitants qui empruntaient la ruelle. C’est ainsi que Monsieur Meier s’adressa un jour à Marceline qui, esseulée et n’ayant personne à qui parler, profita de cette rencontre pour s’épancher sur sa vie difficile et sans attrait, puis se lança à corps perdu dans une liaison adultérine.
Georges avait accepté cet affront. Il n’avait guère le choix. Il était condamné à rester à sa place et ne pouvait même pas protester. Comment protester d’ailleurs lorsque l’on rentre ivre tous les soirs, que l’on n’assume plus ni son rôle de mari, ni son rôle de père ?
Georges n’est pas méchant. Personne ne l’a jamais vu se mettre en colère. Il aime partager les légumes de son jardin. Il est courageux à la tâche. Il est le premier à donner un coup de main lorsqu’il faut aider un voisin à remplacer une ardoise cassée sur un toit ou à tuer le cochon. Et dans ces moments-là, une petite plissure apparaît au coin de ses yeux signifiant, pour ceux qui savent le voir, qu’un peu de vie s’est insinuée dans son âme.
La plupart du temps, ses repas sont tristes et frugaux, toujours identiques ou presque. Comme il est affecté par de sérieux problèmes dentaires, il est incapable de mâcher toute nourriture un peu consistante ou résistante. Il a définitivement jeté son dévolu sur la soupe qu’il avale goulûment, souvent directement en tenant son assiette à deux mains. Marceline lui prépare d’énormes marmites de potage aux légumes du jardin qui suffisent à le rassasier. Puis il avale deux ou trois œufs qu’il gobe dans la coquille sans même prendre la peine de les faire cuire.
Toute la vie de Georges s’organise autour de la filature et de son jardin. Il est un employé irréprochable, ne proteste jamais et effectue sur sa machine à tisser un travail méticuleux. Peu lui importe que les gestes qu’il accomplit chaque jour soient toujours les mêmes. Son esprit est concentré sur un objectif unique. Il doit œuvrer pour que les fils de chaîne et les fils de trame entrelacés sur son métier Jacquard donnent naissance aux plus belles étoffes de mousseline qui soient. Il sait qu’elles vont ensuite servir de matière première à la confection des bas en soie. Il faut que la bobine qui s’enroule sous son regard attentif, fruit exclusif de son travail, soit exempte du moindre défaut. Chaque jour, plusieurs dizaines de mètres du précieux tissu s’enroulent de manière impeccable et Georges les contemple d’un air satisfait, presque heureux. Toutes ces bobines de soie sont la preuve qu’il peut, lui aussi, approcher de la perfection. Elles sont irréprochables. Le tissu impeccablement tendu ne laisse apparaître aucun accroc. Il a devant lui une immense page vierge sur laquelle il peut à loisir réécrire une histoire de vie totalement différente, peuplée de souvenirs héroïques, de virilité sans faille et de la tendresse inconditionnelle d’une femme aimante pendue à son cou.
Le soir venu, Georges regagne son jardin et s’abîme quelques instants dans une contemplation méditative. Le jardin aussi est son œuvre. Il est le résultat d’un travail patient et méticuleux. Georges a créé une telle symbiose avec ses haies de haricots et ses raies de pommes de terre qu’il pourrait les déterrer ou les cueillir les yeux fermés. Il est devenu l’ami intime des vers de terre qui compostent pour lui une terre riche et grasse. Il se prend parfois à penser que lui aussi, un jour, il finira par nourrir cette terre qu’il aime tant. Parmi les plaisirs les plus grands qu’il éprouve lorsqu’il travaille son jardin, aucun n’atteint celui qui consiste à retourner la terre pour préparer les futurs semis. Georges n’aime rien tant que la sensation de la bêche s’enfonçant profondément dans la terre brune, jusqu’à soulever des mottes luisantes et consistantes, qu’il prend plaisir à émietter ensuite avec le tranchant de son outil. Cette terre qui s’offre à lui porte en elle une promesse de fécondité, en même temps qu’elle enfouit les vestiges des récoltes précédentes. La vie et la mort, sous le même coup de bêche, s’entremêlent en permanence, apportant à Georges la sérénité que seule la résolution du plus grand mystère de la vie peut apporter.
Chapitre 3
Jules est la seule personne avec laquelle Georges se sent capable d’échanger quelques mots. Jules, le frère de Marceline, est devenu au fil des ans un être marginal. Il gagne un peu d’argent et assure sa subsistance en effectuant des petits travaux de jardinage dans le village et aux alentours. Il habite une minuscule maisonnette qui se trouve sur un terrain appartenant au pharmacien du village. Il ne paie pas de loyer pour cette misérable bicoque et le pharmacien, en échange, lui demande d’entretenir son verger et son potager. Le pharmacien et son épouse Eloïse s’enorgueillissent de cette charité chrétienne qu’ils étalent au grand jour. Ils prouvent ainsi leur profondeur d’âme au sein de la population du village, admirative de leur dévouement. « Comment est-il possible que deux êtres si fins et si cultivés puissent accueillir à deux pas de chez eux un être aussi misérable ? » se demandent parfois les clients de la pharmacie.
Jules vit dans une pièce unique meublée d’un sommier défoncé, d’une armoire en bois vermoulue, d’une table en formica et de deux chaises dont la paille est noircie par la fumée et la crasse. Le matelas est recouvert d’un édredon qui n’a probablement jamais connu la lessive. Une cheminée assure un peu de chauffage pour l’hiver, mais il n’y a pas d’eau courante. Jules doit chaque matin remplir les brocs et les seaux à partir du robinet installé dans le jardin du pharmacien. Il assure ainsi une toilette minimaliste et peut remplir sa cafetière. Un moulin à café à manivelle trône sur le rebord de la cheminée. Et, pour qui le sait, le tiroir de ce moulin à café fait aussi office de coffre-fort. C’est à cet endroit que Jules cache les quelques billets de banque pliés en quatre qui lui permettent d’assurer sa subsistance.
Jules vit comme un clochard, mais il est heureux. Il est libre. Sa vie ne s’embarrasse d’aucune contrainte. Il braconne le lièvre, pêche les grenouilles qu’il rapporte dans sa besace remplie à ras bord. Lorsque la saison des champignons arrive, il prend plaisir à distribuer ses cueillettes à tous ceux qu’il tient en sympathie. Georges en fait partie. Marceline aussi entretient de bonnes relations avec son frère qui s’invite parfois pour un dîner. Bien que son odeur âcre et soutenue soit difficile à supporter, elle l’accepte à sa table. Jules a toujours un bon mot à raconter sur la vie des habitants de la commune et il égaye les repas du soir. Georges admire cet homme qui, bien que misérable, a gagné sa liberté en refusant toutes les compromissions, cela au prix d’un profond dénuement. La liberté de Jules est une liberté choisie et non subie. Il peut braver et défier tout le monde sans que personne ne puisse l’importuner. Il n’offre aucune prise, aucune faille auxquelles le monde extérieur pourrait s’agripper pour le réduire à néant. Très souvent, Georges ne peut s’empêcher de comparer sa vie à celle de son beau-frère. Jules est heureux, lui ne l’est pas.
Jules est une figure du village. Malgré son côté marginal, tout le monde l’aime et le respecte. Il est le premier à entraîner derrière lui les foules de gamins, les jours de carnaval, en s’affublant de déguisements improbables et en s’agitant avec des pitreries qui émerveillent les enfants, autant qu’elles font sourire les parents.
Chapitre 4
De la déclaration de guerre du 3 septembre 1939 jusqu’à l’offensive allemande du 13 mai 1940, lors de la percée de Sedan, toute la population ardennaise reste dans l’expectative. Aucun combat n’a lieu. Tout juste les gens sont-ils invités à se munir de masques à gaz pour contrer une éventuelle attaque chimique. La population se dit que c’est « une drôle de guerre ». Pourtant, en ce mois de mai qui ressemble à un mois d’été, il faut bien se rendre à l’évidence. Hitler a donné l’ordre d’envahir la France et cela commence par les Ardennes. La guerre est désormais palpable, visible. Georges, démobilisé en août 1939 et affecté à la réserve des travailleurs sans participation aux combats, est contraint de suivre la population lors de l’exode massif qui met 280 000 Ardennais en route vers la Vendée.
Georges, Marceline et leur fille Cécile se retrouvent ce 13 mai 1940 derrière une charrette remplie de valises et de cartons, auxquels s’ajoutent quelques provisions, pour marcher vers la destination des Herbiers qui leur est assignée par les autorités. Accompagnés par des centaines de milliers de compatriotes contraints de fuir eux aussi, ils emportent avec eux tous leurs effets personnels, les vêtements, les draps et les couvertures, l’argenterie héritée de leurs familles respectives, ainsi que les quelques cadres qui ornent les murs de leur modeste maison. Marceline veille sur sa lampe à pétrole, soigneusement emballée dans un amas impressionnant de chiffons protecteurs, comme si cette lampe représentait pour elle le seul espoir de sortir des ténèbres. André, qui vient d’avoir 18 ans, décide de ne pas les suivre. Il profite de ce moment pour s’émanciper et rejoindre le maquis, la clandestinité et la résistance.
Sur la route de l’exode menant à la Vendée, Georges, jusqu’à présent resté dans l’ombre, s’érige subitement en chef de groupe. Il trouve là, pour la toute première fois, en l’absence de son fils, une véritable raison d’exister. C’est lui qui prend désormais les décisions, indique s’il faut s’arrêter ou continuer, fait le choix de l’endroit où dormir lorsque vient la nuit. Marceline, fatiguée par la marche épuisante de l’exode, le laisse faire et s’occupe de l’organisation des ravitaillements.
Pendant leur voyage harassant, guidés de manière désordonnée par les militaires français stationnés à chaque carrefour, Georges, Marceline et Cécile découvrent une pagaille immense. Rien n’a été préparé. La survie dépend de la solidarité des personnes rencontrées sur le chemin. La Croix-Rouge est présente et prodigue quelques soins aux personnes âgées et aux enfants pour qui le voyage est difficile. Parfois, les stukas allemands survolent le convoi de réfugiés et mitraillent allègrement la foule. Certaines familles relèvent déjà leurs morts.
La plupart sont accueillis quelques jours plus tard par la population des Herbiers, petite bourgade en plein cœur de la Vendée. Celle-ci a été désignée un peu avant par le ministère des armées afin de recevoir les familles ardennaises en exil. Située en zone occupée, selon les accords d’Évian signés par le maréchal Pétain, la région est consciencieusement quadrillée par une multitude de soldats allemands qui défilent au pas cadencé et répandent la peur parmi la population.
Georges, Marceline et Cécile sont accueillis par la famille qui leur a été attribuée. Ils échangent son hospitalité contre des travaux de ferme. Georges intrigue. Comment un homme aussi jeune peut-il se trouver à cet endroit, avec sa famille et à ce moment si particulier de la guerre ? Pour un homme de son âge, se présentent normalement trois alternatives : soit il devrait combattre dans les troupes françaises régulières, soit il devrait être fait prisonnier et enrôlé dans le S-T-O, le Service du Travail Obligatoire, soit il serait réformé pour raison de santé. Mais manifestement, Georges est un homme gaillard. Sa présence sur le sol vendéen ne semble pas convaincre les autorités allemandes qui surveillent les nouveaux candidats à l’exil. Un officier allemand qui suit de près les allées et venues de Georges, poussant consciencieusement sa charrette, décide alors de le présenter à la Kommandantur. Il est fait prisonnier quelques jours à peine après son arrivée aux Herbiers.
Georges est arrêté le 10 juin 1938. Il en éprouve une sorte de fierté. Lui aussi va pouvoir dire qu’il a été fait prisonnier de guerre, ce qui lavera sans doute l’affront de la Première Guerre mondiale à laquelle il n’a pas participé. Mais les autorités allemandes comprennent très vite que l’homme qu’ils viennent d’arrêter est insignifiant. Il n’est pas un combattant engagé. Son livret militaire témoigne de son éloignement du conflit armé. Ils le relâchent dix jours plus tard. Georges obtient des autorités militaires françaises que soit inscrite la mention de prisonnier de guerre dans ses états de service. Il obtient dans le même temps un certificat de bonne conduite. Ce document possède pour lui la valeur d’un trophée inestimable. C’est la seule récompense qui lui est attribuée pendant cette Seconde Guerre mondiale. Après quoi, il sera rayé des listes et ne sera plus jamais importuné par l’autorité militaire.
Après quelques semaines passées à survivre sur les terres de Vendée, toute la famille, sous l’impulsion de Marceline, décide de rentrer à Signy-l’Abbaye. Ils ne sont pas les seuls à avoir opéré ce choix. Georges a appris que la filature Bonnet qui l’emploie a repris du service. Elle est désormais partiellement contrôlée par les autorités allemandes. Les machines à tisser sont reconverties pour fabriquer des étoffes de guerre. Georges préfère retourner chez lui et travailler sous la contrainte plutôt que de continuer à être hébergé dans une région qu’il ne connaît pas. Georges, Marceline ainsi que Cécile retrouvent leur maison à peu près intacte. Elle a bien été visitée pendant leur absence, les serrures ont été cassées, probablement enfoncées à coups de crosse, mais l’essentiel est resté là. Même le poste à galène de Georges n’a pas bougé de place. Ses bobinages censés capter les ondes radio sont tellement imposants qu’il en était inintéressant et intransportable. Ils ont eu de la chance. D’autres maisons ont été dévastées par l’occupant et entièrement détruites.
Chapitre 5
André n’a pas suivi ses parents sur les routes de l’exode et il a rejoint le maquis pour s’enrôler dans les Forces Françaises Intérieures. André est déterminé à combattre l’ennemi. Il veut apporter sa pierre à l’édifice de cette résistance souterraine qui s’organise dans l’ombre et le captive. André éprouve une immense fierté lorsqu’il prend cette décision. Il se rêve désormais en fer de lance de la résistance et pas une seule fois il n’est traversé par l’idée qu’il pourrait y laisser sa peau. André est aidé au quotidien par son oncle Jules qui connaît la région comme sa poche et lui indique tous les endroits où il est possible de se cacher pour échapper à l’armée allemande.
Jules est un informateur du réseau. Dans la famille, personne ne sait qu’il occupe cette fonction au sein de la résistance. Personne non plus ne lui prête attention lorsqu’il déambule dans les campagnes, sa besace remplie de grenouilles ou de pissenlits fraîchement cueillis. Mais lorsque Jules comprend qu’André veut s’impliquer dans le réseau des FFI, il prend le risque de se découvrir et de lui fournir les informations de contact nécessaires. André est alors présenté aux membres actifs de la cellule du réseau de Signy-l’Abbaye et prête serment. Il doit désormais une obéissance absolue aux gradés de cette armée souterraine qui le commande. Il doit jurer qu’il préfère mourir plutôt que de trahir ses camarades.





























