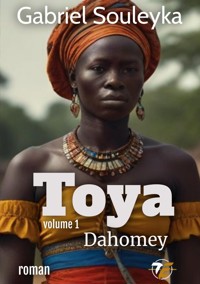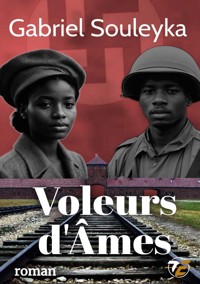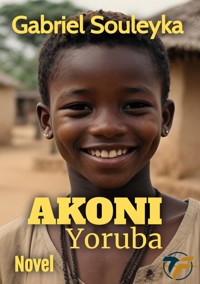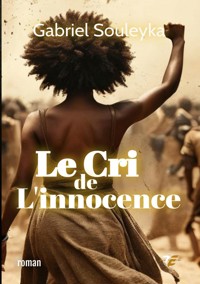
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le29 novembre 1802, en Guadeloupe, une jeune femme de trente ans est conduite à l'échafaud, condamnée à mort pour avoir participé à une révolte contre le rétablissement de l'esclavage par la France. Aboli en 1794 pourtant, elle est enceinte de son premier enfant, la veille elle donne naissance à un petit garçon aussitôt transmis à son premier maître en guise de dédommagement. Cette femme, symbolisant des milliers de guadeloupéenne, avance en silence jusqu'à la potence, affrontant son destin avec dignité. C'est en hurlant : Vivre libre ou mourir, qu'elle fait ses adieux à ce monde. Mais il va se passer une chose inattendue, qui va lancer le récit, une porte lumineuse s'ouvre, elle est aspirée contre son gré, se retrouve dans la cale d'un navire négrier parti de Ouidah en Afrique. Ne comprenant pas la situation, elle découvre alors sa mère Ayomidé, enceinte d'une petite fille, après avoir subit les ravages de l'un des marins. Ayomidé à 14 ans, elle porte cette jeune femme que l'on connaîtra sous le nom de Solitude. Devenant spectatrice unique de sa propre histoire, de celle de sa mère, de toutes ces personnes subissant l'esclavage, de ces résistants de l'ombre formant des clans Neg Marrons. Dans ce livre, découvrez son enfance rugueuse, sa lutte, ses espoirs, son histoire d'amour impossible avec Lukengo, le valeureux africain ayant échappé à sa condition. Elle fera la rencontre de Louis Delgrès, Joseph Ignace, symbolisant la résistance. Une immersion dans la réalité d'une servitude implacable, habillée par le Code Noir. L'histoire de l'esclavage sous un nouvel angle, apportant l'humanisme à des personnes qui étaient sensées ne plus en avoir. Solitude fut maltraité par l'histoire, un mythe pour certain, juste un murmure pour d'autres, l'auteur lui rend hommage avec ce roman rigoureux.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 934
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur,
Le Cri de l’innocence
Solitude, l’enfance (volume 1)
Solitude, révolte (volume 2)
Akoni Yoruba
Voleurs d’âmes
Toya, Dahomey (volume 1)
Toya, Haïti (volume 2)
Nos Héroïnes noires : 30
Khepri l’Egyptien
Insoumis
Renaissance Kamite, Héritage, identité et Modernité
L’ombre oubliée
Retrouvez Gabriel sur l’ensemble de ses réseaux,
Gabriel Souleyka
www.tiolejaeditions.com
Sommaire
AVANT PROPOS
MOURIR
2. CASES
3 PRIVILEGE
4 CHAINES
5 SOUMISSION
ESCLAVES
DOMPTER
MEMOIRE
REVOLUTION
AMOUR
TENEBRES
RESSUCITEE
AVANT PROPOS
Je suis devenu écrivain par la force des choses, œuvrant dans l’industrie cinématographique, quelque peu désarçonné par l’incapacité à pouvoir produire des films traitant de la réalité historique de ce qu’a vécu le peuple noir à travers les époques. Un roman historique est un exercice périlleux, les historiens vous scrutent, les apprentis encore plus, ne parlons même pas de ceux qui jugeront sans avoir produit ne serait ce qu’une ligne. J’ai fait ce choix éclairé, non pas pour légitimer mon parcours, mais bel et bien pour raconter notre histoire.
Le Cri de l’innocence est mon premier roman, très épais, car je n’avais aucune certitude sur la suite de ma carrière littéraire. Mon premier éditeur se sera joué de moi, ne me permettant pas de m’épanouir pour la suite de ce que je voulais entreprendre. Yasmina Fagbemi aura eu l’idée lumineuse de proposer la création de Tioleja éditions. Puisque Tioleja Films existait déjà, elle avait la conviction que nous devions contrôler notre narration, plus encore, éditer nos livres et en assurer la promotion par l’intermédiaire de ses compétences via l’agence YFE. Ouvrant ainsi la voie à mes livres suivants. Qu’elle en soit remerciée, puisque dans cette vie, la fidélité est une chose de plus en plus rare.
Je me devais de rendre justice à la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane, Mayotte, la Kanaki, Haïti, par la voix de Solitude, qui finalement, est celle des opprimées. Ce livre est une leçon d’humanité, de courage et d’une lutte qui résonne encore aujourd’hui aux Antilles. Lisez-le sans contraintes, allez au bout, honoré la, honoré les. Car en vérité, vous êtes Solitude, Lukengo, Louis, Joseph et les autres.
Gabriel Souleyka
MOURIR
Dans l'ombre d’une cellule froide, ravagée par les morsures de la nuit, ils m’ont volé mon fils unique. Je quitterai ce monde sans m’abreuver une dernière fois de son sourire, c’est alors que le visage de Mathilde s’impose à mon âme, fragile et pur, une fillette de neuf ans, si précieuse dans son innocence. Mathilde… Elle n’a rien demandé, née dans la poussière d’une case sordide, à l’ombre d’un maître aussi cruel que le temps qui l’a façonné, Villeneuve, ce nom qu’on murmure avec crainte. Elle est venue au monde dans une nuit de douleur et de silence, arrachée des entrailles de sa mère comme un trésor volé, un joyau meurtri dès la naissance. Sa mère, broyée par la brutalité de cette venue, n’a pas survécu, laissant Mathilde orpheline et porteuse d’une malédiction, car la perte d’une esclave ne vaut guère plus que celle d’un animal aux yeux des colons. Pour cette enfant, née de l’injustice et de la violence, la vie se décline en survie. Pourtant, jamais elle ne se plaint. Malgré sa claudication, elle avance, illuminant l’obscurité de cette existence par une lueur qu’aucune souffrance ne semble pouvoir éteindre. Qui est son père, me demanderez-vous. Elle est née du ravage, de ce mélange forcé qui naît du désir impérieux de ceux qui chérissent secrètement notre peau comme un fruit défendu. Mathilde, marquée par le feu et le sel, est devenue la préférée de tous, avec son rire éclatant, sa force silencieuse, ses pas boiteux mais décidés, traversant jour après jour les champs sous le poids des fagots de canne à sucre. Elle sait ce qu'elle doit endurer, connaît la cruauté du commandeur Jacques, ce Français venu oublier sa honte dans le vin et la violence. Mais elle résiste, Mathilde, comme une fleur qui refuse de faner sous le soleil ardent de l’esclavage. Un après-midi de juin, alors qu’elle ramasse les bagasses, Villeneuve apparaît à cheval. Il est là, inspectant avec l’œil perçant d’un homme obsédé par le profit, et quand il apprend que les rendements sont plus faibles que prévu, sa fureur éclate. Descendu de sa monture, il frappe tout ce qui se trouve sur son chemin. Mathilde tente de se faire invisible, ses petits bras chargés de sa récolte, accélérant vers l’atelier. Mais son fardeau glisse de ses mains sous l’intensité de la peur. Villeneuve s’approche, éructant de colère, les yeux injectés de mépris. À côté de lui, le commandeur murmure, insidieux : « Elle est inutile, une bouche de trop à nourrir. » Le maître saisit alors la fillette, la soulève comme on emporterait un sac, et dans un silence de plomb, il l’emporte, possédé par une rage indicible. Et puis, il y a le geste d’horreur, le basculement définitif. Sans un mot, il jette Mathilde dans la cuve bouillante de mélasse. Son cri déchire la plantation, un hurlement de souffrance pure, déchirante, traversant la chaleur moite, pénétrant l’âme de ceux qui l’entendent. Un seul homme ose défier le maître, s’élançant vers la cuve pour arracher la petite des flammes. C’était Patrice, son vrai nom Fosto, un Bamiléké venu d’Afrique, lui aussi prisonnier de cette folie. Il ne survivra pas à cet acte d’humanité. Quelques heures plus tard, il sera pendu, un dernier regard empli de dignité. Déposée sur le sol de la case, Mathilde n’est plus qu’une plaie vive. Le maître a ordonné de la laisser là, mais Fosto, malgré la menace de mort, l’emmène avec tendresse, tentant de soulager son agonie avec les moyens dérisoires de leur captivité. Pendant trois jours, elle lutte, puis enfin, son cœur s’éteint, emportant son sourire et sa lumière, dans l'ombre éternelle de cette case poussiéreuse. Aucun soin n’a pu venir à elle, aucun autre bras n’a tenté de la sauver. Villeneuve, pourtant son propre géniteur, l’a regardée s’éteindre, car la folie des colons n’a d’égal que leur cruauté, eux qui se croient maîtres d’âmes et de corps, rongés par une maladie de l’esprit qui les consume. Ainsi, Mathilde disparaît, mais elle laisse une marque dans le silence du souvenir, un cri qui perdure, une douleur qui traverse les générations. Pour ce crime odieux, cette barbarie digne des annales de l’histoire de l’humanité, Villeneuve s’expliquera brièvement devant le Procureur du Roi, le Code Noir le contraignant à s’acquitter d’une amende de 15 francs. Voici la valeur d’une vie pour la France, celle d’une petite fille innocente.
On me sort alors de ces pensées, des gardes, souriant à souhait, ils vont me mener à ma dernière destination. Tout est calme, le silence apaisant, un ciel du bleu de l’enfance s’offre à mon regard ; quelques oiseaux me narguent avec l’élégance d’une liberté insolente, virevoltant en des cercles parfaits. Ils n’ont besoin de personne pour subsister ; ne connaissant pas la servitude bien que l’homme aime les mettre en cage avec cette illusion de les soumettre à des lois qu’ils ignorent totalement. Qui peut croire que la nature est une esclave ? Nous marchons sur la même terre, nos cœurs battent au rythme de l’espoir ; faisant apprécier chaque jour, pourtant aujourd’hui je vais perdre la vie ! À la merci de ces visages haineux, jaugeant, cherchant la faiblesse de mon être sans comprendre ce que j’ai été. Jugeant seulement ce que je suis ici, sans rien savoir des secrets de mon âme ! La foule est nombreuse, ignorant tout de mes rêves, de l’homme qui vivait près de moi, de cette vie qui résonnait dans mon ventre hier encore, volée brutalement au cours de la nuit. Ils ne voient que ma couleur, mes cheveux crépus, disant qu’une partie de moi est comme eux, mais que l’autre est bonne pour la corde ; faisant de mon être une malédiction qu’il faut détruire. Le nom que j’ai choisi pour leur déplaire, laisse penser que je suis seule ; ils se trompent, car aujourd’hui vibrent tous ces martyrs anonymes, les ancêtres m’accompagnent avec bienveillance. Je suis le fruit de leurs péchés, d’une honte sans son masque, l’inavouable se dressant devant eux, aussi fière que la légende me précédant, noire par ma dignité et une folie perpétuelle. Issue d’une matrice sombre, sans âme selon eux, m’ayant délivrée dans une saveur cannelle qu’ils adoptent sans le vouloir à trop taquiner ce soleil béni, malgré des poudres blanchissantes. La mulâtresse1, voilà comment ils m’ont nommé, le croisement d’un cheval et d’une ânesse donnant une mule, bête idéale et docile qui jamais ne se plaindra, ne rechignant pas à la tâche en silence ; je suis une Femme pas un animal, refusant leur histoire ; ils n’ont jamais rien fait pour moi, hormis m’asservir continuellement, du moins ils ont essayé en vain, condamnés à l’échec insolent. Fière de ma racine Africaine, délaissant la Française, désormais la peur m’a quitté ; les miens ont rejoint les ancêtres au firmament des illusions perdues, devenant des phares sacrés à leur tour. Ils peuvent donner la mort sans savoir que la liberté m’est acquise, ne viendront que leurs regrets de n’avoir pu me dompter, n’ayant jamais eu mon âme à leur portée, seulement un corps meurtri. Ayant fait cette promesse de rester digne jusqu’à mon dernier souffle, demeurant intacte, mon esprit voguant vers les mornes sauvages, rayonnant au- dessus des champs de canne à sucre. Leurs palabres, trop audibles, pernicieuses et sans convictions, faisant de moi la fille d’un maître incapable de contenir ma rage, il toise au loin l’air mécontent, désespérément seul et triste. Quelle disgrâce de livrer sa propriété à la potence, l’offrir en sacrifice sur l’autel de l’esclavage, pourtant, ce lâche m’aura brutalisé des années durant avant que je ne lui échappe définitivement. Il semble minuscule, impuissant face à ce qui se joue ; lors de ma capture, il me voyait déjà revenir, servant des liqueurs à ses convives, pauvre incrédule sous un chapeau de paille. Riant intérieurement, ne laissant rien paraître ; mon ultime satisfaction étant de lui déplaire encore, avec l’absence de réponses notables à toutes les questions qu’il aura dû se forger tout ce temps !
L’oubli est une forme d’évasion, Solitude, Martyre de l’égalité, vivante dans la mémoire de mon peuple, les combattants de la liberté, mon nom résonnera dans l’immensité de l’espérance. Aux autres, je resterais la folie hurlant à travers leurs habitations2, incapable d’obéir à ces règles faisant de nous des animaux de somme noyés dans un flot continu de sang, sueur et larmes. Voilà pourquoi on me pend sur la grande place, brisant le symbole à la vue de tous, dernière humiliation dissuadant le moindre murmure de révolte, éteindre cette volonté férocement. Ils savaient que je ne cesserai jamais la lutte, d’autres la poursuivront après moi tels les maillons de ces chaînes avec lesquelles ils nous maintenaient, forgeant nos armes du renouveau. Ce n’est que maintenant que je comprends Jésus dont ils voulaient m’abreuver plus que de raison, le rendant indigeste, livré au malheur, fouetté puis mis à mort comme nous autres finalement. Des images reviennent, d’un blanc au regard triste, torturé, meurtri dans sa chair avec lequel ils ont justifié toutes leurs actions, nous asservissant durant des siècles. Eux l’adorent sans rien apprendre de ses enseignements, réduisant son amour universel en une hypocrisie qu’aucun de nous ne devrait suivre, fidèle à une spiritualité millénaire ancrée à l’âme. Parmi la foule, je remarque des visages familiers, mulâtres, noirs, Marron arborant fièrement leurs cicatrices, certains les yeux emplis de larmes, ils sont venus soutenir courageusement mon départ. Je leur donne mon plus beau sourire, c’est la seule chose que j’ai à offrir à présent, les nombreux soldats veillant à ce que je sois avilie, personne n’osera m’adresser de signe pour ne pas me rejoindre. Mes sœurs, frères, resteront en Guadeloupe, asservies par le fouet et les fusils, faisant face avec détermination, héritant un jour de ces terres, legs d’une souffrance impossible. On ne tuera jamais l’irrésistible volonté de liberté nous animant, habitant nos enfants, les suivants, jusqu’au jour où chacun sera comme l’autre, sans distinction de peau, tous égaux. Dans l’air, il y a une odeur troublante, celle de l’herbe humide, la grande mer qui nous borde, si belle que je la déteste de nous maintenir dans cet écrin sans équivoque aux mille couleurs. Vomissant mon peuple, enchaîné par le fer navire après navire, comme ma pauvre mère, capturée, volée à sa terre vers un voyage sans aucun retour, assouvissant une perpétuelle soif de richesse. Débarquant, avec moi dans son ventre, cadeau d’un négrier l’ayant brutalement ravagé pendant la traversée, sans quoi je ne serais pas venue au monde, ignoble présent de l’esclavage. C’est ainsi que je suis née, apprenant à aimer la Guadeloupe, ces fleurs, fruits, plaines et sentiers mystérieux, débouchant sur des cascades purifiant bien des âmes déracinées. Voilà pourquoi les colons l’avaient convoité, quand ils veulent quelque chose, ils le prennent sans passion, juste pour le plaisir de posséder, sans l’humanité essentielle à ce trésor d’une nature fertile. Maintenant, j’allais quitter cette vie, l’Afrique me hantait encore, un idéal demeurant dans chacun de mes rêves, au travers des contes autour d’un feu, sur les hauteurs de la Soufrière avec mon clan. Ses chants, danses, coutumes ancestrales, la plaine jaunie par le soleil brûlant, je ne la verrais que dans cet au-delà dont je ne savais rien, seulement que les ancêtres me feraient un accueil fraternel. Mes prières ont toujours été pour mon peuple perpétuant la terre sacrée, véritable berceau nacré, dont nous avons tellement cru, la cherchant chaque nuit, derrière la lune et les étoiles lumineuses.
À présent, ressentant tout, de mes pieds nus sur ces planches sèches, composant la potence où je me tenais, à cette foule instigatrice voulant voler mon dernier souffle de volonté tenace. Une vibration remontant dans mon corps, comme pour me rassurer sur cet ultime voyage, s’est faite plus intense, diffusant une paix apaisante, bienvenue à mon cœur agité de toute part. Les ténèbres envahissaient doucement mes yeux, la fatigue de ces longues semaines refaisait surface, m’endormir paisiblement, ne pas souffrir, quitter ce monde sans aucun regret. Une voix lourde et blême, venue de nulle part, brisait mes songes, l’écueil de ma communion.
— Désires-tu la confession ma fille ?
Portant robe noire, le visage farineux, un prêtre qui tant de fois m’avait insulté, voilà que j’étais son enfant à présent, hypocrisie maladive appelant une réponse sèche.
— Je ne suis pas ta fille, tu n’es pas mon père !
Ruisselant de sueur, s’épongeant avec son mouchoir, jauni par le temps, ma répartie l’avait giflée telle une pierre en pleine poitrine.
— Dieu est bon, je dois te donner l’absolution !
— Mais les nègres n’ont pas d’âme, ton livre l’a suffisamment répété !
— Tu es mulâtresse reconnue par le Seigneur !
— Je sors du ventre d’une négresse à la peau aussi noire que la nuit ! Où était-il lorsque je me faisais violer par des chasseurs ? Quand les miens recevaient la mort par manque de travail ? Où était-il à Baimbrige, au Fort Saint-Charles, à Matouba ?
Sa gestuelle répulsive dévoilait son visage hypocrite.
— Je ne suis pas juge, encore moins bourreau ; seulement un représentant de Dieu venu t’apporter le dernier réconfort car tu es baptisé !
— Ma seule église c’est l’Afrique, m’ayant donné la véritable foi !
Son rire gras voulait fragiliser mon propos, serrant fermement sa bible contre lui en quête d’une réponse.
— Tes blasphèmes ne sont que provocation, il n’y a aucune inclination dans vos croyances primitives, fait repentance pour le salut de ton âme !
— Le salut réside dans la liberté de mon peuple, quant à mon âme, elle brillera au firmament de mes glorieux ancêtres !
Reculant, dévoilant un masque de dégoût, aussi répugnant que tout son être.
— Ainsi soit-il, va donc les rejoindre dans l’abîme de damnation, tous ces sauvages !
Signant des croix dans le vide, comme pour me prémunir, je souriais avec malice.
— Si je suis avec eux, alors ce n’est pas si mal, j’irais le cœur léger !
Il s’est retiré, dodelinant de la tête, marmonnant des paroles inaudibles, mon arrogance avait eu raison de ce minable représentant du Dieu imaginaire, que personne n’avait jamais vu en vérité. C’est à cet instant que je découvrais le bourreau, la fin approchait, portant un vulgaire masque de jute, cachant à peine son visage, avec des gants ridicules, lui donnant un aspect « démoniaque ». Devinant la même couleur que moi, quelle ironie du sort, les tâches ingrates nous revenaient souvent, faisant des mulâtres les parfaits exécutants dociles, jusqu’à mener une sœur à la mort. Nous étions tous deux enfants de la superstition, fardeau du blanc et honte du noir, personne n’assumant vraiment notre condition, le fruit d’un désir inavoué envers les femmes africaines. Ne comprenant toujours pas, pourquoi la saveur noire était courtisée par ces colons, à croire que leurs épouses avaient le goût du pain rassis, des fleurs fanées par le soleil sans éclat aucun ? La beauté sombre pouvait ensorceler n’importe quel individu, alors pourquoi fouetter celle, qui par sa grâce innocente, comblait bien des regards ? Comment la soumettre aux pires sévices ? Venir la visiter de nuit tel un voleur, au prétexte fallacieux de blanchir mon peuple, effaçant la noirceur des âmes en peine, réduite à un objet servile, ces lâches affirmant une virilité sans audace. En vérité, ils ne pouvaient admettre cette attirance irrésistible les habitant, nous étions sûrement dans chacun de leurs rêves, des ombres éphémères, douceur ébène aux courbes impossibles. Le charme noir m’avait frappé, dès que mon regard s’était posé sur mon homme, fermant les yeux, cherchant son noble visage, faisant le silence en moi, m’abreuvant de ses paroles tendres. Rien ne venant, dépité, fixant ce mulâtre à l’air pataud, donnant l’impression de m’attendre.
— Tu n’as plus rien à craindre, c’est bientôt fini petite sœur ! L’incroyable douceur de sa voix m’avait prise aux dépourvues.
— Je n’ai pas peur grand frère !
— Pourquoi pleures-tu alors ?
Des larmes, incontrôlables, coulaient le long de mes joues, sans doute les souvenirs d’une vie de servitude, de lutte, de cet amour s’étant répandu en moi.
— Rien ne rapproche davantage que l’absence, le fils qu’il m’a offert, a été volé cette nuit !
— Le tonnerre de Matouba résonne dans le cœur du peuple, ton enfant sera honoré d’avoir eu comme mère la mulâtresse Solitude, une guerrière sans peur !
Ne voulant plus penser à cet enfant, que je ne verrai jamais grandir, qu’il arrête de tenter de me réconforter, la chose était jugée, ses paroles n’apportaient rien, la mort s’imposait d’elle-même. Le silence s’est fait entre nous, nos regards en disaient plus, déroulant une corde épaisse, la passant autour de mon cou avec une certaine délicatesse terrifiante en vérité, bien que je le cache. Faisant revenir en mémoire l’un de ses pendants, ayant pris des précautions à la pose d’un collier d’identification lors de mon enfance, symbolisant un temps ma soumission aux yeux de tous. Cette corde était rêche, agressive, la serrant si fort que j’en ai eu le souffle coupé, une panique sournoise frappait à ma porte, je devais garder mon calme, ne pas sombrer, rester digne tout en l’écoutant.
— Pardonne-moi, j’ai serré le nœud, ta fin sera rapide !
Rien dans mon regard ne disait que je voulais trépasser, seulement vivre encore un instant.
— Je pardonne ce que tu es, pas ce que tu fais !
Ses mains tremblaient, presque honteuses de ses actes.
— Je suis un lâche, pris dans un filet dont personne ne s’échappe !
— Pourtant je le fais, vois comment je vais fuir, toute l’armée de France ne pourra pas me suivre cette fois !
Reculant, faisant presque une révérence, annonçant la fin, souhaitant prolonger cet échange avec lui, qui constituait à présent le seul lien avec les miens, derrière son masque grotesque, bien dérisoire. La trappe allait s’ouvrir, je ne toucherais plus terre, perdant l’harmonie avec la nature, uniquement reliée par une corde fournie par la France, m’ayant capturée, soignée, gardée, afin de mieux me tuer aujourd’hui. Cette Nation exemplaire pendait une femme insignifiante, aspirant à la liberté, c’est pour ce crime que l’on m’ôtait la vie à trente ans, exposant mon enfant à un esclavage mortel. Mon martyr étoufferait notre combat sous leurs bottes de cuir, c’est sûrement ce qu’ils pensaient en m’exhibant ainsi aux Français, mettant un visage sur la révolte, rassurée par mon apparence chétive. Je n’étais que l’écho de la fureur du peuple, une étoile, dans une nuit clairsemée, brisant ces chaînes, maintenant tant des miens dans l’ignorance de leur salut, les appelant au soulèvement. Ce vingt-neuf novembre 18024 serait le sceau de l’infamie, marquant la fin du calvaire de tous ceux qui sont tombés lors de cette lutte glorieuse, inaugurant une aube nouvelle, faite d’espoir et de bravoure. La mort de l’esclavage était pourtant acquise, leur chef en avait décidé autrement, nous laissant à notre condition, on ne pouvait pas l’accepter sans combattre ou le revendiquer fièrement, avec courage. L’éveil serait durable, un réveil brutal pour chaque Français, ils ne pourraient plus donner du fouet en paix car on avait versé leur sang, tous savaient qu’on ne courberait plus jamais notre dos. Symbolisant l’abolition malgré moi, bien que je n’aie jamais effleuré l’Afrique, beaucoup se reconnaissaient dans ma folle volonté de batailler, incarnant la détermination de ma terre sacrée. Ceux qui m’avaient côtoyé sur les hauteurs de la Soufrière, voyaient que la liberté m’accompagnait à chaque pas, que mon homme en était le plus digne des représentants, un guerrier indomptable. Le général Lacrosse, à qui je devais ce jour funeste, s’est levé de sa tribune, sans même me regarder, donnant le signal au bourreau pour son office, d’un geste capricieux plein de dédain. Prenant ma plus forte inspiration par peur de manquer d’air, la trappe s’est déclenchée, ne touchant plus les planches, le temps s’est suspendu, un sentiment de frayeur s’emparant de moi. Les yeux bien ouverts, hurlant de toute mon âme, que chacun puisse l’entendre, d’un cri, symbolisant tout ce pour quoi nous avions vécu, avec perte et fracas.
— Vivre libre, ou mourir !
Le soleil ne pouvait plus m’aveugler, quittant ce monde dans une lumière déclinante, il faisait sombre, seulement le néant, la clameur disparaissant sous une chape de silence trop inquiétante. Pensant ressentir une douleur inconnue, sans savoir pourquoi, je n’étais plus sur la potence, mais ailleurs, dans une sorte de voile ténébreux épais, m’enveloppant de toute part, presque perdue. Les ancêtres se jouaient de moi, j’avais rêvé tout cela, la folie volait-elle mes derniers instants ? Ma mère racontait souvent que nous retournions auprès du Père Céleste, ne comprenant pas ce qui se passait, mon âme vibrait d’une étrange sensation irréelle, mélange d’appréhension et d’angoisse. Souhaitant hurler, aucun son ne venait, touchant mes mains pour être sûre que j’étais consciente, elles étaient absentes, invisibles, à mon grand désarroi, mon corps n’avait pas fait cette traversée. Une peur intense m’a envahie, l’ignorance s’installait, un doute rongeait mon esprit, mon combat ne pouvait pas se figer dans un vide absolu, invoquant les ancêtres, cherchant une issue favorable. C’était sans doute la récompense des martyrs, ne pas souffrir plus que de raison, mais pourquoi, tout ce mystère ? Où étaient les rivages éternels, le bassin sacré dont ma mère parlait ? J’aurais voulu pleurer, ne le pouvant plus, j’ai patienté, sans notion du temps, puisque rien ne pouvait me donner de repère viable, complètement perdue, désespérée par cette situation inconnue. Ni lune ou soleil, rien de tangible, une impression de flottement, comme noyée dans une eau invisible, désagréable souvenir d’enfance, se mêlant à ma réalité tellement insoluble. C’est alors qu’une lumière aveuglante perçait le voile, dardant de ses rayons, qui au fur et à mesure faisaient reculer les ténèbres, m’avançant vers la source, ignorant comment me mouvoir. Distinguant une porte, se dessinant doucement, sans pouvoir évaluer le haut du bas, pas de sol, seulement une nausée perturbante, ravageant amèrement ce qu’il me restait d’esprit et lucidité ; face à ce rectangle éblouissant, insondable, j’étais perplexe, immobile, puis soudainement, sentant une emprise invisible, saisissant mon essence, m’aspirant brutalement à l’intérieur de lui. Étrangement, je n’ai ressenti aucune crainte, acceptant mon sort, que pouvait-il m’arriver de pire que la potence ? La fébrilité n’étant pas coutumière, attendant à nouveau, admettant la fatalité ; en l’absence de respiration, de toute vitalité, déduisant que j’étais devenu un esprit, condamné à l’errance éternelle dans un autre monde ou à subir de nouvelles épreuves, endurcissant l’âme. Le décor se dévoilait difficilement, dans l’air, une drôle d’atmosphère, ne pouvant la sentir, mais la devinant aisément, c’était aussi sombre que la cellule où j’avais accouché hier seulement. Mon existence terrestre étant terminée, il fallait affronter la nouvelle avec courage, trouver la foi de continuer, bien que fatiguée de ces souffrances trop nombreuses contre si peu de bonheur et d’épanouissements. Ne pas se laisser abattre, forcer la concentration, prendre la mesure de ce qui m’entourait, car si l’épreuve de la tombe s’imposait, je devais en avoir le cœur net et me ressaisir pour la braver. Une vision terrifiante s’est alors offerte soudainement, des femmes, enfants, tous noirs, puis des hommes enchaînés les uns aux autres, tels des poissons sur l’étal, dans un alignement morbide et boisé. Tout était clair, je me trouvais dans la cale d’un navire négrier, croyant rejoindre le paradis des ancêtres, c’est l’enfer qui m’avait englouti, dévoilant le calvaire de mon peuple devenu captif. Un entassement méthodique, reposant sur le profit, fruit d’une longue tradition inhumaine, faisait frémir toute mon âme, cela semblait tellement réel, que je pouvais presque les toucher sans forcer. Les nombreux récits m’ayant conté ce voyage infernal ne remplaçaient pas ce que je voyais à présent, des malheureux, écrasés dans des compartiments bien trop étroits et oppressants à souhait ; respirant un air méphitique qu’un chien n’aurait pas voulu. Sans vraiment le sentir, je devinais au travers des minces filets de lumières des écoutilles, une poussière nauséabonde de vermine infecte ; beaucoup étaient accroupis, soutenant difficilement la tête, les visages figés sur une expression morbide me glaçant d’effroi, par chance, personne ne percevait ma présence « fantomatique ». Certaines jeunes filles, à peine âgées de quinze ans, tenaient misérablement un nouveau-né, cherchant du lait sur des seins asséchés pendant comme des bourses vides, sans vitalité aucune. Ils étaient au moins trois cents, mon homme martelait que le cœur pouvait mourir sur ce navire, tandis que beaucoup rejoignaient les ancêtres au fond de la mer, hantée par une folie destructrice. Détaillant cet antre du malheur, les frères étaient tous enchaînés, séparés des femmes et des enfants, allongés sur une planche épaisse, constituant un second pont sur toute la longueur, de chaque côté ; certains couchés sur le flanc, tellement proches que les jambes se mélangeaient les unes aux autres, complètement nus. Une manière de les maintenir dans une soumission forcée. J’étais impuissante, puisqu’invisible, simple observatrice de passage. Ces positions volontairement avilissantes, semblaient un supplice, beaucoup étaient repliés sur eux- mêmes, sans pouvoir tendre les membres, tous éteints, dans un véritable cercueil flottant menant à l’enfer. Au fond, solidement harnachées, des provisions, que par expérience je reconnaissais, ayant suffisamment pillé d’entrepôts et de navires lors de nos raids, nécessaires à notre survie quotidienne. Des tonneaux de fèves en grande quantité, du riz, maïs, manioc, bananes… de quoi sustenter l’équipage et laisser les restes à ces malheureux qui devaient tous s’habituer à la malnutrition. La faim posait un problème dès la capture, hélas, chacun de nous en souffrirait tout au long d’une vie de servitude, au point d’en tomber malade, en perdre le sommeil, verser bien des larmes amères. Me souvenant que parfois, on attachait une pierre contre nos ventres pour mieux le tromper. C’est alors, que trois hommes blancs ont fait irruption par une ouverture, munis de couteaux et d’une baguette fine à la main dont je devinais l’utilité, d’apparence brutale, terrifiante et malsaine ; leurs barbes fournies disaient qu’ils étaient en mer depuis un long moment, deux portaient un énorme baquet, le troisième, un sac en toile, rempli de petites écuelles individuelles en bois. M’approchant, distinguant une espèce de brouet infâme, épaissi avec de la farine de maïs, rehaussé de piment comme l’avaient décrit tant des miens, les soirs, réunis autour du feu. Aussitôt, comme un ballet organisé, les paumes se sont tendues, une voix sinistre a résonné, faisant sursauter les enfants, recroqueviller les femmes, tressaillir mon esprit d’une crainte rédemptrice.
— À la gamelle les nègres !
L’auteur du cri guttural, portant le sac, semblait agacé par cette besogne, balançant ses offrandes.
— Commencez par les négrillons, j’en ai attrapé hier, chapardant le rabiot, soyez vigilants !
Cet ordre est resté sans effet, l’un s’est mis à distribuer maladroitement les parts, pendant que l’autre s’approchait, donnant furieusement des coups de baguette avec un bon plaisir sadique. Je crois que je me devais de voir ça avant de partir définitivement, cette scène était dégradante, parmi eux il y avait des braves, réduits à mendier la pitance qu’on leur jetait presque à la figure. Alors que libres, ils auraient broyé leurs crânes, ravaler ces écuelles ébréchées cisaillant des lèvres bien trop sèches. Ces forces de la nature devenant serviles par cette traversée douloureusement destructrice. J’aurais voulu détourner le regard, mais au fond de moi, il fallait témoigner de la souffrance du calvaire négrier que je ne connaissais qu’au travers des récits, si telle était la volonté des ancêtres. L’amateur de violence fortuite s’est mis en quête d’un autre baquet, le dénichant près de quelques tonneaux solidement arrimés au fond de cale, y puisant de l’eau paraissant croupie. Cela ne semblait pas les déranger outre mesure, il l’a rempli pour aller faire distribution d’un breuvage qui allait sans doute ravager bien des ventres voire en tuer certains malheureusement. J’aurais pleuré toutes les larmes de mon corps afin d’apaiser leur soif. Cette frustration me forçait à scruter alentour, ne pas rester songeuse face à ce drame, maîtrisant enfin mon déplacement. Il n’y avait que souffrance et peine derrière ces corps meurtris, puis soudain, je l’ai remarquée, recroquevillée, refusant de manger, comme prisonnière d’elle-même, vision impossible en vérité. La reconnaissant immédiatement malgré son jeune âge, Ayo, ma tendre maman, oui c’était bien elle, son nom voulait dire « Joie » en yoruba7, son absence précoce avait occasionné un vide terrible toutes ces années. Si fragile, tellement proche, que j’aurais pu caresser sa joue, lui dire combien je l’aimais, de tout mon être, que son cœur et ses conseils m’avaient accompagné durant chacune de mes épreuves ! Tout devenait clair, traversant une époque révolue, les ancêtres montraient ce que j’étais à l’origine car son ventre bien rond trahissait ma présence, grandissant doucement en son sein. J’avais donné la vie seulement hier, la comprenant encore plus à présent, cela paraissait irréelle de me trouver ici, avec elle, faisant face à moi-même, à peine façonnée d’un souffle créateur. On m’avait raconté le jour de ma naissance, hurlant sa rage lors de la délivrance dans une des horribles cases. Me couvrant de tendresse, malgré la douleur, refusant de me laisser à qui que ce soit. Ma couleur ne m’avait pas autorisé à rester dans son affection. A presque dix ans, confiée à Denise, une femme blanche chargée d’éduquer les enfants mulâtres de l’habitation, puis je fus bannie en guise de punition. Cette séparation forcée, infligeant une cicatrice jamais guérie, l’aura conduite à dériver vers le gouffre abyssal d’une folie devenue son unique refuge, jusqu’à agripper le marronnage seule en m’abandonnant. Louis Delgrès8 disait que connaître son ennemi permettait de mieux le combattre, si seulement j’avais pris la mesure en allant visiter ces cercueils flottants, briser leur organisation bien établie. Ma mère était dans un état misérable, je décidais lâchement de rejoindre le pont supérieur, pour ne pas m’écrouler devant sa souffrance, profiter de ma présence, afin d’espionner ces ignobles brutes. L’occasion m’était offerte, découvrir l’intimité des négriers, ceux qui vendaient des êtres humains aux plus offrants, par un système certainement bien rôdé des siècles durant par les blancs. Cette sensation de flottement était troublante, évoluant telle une brise, traversant les parois sans même me rendre compte, pareille à une brume légère, s’insinuant partout sans aucune entrave. Désirant observer de près ces voleurs d’hommes, parmi eux se trouvaient fatalement mon géniteur, me retrouvant à l’extérieur, sur le pont principal encombré de marchandises. La mer était vaste, aussi bleue que le ciel, se confondant avec l’horizon ; aucune terre en vue, seulement l’immensité d’une beauté cristalline dont aucun des miens ne pouvait jouir de toute façon. Les matelots étaient moins nombreux, mais sans doute suffisamment armés pour contenir tout soulèvement. Ces paresseux donnaient l’air de ne rien faire prenant la fraîcheur marine. Pendant que ma douce Ayo étouffait avec les autres dans des relents de déjection, du soulagement obligé par l’absence de commodité contribuant à une infection généralisée ; le scorbut et toutes les maladies mortelles. En Guadeloupe, le marronnage m’avait offert une vraie liberté, me permettant d’étancher ma curiosité envers les bateaux, n’ayant de cesse d’apprendre leur organisation, la structure d’apparence complexe. Si bien, que je savais où se trouvait le poste de pilotage. Un blanc bedonnant au regard couleur de mangue, maniant la barre, soumettant ce monstre affamé de l’âme du peuple noir, naviguant vers l’oubli. Tout près de lui, un petit chétif à l’œil mauvais, dissimulant sa laideur derrière des fars et un habit de brocart trop large pour lui, tenant un livre en main, l’air nauséeux. Approchant de ces vermines, pris dans une discussion, le court sur pattes avait la parole.
— Vous avez été mal inspiré par ce changement de cap, ce retard nous aura coûté une dizaine de nègres ! En ma qualité de subrécargue, vous n’ignorez pas mes prérogatives ?
Continuant de fixer l’horizon, comme surpris par la remarque, il le prenait de haut.
— Mon souci est d’arriver à bon port, le vôtre, de rester fidèle au devis d’armement, ces traversées occasionnent toujours des pertes !
— Que la peste nous frappe, la tempête je m’en accommode, mais pas l’ivresse de vos hommes capitaine ! Sans compter ces impotents que vous avez acceptés, ils vont contaminer la marchandise.
Serrant fermement la barre, au point d’en faire blanchir ses phalanges, sa colère montait.
— Voyez ce navire comme un tonneau de vin fermentant au gré des vents, personne n’aime quand c’est aigre, n’est-ce pas ?
— Dans ce cas, que faites-vous des mauvaises graines, risquant d’avarier la cargaison !
Son sourire carnassier n’augurait rien de bon, j’avais bien compris chaque mot, ne voulant pas le croire, bien que le Code Noir nous considère comme une marchandise, un simple meuble. Je n’avais jamais vu de mobilier s’exprimer, crier de douleur, pleurer ou saigner, Colbert avait dû abuser de l’absinthe lors de sa rédaction, n’ayant sans doute jamais regardé un noir de plus près. Ils parlaient d’êtres humains sans aucune compassion, ne visant que les profits à venir, calculant le rendement, comme sur une habitation, nous réduisant à des chiffres sur un livre de compte en cuir. Ce sont des gens identiques que j’avais connus tout au long de ma vie, n’allant pas au-delà de notre condition, les bêtes avaient plus de valeur que nous, puisqu’elles ne se plaignaient jamais. Lorsque Goliath, un chien du domaine dans lequel j’avais perdu ma jeunesse, a rendu son dernier souffle, son maître l’avait pleuré, enterré au jardin, nous forçant à chanter son office funèbre. À la suite, un travailleur succombait de fatigue, son corps était tombé dans le fossé, la cadence, les quotas, imposaient de rester à nos postes respectifs, laissant la dépouille décrépir au soleil. La production l’emportait sur la raison, on n’avait pas eu le temps de l’inhumer selon nos coutumes, attendant le repos dominical pour le faire, fameux jour du Seigneur, soi-disant bénit. Les rires gras de l’équipage m’avaient ramené au navire, l’ouverture menant à la cale était ouverte, un des hommes tirait une corde, pendant qu’un autre hurlait des ordres.
— T’en as cinq, ils vont pointer le museau, tiens-toi prêt à les recevoir ! Aussitôt, un marin réceptionnait les miséreux trop affaiblis, un vieil homme, aux cheveux grisonnants, s’est écrasé sur le pont tête en avant, sous les regards amusés.
— Qu’est-ce qu’on fait d’eux capitaine ?
— Combien t’en compte moussaillon ?
— Deux mâles, trois femelles, elles ont de bonnes dents les bougresses ! Ils ne pouvaient pas se contenter de capturer et vendre, faisant preuve de cruauté, l’une des brutes frappait sans retenue, le capitaine reprenant.
— Ce ne sont pas des canassons, il n’y aura pas de collier à l’arrivée ; le regard est vitreux, ça sent le scorbut, par-dessus bord !
Des anciens, dans la fleur de l’âge, ayant le mérite d’avoir traversé leur époque, servant de repères aux plus jeunes, ils étaient nos trésors de sagesses, des attaches solides pour toutes nos vies. Lorsque la vieillesse les prenait, un esclave devenait une « épave »11, périssant seule et en silence, des ombres inutiles pour les colons, le remplaçant dans la foulée par un captif bien plus robuste. Ces vénérables ont été jetés à la mer, sans pitié, pourtant nos cris étaient les mêmes que les leurs, la couleur ne pouvait pas justifier la bestialité, cela me terrifiait, cette absence totale de compassion. Le blanc était fou et le noir pas assez, pour que cela se passe ainsi, en pleine mer, personne ne pouvait les entendre hurler, cette fosse commune avait la taille de l’Afrique si ce n’est plus encore. J’avais l’âme brisée devant cette tragédie, personne ne saurait jamais rien, comment en étions-nous arrivés là ? La barbarie inhumaine était à l’œuvre, voire le diable dont parlaient ceux de la croix. Toutes les histoires que j’avais pu écouter sur mon peuple, vantant notre royauté, les traditions ancestrales, teintées de batailles épiques, étaient vraies, aussi solide que le roc dans mon cœur. Faiseur de reines légendaires, bâtisseur de temples, plus grand que des montagnes, de villes devenant des modèles de vertus, pyramides mystérieuses, gardées par des lions de pierre terrifiants. Le blanc était venu de ces contrées froides, semant la mort sur son passage, asservissant toute une nation de guerriers, des milliers d’hommes, femmes, enfants, déportés massivement pour le gain. Je ne le comprenais pas, tout comme le sort de ceux qui vivaient en Guadeloupe jadis, car là aussi, ils étaient arrivés en conquérant, massacrant, torturant, pillant, fidèles à leurs habitudes séculaires. Les sages autour du feu, avaient parlé de peau sombre, les Kalinago, aux rites, proches des nôtres, il ne restait plus rien de ce peuple, comme disparu de l’île, anéanti par les colons avec soin. J’aimais l’idée d’une fuite vers le lointain, au- delà de la Martinique voisine, ayant subi le même sort, l’immensité de la mer recelait sûrement des terres où l’on pouvait demeurer libre sans eux. Ces pensées amères, conjuguées à ce que je venais de voir, m’avaient conduite à retourner près de ma mère, l’unique réconfort visuel sur cet infect navire, malgré son état, douloureux à soutenir. Finissant par s’endormir, avec toute l’agitation, dans la position où je l’avais laissée, enfermée dans ses rêves, sans doute plus confortables que l’horrible cale où la mort rôdait en silence. Écrasée contre la paroi humide par le poids des autres, les yeux gonflés, la source de ses larmes était tarie, ne vivant que pour me mettre au monde, alors que la malédiction l’avait frappée souvent. Je me suis penchée afin de mieux la regarder, elle portait moins de cicatrices que dans mes souvenirs, ses cheveux laineux avaient encore toute leur vigueur, sa peau si belle luisait, telle une soie douce ; jalousant sa couleur noire, elle avait perdu son innocence ici ma pauvre maman, bien trop jeune pour affronter tant d’oppressions, éprouvée au plus profond de son être et de son âme estropiée. Le silence avait envahi la cale, quelques pleurs rendaient l’ambiance un peu plus sinistre, espérant secrètement demeurer dans son ventre éternellement, pouvoir couler ce navire, par un pouvoir inconnu, que ce supplice s’arrête enfin. Puisqu’aucun ne savait ce qui allait se passer par la suite, une existence accablée, ne laissant qu’une agonie permanente, l’ombre d’une mort planifiée avec malice, d’une servilité infamante. Ils finiraient en cage, au marché, sur l’estrade, vendue à un monstre, souvent alcoolique, travaillant sous un soleil brûlant, s’écroulant de fatigue dans des cases infestées de puces et de poux. Mangeant du manioc, des racines à foison, au point de s’en dégouter, afin de contenter un corps trop usé par un labeur saisonnier, dont la fin ne cesse que par le repos dans une fosse commune. Abreuvés des sermons de prêtres hypocrites, chaque dimanche, promettant le paradis si on restait de parfaits « meubles » obéissants, soumis à des croyances totalement étrangères à nous. Le Code Noir serait la bible de nos vies brisées sur l’autel de l’esclavage, au bon plaisir des colons. Des chasseurs abjects leur couperaient les pieds, les mains, si l’envie d’évasion les prenait, ils gouteraient le tison ardent qui marque le cœur, plus que la peau, dans une douleur à rendre fou. Ils perdraient connaissance sous le fouet, seraient pendu, démembré, violé, abusé, détruit dans le plus profond de leur âme, prêt à tout pour ne pas subir les punitions, y compris trahir les siens. Devenant des épouvantails, juste bons à récolter la canne, afin d’adoucir les lèvres blanches, toujours aussi gourmandes, dévorant le sucre de façon insatiable, notre sueur, nos larmes de sang et ce qui nous anime. Finalement, ils appelleraient la mort et la délivrance de ce calvaire, se transmettant un mal de génération en génération, préférant le suicide, une échappée ratée permettant d’être abattus dans l’indifférence totale. L’un de ceux qui avaient assuré la distribution du brouet était revenu discrètement, sa façon sournoise de frapper les miens, disait qu’il était assez cruel, pour s’occuper de ses tâches barbares. Déambulant dans la cale, l’air aviné, dans son regard brillait une lueur ; que je ne connaissais que trop bien, celle du prédateur en quête d’une proie, nécessairement humaine et docile de préférence. Se penchant avec avidité sur de jeunes garçons, assommés de fatigue, jetant son dévolu sur l’un d’eux, cinq ou sept ans à peine, endormi contre les autres petits, pleins de son innocence infantile. Les femmes et les enfants n’étant pas enchaînés, il l’a saisi par le cou brutalement, prenant soin de lui barrer la bouche de sa main, volant son espérance dans un silence morbide. Tétanisé par la peur, semblable à une poupée de chiffons, ce goret l’a emporté sous son bras comme un fagot de paille, vers des œuvres sans doute diaboliques, impossible à imaginer. Mon devoir m’invitait à les suivre, il allait sûrement lui infliger un mauvais sort, la nuit était tombée, les étoiles donnaient l’impression d’être descendues sur le pont, pleurant avec nous. Personne ne semblait les remarquer, d’un pas tranquille, avec assurance, il avait trouvé une place derrière des ballots épais, à l’abri des regards, j’allais donc être l’unique témoin de sa malfaisance. Je ne connaissais que trop bien le viol et ses conséquences sur l’âme, cet enfant allait faire des cauchemars, durant toute sa vie d’homme, personne ne pourrait jamais le consoler véritablement. Malgré l’échec improbable de ma tentative, essayant vainement de projeter mon esprit, à la manière d’un spectre afin de l’arrêter, en pure perte, assistant à cette horreur, trop punie de ma curiosité maladive. Priant les ancêtres avec force, qu’ils brisent ce scélérat, ne supportant pas cette monstruosité, il fallait un réconfort moral afin d’accepter l’innommable, personne n’est venu le sauver, à mon grand regret. Repartant près d’Ayo, les gémissements de douleur de ce petit m’ont poursuivi, un traumatisme récurrent, au point où je souhaitais revenir à ma corde, remuant trop de mauvais souvenirs dans mon âme. Ressusciter pour mieux mourir, sentir ma nuque se rompre, puis le néant chimérique, la paix, ne désirant plus rester sur ce navire, j’en avais assez vu, invoquant mon retour à cette potence. C’est alors qu’une voix masculine a traversé le silence, apaisante, rassurante, familière, venant de l’entrepont.
— Tu es parmi nous, je devine ta présence, dévoile-toi !
Un autre esprit hantait les lieux ? Cherchant dans la pénombre poussiéreuse, non, je ne rêvais pas, l’un des captif me fixait avec intensité, c’est bien moi qu’il observait, d’un regard perçant, très insolite. Sans doute un sorcier, disposant de pouvoir mystique, découvrant que je parcourais la cale sous un aspect ténébreux, ces chamanes avaient des capacités insoupçonnées, possédant les clés de mystères insondables. Bien qu’allongé, écrasé contre les autres, il a redressé quelque peu la tête, m’adressant un signe, confirmant ce que je savais déjà, lui et moi devions avoir une discussion des plus formelle. M’approchant avec crainte, cet homme pouvait peut-être me donner la voie du passage vers la porte lumineuse ? Ma volonté de quitter la place se faisait encore plus forte à présent. Afin de faciliter notre conversation, je me suis placée audessus de lui, ignorant s’il me voyait véritablement, dans le doute, gardant une certaine distance, sait-on jamais, précaution nécessaire. Son visage était marqué par le temps, quelques cheveux blancs indiquaient un âge de sagesse, j’ai lancé un appel pour prendre la mesure.
— Peux-tu entendre ce que je dis l’ancien ?
Son sourire énigmatique était le bienvenu, après la vision détestable de ce petit garçon, dont l’innocence venait d’être volée, sa voix se voulait rassurante.
— Oui, tout comme toi, es-tu un de ces mauvais esprits qui tourmente les âmes de ce navire ?
— Je suis fille de la superstition selon certains car mulâtresse, visitant celle qui m’a mise au monde, Ayo, dormant en dessous de toi, m’abritant dans son ventre ! Les ancêtres m’ont ouvert une porte vers mon passé.
Semblant réfléchir à mon propos, visiblement satisfais de ma réponse.
— Il s’agit de ma nièce Ayomidé, son nom signifiant, que la joie est arrivée, si tu es ici c’est que malheureusement ta vie n’est plus ! Les ancêtres t’ont honoré, afin que tu puisses saluer les tiens, preuve que ton teint n’a pas détruit tes racines !
Ce noble noir, au discernement évident, était mon grand-oncle, cela rendait les choses plus faciles, je n’avais donc rien à craindre.
— Pardonne-moi, elle ne m’a pas parlé de toi, j’ignore tout de ma destination finale. Je me tenais sur la potence, pendue pour avoir voulu vivre libre ! Emportée par une porte lumineuse, arrivant dans la cale de ce navire, sans aucune recommandation, livrée à mon nouvel état.
Il ne cessait de sourire, malgré la gravité de mes paroles, rétorquant.
— La tribu reconnaît sa fille, ta lutte est la nôtre en vérité.
— La mort m’a prise, mon corps est sans doute exposé, la peur domine ceux qui restent !
Hochant la tête pour appuyer son propos.
— Tu n’as pas été choisi vainement, les ancêtres savent ce qu’ils font, l’esclavage n’est pas notre condition naturelle et le monde doit l’admettre !
— J’ignore l’essentiel, seulement que je suis yoruba, maman est avare de son histoire.
— Je l’ai fait naître un jour de pluie, elle me verra mourir un jour de soleil. C’est sans doute pour cela qu’on ne se connaît pas !
Ces paroles ne me réconfortaient guère, il n’avait pas dû finir la traversée, pourtant, il paraissait si serein.
— Alors, parle-moi d’elle, de notre terre, on a dû m’envoyer ici pour cela, je crois !
Fermant les yeux, inspirants longuement, comme pour donner une prière.
— L’Afrique est immense comme la mer, au nord se trouve les Arabes à la peau brune, ils sont ancrés dans l’islam, comme l’arbre épais qui résiste aux embuscades du vent ! Ouvrant le commerce des nôtres, jusqu’à l’Égypte, puis pour les blancs ensuite.
— Je connais l’islam car mon compagnon en était disciple, mais pas ces Arabes !
La nouvelle ne semblait guère le rassurer.
— Ils sont venus du Hedjaz, un territoire situé vers l’orient, il y’a bien longtemps, conquérant des terres en Afrique. Considérant les noirs comme une malédiction des fils de Cham, nous n’avons que peu de valeur à leurs yeux, malgré les nations noires ayant adopté leurs rites. Fondant sur les nobles Soninkés, Peuls, Mandingues, devenant musulmans et à leur tour des vendeurs d’hommes.
Son annonce m’a soudainement emplie d’effroi.
— Tu dis que des noirs ont participé à cela ?
— Le blanc dispose d’une magie puissante, avec laquelle il fait des armes redoutables, venant à bout de n’importe lequel de nos guerriers !
Je l’ai coupée subitement, oubliant sa condition.
— Notre peuple sait se battre, autant qu’eux, si ce n’est plus encore ! Sa sagesse m’imposait le silence.
— Mais cela n’aura pas suffi à protéger nos villages, ce sont bien des noirs de l’islam qui les ont guidés, répandant le poison de l’esclavage.
— Que la malédiction s’abatte sur eux, mon homme et les siens pratiquaient cette religion, sans pour autant renier l’Afrique, avec le temps, il en est revenu, honorant les ancêtres !
Il soufflait, cherchant visiblement ses mots.
— Nos terres sont les vestiges d’une spiritualité antérieure à ces doctrines, apportées par des étrangers, suscitant la division, l’homme blanc s’est montré opportuniste ; semant la confusion dans nos esprits faibles, trahissant nos divinités, nous en avons payé le prix !
— Je nous pensais suffisamment nombreux pour les combattre ?
— Au fleuve Volta, il y’a autant de tribus que d’oiseaux dans le ciel, nous sommes yorubas, du village de Dabeya, nous avions un Roi, Djibali le fort, plus de mille guerriers, réputé pour la chasse, nous sommes respectés à des lieux ; aucun animal ne nous résiste, pas même le crocodile, dont la peau décore nos braves !
J’avais toujours rêvé de connaître mes origines, il était la réponse à mes prières.
— Comment sont nos maisons mon oncle ?
— Un prolongement de la terre, on ne s’y attache pas, voilà pourquoi elles sont si petites, on y dort seulement ; les murs sont épais, repoussant le vent ! C’est de nos mains que nous les bâtissons, le toit est un entrelacs de bois que nous avons tressé afin que la pluie ne vienne pas nous déranger. Les repas y sont pris en famille, c’est aussi notre repère de vie dans le village, elles sont toutes identiques, ne suscitant ainsi aucune convoitise du voisin !
— Comment vivent nos sœurs ?
— La femme est une reine, au sein de la tribu, protégée, sous la tutelle des anciennes. La naissance d’Ayomidé fut célébrée dignement, sacrifiant une vache pour affirmer notre fierté, couverte d’affection ! Elle aimait tant courir dans la plaine, son sourire illuminait mes jours, espiègle et joueuse, se cachant partout où elle le pouvait, la cherchant parfois jusqu’à la nuit tombée.
— Elle est endormie près de nous, portant ce fardeau que je suis, quel âge a-t-elle mon oncle ?
— Quatorze saisons seulement, promise à un bel avenir, mais tout est perdu, nous voici brisés, abandonnés de tous, à la merci d’un destin funeste !
Ses yeux commençaient à se mouiller au fur et à mesure, je devais reprendre son attention.
— Aucun homme n’a pu la défendre ?
Secouant la tête de désapprobation, sa voix est devenue plus mélancolique.
— À l’enfance, les âmes sœurs vont se découvrir, lors d’une cérémonie durant plusieurs nuits ! Elle savait que c’était lui, un brave de seize saisons, fier, chasseur intrépide, il a fallu plus de cinq fusils pour en venir à bout ! Ils ont brûlé son corps, n’en laissant que des cendres ! Ayomidé a tout vu, c’est avec ces dernières visions qu’elle a quitté notre terre.
— Mais pourquoi ont-ils choisi votre village mon oncle ?
Sentant qu’il voulait se lever, dans sa position, cela paraissait impossible.
— La saison des pluies touchait à sa fin, promesse de récoltes abondantes et de troupeaux bien gras, comme souvent, des messagers sont venus aux nouvelles, faisant des propositions de troc. Un oiseau de malheur a informé le Roi, des blancs avaient ravagé son village, aidé par des Mandingues, porteur d’une magie crachant le tonnerre et semant la mort ! Que nous connaissions comme fusils, sans en avoir la pratique ni l’usage.
— Vous auriez pu vous préparer ? Vous unir avec les clans alentour ?
— La désunion était notre faiblesse, chacun espérant la chute de l’autre ! Le Roi a donné ses ordres, il fallait se battre pour notre survie.
— Ils étaient donc aussi nombreux que nous ?
Secouant la tête de désapprobation.
— Le fusil est sorcellerie, un seul peut tuer des dizaines, quand tu ne connais pas sa mélodie, le cœur se fige et tout se raidit ! La peur prend le dessus, c’est ainsi que nous avons perdu notre village.
— Les esclaves sont arrivés en Guadeloupe bien avant ma naissance, générations, après générations ! Ils chassent donc le noir depuis des siècles !
— Les comptoirs ne datent pas d’hier, nous avons été aveuglés par l’appât de richesses faciles, nos Rois ont commercé avec les blancs, profitant de leurs bienfaits, avec des offrandes ostentatoires. Endormies dans un orgueil néfaste, qui allait finir par avoir raison de nous, les Arabes ont ouvert des ports, les comptoirs sont devenus des prisons à ciel ouvert ou l’on s’est mis à vendre des hommes dans toutes les langues du monde ! J’ignore toujours pourquoi.
La vérité devait lui être donnée, répondant instantanément.
— De la canne à sucre, du café, de l’indigo, du coton, du tabac, des champs à perte de vue, de quoi nourrir toute l’Afrique, notre peuple meurt doucement pour satisfaire les papilles de blanc, avide de friandises !
Ma révélation s’abattant, telle une massue invisible, il s’est prostré, les larmes recouvrant son visage, épuisé par tant de malheurs, égarés par ces quelques mots que je venais de répandre. Ne prenant pas la mesure de tout cela, gardant la posture un long moment, honteuse d’avoir été aussi franche, peut-être même brutale sans le vouloir, regrettant cette maladresse trop insolente. Tant des nôtres avaient achevé leurs vies dans des champs de cannes à sucre, des milliers, autant que les sauterelles ravageant la production, emplissant les sillons de sueur et de sang trop serviles. Le silence ayant le dessus sur sa peine, j’ai relancé.
— Je suis désolée mon oncle, la chance qui m’est donnée de pouvoir te parler, ne doit pas être détournée par ces considérations.
Essuyant ses larmes d’un geste franc, regardant vers le haut, l’air confiant.
— Il n’y a rien à faire ma fille, tu n’es pas la cause de cela, je pleure sur Dabeya, tant de villages réduits en cendre, ces sacrifices, pour des récoltes ? La nature offre ses bienfaits sans contrepartie, les animaux ne craignent pas la faim, quelle que soit la saison.
La colère prenait le pas sur son expression.
— La transhumance des gnous parcourt l’Afrique sur des milliers de kilomètres, c’est l’ordre des choses. Je crois que ces hommes sont venus pour tout défaire, ils ne gagneront pas ce combat.
— Ce sera la fin de leur monde, ce n’est pas une si mauvaise nouvelle !
— Non ma fille, celle de l’humanité, nous sommes d’une source unique, les blancs, aussi puissants soient-ils, ont les mêmes aspirations que nous !
— Seulement le profit, priant un Dieu invisible, qui ne répond jamais, prenant ce qui ne leur appartient pas. Ils sont un poison sur terre, que je déteste du plus profond de mon être !
Son sourire malicieux revenait, à mon grand soulagement .
— Si tu laisses la haine envahir ton cœur, que vas-tu devenir ?
— Une martyre ! Vivant libre mes dernières années, la France a grondée, envoyant des navires, ces soldats, jusqu’à nous étouffer, éteignant notre lutte. Mais, on n’éteint pas l’embrasement d’un peuple avec un bol d’eau.
Redevenant sérieux, presque grave.
— L’espoir est mince ma fille, il a le mérite d’exister, je crois qu’ils préfèreront nous tuer que de voir l’émancipation des nôtres. Chaque génération aura sa guerre, ses héros, puis viendra celui qui pourra percer leur occultisme, ils vont trembler à leur tour, le noir pourra de nouveau fouler l’Afrique avec fierté.
Je me devais de lui parler de ce général dont nous avions entendu les récits .
— Celui-là est venu, de l’île Saint-Domingue15, des milliers de noirs ont massacré les blancs, portés par le rêve de Toussaint Louverture16 ! Chassant les Français jusqu’au dernier, offrant de nouvelles voies pour nous.
Pensant l’avoir impressionné, il faisait la moue .
— Sont-ils retournés en Afrique ?
— Non, mais ils vivent librement à présent !
— Alors ils sont orphelins, la liberté n’est pas d’aller contre le vent, mais de marcher sur le sentier de ses ancêtres, sinon tu n’es plus que l’ombre de toi-même à la recherche d’un passé que tu ne retrouveras jamais.
— La liberté reste la liberté mon oncle !
— Sans les racines, un arbre finira par mourir.
— Nos enfants vont en planter de nouvelles sur ces terres, nos traditions orales ne se perdent pas, les plus téméraires pourront faire des navires pour retourner en Afrique.
— C’est là un drôle de rêve !
— Le rêve est la clé de l’espoir, puisant sa force dans la lutte, l’amour, je l’ai connu et c’est lui qui m’aura véritablement rendu libre. Je suis morte comme j’ai vécu, vivre libre ou mourir est notre devise !
Fixant encore le plafond, comme si ses yeux pouvaient percer la coque, cherchant les étoiles, fredonnant dans sa langue natale, des paroles désormais comprises sans l’aide d’un traducteur.
— Par le feu qui consume tout, la terre qui s’agite, faisant germer la pousse ; par un vent qui souffle, répandant ses bienfaits rafraichissants . par cette eau frémissante sinuant sous les roches ; Père de toute chose, entendez ma prière ! Renforcez les serviteurs que nous sommes, de la bienveillance des ancêtres, semez l’harmonie parmi vos enfants. Puisse le soleil raviver notre flamme, la lune sauvegarder nos esprits troublés, Père de toute chose, délivrez-nous du mal !
Reprenant plusieurs fois ce chant, comme ivre de ses propres paroles, dodelinant la tête de gauche à droite, les yeux fermés, la mélancolie embaumant son visage, tranquillisant son âme si blessée. Cette prière authentique parfumait mon cœur d’une béatitude bienvenue, illuminant cette prison de bois flottante, touchée par la grâce des ancêtres, le temps d’une résonnance bien inspirée. Au point, de sentir mon esprit vibrer, à défaut d’un corps immatériel, d’une douceur rassurante. Soudain, affichant un air grave, posant une voix plus sombre, teintée d’amertume.
— Un jour, accompagnant l’aube, sortant inspecter une clôture, détruite par la colère d’un buffle. Ayomidé chahutait son homme, une ancienne l’a reprise à l’ordre, lui faisant tresser un panier, tandis qu’il venait m’aider ! L’odeur des maisons préparant le repas du midi exhalait la plaine, la quiétude régnait car les guerres étaient rares. Quelques gardes assuraient une présence à l’entrée du sentier et d’un chemin de chèvre ! Un fauve pouvait surgir de la savane, on portait toujours un couteau, voire une lance. Lorsqu’ils sont arrivés du nord, par cette belle journée, c’était pour semer la mort et la peur. Choisissant de protéger les petits, l’ennemi était comme les fourmis qui vont à la bataille, organisé et redoutable ! Sachant qui tuer, capturer, chassant femmes et enfants, n’épargnant personne, avec une cruauté jamais vue dans nos contrées. Ayomidé s’est blottie près de moi, ils étaient bien trop nombreux !
Des larmes coulaient à nouveau le long de ses rides, n’ayant pas l’air de s’en apercevoir, continuant son récit envoûtant.
— Leurs filets ont pris beaucoup des nôtres, nous étions encerclés, le feu et le sang se mêlaient à la cohue. Disposant d’éclaireurs noirs, hurlants en yoruba de nous rendre pour être traités équitablement ! La mort frappait sans distinction ! Le traitement juste consistait en coups de bâtons pour les hommes, afin d’éteindre la rébellion. Enchaîner les uns aux autres, de façon à ne pas pouvoir prendre la fuite, c’était la fin. Si j’avais su que nous allions terminer ainsi, j’aurais tué ma nièce, plutôt que de connaître ce déshonneur. Brûlant notre village millénaire, profanant les corps, ils ont volé notre âme ce jour funeste. Répandant la peur dans nos cœurs, exhibant la tête du Roi sur une pique. Des jours ont passé, trois je crois, la soif nous faisait délirer les uns les autres, on se maudissait mutuellement. Le tonnerre continuait de gronder au loin, ils attaquaient nos voisins, avec la même détermination qui nous avait emportés. Formant des groupes, tellement nous étions nombreux, les hommes, les femmes, les enfants, les anciens, et cette obsession pour nos dents !
Donnant une explication, lui qui prenait la peine de se remémorer ce drame, partageant sa douleur.