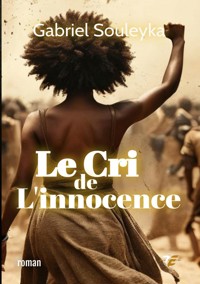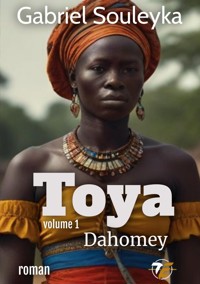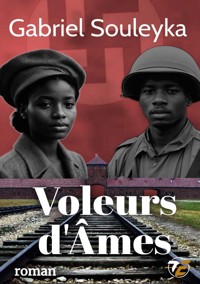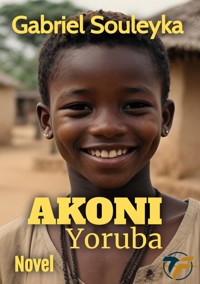Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Solitude
- Sprache: Französisch
Ayomidé, 14 ans, vit paisiblement au Bénin, en 1771, dans un petit village. Des esclavagistes les attaquent, elle est enlevée, emmenée au port de Ouida. Devenant esclave, elle est envoyée en Guadeloupe, sur le navire, durant la traversée, elle est violée par un marin, se retrouvant enceinte. Arrivée sur l'île, elle découvre la vie d'esclave, donne naissance à une petite fille nommée Solitude. Ensemble, elles vont devoir affronter les épreuves de la servitude, tout fait pour reprendr leur liberté. Un espoir existe, les Marrons, ces guerriers intrépides qui vivent dans les forêt de Guadeloupe. Elles vont devoir s'armer de courage pour les rejoindre, c'est l'histoire d'une femme ordinaire au destin extraordinaire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur :
Le cri de l’innocence
Solitude, l’enfance (volume 1)
Solitude, révolte (volume 2)
Akoni Yoruba
Voleurs d’âmes (sortie février 2024)
Retrouvez Gabriel sur l’ensemble de ses réseaux :
@Gabriel Souleyka
www.gabrielsouleyka.com
www.tiolejafilms.com
Sommaire
REMERCIEMENTS
1. MOURIR
2. CASES
3. PRIVILÈGE
5. CHAÎNES
5. SOUMISSION
8. ESCLAVE
L’AUTEUR
REMERCIEMENTS
De la Guadeloupe à l’Afrique, nous sommes ensemble ! Je remercie les équipes de TIOLEJA FILMS, qui m’ont permis de perpétuer notre histoire. En yoruba, tioleja signifie incassable. Yasmina. F. Edwards a ravivé la flamme, militant depuis des années avec le leitmotiv : le chasseur ne raconte jamais l’histoire du lion.
Elle a su me motiver pour que je prenne la mesure de notre mission, qui va au-delà de ce modeste roman.
Je me dois de citer Michel. N. Christophe, qui aura bâti un pont entre les Antilles et l’Afrique. Écrivain talentueux, pour son aide à la relecture
J’ai découvert Solitude sur le boulevard des héros, aux Abymes en Guadeloupe. Frappé par la force de l’image taillée, enceinte, fière, fixant l’horizon, mais ensuite déçu de ne trouver aucun livre sérieux sur elle, si ce n’est des citations, des fictions. Ne voulant pas la réduire à la sommaire présentation de l’historien français Auguste Lacour, la dépeignant comme une folle agitant un sabre pour exciter la troupe. Ne tombez pas dans le piège, en polémiquant sur Solitude. Elle n’est pas qu’une statue sur un boulevard, dans un jardin, une effigie sur un timbre. Elle symbolise l’ensemble de ces femmes, ces hommes qui aujourd’hui sont orphelins d’une histoire que personne ne raconte. Ce temps est révolu, je vais vous conter l’histoire de cette femme ordinaire, au destin extraordinaire.
Gabriel Souleyka
1. MOURIR
Quand j’étais enfant, je croyais aux monstres, toujours les mêmes, fouet à la main, un rictus de colère, traînant ma mère par le bras, pour la châtier de n’avoir pas assez coupé de canne. En grandissant, rien n’est venu me rassurer. Portant l’uniforme de soldat, un titre de premier consul pour rétablir l’esclavage, les monstres sont devenus plus sournois. Avec le temps, rien n’a changé. Aujourd’hui est le dernier jour de mon existence, j’ai trente ans, tout ce qui compte un tant soit peu m’aura été volé, détruit par ceux-là mêmes qui disent que je suis une citoyenne. Ils m’appellent mulâtresse1, le croisement d’un cheval et d’une ânesse donne une mule. Une bête docile, qui jamais ne se plaint, ne rechigne pas à la tâche. Je suis une femme, pas un animal, je refuse leur histoire ; née en Guadeloupe, dans le fracas de la servitude, la voilà ma réalité. Pourquoi suis-je condamnée ? Le crime odieux d’avoir voulu vivre libre, conformément aux principes de leur révolution. Une voix lourde, venue de nulle part, brise mes songes.
— Désires-tu la confession, ma fille ?
Il porte une robe noire, un visage farineux, c’est un prêtre, j’adresse une réponse sèche.
— Je ne suis pas ta fille, tu n’es pas mon père !
Il s’éponge avec un mouchoir jauni par le temps. Ma répartie le gifle, telle une pierre en pleine poitrine.
— Dieu est bon, je dois te donner l’absolution !
— Mais les nègres n’ont pas d’âme, non ?
— Tu es mulâtresse reconnue par le Seigneur !
— Je sors du ventre d’une négresse. Où était-il quand je me faisais violer par des chasseurs ? Où était-il, à Baimbridge, au fort Saint-Charles, à Matouba ?
Sa gestuelle répulsive dévoile un visage hypocrite,
— Je suis venu t’apporter les sacrements, repens-toi !
— Ma seule église, c’est l’Afrique !
Il serre sa bible contre lui, en quête d’une réponse.
— Tes blasphèmes ne sont que provocations inutiles.
— Le salut réside dans la liberté de mon peuple. Mon âme brillera au firmament de mes glorieux ancêtres !
Il recule, dévoile un masque de dégoût.
— Ainsi soit-il. Va donc rejoindre ces sauvages ! Je souris avec malice.
— Si je suis avec eux, alors j’irais, le cœur en joie !
Il dodeline de la tête, se retire, marmonnant des paroles. Mon arrogance a eu raison de ce minable représentant d’un Dieu que personne n’a jamais vu. C’est à cet instant que je découvre le bourreau. La fin approche. Il porte un masque de jute, cache à peine son visage ; cela lui donne un aspect « démoniaque ». Il a la même couleur que moi. Quelle ironie du sort ; les tâches ingrates nous reviennent souvent, nous faisons de parfaits domestiques. Nous sommes des enfants de la superstition, fardeau du blanc et honte du noir. Personne n’assume vraiment notre condition, le fruit d’un désir inavoué envers les femmes d’Afrique. La beauté sombre peut ensorceler n’importe quel individu, alors, pourquoi fouetter celle qui par sa grâce innocente, comble bien des regards ? Comment la soumettre aux pires sévices ? Au prétexte fallacieux de blanchir mon peuple ; réduite à un objet servile, venir la visiter de nuit, tels des voleurs ; ces lâches affirment une virilité sans audace. Le bourreau donne l’impression de m’attendre.
— Tu n’as plus rien à craindre, c’est bientôt fini !
La douceur de sa voix me prend au dépourvu.
— Je n’ai pas peur !
— Pourquoi pleures-tu, alors ?
Des larmes incontrôlables coulent le long de mes joues.
— Rien ne rapproche davantage que l’absence. Ils ont dérobé mon fils cette nuit !
— Le tonnerre de Matouba 2 résonne dans le cœur du peuple. Ton enfant sera honoré d’avoir eu comme mère Solitude, une guerrière impavide !
Qu’il arrête de tenter de me réconforter ! La chose a été jugée. Ces paroles n’apportent rien, la mort s’impose d’elle-même. Le silence s’installe entre nous. Nos regards en disent long. Il déroule une corde épaisse, la passe autour de mon cou. Je suis terrifiée, mais je le cache. Un souvenir revient. Un autre avait pris les mêmes précautions pour me poser un collier d’identification. La corde est rêche, agressive, serrée si fort que j’en ai le souffle coupé.
— Pardonne-moi, je serre le nœud, ce sera rapide ! Je veux encore vivre, mais il ne le sait pas.
— Je pardonne ce que tu es, pas ce que tu fais ! Il a honte, ses mains tremblent.
— Je suis un lâche, pris dans un filet dont personne n’échappe !
— Pourtant je le fais. Vois comment je vais fuir. L’armée de France ne pourra pas me rattraper, cette fois !
La France, par l’entremise de Napoléon, va pendre une femme insignifiante, car je suis le visage de la révolte, petite femme anonyme des Antilles. Une étoile dans une nuit clairsemée. Ce 29 novembre 18023 sera le sceau de l’infamie. Il marque la fin du calvaire de ceux tombés pendant cette lutte glorieuse. Le général Lacrosse4, d’un geste capricieux, se lève de sa tribune, sans même me regarder, donne le signal au bourreau. La trappe se déclenche, je prends ma plus forte inspiration par peur de manquer d’air. Les planches se dérobent sous mes pieds. Un sentiment de frayeur m’envahit. Les yeux ouverts, je hurle de toute mon âme, afin que chacun puisse entendre tout ce pour quoi nous avons vécu.
— Vivre libre ou mourir !
Je quitte ce monde dans une lumière déclinante. Il fait sombre, c’est le néant, la clameur disparaît sous une chape inquiétante de silence. Sans savoir pourquoi, je pensais ressentir une douleur inconnue. Je ne suis plus sur la potence, mais ailleurs, presque perdue dans un voile ténébreux, qui m’enveloppe de toutes parts. Les ancêtres se jouent de moi. J’avais rêvé de tout cela. La folie usurpait-elle mes derniers instants ? Ma mère racontait que nous retournions auprès du Père céleste. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mon âme vibre d’une étrange et irréelle sensation, un mélange d’appréhension et d’angoisse. Je veux hurler, mais je ne peux pas. Je cherche mes mains, pour être sûre que je suis consciente. Elles sont invisibles, à mon grand désarroi, mon corps n’a pas fait la traversée. Une peur intense m’envahit.
L’ignorance s’installe, un doute ronge mon esprit. Mon combat ne peut pas se dissoudre dans le vide absolu. J’invoque les ancêtres pour une issue favorable. Ne pas souffrir est sans doute la récompense des martyrs, mais, pourquoi tout ce mystère ? Où sont les rivages éternels, le bassin sacré dont ma mère parlait ? J’aurais pleuré, mais je patiente, je perds la notion du temps, puisque rien ne sert de repère. Ni lune ni soleil, une impression de flottement, comme noyée dans une eau invisible. Une lumière aveuglante perce alors le voile, me darde de ses rayons, déchire les ténèbres. J’approche de la source, j’ignore comment me mouvoir. Une porte se dessine doucement, je ne distingue ni haut ni bas, seulement une nausée perturbante, qui ravage ce qu’il me reste d’esprit. Je suis perplexe, immobile, face à un rectangle éblouissant, insondable, brusquement, une emprise invisible saisit mon essence, m’aspire brutalement.
Étrangement, je ne ressens aucune crainte. Que peut-il m’arriver de pire que la potence ? La fébrilité n’étant pas coutumière, j’attends à nouveau, admets la fatalité ; en l’absence de respiration, de toute vitalité, j’en déduis que je suis devenu un esprit, condamné à l’errance éternelle, ou, à subir de nouvelles épreuves. Le décor se dévoile difficilement, dans une drôle d’atmosphère, aussi sombre que la cellule où hier seulement j’ai accouché de mon fils. Soudain, une vision terrifiante se dévoile, des femmes, des enfants noirs, puis des hommes, enchaînés, les uns aux autres, dans un alignement morbide. Je suis dans la cale d’un navire négrier. Je pensais rejoindre les ancêtres. C’est l’enfer qui m’a attrapé. Cela semble tellement réel, je peux presque les toucher. Les histoires, dont on m’a parlé, ne remplacent pas ce que je vois. Des malheureux, écrasés dans des compartiment ; ils respirent un air méphitique.
Je devine, au travers des minces filets de lumières des écoutilles, une poussière nauséabonde ; beaucoup sont accroupis la tête chancelante, le visage figé, l’expression morbide, qui me glace d’effroi. Personne ne remarque ma présence. Quelques jeunes filles, d’à peine quinze ans, tiennent un nouveau-né dans leurs bras. Ils cherchent du lait dans des seins sans vitalité, qui pendent comme des bourses vides. Ils sont au moins trois cents. Mon homme répétait que le cœur pouvait mourir sur ce navire tandis que beaucoup rejoignaient les ancêtres au fond de la mer. Dans cet antre du malheur, les frères sont enchaînés complètement nus, allongés sur une planche épaisse, un second pont, sur toute la longueur, de chaque côté, séparés des femmes et des enfants ; certains sont couchés sur le flanc, tellement proches, que leurs jambes se mêlent les unes aux autres.
Je suis impuissante, puisqu’invisible. Ces positions avilissantes ressemblent à un supplice. Beaucoup, repliés sur eux-mêmes, ne peuvent pas tendre les membres. Éteints dans un cercueil flottant. Au fond, je vois des provisions solidement harnachées. Je les reconnais, grâce à l’expérience acquise, les ayant suffisamment pillés des entrepôts et des navires lors de nos raids. Des tonneaux de fèves, du riz, du maïs, du manioc, des bananes… De quoi sustenter l’équipage, laisser les restes à ces malheureux qui devront tous s’habituer à la malnutrition. La faim pose un problème dès le début. Hélas, chacun de nous en souffrira tout au long de nos vies, au point d’en tomber malade, d’en perdre le sommeil, de verser des larmes amères. Je me souviens encore que parfois, on attachait une pierre contre nos ventres pour mieux tromper la faim.
Trois hommes munis de couteaux et d’une baguette fine à la main, dont je devine l’utilité, font irruption. D’apparence affreuse, leurs barbes fournies signalent qu’ils sont en mer depuis longtemps. Deux portent un énorme baquet. Le troisième, un sac en toile, remplie d’écuelles en bois. Je m’approche pour observer ; découvre un brouet infâme, épaissi avec de la farine de maïs, rehaussé de piment, comme l’on me l’a tant de fois décrit. Les paumes se tendent aussitôt, comme dans un ballet organisé. Une voix sinistre résonne, fait sursauter les enfants, les femmes se recroquevillent.
— À la gamelle les nègres !
L’auteur du cri guttural balance ses offrandes.
— Commencez par les négrillons5. J’en ai attrapé hier volant du rabiot. Restez vigilants !
Cet ordre reste sans effet. L’un se met à distribuer maladroitement les parts, pendant que l’autre s’approche, donnant furieusement des coups de baguette. Je me dois de voir cette scène dégradante avant de partir définitivement. Des braves, réduits à mendier une pitance qu’on leur jette à la figure. Libres, ils auraient broyé les crânes de leurs bourreaux. Des forces de la nature rendues serviles par une traversée destructrice. Je veux détourner le regard, mais au fond de moi, je sais, si telle est la volonté des ancêtres, qu’il me faut témoigner de la souffrance du calvaire négrier. Le plus violent des trois hommes part à la recherche d’un autre baquet, près de tonneaux solidement arrimés au fond de cale, pour y puiser de l’eau croupie. Il remplit le seau avant de procéder à la distribution du liquide infâme qui va ravager bien des ventres, voire tuer certains malheureux.
J’aurais pleuré toutes les larmes de mon corps afin d’apaiser leur soif. La frustration me force à scruter alentour. Il n’y a que souffrance derrière ces corps meurtris. Subitement, je remarque une jeune femme recroquevillée, la seule qui ne mange pas, prisonnière repliée sur elle-même. Une vision insoutenable. Malgré son jeune âge, je la reconnais immédiatement. Ayomidé, ma tendre maman, oui, c’est bien elle. Son nom veut dire « Joie » en yoruba6. Elle semble si fragile, je pourrais caresser sa joue, lui dire combien, je l’aime ; lui faire savoir que ses conseils m’ont accompagné durant chacune de mes épreuves ! Tout devient clair, je traverse une époque révolue. Les ancêtres me montrent mes origines. Son ventre rond trahit ma présence. J’ai donné la vie seulement hier, je la comprends encore mieux à présent.
On m’a raconté le jour de ma naissance, dans une case, hurlant de rage pour me délivrer. Me retrouver ici, avec elle, semble irréel. La couleur de ma peau ne m’a pas permis de rester dans son affection. Confiée à Denise, à l’approche de cinq ans, je crois, une femme blanche chargée d’éduquer les enfants mulâtres de l’habitation. Cette séparation forcée m’infligea une cicatrice jamais guérie. Elle conduisit ma mère vers la folie avant de m’abandonner pour le marronnage. Selon Louis Delgrès7, connaître son ennemi permet de mieux le combattre. Si j’en avais pris la mesure, en visitant ces cercueils flottants, j’aurais brisé leur organisation bien établie. Ma mère semble dans un état misérable. Ne le supportant pas, je rejoins lâchement le pont supérieur pour ne pas m’écrouler devant sa souffrance. Je veux espionner ces ignobles brutes.
L’occasion m’est offerte de découvrir l’intimité des négriers. Troublée par une sensation de flottement, j’évolue, telle une brume légère, m’insinue partout, traversant les parois sans m’en rendre compte. J’observe de près ces voleurs d’hommes, je trouverai fatalement mon géniteur parmi eux. Me voilà maintenant à l’extérieur, sur le pont principal encombré de marchandises. La mer est aussi bleue que le ciel. Vaste, elle se confond avec l’horizon.
Aucune terre en vue, seulement l’immensité d’une beauté cristalline. Les matelots moins nombreux, mais suffisamment armés pour contenir un soulèvement donnent l’air de ne rien faire dans la fraîcheur marine. Pendant ce temps, ma douce Ayo étouffe avec les autres dans les relents de déjections qui contribuent aux infections généralisées, comme le scorbut et d’autres maladies mortelles.
En Guadeloupe, le marronnage m’a rendu la liberté, permis d’étancher ma curiosité envers les bateaux. Je n’ai eu de cesse d’apprendre leur organisation, la structure de leur apparence complexe. Si bien que je sais où se trouve le poste de pilotage. Un blanc bedonnant au regard terne, manie la barre. Il soumet à sa volonté ce monstre de bois qui navigue vers l’oubli. Tout près, un homme chétif à l’œil mauvais dissimule sa laideur derrière du fard et un habit de brocart trop large pour lui. Il tient un livre en main, l’air nauséeux. J’approche, le plus court sur pattes parle.
— Ce changement de cap va nous coûter cher. En ma qualité de subrécargue8, vous n’ignorez pas mes prérogatives ?
Fixant l’horizon, prenant son vis-à-vis de haut.
— Mon souci est d’arriver à bon port. Vous resterez fidèle au devis d’armement9. Ces traversées occasionnent toujours des pertes !
— Si une tempête nous frappe, je m’en accommode, mais pas de l’ivresse de vos hommes, capitaine ! Sans compter ces impotents que vous avez acceptés. Ils vont contaminer la marchandise.
La colère monte, il serre la barre au point d’en faire blanchir ses phalanges.
— Ce navire est un tonneau qui fermente au gré des vents. Personne n’aime le vin aigre, n’est-ce pas ?
— Dans ce cas, que faites-vous des mauvaises graines qui risquent d’avarier la cargaison ?
Son sourire carnassier n’augure rien de bon. Je connais déjà ces mots. Le Code noir nous considère comme de simples meubles. Le mobilier ne s’exprime pas, ne crie pas et ne saigne pas. Colbert a dû abuser de l’absinthe lors de sa rédaction. Il calcule le rendement comme sur une habitation, parle d’êtres humains réduits à des chiffres dans un livre. J’ai connu de pareilles personnes tout au long de ma vie, elle ne regarde que notre condition d’esclave. Lorsque Goliath, un chien du domaine, a rendu son dernier souffle, son maître l’a pleuré, puis enterré dans le jardin, nous forçant à chanter son office funèbre. Un travailleur, mort de fatigue, est tombé dans le fossé. La cadence, les quotas, nous imposent de rester à nos postes, laissant sa dépouille décrépir au Soleil. La production l’emporte sur la raison. On a attendu le repos dominical pour l’inhumer selon nos coutumes. Les rires gras de l’équipage me ramènent au navire dont la trappe menant à la cale est ouverte. Un homme tire une corde, pendant qu’un autre crie.
— T’en as cinq, ils vont pointer le museau, tiens-toi prêt à les recevoir !
Un homme s’écrase sur le pont, tête en avant.
— Qu’est-ce qu’on fait d’eux, capitaine ?
— Combien t’en comptes, moussaillon ?
— Deux mâles et trois femelles. Elles ont de bonnes dents, les bougresses !
L’un d’eux les frappe sans retenue. Le regard vitreux, le capitaine reprend.
— Ça sent le scorbut. Allez, par-dessus bord !
Les anciens sont nos repères, des ombres inutiles pour les colons qui les remplacent par un captif plus robuste dans la foulée. Lorsque la vieillesse arrive, elle transforme un esclave en « épave »10 mourant dans le silence, jeté à la mer. Nos cris sont semblables aux leurs. La couleur ne peut pas justifier cette bestialité ; cette absence totale de compassion. Le blanc est fou, et le noir, pas assez. Mon âme se brise. Personne ne saura jamais rien de cette tragédie. Comment en sommes-nous arrivés là ? La barbarie, voire le diable dont parlent ceux de la croix, est à l’œuvre. Toutes les histoires que j’ai entendues sur mon peuple ; vantant notre royauté, nos traditions ancestrales, nos batailles épiques, sont vraies, solide comme le roc dans mon cœur.
Faiseur de reines légendaires, bâtisseur de temples plus grands que des montagnes, de villes, de pyramides mystérieuses, gardées par des lions de pierre. Le colon, venu des contrées froides, sème la mort sur son passage. Asservissant des milliers d’hommes, de femmes, et d’enfants, déportés massivement pour du sucre. Tout comme le sort de ceux qui vivaient en Guadeloupe avant nous. Nos sages parlaient de peaux sombres, des Kalinago11, dont les rites, proches des nôtres, ont disparu, comme ce peuple, dont il ne reste plus rien. J’aime l’idée d’une fuite vers le lointain, au-delà de la Martinique, qui subissait le même sort. L’immensité de la mer recèle sûrement des terres où l’on peut demeurer libre, sans eux. Amères, ces pensées conjuguées à ce que je venais de voir me conduisent, malgré son état, auprès de ma mère, mon unique réconfort sur ce navire infect.
Elle a fini par s’endormir, malgré l’agitation, dans la position où je l’avais laissée, enfermée dans des rêves sans doute plus confortables que l’horrible cale où la mort rôde en silence. Écrasée par le poids des autres contre la paroi humide, les yeux gonflés, la source de ses larmes est tarie. Elle ne survit plus que pour me mettre au monde. Afin de mieux la regarder, je me penche au-dessus d’elle. Elle a moins de cicatrices que dans mes souvenirs. Ses cheveux d’aspect laineux ont encore toute leur vigueur. Sa belle peau luit comme une soie douce. Bien trop jeune pour affronter autant d’oppression ; éprouvée au plus profond de son être, de son âme estropiée, ma pauvre maman a perdu son innocence, ici. Le silence envahit la cale. Des pleurs rendent l’ambiance sinistre. Par un pouvoir inconnu, je voudrais couler ce navire, afin que le supplice s’arrête.
Ils vont finir en cage, au marché, sur l’estrade, vendus à un monstre alcoolique, travailler sous un soleil brûlant ; s’écrouler de fatigue dans des cases infestées de puces et de poux. Ils mangeront du manioc, des racines à profusion, au point de s’en dégoûter, pour contenter un corps trop usé par un labeur saisonnier, dont la fin ne cesse que par le repos dans une fosse commune. Abreuvés, chaque dimanche, de sermons de prêtres qui promettent le paradis, s’ils restent de parfaits « meubles », obéissant, soumis à des croyances totalement étrangères. Des chasseurs abjects leur couperont des membres si l’envie d’évasion leur prend. Ils goûteront au tison ardent, marquant le cœur plus que la peau ; perdront connaissance sous l’effet du fouet, pendus, démembrés, violés, abusés, détruit dans le plus profond de leur âme.
Devenir un épouvantail, juste bon à récolter la canne, afin d’adoucir les lèvres, toujours aussi gourmandes, dévorant le sucre de façon insatiable, dont le prix est la sueur, les larmes et nos vies. Finalement, ils vont appeler la mort et la délivrance de ce calvaire, transmettant un mal de génération en génération, préférant le suicide, une échappée ratée permettant d’être abattus dans l’indifférence totale. L’un de ceux qui avaient assuré la distribution du brouet est revenu discrètement. Sa façon sournoise de frapper les miens dit qu’il est suffisamment cruel pour s’occuper de ces tâches barbares. Il déambule dans la cale, l’air aviné. Dans son regard brille une lueur que je connais que trop bien, celle du prédateur en quête d’une proie.
Il se penche avec avidité sur de jeunes garçons assommés de fatigue, jette son dévolu sur l’un d’eux, cinq ou sept ans à peine, endormi contre les autres, plein de son innocence. Les femmes et les enfants ne sont pas enchaînés. Il le saisit par le cou, prenant soin de lui barrer la bouche de sa main, volant son espérance dans un silence morbide. Tétanisé par la peur, ce porc l’emporte sous son bras comme un fagot de paille, semblable à une poupée de chiffons, vers des œuvres sans doute diaboliques, impossibles à imaginer. Mon devoir m’invite à les suivre. Il va sûrement lui infliger un mauvais sort. La nuit est tombée, les étoiles donnent l’impression d’être descendues sur le pont pour pleurer avec nous. Personne ne les remarque. D’un pas tranquille, avec assurance, il trouve une place derrière des ballots, à l’abri des regards. Je suis l’unique témoin de sa malfaisance.
Je sais le viol et ses conséquences sur l’âme, cet enfant va faire des cauchemars durant toute sa vie d’homme. Personne ne pourra jamais le consoler. Malgré l’échec de ma tentative, j’essaye vainement de projeter mon esprit, afin de l’arrêter. En pure perte. J’assiste à cette horreur, punie de ma curiosité maladive. Je prie alors les ancêtres, avec force, qu’ils brisent ce scélérat. J’ai besoin d’un réconfort moral pour accepter l’innommable. À mon grand regret, personne ne vient le sauver. Je repars près d’Ayo, les gémissements de douleur de ce petit me poursuivent, un traumatisme récurrent, au point où je souhaite revenir à ma corde, remuant trop de mauvais souvenirs dans mon âme. Ressusciter pour mieux mourir, sentir ma nuque se rompre, puis le néant chimérique, la paix. Je ne veux plus rester sur ce navire. J’en avais assez vu. C’est alors qu’une voix masculine, apaisante, rassurante, familière, perce le silence. Elle vient de l’entrepont.
— Tu es parmi nous. Dévoile-toi !
Un autre esprit hante les lieux ? Je le cherche dans la pénombre poussiéreuse. Non, je ne rêve pas. L’un des captifs me fixe avec intensité. C’est bien moi qu’il observe d’un regard insolite. Sans doute un sorcier qui dispose de pouvoir mystique. Il a découvert que je parcourais la cale sous mon aspect ténébreux. Ces chamanes ont des capacités insoupçonnées, possédant les clés de mystères insondables. Bien qu’allongé, écrasé contre les autres, il redresse quelque peu la tête, il m’adresse un signe, confirmant ce que je savais déjà. Lui et moi devons avoir une discussion des plus formelles. Je m’approche avec crainte, cet homme pourra me donner peut-être la voie du passage vers la porte lumineuse ? Ma volonté de quitter la place se fait encore plus forte à présent. Afin de faciliter notre conversation, je me place au-dessus de lui, ignorant s’il me voit. Dans le doute, je garde une distance. Sait-on jamais ? Précaution nécessaire.
Son visage est marqué par le temps ; quelques cheveux blancs indiquent un âge de sagesse. Je lance un appel pour prendre la mesure.
— Peux-tu entendre ce que je dis, l’ancien ? Son sourire énigmatique me surprend.
— Es-tu l’un de ces mauvais esprits qui hantent ce lieu ?
— Je visite Ayomidé. Elle m’abrite dans son ventre. Les ancêtres ont ouvert une porte vers mon passé.
Il réfléchit à mon propos.
— C’est ma nièce, son nom signifie que la joie est arrivée ! Les ancêtres t’ont honoré afin que tu puisses saluer les tiens, preuve que tu n’as pas oublié tes racines !
Cet homme est donc mon grand-oncle. Je n’ai rien à craindre de lui.
— Je n’ai pas de souvenir de toi. J’ignore tout de ma destination finale. Je me tenais sur la potence, pendue pour avoir voulu vivre libre ! Emportée par une porte lumineuse, je suis arrivée dans la cale de ce navire, livrée à mon nouvel état.
Il ne cesse de sourire, malgré la gravité de mes paroles.
— Un Yoruba reconnaît sa fille. Ta lutte est la nôtre.
— La mort m’a prise, mon corps est exposé, la peur domine ceux qui restent !
Il hoche la tête pour appuyer son propos,
— Les ancêtres connaissent les mystères du destin, l’esclavage n’est pas notre condition !
— J’ignore l’essentiel. Je sais seulement que je suis Yoruba. Maman est avare de son histoire.
— Je l’ai fait naître un jour de pluie, elle me verra mourir un jour de soleil. C’est sans doute pour cela qu’on ne se connaît pas !
Ces paroles ne me réconfortent pas. Il n’a pas dû finir la traversée, pourtant, il paraît si serein.
— Alors, parle-moi d’elle, de notre terre !
Il ferme les yeux, inspire longuement, comme pour prier.
— L’Afrique est immense comme la mer. Au nord se trouvent les Arabes à la peau brune, ils sont ancrés dans l’islam, comme l’arbre épais qui résiste aux embuscades du vent ! Ouvrant le commerce des nôtres, jusqu’à l’Égypte, puis pour les blancs ensuite.
— Je connais l’islam, mon homme avait embrassé la foi, mais je ne sais rien des Arabes !
La nouvelle ne semble guère le rassurer.
— Ils sont venus du Hedjaz, un territoire situé vers l’orient, il y a bien longtemps, pour conquérir des terres en Afrique. Considérant les noirs comme une malédiction des fils de Cham12, nous n’avons que peu de valeur à leurs yeux, malgré les nations noires qui ont adopté leurs rites. Fondant sur les nobles Peuls, les Mandingues, devenus musulmans et à leur tour des vendeurs d’hommes.
Son annonce m’emplit d’effroi.
— Tu dis que des noirs ont participé à cela ?
— Le blanc a des armes redoutables qui viennent à bout de n’importe lequel de nos guerriers !
Je le coupe subitement, oubliant sa condition.
— Notre peuple sait se battre, autant qu’eux, si ce n’est plus encore !
Sa sagesse m’impose le silence.
— Mais cela n’aura pas suffi à protéger nos villages. Ce sont des noirs qui les ont guidés, répandant le poison de l’esclavage.
— Que la malédiction s’abatte sur eux !
Il souffle, cherchant visiblement ses mots.
— Ces religions ont été apportées par des étrangers, ajoutées à notre spiritualité ancestrale. L’homme blanc s’est montré opportuniste, semant la confusion dans nos esprits faibles ; trahissant nos divinités, nous en avons payé le prix !
— Je nous pensais suffisamment nombreux pour les combattre ?
— Au fleuve Volta, il y a autant de tribus que d’oiseaux dans le ciel. Nous sommes Yoruba. Du village de Dabeya. Nous avions un roi, Djibali le fort ; plus de mille guerriers. Réputés pour la chasse, nous sommes respectés à des lieux ; aucun animal ne nous résiste, pas même le crocodile, dont la peau décore nos braves !
Cet homme est la réponse à mes prières sur l’histoire des miens.
— Comment sont nos maisons, mon oncle ?
— Un prolongement de la terre, on ne s’y attache pas ; voilà pourquoi elles sont si petites, on y dort seulement. Leurs murs épais repoussent le vent ! C’est de nos mains que nous les bâtissons. Le toit est un entrelacs de bois que nous avons tressé afin que la pluie ne vienne pas nous déranger. Les repas y sont pris en famille, c’est aussi notre repère de vie dans le village. Elles sont toutes identiques, ne suscitant ainsi aucune convoitise du voisin !
— Comment vivent nos sœurs ?
— La femme est une reine, au sein de la tribu, elle est protégée, sous la tutelle des anciennes. La naissance d’Ayomidé fut célébrée dignement, sacrifiant une vache pour affirmer notre fierté, couverte d’affection ! Elle aimait tant courir dans la plaine, son sourire illuminait mes jours, espiègle et joueuse, elle se cachait partout où elle le pouvait, nous la cherchions, parfois, jusqu’à la nuit tombée.
— Elle est endormie près de nous, portant ce fardeau que je suis. Quel âge a-t-elle mon oncle ?
— Quatorze saisons, promise à un avenir radieux, mais tout est perdu. Nous voici brisés, abandonnés de tous, à la merci d’un destin funeste !
Ses yeux se mouillent, je dois reprendre son attention.
— Aucun homme n’a pu la défendre ?
Sa voix devient mélancolique.
— À l’enfance, les âmes sœurs vont se découvrir, lors d’une cérémonie durant plusieurs nuits ! Elle savait que c’était lui, un brave de seize saisons, fier, chasseur intrépide, il a fallu plus de cinq fusils pour en venir à bout ! Ils ont brûlé son corps, n’en laissant que des cendres ! Ayomidé a tout vu, c’est avec ces dernières visions qu’elle a quitté notre terre.
— Mais pourquoi ont-ils choisi votre village ?
Il veut se lever. Dans sa position, cela paraît impossible.
— La saison des pluies touchait à sa fin, promesse de récoltes abondantes et de troupeaux bien gras. Des messagers sont venus aux nouvelles, faisant des propositions de troc. Un oiseau de malheur a informé le roi. Aidés par des Mandingues, des blancs porteurs d’une magie crachant le feu et semant la mort, avaient ravagé son village, avec ce que nous connaissions comme des fusils, sans en avoir la pratique ni l’usage.
— Vous auriez pu vous préparer ? Vous unir avec les clans alentour ?
— La désunion était notre faiblesse, chacun espérait la chute de l’autre ! Le roi a donné ses ordres, il fallait se battre pour notre survie.
— Ils étaient donc aussi nombreux que nous ?
Il secoue la tête de désapprobation.
— Le fusil est sorcellerie, un seul peut tuer tous les guerriers. Quand tu ne connais pas sa mélodie, le cœur se fige et tout se raidit ! La peur prend le dessus, c’est ainsi que nous avons perdu notre village.
— Générations, après générations, les esclaves sont arrivés en Guadeloupe avant ma naissance ! Ils chassent donc le noir depuis des siècles !
— Les comptoirs13 ne datent pas d’hier, nous avons été aveuglés par l’appât de richesses faciles. Nos rois ont commercé avec les blancs, profitant de leurs bienfaits, d’offrandes ostentatoires. Endormies dans un orgueil néfaste qui allait finir par avoir raison de nous, les Arabes ont ouvert des ports. Les comptoirs sont devenus des prisons à ciel ouvert où l’on s’est mis à vendre des hommes dans toutes les langues du monde ! J’ignore toujours pourquoi. Je lui dois la vérité.
— De la canne à sucre, du café, de l’indigo, du coton, du tabac, des champs à perte de vue, de quoi nourrir toute l’Afrique, notre peuple meurt doucement pour satisfaire les papilles de blancs avides de friandises !
Ma révélation s’abat. Il se prosterne. Les larmes recouvrent son visage épuisé par tant de malheurs, égarés par ces quelques mots que je viens de répandre. Il ne prend pas la mesure de tout cela, garde sa posture un long moment. Honteuse d’avoir été aussi franche, peut-être même brutale, je regrette cette maladresse insolente. Tant des nôtres ont achevé leurs vies dans des champs de cannes à sucre, des milliers, autant que les sauterelles qui ravagent la production. Ils ont rempli les sillons de sueur et de sang trop serviles. Le silence prend le dessus sur sa peine, je relance.
— Je suis désolée, la chance qui m’est donnée de te parler ne doit pas être détournée par ces considérations.
Il essuie ses larmes d’un geste franc, regarde vers le haut,
— Il n’y a rien à faire ma fille, tu n’es pas la cause de cela. Je pleure sur Dabeya, tant de villages réduits en cendre, ces sacrifices, pour des récoltes ? La nature offre ses bienfaits sans contrepartie. Les animaux ne craignent pas la faim, quelle que soit la saison.
La colère prend le pas sur son expression.
— La transhumance des gnous parcourt l’Afrique sur des milliers de kilomètres, c’est l’ordre des choses. Je crois que ces hommes sont venus pour tout défaire, ils ne gagneront pas ce combat.
— Ce sera la fin de leur monde, ce n’est pas une si mauvaise nouvelle !
— Non, ma fille, celle de l’humanité. Nous sommes d’une source unique. Les blancs, aussi puissants soient-ils, ont les mêmes aspirations que nous !
— Seulement le profit. Ils prient un Dieu invisible que personne n’a jamais vu ! Ils prennent ce qui ne leur appartient pas. Sur terre, ils sont un poison que je déteste du plus profond de mon être !
Son sourire revient, à mon grand soulagement.
— Si tu laisses la haine envahir ton cœur, que vas-tu devenir ?
— Une martyre ! Vivant libre, mes dernières années. La France a envoyé des navires remplis de soldats jusqu’à nous étouffer, pour souffler notre lutte. Mais, on n’éteint pas l’embrasement d’un peuple avec un bol d’eau.
Il devient sérieux, presque grave.
— L’espoir est mince, ma fille, ils préféreront nous tuer tous. Chaque génération aura sa guerre, puis viendra celui qui pourra percer leur occultisme. Ils vont trembler. Le noir pourra de nouveau fouler l’Afrique avec fierté.
Je me dois de lui parler de ce général dont nous avions entendu les récits.
— Celui-là est venu de l’île de Saint-Domingue14 où des milliers de noirs ont massacré les blancs, portés par le rêve de Toussaint Louverture15 ! Chassant les Français jusqu’au dernier, offrant de nouvelles voies pour nous.
Je pense l’impressionner, mais il fait la moue.
— Sont-ils retournés en Afrique ?
— Non, mais ils vivent librement à présent !
— Alors ils sont orphelins. La liberté n’est pas d’aller contre le vent, mais de marcher sur le sentier de ses ancêtres, sinon tu n’es plus que l’ombre de toi-même à la recherche d’un passé que tu ne retrouveras jamais.
— La liberté reste la liberté, mon oncle !
— Sans les racines, un arbre finira par mourir.
— Nos enfants vont en planter de nouvelles sur ces terres. Nos traditions orales ne se perdent pas, les plus téméraires pourront faire des navires pour retourner en Afrique.
— C’est là un drôle de rêve !
— Le rêve est la clé de l’espoir, puisant sa force dans la lutte, l’amour. Je l’ai connu et c’est lui qui m’aura véritablement rendu libre. Je suis morte comme j’ai vécu, vivre libre ou mourir est notre devise !
Il fixe le plafond, comme si ses yeux pouvaient percer la coque. Il cherche sans doute les étoiles, se mettant à fredonner dans sa langue natale des paroles qu’à présent je comprends, sans l’aide d’un traducteur.
— Par le feu consumant tout, la terre s’agitant pour faire germer la pousse ; par un vent qui souffle, répandant ses bienfaits rafraîchissants, par cette eau frémissante sinuant sous les roches ; père de toute chose, entends ma prière ! Renforce les serviteurs que nous sommes, de la bienveillance des ancêtres sème l’harmonie parmi tes enfants. Puisse le Soleil raviver notre flamme, la Lune sauvegarder nos esprits troublés. Père de toute chose, délivrez-nous du mal !
Il se répète, ivre de ses paroles, dodeline la tête de gauche à droite, les yeux fermés. Soudain, il affiche un air grave, pose une voix teintée d’amertume.
— Un jour, accompagnant l’aube, sortant inspecter la clôture détruite par la colère d’un buffle, Ayomidé chahutait son homme. Une ancienne l’a rappelé à l’ordre, lui faisant tresser un panier, tandis qu’il venait m’aider ! L’odeur des maisons où se préparait le repas du midi exhalait la plaine. La quiétude régnait, car les guerres étaient rares. Quelques gardes assuraient une présence à l’entrée du sentier et d’un chemin de chèvre ! Un fauve pouvait surgir de la savane, on portait toujours un couteau, voire une lance, avec soi. Lorsqu’ils sont arrivés du nord, par cette belle journée, c’était pour semer la mort et la peur. Choisissant de protéger les petits, l’ennemi était comme les fourmis qui vont à la bataille, organisées et redoutables ! Sachant qui tuer, capturer, chassant femmes et enfants avec une cruauté jamais vue dans nos contrées, n’épargnant personne. Ayomidé s’est blottie près de moi. Ils étaient bien trop nombreux !
Des larmes coulent le long de ses rides.
— Leurs filets ont pris les nôtres, tout était àfeu et à sang. Disposant d’éclaireurs noirs, hurlant en yoruba de nous rendre si nous voulions être traités équitablement ! La mort frappait sans distinction ! Le traitement juste consistait en coups de bâtons pour les hommes afin d’éteindre leur rébellion. Enchaîner les uns aux autres de façon à les empêcher de prendre la fuite. C’était la fin. Si j’avais su que nous allions terminer ainsi, j’aurais tué ma nièce plutôt que de la laisser connaître ce déshonneur. Brûlant notre village millénaire, profanant les corps, ils ont volé notre âme ce jour funeste. Répandant la peur dans nos cœurs, exhibant la tête du roi sur une pique. Des jours sont passés, trois, je crois, la soif nous faisait délirer, nous nous maudissions mutuellement. Le tonnerre continuait de gronder au loin. Ils attaquaient nos voisins avec la même détermination qui nous avait emportés. Ils nous attroupaient en groupes distincts tellement nous étions nombreux, d’hommes, de femmes, d’enfants, d’anciens, avec cette obsession pour nos dents !
Je le laisse respirer, et puis lui annonce :
— C’est pour le marché aux esclaves, la dentition est un signe de bonne santé, l’assurance d’une vitalité robuste. Quand elles sont abîmées, ça signifie des nuits de souffrance sans pouvoir travailler.
Il est atterré par ma réponse,
— Ils ont donc fait de notre peuple une marchandise.
Sa perspicacité m’étonne, bon nombre des miens n’assimilent pas cette notion de propriété, réduisant tout notre être à un objet sans âme, pensant préserver leur bonté sous la lourde croix. L’accepter, c’était renier ses racines, abandonner son cœur à la merci du colon. Ce dernier utilise les outils à sa disposition pour développer sa production, loin de toute considération humaine. L’esclavage ne fonctionne que parce que nous l’avons pris pour de la fatalité, une malédiction des Dieux, un caprice du destin. On garnit les bancs des églises, on pleure sur notre sort. Son récit me transperce de toutes parts. J’imagine une tempête de tristesse qui emporte l’espérance sur ce satané navire, qui vogue vers une fortune funeste. Au-delà même, d’être devenus des bêtes, asservir la volonté d’un peuple passe par la destruction de son humanité, supprimant son désir de liberté, favorisant un règne tyrannique de soumission abjecte. Cette œuvre malfaisante a nécessité des siècles de souffrance, réduisant à néant tout espoir dans un cœur innocent, façonnant le réceptacle creux d’une haine terriblement tenace. On existe désormais que pour servir un maître, sans avenir ni perspective, voilà ce que l’esclave est, un jouet de la malchance à la disposition des pires sadiques. Sa voix mélodieuse, toujours aussi mélancolique, reprend.
— Marchant des jours, Ayomidé a gardé le silence, la mort de son avenir l’a marqué profondément. J’espérais, en mon for intérieur que des guerriers téméraires allaient fondre sur nos ennemis ! Malheureusement, nous sommes arrivés au port de Ouidah16, où les blancs ont des bâtisses en pierre. Les Arabes étaient là aussi pour toucher leurs récompenses.
— Pourquoi personne ne s’est révolté ?
— Quelques tentatives ont permis d’agrémenter les trophées macabres, de supprimer toute envie chez les autres. Ils sont devenus du bétail, eux des bergers très habiles. Nourrissant à peine la foule, on nous maintenait dans la faiblesse. Ibos, Congo, Peuls, Bamilékés, tous mélangés, ils parlaient différents dialectes, enfermés dans leur peur, sans pouvoir se concerter, sans pouvoir l’exprimer.
Ce ravage négrier a touché toute l’Afrique, semblable à une lèpre honteuse, il a défiguré mon peuple, vidé la terre de ses fils, brisé les rêves d’une postérité radieuse sur des générations. Ma lutte recouvrait ce désir inné de liberté, d’une fierté perdue, cela valait une pendaison en place publique. J’ai affirmé, par mon martyr, que nous avions cessé de capituler. Tous ces visages, autour de moi, transpiraient une peur insoluble, abandonnant jusqu’à l’idée de vivre, seule la mort à présent pouvait les délivrer, laissant s’échapper cette aura « martiale » si nécessaire. Cette traversée prépare au calvaire d’une existence vouée à chercher la rédemption, un retour sur la terre sacrée. On se meurt d’épuisement dans un champ de canne, loin des siens. Mon homme avait gardé la foi jusqu’au bout, fidèle à ses principes, attendant le moment propice. Sa récompense avait l’apparence d’une bataille rangée qui brisait les chaînes de l’amertume avec ma folie. Il me fallait désormais tenter d’influencer mon oncle afin que sa destinée ne se termine pas ici.
— Ton courage est un exemple, veille sur ma mère, reste son repère, nous avons besoin de toi. Des guerriers ont trouvé refuge sur les hauteurs de l’île, tu ne seras pas seul.
— Je suis né en Afrique, comblé d’une vie bien trop remplie. Ayomidé est plus forte que moi ; elle est si têtue, ils ont essayé de la faire embarquer sans moi, rugissant, telle une lionne blessée, elle a fini par céder. Je suppose qu’ils ne voulaient pas l’abîmer.
— Si je suis dans son ventre, c’est qu’ils n’ont pas pris de précaution !
Il rejette ma répartie, ne peut m’empêcher de ressasser ce viol qui sonne comme une fatalité, bien qu’il ait permis ma naissance, je devais le questionner. Découvrir ce secret, enfoui dans le tréfonds de son cœur, si bien que je crois naïvement être née comme le Fils de la Vierge Marie, fille légitime du Dieu yoruba. J’ai toujours aimé cette idée irrationnelle. La pensée, que mon géniteur puisse être un blanc, pesait lourd ; un fardeau intolérable à assumer. Si l’on m’avait autorisé à parler avec mon oncle, c’est que je pouvais lui demander ce qui s’était passé, aussi horrible que ce soit à entendre, mon nouvel état l’aurait supporté.
— Ma présence permet de comprendre mon histoire. Je dois savoir ce qui est arrivé à ma mère !
Son expression ne me rassure guère. Son œil tremble. Il joint ses mains presque en prière.
— Il est des souvenirs que l’on refuse par peur de les revoir franchir le territoire des ombres. Tu en as le droit légitime, ma fille !
Il marque un arrêt, au bord des larmes cherche ses mots, ne cesse de se mordre les lèvres. Je n’ose pas lui dire que dans quelques années à peine, mon intimité sera volée par d’infâmes chasseurs de primes qui piétineront mon âme d’un traumatisme amer qui ne s’efface jamais. Encore une enfant, enfouissant ce souvenir tout au fond de moi, comme si une parcelle de négritude refusait cette condition, celle qui permet à l’homme blanc d’abuser de mon innocence. Le viol constitue le crime le plus odieux de l’esclavage puisque le maître en use régulièrement. Toute sœur peut le connaître durant une vie servile. Le corps d’un esclave n’a de valeur que par sa production quotidienne. Aussitôt remplacée par un autre, la mort n’est rien, juste une façon implicite d’accorder le droit de nous traiter avec cruauté. Ayo, ma mère adorée, l’a subie, dans des conditions sordides, coincée entre toute cette peine, dans des relents fétides, mêlant les déjections de chacun, achevant son humiliation. Mon oncle semble gêné, hésite longuement à reprendre son récit.
— Pour appréhender cette tragédie, tu dois savoir ce qu’on a traversé. Nous sommes restés plusieurs jours au port à attendre le navire. La chaleur assommante a eu raison de nombre parmi nous. Beaucoup sont morts. Les distributions de bouillis de manioc et les bananes donnaient lieu à des bagarres fréquentes.
Je comprends son propos, la faim rend exécrable.