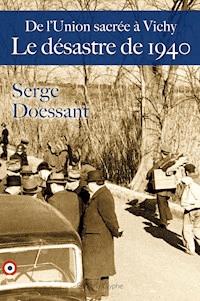
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Glyphe
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Un essai très intéressant sur une période noire de l'Histoire française.
La Troisième République, qui avait su s’imposer et gagner la Grande Guerre, a subi dès 1919 un lent et inéluctable déclin, qui l’a conduite à son effondrement en 1940.
Quel contraste saisissant entre la ferveur, la capacité de rassemblement de la Belle Époque, et le désenchantement, la division du personnel politique de l’entre-deux-guerres ! Dès la déclaration de guerre d’août 1914, le président proclamait l’Union sacrée et la République montrait son esprit de décision en gagnant la bataille de la Marne. En 1940, alors que le chef de l’État brille par son absence, le personnel politique est divisé jusqu’au sein du gouvernement et une atmosphère de défaitisme conduit le pays à l’armistice. Pour ceux qui l’ont vécue, la débâcle laisse le souvenir de millions de réfugiés, de 100 000 soldats et autant de civils tués.
Dès le lendemain de la défaite, le nouveau régime trouvait des boucs émissaires : la République démocratique, le Front populaire, « l’esprit de jouissance »… Mais les dirigeants de l’État français mis en place par le vainqueur de Verdun, eux-mêmes responsables de la défaite, n’attendront pas trois mois pour mettre en place le statut des Juifs. Ils montraient là leur véritable objectif : la revanche, mais cette fois-ci contre la République.
La réalité du désastre de 1940 est cruelle. C’est le grand mérite de ce livre de le montrer.
EXTRAIT
Beaucoup a été dit sur les raisons du naufrage de 1940. La polémique a d’abord été lancée immédiatement après l’armistice par le gouvernement de Vichy lui-même, dont les membres les plus éminents avaient pourtant mené les armées à la défaite : les Alliés, notamment la Grande-Bretagne, n’avaient pas soutenu la France aussi fortement que pendant la Grande Guerre; la France avait eu tort de déclarer la guerre sans l’avoir sérieusement préparée; enfin et surtout, les Français ne pouvaient s’en prendre qu’à eux-mêmes puisqu’ils avaient, dans les années précédant la défaite, « préféré l’esprit de jouissance à l’esprit de sacrifice ». Après 1945, on mettra en cause, au contraire, l’attitude purement défensive voire défaitiste des dirigeants politiques et militaires d’avant-guerre, leur incompréhension de la nouvelle donne que constituait la mécanisation des armées, leur incapacité à définir et à appliquer une politique étrangère claire, voire leur tropisme envers le fascisme. Certains ont aussi incriminé des institutions déliquescentes, d’autres les hommes politiques qui n’auraient pas été à la hauteur des événements.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Diplômé de Sciences Po Paris, auteur et conférencier,
Serge Doessant a construit son livre,
Le général André, à partir d’une consultation sans a priori des sources d’archives, étayée par des documents familiaux inédits. Il offre ainsi une vision totalement nouvelle de la personnalité et de l’action du général André.
Il a déjà donné plusieurs conférences : à l'Institut Charles de Gaulle, au Cercle des armées notamment et, récemment, au Salon du livre d’histoire de Bourges.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À la mémoire des victimes civiles et militaires de mai-juin 1940
AVANT-PROPOS
IL Y A SOIXANTE-DIX ANS, la France connaissait l’une des plus graves défaites de son histoire. L’attaque foudroyante de l’armée allemande et la débâcle des troupes françaises, commencées à Sedan, ont plongé le pays dans un exode sans précédent. Le monde entier a été saisi de stupeur et s’est demandé comment la France, qui avait supporté l’essentiel du conflit entre 1914 et 1918, et dont on disait à la fin de la Grande Guerre que son armée était la plus puissante du monde, avait pu être vaincue en six semaines par l’Allemagne. L’étonnement sera encore plus grand lorsque le gouvernement conduit par le maréchal Pétain, l’une des gloires de la Grande Guerre, conclura immédiatement l’armistice, signé, suprême humiliation, à Rethondes, là même où les Alliés avaient scellé la défaite de l’Allemagne le 11 novembre 1918.
Or, moins de vingt-six ans auparavant, en septembre 1914, les fantassins français remportaient la victoire de la Marne après six semaines d’échecs et une épuisante retraite. Les armées françaises avaient donc su réagir efficacement en 1914. Elles se sont effondrées en 1940. Comment expliquer ce saisissant contraste ? En 1914, la Troisième République a quarante-quatre ans. Lorsqu’elle est née de la défaite de 1870, à Sedan déjà, sa pérennité était d’autant moins assurée que la majorité de l’Assemblée nationale ne lui était pas favorable. Elle a pourtant traversé victorieusement des crises majeures qui, très tôt, ont failli l’emporter, car elles remettaient à chaque fois en cause sa légitimité. Même l’affaire Dreyfus, emblématique des oppositions entre les Français, sera surmontée après douze années d’incroyables soubresauts. En grave infériorité numérique face à l’Allemagne (45 millions d’habitants en comptant l’Algérie, contre 67 millions d’Allemands), la République a su, par une politique extérieure menée avec constance, pallier cette infériorité et, surtout, elle a construit une armée solide et moderne, œuvre qui sera très longtemps sous-estimée. Enfin, dès le 4 août 1914, lendemain de la déclaration de guerre, le président de la République Raymond Poincaré proclamait, dans un message au Parlement, que la France serait « héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l’ennemi l’Union sacrée. » Ce régime dont l’avenir était rien moins qu’assuré en 1870 a ainsi surmonté des défis d’une exceptionnelle ampleur. Les raisons de ces succès sont multiples et il est important de les examiner afin de comprendre pourquoi, la Grande Guerre terminée, la République ne sera plus en adéquation avec l’évolution du monde.
Après 1918 en effet, la République a dû faire face à des défis d’une tout autre ampleur : gérer le retour à la paix, affronter la grande crise de 1929, enfin tenter de définir une politique à l’égard des dictatures européennes. Sur chacune de ces questions, certes difficiles et inédites, elle n’avait plus l’efficacité qu’elle avait montrée avant 1914. Les causes de cette inefficacité sont diverses et fort nombreuses. Elles sont à l’origine du drame de 1940. La Troisième République avait alors soixante-dix ans. Auréolée d’une victoire chèrement acquise en 1918, elle avait mené à bien, en une décennie, la reconstruction des régions détruites. Mais elle va tomber, en six semaines aussi, sans même que le président de la République, Albert Lebrun, intervienne publiquement. Contrairement à 1914 où seuls quelques rares coloniaux avaient participé à des conflits, la haute hiérarchie militaire de 1940 était entièrement issue des officiers qui avaient mené la France à la victoire en 1918. Les chefs – Pétain, Gamelin, ancien collaborateur de Joffre, Weygand, ancien adjoint de Foch et tant d’autres – avaient une grande expérience de la guerre, et c’est d’ailleurs pour cela qu’ils avaient été choisis. Mais cette « expérience » s’est révélée totalement inopérante.
Beaucoup a été dit sur les raisons du naufrage de 1940. La polémique a d’abord été lancée immédiatement après l’armistice par le gouvernement de Vichy lui-même, dont les membres les plus éminents avaient pourtant mené les armées à la défaite : les Alliés, notamment la Grande-Bretagne, n’avaient pas soutenu la France aussi fortement que pendant la Grande Guerre ; la France avait eu tort de déclarer la guerre sans l’avoir sérieusement préparée ; enfin et surtout, les Français ne pouvaient s’en prendre qu’à eux-mêmes puisqu’ils avaient, dans les années précédant la défaite, « préféré l’esprit de jouissance à l’esprit de sacrifice ». Après 1945, on mettra en cause, au contraire, l’attitude purement défensive voire défaitiste des dirigeants politiques et militaires d’avant-guerre, leur incompréhension de la nouvelle donne que constituait la mécanisation des armées, leur incapacité à définir et à appliquer une politique étrangère claire, voire leur tropisme envers le fascisme. Certains ont aussi incriminé des institutions déliquescentes, d’autres les hommes politiques qui n’auraient pas été à la hauteur des événements.
Sur le plan strictement militaire, « l’art de la guerre » avait profondément évolué dans les cinquante années précédant 1914, puis pendant la Grande Guerre. Même avec beaucoup de retard, les chefs de l’armée avaient alors su s’adapter et innover face aux nouvelles conditions des conflits. Cette capacité d’adaptation avait été plus rapide que celle de l’Allemagne d’où, avec l’aide des alliés, la victoire de 1918. Après le traité de Versailles, la pensée militaire française a semblé ne plus poursuivre sa marche en avant, l’armée donnant alors l’étrange impression d’être « en retard d’une guerre », comme on l’a souvent dit. Ce retard de la science militaire est aussi l’une des raisons de la défaite. Mais à qui doit-on l’attribuer : aux chefs de l’armée, dont la capacité d’innovation s’était tarie ? aux gouvernements successifs qui n’ont pas su donner l’impulsion indispensable et choisir les meilleurs officiers aux postes clés ?
Cet ouvrage est un essai. S’il n’est pas nécessaire, pour comprendre ce qui s’est passé en 1940, d’examiner en détail l’histoire de la Troisième République, il est cependant indispensable de revenir sur les principaux événements qui ont fondé la République, permis son enracinement dans la société française et la victoire de 1918, puis entraîné son déclin jusqu’au désastre de 1940. En cela, nous suivrons les recommandations de Fernand Braudel, selon lesquelles il ne faut pas hésiter « à reculer pour expliquer, car, plus on recule dans le passé, mieux on analyse1. »
1. Marc Ferro, Pétain, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1987, préface.
PREMIÈRE PARTIELE TRIOMPHE DE LA RÉPUBLIQUE (1870-1918)
CHAPITRE ILA RÉPUBLIQUE PAR SURPRISE (1870-1899)
LE SECOND EMPIRE est mort sur le champ de bataille de Sedan, le 2 septembre 1870. Deux jours plus tard, Gambetta et Jules Favre proclamaient la république à l’Hôtel de ville de Paris. Mais de quelle république allait-il s’agir ? Il était bien difficile de répondre à cette question tant le monde politique français était divisé, alors que les armées prussiennes occupaient une partie du pays. Peu de responsables imaginaient alors que cette république durerait soixante-dix ans et qu’elle surmonterait victorieusement de graves crises et un terrible conflit. Ce n’est pas le moindre des paradoxes de ce régime supposé faible.
UNE ASSEMBLÉE MONARCHISTE CHOISIT LA RÉPUBLIQUE
Ce qui frappe dans la réaction de la France après le désastre de Sedan de 1870, c’est la volonté farouche de résister à la Prusse, notamment chez les Parisiens. Après l’entrevue de Ferrières où Bismarck exige la cession de l’Alsace et de la Lorraine, Jules Favre revient dans une capitale favorable à la lutte à outrance, et Gambetta, le ministre de la Défense et de l’Intérieur du gouvernement provisoire, quitte Paris en ballon, s’installe à Tours et organise la lutte avec cinq cent mille soldats. Mais Chanzy est arrêté au Mans, Faidherbe à Saint-Quentin et Bourbaki entre Besançon et la Suisse. Au moins la France a-t-elle, en combattant ainsi, relevé son prestige aux yeux de l’étranger et sauvé son honneur. À Paris, le froid, la faim, les bombardements amènent toutefois le gouvernement provisoire à cesser la lutte et Jules Favre signe la capitulation de la capitale le 28 janvier 1871. L’armistice, conclu pour trois semaines, devait permettre d’élire une Assemblée qui déciderait la poursuite de la guerre ou la signature de la paix. Le 8 février 1871, les élections organisées hâtivement amènent une majorité largement favorable à la paix à l’Assemblée nationale. Bordeaux joue pour la première fois le rôle de capitale du pouvoir, comme elle le fera encore en 1914 et en 1940. L’Assemblée nomme Thiers « chef du pouvoir exécutif de la République française… en attendant qu’il soit statué sur les institutions de la France » car il est convaincu que l’urgence est à la réorganisation du pays et non à se préoccuper de la nature des institutions qui divisait alors profondément les hommes politiques. Mais ce n’était que partie remise.
Les préliminaires de paix sont adoptés malgré les protestations des représentants de l’Alsace et de la Lorraine qui sont contraints de démissionner. Et l’Assemblée se transporte à Versailles car sa majorité très conservatrice se méfie de Paris. Or, la population de la capitale est mécontente de la paix et de la présence de l’Assemblée à Versailles car, pour Louis Blanc, Paris était la « capitale nécessaire. » Thiers, totalement insensible aux souffrances des Parisiens, veut leur enlever les canons de Belleville et de Montmartre. La foule s’y oppose et les généraux Lecomte et Thomas sont exécutés. Puis c’est l’élection de la Commune. Les premiers engagements avec l’armée de Thiers commandée par Mac-Mahon se produisent au début d’avril. Des exactions sont perpétrées dans les deux camps, et c’est la Semaine Sanglante : 1 000 soldats Versaillais, entre 20 000 et 30 000 communards y trouvent la mort. Les exécutions sommaires par les Versaillais resteront longtemps dans la mémoire des Parisiens car, commises sur ordre des généraux d’une armée incontrôlée et désorganisée, elle entraînera une méfiance profonde entre Paris et la province qui ne s’atténuera qu’avec la Première Guerre mondiale. Quant au mouvement ouvrier, il était décapité pour des décennies et la République se souciera fort peu du sort de ses travailleurs. Ce sera une constante bien regrettable jusqu’en 1936.
Le traité de Francfort signé le 10 mai 1871 et la Commune morte le 28 mai, Thiers peut désormais se consacrer aux institutions. Sur les 650 députés réunis à Versailles, 500 sont favorables à la monarchie, mais ils sont divisés entre légitimistes fidèles au comte de Chambord, petit-fils de Charles X, et orléanistes, puissants dans le monde des affaires. C’est d’abord le comte de Chambord qui est sollicité pour monter sur le trône. Mais on achoppe sur le refus obstiné du prétendant d’accepter le drapeau tricolore. Or, dès les 117 élections partielles du 2 juillet 1871, 112 républicains sont élus, dont Gambetta. Ne pouvant choisir un roi après le refus de Chambord, l’Assemblée décide que Thiers, « chef du pouvoir exécutif », sera le « président de la République française. » Il est vite apparu que les députés se souciaient alors plus de la sauvegarde de leurs intérêts que de la nature du régime. Il suffira que la République préserve leurs affaires, et ils s’y rallieront…
L’humiliant traité de Francfort avait non seulement retiré à la France l’Alsace moins Belfort et une partie de la Lorraine dont Metz, mais il avait aussi prévu le paiement d’une indemnité de cinq milliards de francs dans les trois ans. Thiers s’oppose, en bon représentant de la bourgeoisie, à un impôt sur le revenu pour financer cette indemnité et il opte pour l’emprunt qui est couvert 14 fois ! Emis à 84,50 pour un nominal de 100, les milieux financiers ont à cette occasion la confirmation qu’ils attendaient : la République autoritaire est aussi capable que la monarchie de protéger leurs intérêts. C’est pourquoi les hommes d’affaires vont rapidement créer le « centre gauche » favorable à la participation au pouvoir républicain avec Léon Say, Henri Germain, qui avait fondé le Crédit Lyonnais en 1863, et Casimir-Périer.
LA RÉPUBLIQUE SE SOUCIE DE SON ARMÉE
La défaite de 1870-1871 a hanté les dirigeants politiques comme les officiers dont beaucoup feront le serment de remettre l’armée à un niveau tel que la revanche ne soit pas seulement une vue de l’esprit. La France était alors à peu près à égalité numérique avec l’Allemagne : 38 millions d’habitants contre 39 millions d’Allemands. Son échec face à la Prusse était dû à une insuffisante organisation de l’armée et à l’infériorité manifeste de son artillerie. Aussi le nouveau régime républicain va-t-il, très tôt, et de manière constante, se préoccuper de restaurer la puissance militaire perdue. Pour ce faire, Thiers accepte un compromis avec la majorité conservatrice de l’Assemblée. Par la loi du 27 juillet 1872, le service militaire est « obligatoire », mais un système de tirage au sort institue un service de cinq ans pour les conscrits qui tirent un « mauvais numéro » et de six mois ou un an, en fonction des besoins ou des crédits disponibles, pour les « bons numéros ». De très nombreuses dispenses sont toutefois prévues : conscrits de petite taille (moins de 1,53 m), infirmes ou soumis à des obligations familiales, ce qui avait son importance dans un pays essentiellement rural. Enfin, les étudiants en médecine et en pharmacie, issus des milieux privilégiés, et les étudiants futurs ecclésiastiques sont totalement dispensés de service.
Les élections partielles continuent inlassablement d’envoyer des « radicaux » à l’Assemblée. Accusé de les favoriser en sous-main, Thiers est écarté le 24 mai 1873 et l’Assemblée élit Mac-Mahon président de la République. Il désigne Broglie comme président du Conseil et c’est le temps de « l’Ordre moral ». Puis, en septembre 1873, le dernier soldat prussien quitte le territoire. Le 30 octobre, le comte de Chambord refuse définitivement le drapeau tricolore et, la monarchie étant désormais impossible, on fixe le mandat de Mac-Mahon à sept ans : les orléanistes acceptent le mot « République » et la gauche se résout à admettre le Sénat par l’amendement Wallon qui est voté à… une voix de majorité. La Troisième République a été dès le départ un régime de difficiles compromis qui, pensait-on, n’assureraient pas sa pérennité. Mac-Mahon choisit Jules Simon comme président du Conseil, parce qu’il s’opposait à Gambetta qui tonnait contre les catholiques, puis il l’accule à la démission et dissout l’Assemblée. Mais les élections confirment la majorité républicaine. Mac-Mahon tente bien de constituer un ministère conservateur dirigé par le général de Rochebouët, commandant du 18e corps d’armée à Bordeaux, mais les chambres refusent même de dialoguer avec lui. Et Rochebouët retourne tranquillement commander son corps d’armée… Cet épisode est à l’origine de l’affaiblissement de la fonction présidentielle et jette le discrédit sur la dissolution. Ce sera lourd de conséquences, notamment dans l’entre-deux-guerres où aucun président de la République ne se hasardera à utiliser cette arme pourtant bien utile pour dégager des majorités stables ou pour trancher des questions essentielles.
LA RÉPUBLIQUE DES AFFAIRES, LIBÉRALE ET LAÏQUE
Jules Grévy remplace Mac-Mahon démissionnaire en janvier 1879. Il représente l’industrie jurassienne, et, malgré une grande instabilité ministérielle, les mêmes hommes demeurent aux postes clés : Léon Say aux Finances, Freycinet aux Travaux publics, et Méline à l’Agriculture pour laquelle il fera voter des lois très protectrices. Freycinet va entreprendre la construction de canaux, mais surtout de lignes de chemin de fer qui donneront lieu à beaucoup de spéculations, chaque député voulant créer sa propre ligne. Et lorsqu’on proposera aux grandes compagnies de racheter les petits réseaux déficitaires, l’État donnera sa garantie :
« Les bénéfices d’exploitation aux entreprises, le déficit affectant les finances publiques, tel était le libéralisme des milieux d’affaires.1 »
Dans un tel contexte d’affairisme, le premier scandale éclate en 1882. C’est la faillite de l’Union Générale, banque catholique créée pour faire contrepoids à la banque protestante et israélite plutôt républicaine, en profitant des largesses du plan Freycinet. Le Centre gauche lié aux affaires triomphe. Jules Ferry va continuer de le satisfaire avec sa politique coloniale. Il ne s’agissait pas d’un plan mûrement réfléchi, mais les réalisations étaient très concrètes : traité du Bardo pour la Tunisie (1881), occupation de Tananarive et de Diégo-Suarez (1883), conquête du Tonkin (1884). Il faudra la défaite de Langson, à la frontière chinoise, en 1885, pour provoquer la chute de Jules Ferry. Cette expansion coloniale sera vivement contestée par des hommes politiques comme Clemenceau qui voyaient là un moyen de se distraire de l’essentiel : la revanche contre l’Allemagne. Même si l’importance économique de l’Empire colonial français est incontestable, nous sommes pourtant bien loin du poids de l’Empire anglais dans l’économie de nos voisins d’outre Manche :
Importance de l’Empire colonial dans l’économie française en 19132 :
L’empire colonial présentait toutefois un intérêt essentiel, celui de permettre aux entreprises de disposer d’un marché « constant et prédictif ».
Le nouveau régime se devait, sur le plan strictement politique, de marquer une rupture avec le Second Empire. Après avoir voté l’amnistie pour les Communards (1880), il décide sans hésiter la liberté totale de réunion et de la presse. Quant à la liberté d’association, elle ne sera reconnue par la loi Waldeck-Rousseau de 1884 que pour les associations professionnelles. C’est avec cette loi que le syndicalisme a pu prendre son essor mais la restriction de son champ d’action avait pour objectif d’en exclure les congrégations religieuses. Dans un fort contexte de progrès matériel dû aux inventions, les républicains reprochaient en effet aux milieux catholiques leur opposition à la République, ce qui constituait un grand péril car elle disposait d’un levier d’action important : l’enseignement. C’est pourquoi Ferry, ministre de l’Instruction publique à partir de 1879, décide de créer un enseignement laïque public. La loi de 1880 prévoit que les membres des congrégations non autorisées ne pourront plus enseigner dans l’enseignement public ou libre, mais, devant le refus du Sénat, Ferry applique strictement les lois existantes relatives aux congrégations non autorisées : 300 d’entre elles avec 3 000 membres sont dissoutes. Puis il décide la création de l’enseignement secondaire pour les jeunes filles par la loi Camille Sée de 1880. Enfin, il rend l’enseignement primaire public, laïque dans les programmes et dans son personnel, et obligatoire. La loi et les décrets de Jules Ferry seront les grands textes fondateurs de la République. Leur importance est considérable pour son avenir :
« En obligeant la partie la moins fortunée de la Nation à choisir pour ses enfants l’école neutre, les réformateurs présidaient à une laïcisation profonde qui reste l’un des caractères essentiels de la société française d’aujourd’hui1. »
L’ÉCHEC DE BOULANGER, LE « GÉNÉRAL REVANCHE »
Avec la tentation boulangiste, la République va devoir faire face à un danger d’autant plus important qu’il prenait sa source dans l’armée à laquelle elle avait prodigué tous ses soins depuis 1871. Sur la recommandation de Clemenceau, Boulanger, général de division de seulement 47 ans, devient ministre de la Guerre de Freycinet et de Goblet (1886-1887), après avoir commandé le corps expéditionnaire en Tunisie, où il s’était heurté au résident général, Paul Cambon, qui avait obtenu son retour en France. Boulanger prend immédiatement des mesures en faveur du soldat qui le rendent très populaire : on remplace les paillasses par des sommiers et les gamelles par des assiettes ; on peint les guérites en bleu-blanc-rouge. Mais il fait aussi des réformes plus profondes. Son projet de loi de mai 1886 réduit de cinq à trois ans la durée du service militaire et modifie les dispenses prévues depuis 1872 en faveur des étudiants et des élèves ecclésiastiques : ils feront désormais un service réduit à un an, au lieu d’une exemption totale, ce que l’on résumera d’une formule ironique : « Les curés sac au dos. » La loi ne sera toutefois votée qu’en 1889, alors que Boulanger avait quitté le ministère de la Guerre. Le ministre de la Guerre a fait aussi un choix essentiel en remplaçant le fusil Gras par le Lebel.
Mais le général Boulanger, porté par sa popularité, va faire de la politique, ce qui le perdra car il n’avait ni la profondeur de pensée, ni le caractère pour y réussir. En 1887 survient la rocambolesque affaire Schnaebelé, du nom d’un commissaire de police français de Moselle, qui, selon la presse, aurait été arrêté en territoire français par la police allemande, le 20 avril, pour cause d’espionnage. Il avait en fait franchi la frontière après avoir été attiré par son homologue allemand, Gautsch. Cet évènement va déclencher une vague d’indignation en France, à laquelle Boulanger, présenté comme le « général revanche », n’était évidemment pas étranger. Lorsqu’il présente en Conseil des ministres un décret de mobilisation des troupes de couverture pour faire face à la « provocation allemande », le prudent président de la République, Jules Grévy, refuse de le signer et l’affaire se réglera sur un plan strictement diplomatique. Cette péripétie montre que les présidents de la Troisième République n’étaient pas toujours « inertes ». Elle montre surtout que Boulanger avait fait preuve d’une grande imprudence en utilisant un commissaire de police comme intermédiaire avec ses services de renseignements en Allemagne. En réponse à la demande d’explications de la France, Bismarck reconnaîtra finalement que Schnaebelé avait été attiré officiellement mais déloyalement en territoire allemand ; il sera libéré dix jours plus tard. Bien entendu, les partisans de Boulanger affirmeront que c’était lui qui avait fait « reculer » l’Allemagne.
Mais c’en était trop, Boulanger quitte le gouvernement. Il obtient immédiatement 38 000 voix à une élection partielle dans la Seine à laquelle il ne s’était même pas présenté, car cela lui était interdit par son statut militaire. Son successeur à la Guerre, le général Ferron, le nomme commandant du 13e corps d’armée à Clermont-Ferrand et la foule tente de le retenir à la gare de Lyon en se couchant sur les voies. Il part sous les vivats, juché sur une locomotive… Boulanger a de plus en plus de partisans à gauche comme à droite lorsque survient le scandale des décorations. Le gendre du président Jules Grévy, Daniel Wilson, député d’Indre-et-Loire, est accusé de vendre des décorations au sein même de l’Élysée, et le général Caffarel, sous-chef d’état-major de l’armée, est soupçonné d’avoir participé à ces malversations. Pour se défendre, Caffarel, qui avait été nommé à son poste par Boulanger, met ce dernier en cause, mais Boulanger se défend avec une telle véhémence que le ministre de la Guerre lui inflige trente jours d’arrêts de rigueur. Finalement, un conseil d’enquête présidé par le général Saussier, le gouverneur militaire de Paris, conclut que Caffarel a commis des « fautes contre l’honneur » et il est mis à la retraite d’office.
« IL N’EST PAS TRÈS FORT, MAIS IL PORTE UN NOM RÉPUBLICAIN »
Grévy doit démissionner devant les turpitudes de son gendre. Il est remplacé par le discret Sadi Carnot, élu de la Côte-d’Or. Ce petit-fils de l’illustre Lazare Carnot, l’Organisateur de la Victoire de la République en 1793, est élu grâce aux voix de la gauche mobilisées par Clemenceau qui trouvera à cette occasion une des formules dont il avait le secret :
« Il n’est pas très fort, mais il porte un nom républicain. »
Sadi Carnot n’était peut-être pas « très fort », mais il sera, en succédant à Jules Grévy, président de la République pendant un septennat presque complet et il saura nommer des présidents du Conseil à des moments difficiles pour la République : agitation boulangiste, scandale de Panama, attentats anarchistes dont il va être lui-même victime en juin 1894 à Lyon. Il serait donc bien hasardeux de partager le bon mot de Clemenceau car la « magistrature d’influence » de Sadi Carnot a dû compter. Être discret ne signifie pas manquer de discernement ni de savoir-faire. C’est incontestablement lui, par « sa gravité douce et sa chaste raideur4 », qui va ancrer la fonction présidentielle dans la vie publique. On ignore souvent que Sadi Carnot avait été un condisciple du futur général André à l’École polytechnique, entre 1857 et 1859. Fidèles amis, ils étaient tous les deux originaires de la Côte-d’Or. Promu général de brigade en décembre 1893, Louis André est immédiatement nommé commandant de l’École polytechnique. Cette nomination va mettre sur le devant de la scène une personnalité militaire alors très réputée dans les milieux scientifiques mais atypique au sein de l’armée, car c’est à partir de 1894 que le général André va se montrer publiquement républicain. Il l’était déjà sous l’Empire mais il avait jusque-là su se faire discret sur ses opinions. Lorsque le général Mercier, ministre de la Guerre depuis seulement trois semaines, lui annonce fin 1893 qu’il le nomme à la tête de Polytechnique, il est évident que c’est Sadi Carnot, le chef des armées selon la Constitution, qui avait avancé le nom de Louis André.
Le scandale Wilson va évidemment attiser l’antiparlementarisme, ce dont Boulanger va profiter. Début 1888, il lance son journal La Cocarde avec un programme dont la précision n’était pas la qualité première : Dissolution, Révision, Constituante. Il va enfin pouvoir se présenter aux élections grâce à une maladresse du gouvernement puisque, mis à la retraite d’office, il est désormais éligible. Élu et réélu dans plusieurs départements, il obtient la consécration dans la capitale où il bat le candidat unique de la gauche et du gouvernement. La foule descend dans la rue et crie « À l’Élysée. » Mais Boulanger hésite. La présence à ses côtés de sa maîtresse, madame de Bonnemain, qu’il aime sincèrement, le fait réfléchir. Or, cette circonstance favorable ne se représentera plus. Charles Floquet, le président du Conseil, s’oppose immédiatement à Boulanger à la tribune de la Chambre. L’échange est si violent que les deux hommes se battent en duel le lendemain à Neuilly. Contre toute attente, c’est Floquet qui blesse assez gravement au cou son adversaire : sexagénaire et civil, il avait battu Boulanger, général de division de 51 ans ! Le ridicule n’était pas loin.
UN REDOUTABLE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR : CONSTANS
Le gouvernement, un instant décontenancé, va réagir vigoureusement devant la menace boulangiste grâce au ministre de l’Intérieur, Ernest Constans. Étonnante personnalité que ce professeur de droit, élu de Toulouse, qui, déjà ministre de l’Intérieur de Ferry, avait appliqué sans faiblesse les décrets contre les congrégations non autorisées. Ministre extraordinaire de France en Chine, puis gouverneur général de l’Indochine, Constans avait préféré conserver son mandat de député et il était rentré en France en 1888. Heureusement pour le gouvernement de Tirard (février 1889) où il se voit confier l’Intérieur. L’habileté diabolique dont Constans va faire preuve signera la perte de Boulanger qui n’était vraiment pas de taille à résister. Constans fait accélérer la discussion du projet de loi fixant la procédure devant la Haute Cour, devant laquelle Boulanger va être déféré, puis il s’attire la complaisance des monarchistes libéraux en accordant le retour en France du duc d’Aumale, fils de Louis-Philippe, que Boulanger avait fait exiler alors qu’il lui devait une partie de sa carrière. Enfin, Constans fait répandre le bruit que Boulanger va être arrêté. Il n’en faut pas plus au général qui s’enfuit à Bruxelles le 1er avril 1889 sous les yeux de la police qui se garde bien de l’arrêter ! Et, pour se débarrasser totalement de lui, Constans fait voter la loi interdisant les candidatures multiples et il le fait condamner en Haute Cour. Le centenaire de la Révolution avec l’inauguration de la Tour Eiffel va vite faire oublier le flamboyant général. Boulanger se donnera la mort à Bruxelles, en septembre 1891, à 54 ans, sur la tombe de madame de Bonnemain qui était décédée après une longue agonie. Il était incapable de vivre sans elle et c’est un aspect bien touchant du personnage. Constans se retire du pouvoir en février 1892. Il sera nommé ambassadeur à Constantinople de 1898 à 1908. Quant à Wilson, condamné en première instance, il est acquitté en appel. Maire de Loches en 1892, il est encore élu deux fois député de l’arrondissement mais est invalidé deux fois par la Chambre de députés qui réglait ainsi ses comptes elle-même. Élu de nouveau en 1898, il sera battu en 1902. Ce ne sera pas la seule fois, sous la République, qu’un homme politique condamné retrouve son siège.
L’affaire Boulanger avait encore montré que la République était capable de résister vigoureusement à ses adversaires, malgré l’instabilité ministérielle. Sous la présidence de Jules Grévy, la durée moyenne d’un ministère était de 8,9 mois. Elle tombera à 7,8 mois sous Sadi Carnot dont la présidence verra la fin de l’agitation boulangiste. Sans doute les cadres politiques étaient-ils, malgré l’instabilité, de qualité et savaient-ils, alors, s’unir pour défendre la République. Nous aurons l’occasion d’en reparler lors des futures crises.
PANAMA
L’affaire Boulanger, à peine terminée, survient celle de Panama. La faillite de la Compagnie de Panama, déjà ancienne puisque datant de 1888, va troubler le pays. Fondée en 1881 par Ferdinand de Lesseps, la société s’était donné comme objectif de réaliser un canal transocéanique à travers l’isthme de Panama, comme il l’avait fait à Suez sous le Second Empire. Mais les travaux se sont révélés beaucoup plus complexes en raison de la géographie et de la géologie et les moyens financiers nécessaires augmentaient sans cesse. Or, ce n’était pas un projet susceptible d’intéresser la « Haute Banque » qui ne voyait que par les mines et les emprunts d’État. Aussi, la compagnie avait-elle été contrainte de recourir aux petites banques, protestantes ou israélites, qui avaient « arrosé » la presse afin que celle-ci encourage le placement des emprunts dans le public. De fait, les frais de souscription, encaissés par les banques, qui ne prenaient aucun risque, se sont avérés très élevés. C’est ainsi que l’emprunt à lots de 1885 sera autorisé par le ministre des Travaux publics Baïhaut moyennant le paiement d’un million de francs, et que beaucoup de députés seront achetés pour acquérir leurs votes. Tous seront d’accord pour étouffer le scandale qui est cependant mis sur la place publique en 1893 par La Libre Parole, journal antisémite fondé par Drumont.
C’est aussi à cette époque que la condition ouvrière redevient d’actualité. Des échauffourées sanglantes avaient opposé l’armée, alors seule chargée de maintenir l’ordre, aux ouvriers à Decazeville (1886) et à Fourmies (1891). Les salaires étaient faibles et ils n’étaient pas versés aux apprentis, ni en cas de maladie ou de chômage. Il faudra attendre 1892 pour que le travail de nuit des femmes et des enfants soit interdit et 1898 pour voir votée une loi sur les accidents du travail. L’insalubrité des logements était patente et l’alcool régnait en maître. La République était bien dure pour ses travailleurs. Ce sont finalement les attentats anarchistes qui attirent l’attention sur les problèmes sociaux. C’est Ravachol qui fait sauter des maisons de magistrats en 1892, et Vaillant qui lance une bombe à la Chambre des députés, sans faire de victimes, en 1893. Le gouvernement de Casimir-Périer fait voter la loi scélérate qui prévoit cinq ans de prison pour provocation au meurtre. Cette loi sera considérée comme attentatoire aux libertés par la gauche qui redoutait qu’on l’emploie contre elle, et ce sera l’origine de son désaccord complet avec Casimir-Périer. La prochaine victime des anarchistes sera, on le sait, le président de la République, Sadi Carnot lui-même, assassiné par Caserio en 1894 à Lyon. Une loi des suspects condamne alors toute propagande anarchiste. Casimir-Périer, des mines d’Anzin, remplace Sadi Carnot, mais il ne reste que quelques mois à son poste car les socialistes lui reprochent d’appartenir au grand capital. Il est remplacé par Félix Faure, dont les liens avec les armateurs havrais sont pourtant connus. La « République des affaires », on le voit, n’avait pas dit son dernier mot. Aux élections de 1898, les radicaux perdent des sièges, notamment Clemenceau qui, compromis dans Panama, n’est pas réélu. Les monarchistes s’effondrent et cette perte n’est pas compensée par les députés « ralliés » qui ne sont que 35, leurs chefs Albert de Mun et Jacques Piou n’étant même pas réélus. Quant aux socialistes, ils passent de 20 à 48 sièges avec la poussée des revendications ouvrières.
L’AFFAIRE DREYFUS
La Libre Parole avait mis en cause les députés « chéquards » et « panamistes. » Ce n’était qu’un début car, avec l’affaire Dreyfus qui éclate à l’automne 1894, ces attaques contre le régime et ses représentants vont atteindre leur paroxysme. L’Affaire va remettre l’armée au centre du débat politique. Contrairement à ce qui s’était passé avec Boulanger, dont l’action avait finalement été assez peu suivie dans l’institution, elle va être profondément divisée sur le cas du capitaine et, surtout, beaucoup d’officiers, notamment de haut rang, ne vont pas hésiter à prendre position contre Dreyfus. C’est le plus grand défi que la République eut à affronter. Elle va hésiter, tergiverser, faire preuve de beaucoup de faiblesse, mais, finalement, elle surmontera définitivement cette crise en 1906, huit ans avant la prochaine épreuve, plus redoutable encore, celle de la Grande Guerre. Il était temps !
Nous avons longuement parlé dans un autre ouvrage5 de la manière dont le capitaine Dreyfus avait été condamné pour haute trahison à la déportation à perpétuité sur un dossier secret qui ne lui avait pas été communiqué et, surtout, de l’unanimité qui prévalait alors sur sa culpabilité dans le pays, et plus particulièrement dans l’armée. Le général André, qui commandait l’École polytechnique lorsque l’affaire a éclaté, dira avoir été, « comme tout le monde, un antidreyfusard de la première heure ». Lui, l’officier républicain dès l’Empire, qui avait combattu le boulangisme lorsqu’il commandait l’artillerie de Vincennes, n’a pas eu un instant d’hésitation. La France entière aussi croira à la culpabilité du capitaine. La haute hiérarchie militaire ne faisait évidemment pas exception puisque l’antisémitisme régnait à l’état-major depuis que le général de Miribel avait interdit qu’on y affecte des officiers israélites6. Ce qui frappe d’abord dans l’affaire Dreyfus, c’est la pusillanimité des responsables politiques, incapables de fournir une ligne de conduite claire à l’armée, voire coupables de couvrir ses forfaitures. Lorsque Casimir-Périer, le président de la République, démissionne en janvier 1895, quelques semaines après la condamnation de Dreyfus, sa décision n’est en rien liée à l’Affaire naissante : il regrette simplement que ses pouvoirs soient limités et il est victime de l’opposition systématique des députés de la gauche. Pourtant, il sait que Dreyfus a été condamné par un conseil de guerre au vu d’un dossier secret dont ni l’accusé ni son défenseur n’ont eu connaissance. Que le titulaire de la plus haute charge de l’État ait, tout comme le fera son successeur Félix Faure, couvert une telle forfaiture est invraisemblable. Certes, les présidents de la République ont alors peu de pouvoirs directs mais ils disposaient d’une « magistrature d’influence » qui leur permettait d’imposer une décision ou de peser sur un choix. On se souvient de l’attitude de Jules Grévy face au général Boulanger au moment de l’affaire Schnaebelé, et du rôle de Sadi Carnot dans les nominations au sein de l’armée. Émile Loubet, lui aussi, pèsera directement sur la politique étrangère pendant tout son septennat (1899-1906) en obtenant systématiquement la présence de Delcassé au ministère des Affaires étrangères dans chaque nouveau gouvernement.
Les chefs de l’armée sont, eux, responsables de leur propre entêtement. Passons sur le cas du général Mercier, le ministre de la Guerre qui a déclenché l’affaire, et dont l’acharnement ne cessera pas, même après l’arrêt de la Cour de cassation qui innocentera définitivement Alfred Dreyfus en 1906. Mais les autres responsables de l’armée ? Le général de Boisdeffre, le chef d’état-major, l’homme de l’alliance franco-russe, couvrira toutes les turpitudes de ceux qui avaient commis des faux. Il ne démissionnera que lorsque le commandant Henry, l’auteur du « faux patriotique », sera retrouvé mort dans sa cellule du Mont Valérien (1898). Quant au Général Gonse, le sous-chef d’état-major de l’armée, il antidatera de trois ans une pièce concernant les prétendus « aveux » de Dreyfus, et couvrira de sa signature des faux en écriture à la Section de statistique. Que des militaires de haut rang se livrent à de telles pratiques, hors de la légalité, était bien inquiétant pour la démocratie et pour la République. C’est finalement l’article J’accuse de Zola et la mort du successeur de Casimir-Périer, Félix Faure, dans les bras de sa maîtresse à l’Élysée en février 1899, qui vont faire réagir la classe politique. La République s’est alors trouvée en grand danger et, une fois encore, elle va savoir se défendre grâce à l’habileté et à l’autorité des hommes qui la dirigeaient.
L’ARMÉE, ENFANT CHÉRI DE LA RÉPUBLIQUE
Fort occupé à consolider la République en luttant contre le boulangisme, puis en se sortant sans grand honneur du scandale de Panama qui l’avait éclaboussé, le personnel politique français n’en avait pas pour autant délaissé l’armée. Elle faisait l’objet, depuis 1871, de toute son attention.
Le service militaire obligatoire avait été réduit, nous l’avons vu, de cinq à trois ans en 1889, sur l’initiative de Boulanger. Des dispenses étaient accordées aux soutiens de famille, ce qui était important dans un pays essentiellement agricole. Elles étaient aussi consenties aux étudiants en médecine et en pharmacie. Mais elles vont être étendues, par la loi du 19 juillet 1892, aux « intelligences travaillant à la grandeur du pays ». Il s’agissait de tous les étudiants de l’enseignement supérieur qui ne faisaient ainsi qu’un an de service au lieu de trois, distorsion fort mal ressentie par les autres appelés. À partir de cette loi très inégalitaire, le nombre des étudiants suivant les cours de l’enseignement supérieur va doubler en France. C’est à cette époque que sont créées les Écoles de commerce de Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, que le nombre de docteurs en médecine va passer de 600 à 1 300 par an, et celui des docteurs en droit de 100 à 4507. Les dispenses accordées ainsi aux étudiants étaient fondées sur l’idée qu’un pays « ne doit pas sacrifier à sa défense sa valeur intellectuelle ». La réalité était beaucoup plus prosaïque car alors, seuls les fils de familles fortunées pouvaient suivre les cours de l’enseignement supérieur. La « chasse à la dispense » était, pour les chefs de bonne famille, un sport d’un genre particulier dont le but était uniquement que leurs fils n’effectuent qu’un an de service au lieu de trois. Anatole France avait bien perçu cette quête éperdue des pères au diplôme de l’enseignement supérieur de leurs enfants : ils soutenaient sans vergogne le service de trois ans, mais s’efforçaient par tous les moyens, pour leurs propres fils, d’obtenir une dispense en allant jusqu’à leur faire suivre des cours de malgache ou de tamoul8… Il faut voir là, avec la difficile condition du conscrit, l’origine des menées antimilitaristes qui vont naître à la fin du siècle ; et la responsabilité du pouvoir civil est évidente. Lorsque le général André mettra fin aux dispenses en décidant un service unique de deux ans pour tous et que, suivant les principes élaborés par Lyautey dans son célèbre article de la Revue des Deux Mondes de 1891, il mettra en valeur le « rôle social des officiers », il fera l’objet de très violentes attaques des milieux politiques conservateurs. Mais, n’était-il pas déjà trop tard ?
La politique constante de renforcement de l’armée va bouleverser l’architecture des grandes villes et des villes moyennes. Chaque cité revendiquait hautement la présence d’un régiment dans ses murs, gage de prestige et de développement économique. Les innombrables casernes construites alors, jointes aux nouvelles gares de chemin de fer et aux hôtels de ville, vont donner aux cités un style « Troisième République » encore bien visible aujourd’hui. C’est à cette époque que la vie militaire entre dans chaque famille française, très concernée par la condition de ses fils conscrits. Les chansons des cafés-concerts de la Belle Époque, qui faisaient allusion à l’armée, sont innombrables. Des conseils de révision, qui donnaient alors lieu à des fêtes dans chaque village, aux revues suivies par des foules considérables dans les villes, on voit bien que l’armée est alors constamment présente dans la vie des Français. Quant au prestige de l’officier, il est au zénith. On célèbre surtout son esprit de discipline, comme l’exprimera avec humour Anatole France :
« Par l’ampleur de ses sentiments religieux, la générale avait beaucoup nui à son mari. Mais ils n’y prenaient garde ni l’un ni l’autre. Le général avait aussi des sentiments chrétiens. Ce qui ne l’eût pas empêché de faire arrêter le cardinal-archevêque sur un ordre écrit du ministre de la Guerre.9 »
L’équipement de l’armée va considérablement évoluer avec l’invention du canon à tir rapide. La mise au point du frein qui absorbe le recul et fait revenir la pièce à la même place en conservant son pointage va permettre au canon de 75 de tirer 15 à 20 obus par minute, soit cinq fois plus qu’en 1870. Fabriqué en acier, métal plus résistant, il est muni d’un explosif plus puissant qui augmente l’impact du projectile. Le tir rapide rendra, à la fin du XIXe siècle, le mouvement des troupes beaucoup plus dangereux sur le champ de bataille. La puissance de feu des fantassins est aussi multipliée par cinq. Le soldat portait en moyenne 90 cartouches en 1880 et ce chiffre atteindra 200 en 1914. Les fusils à répétition seront perfectionnés à partir de 1880. La « poudre B », sans fumée ni résidus, inventée par Paul Vieille en 1884, est adoptée sur le fusil Lebel 1886 dès le 1er mai 1887 sur l’initiative du ministre de la Guerre, Boulanger. Ces perfectionnements vont permettre une grande précision de tir jusqu’à quatre kilomètres de distance. Le Lebel sera le fusil français de la Grande Guerre.
1. Paul Bouju et Henri Dubois, La Troisième République, Que sais-je ? Paris, PUF, 1967, p. 28.
2. Jacques Marseille, Les colonies, une bonne affaire ? Histoire, juillet 1984, p. 122-126.
3. Paul Bouju et Henri Dubois, op. cit., p. 35.
4. Anatole France, L’Orme du Mail, Éditions omnibus 2000, p. 37 [Calmann-Lévy, 1897].
5. Le Général André, de l’affaire Dreyfus à l’affaire des fiches, Paris, Éditions Glyphe, 2009.
6. Ibid., p. 332.
7. Chiffres extraits de Général Pédoya, L’armée évolue, Paris, Chapelot et Cie, 1909.
8. Anatole France, M. Bergeret à Paris, Paris, Éditions Omnibus 2000, p. 417-419 [Calmann-Lévy, 1901].
9. Anatole France, L’Orme du Mail, Paris, Éditions omnibus 2000, p. 125 [Calmann-Lévy, 1901].
CHAPITRE IILA RÉPUBLIQUE MILITANTE (1899-1909)
L’AFFAIRE DREYFUS aurait fait succomber beaucoup de régimes. Mais la Troisième République va, finalement, surmonter cette crise majeure. Les institutions, même si elles conduisaient à de très nombreuses crises ministérielles, avaient au moins l’avantage, dans cette période de consolidation du régime, de modifier les majorités « à la marge » à chaque nouveau gouvernement, permettant ainsi de faire avancer la cause de la République. C’est ainsi qu’elle s’imposera, comme subrepticement.
LA DÉFENSE RÉPUBLICAINE MET FIN À L’AFFAIRE
Lorsqu’il apparaît que la République est en grand danger, quand le président Émile Loubet, le successeur de Félix Faure, est conspué à la gare Saint-Lazare, puis frappé à Auteuil en juin 1899 par les nationalistes, ce sont les députés qui vont réagir. Ils adoptent une motion affirmant qu’ils ne donneront leur soutien qu’à un « gouvernement qui saura défendre fermement les institutions républicaines ». Une nouvelle fois, c’est la qualité des responsables politiques qui va compter, avec Waldeck-Rousseau, le président du Conseil choisi par Émile Loubet, et même avec son ministre de la Guerre, le général de Galliffet, le « fusilleur de la Commune. » Galliffet éloigne de leurs postes les généraux qui s’étaient trop compromis dans l’Affaire. Un an après, son successeur, le général André, ne transigera pas non plus avec la discipline, et il relèvera immédiatement de leurs fonctions les deux hauts responsables de l’armée, les généraux Jamont et Delanne.
Pourtant, les choses avaient mal commencé avec le conseil de guerre de Rennes qui rejugeait Dreyfus en septembre 1899. Galliffet, le ministre de la Guerre, avait obtenu du gouvernement que l’accusation, portée par le commandant Carrière, reste libre de ses actes et de ses propos. Or, Carrière va en profiter pour soutenir de nouveau que le bordereau accusateur avait bien été écrit par Dreyfus, alors que la Cour de cassation avait cassé le premier arrêt au motif qu’il était prouvé que son auteur n’était pas Dreyfus mais Estherazy ! L’armée, une fois encore, s’enfonçait dans le mensonge et bafouait sans vergogne une décision de la Cour de cassation, qui s’en souviendra en 1906 lorsqu’elle innocentera définitivement le capitaine.
Fort heureusement, même dans la Grande Muette, il s’est trouvé des esprits responsables et surtout courageux. Picquart d’abord, le chef de la Section de statistique, curieux nom donné alors au contre-espionnage, qui n’hésite pas à mettre sa carrière en jeu en affirmant qu’il ne pouvait emporter dans sa tombe ce terrible secret : l’auteur du bordereau, c’était bien Estherazy et non pas Dreyfus. Il sera, pour cela, radié des cadres de l’armée qu’il ne réintégrera qu’après huit années ! D’autres officiers vont courageusement défendre Dreyfus à Rennes, comme le lieutenant-colonel Mercier-Milon, le général Sébert, qui mettra en pièces les inepties de Bertillon, le chef du Service de l’identité judiciaire à la préfecture de police, enfin le capitaine de Fonds-Lamotte affirmant que le bordereau n’avait pu être écrit par un artilleur, comme l’était Dreyfus. Mais rien n’y faisait et, à Rennes, Dreyfus était de nouveau condamné… avec circonstances atténuantes ! Or, c’était déjà un combat d’arrière-garde, comme l’écrira Léon Blum :
« Mais, quoi qu’il arrivât, quelle que fût la sentence du conseil de guerre – lequel, en fin de compte, devait déchaîner tout le monde contre lui en condamnant avec circonstances atténuantes ! – il n’était pas moins Dreyfus innocent ; il n’était pas moins redevenu le capitaine Dreyfus ! Quoiqu’il arrivât, il ne retournerait plus là-bas dans l’Ile. Il était réhabilité vis-à-vis de la conscience universelle1. »
Émile Loubet, le président de la République, va gracier Dreyfus après cet incompréhensible verdict. Mais le capitaine, de nouveau condamné, même avec circonstances atténuantes, était toujours considéré comme coupable. C’est le général André, ministre de la Guerre de 1900 à 1904, qui imposera la vérité pour Dreyfus. Ce général, si injustement décrié depuis, a alors sauvé l’honneur de l’armée. Au fond, le principal reproche que lui feront ses innombrables détracteurs était d’avoir mis fin à l’Affaire dans l’institution. Après avoir évité pendant trois ans de se « brûler les doigts », comme il le dira, avec le dossier Dreyfus, il va personnellement s’impliquer, en examinant une heure chaque soir les pièces des procès avec l’étonnant capitaine Targe. En trois mois, ils vont découvrir les faux et les falsifications et Louis André dira : « L’armée se grandira en reconnaissant ses erreurs ». Il avait fallu près de neuf années pour adopter cette attitude de bon sens, et toute son autorité avait été nécessaire pour imposer la vérité. Finalement, la Cour de cassation innocentera totalement Alfred Dreyfus le 12 juillet 1906, dans un attendu demeuré célèbre :
« Attendu, en dernière analyse, que de l’accusation contre Dreyfus, rien ne reste debout ».
Le général Mercier, qui avait déclenché toute l’affaire en 1894, considérera que cet arrêt était « illégal ». Il était alors sénateur de la Loire-Inférieure… Mais bien peu le suivront dans cette affirmation forcenée de la culpabilité de Dreyfus. Nous étions alors en 1906. L’affaire des fiches avait contraint le général André à la démission fin 1904, mais la discipline qu’il avait de nouveau imposée, les réformes importantes qu’il avait menées, violemment critiquées de toutes parts, mais sur lesquelles personne, curieusement, ne reviendra, avaient grandement contribué à l’apaisement au sein de l’armée. Il était urgent qu’elle se consacre désormais uniquement au rôle dont elle n’aurait jamais dû sortir : la Défense nationale. La Troisième République, ce régime supposé faible, l’a donc emporté, une nouvelle fois, à l’issue d’une agitation d’une ampleur sans précédent.
LA RÉPUBLIQUE S’IMPOSE
L’Affaire avait donné à la droite une doctrine mise en forme par Maurice Barrès. Le grand écrivain affirmait en effet que, pour rester fidèle à elle-même, la France devait pratiquer le culte de la terre et des morts et, pour lui, ce n’était pas le chemin pris depuis la Révolution en raison des influences juive et protestante. Aussi la République devait-elle se faire autoritaire. C’est l’Action française qui propage cette doctrine à partir de 1899. De là à prôner la monarchie, il n’y avait qu’un pas que franchira Charles Maurras. À gauche, l’Affaire avait soudé les rangs, et la Défense républicaine durera six années, même si elle deviendra le « Bloc des gauches » en 1902. Les socialistes commencent à surmonter leurs divisions, le parti radical et radical socialiste est fondé en 1901, l’« Alliance démocratique » est créée par des modérés (Barthou, Rouvier) désireux de rester au pouvoir en gardant le contact avec la gauche dans l’espoir de maintenir, voire de développer, leurs intérêts.
Le ministère Waldeck-Rousseau (1899-1902) va durer trois ans, longévité exceptionnelle pour l’époque. Il est vrai que la personnalité du président du Conseil, très éloignée de l’emphase, a beaucoup joué. « Il régnait » dira de lui son ministre des Finances, Joseph Caillaux. Mais sa majorité hétéroclite allant des socialistes aux modérés l’oblige à souder ses partisans sur les rares thèmes susceptibles de les fédérer, à défaut de régler sur le fond des questions pourtant essentielles comme la condition ouvrière. C’est la lutte contre les congrégations qui va jouer ce rôle de synthèse. La première application sera la fameuse loi sur les associations du 1er juillet 1901, texte modéré qui laissait cependant place à une interprétation plus restrictive que ne manquera pas de faire le successeur de Waldeck-Rousseau, Émile Combes. Lorsque Combes exige qu’une demande d’autorisation soit présentée par les écoles relevant de congrégations déjà autorisées, trois mille d’entre elles refusent et le président du Conseil décide de les fermer. L’armée est appelée à assurer l’ordre à l’occasion de ces fermetures. Même le très catholique colonel Foch, nommé en juillet 1903 par le général André commandant du 35e régiment d’artillerie à Vannes, doit répondre aux réquisitions du préfet du Morbihan. Les évêques préféraient d’ailleurs avoir devant eux des officiers catholiques plutôt que des anticléricaux et, finalement, les fermetures des congrégations comme, plus tard, les Inventaires se passeront, malgré les incidents, sans trop de difficultés. Ce qu’il faut bien regretter ici, avec l’écrivain militaire Louis Garros, c’est l’intransigeance du gouvernement comme de la hiérarchie catholique :
« Le gouvernement n’aurait pas été insensible à un geste de l’autorité ecclésiastique, un geste non pas de soumission, c’était trop demander, mais un geste de conciliation. Un pape clairvoyant eût, sans hésiter, engagé des négociations. Il ne s’en trouva pas2. »
La séparation de l’Église et de l’État était dès lors inéluctable. Elle sera réalisée par la loi du 9 décembre 1905, sous le gouvernement Rouvier, avec Aristide Briand comme rapporteur d’un texte, fruit de quinze mois de négociations :
« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».
Les Inventaires des biens des paroisses qui devaient être transférés dans les « associations cultuelles » vont être l’occasion d’incidents, quelquefois violents. Rappelons que, contrairement à une légende savamment entretenue, le général André n’était plus ministre de la Guerre au moment des Inventaires. Clemenceau, alors ministre de l’Intérieur, aura beau jeu d’y mettre fin par une circulaire confidentielle adressée aux préfets le 16 mars 1906 après la mort d’un manifestant dans le Nord. Le 20 mars, à la Chambre, il s’exprimait ainsi :
« Nous trouvons que la question de savoir si l’on comptera ou ne comptera pas les chandeliers dans une église ne vaut pas une vie humaine ».
Cette position de fort bon sens était aussi très opportuniste, car Clemenceau avait auparavant poussé à l’anticléricalisme le plus extrême, reprochant même au général André, lorsque ce dernier avait réintégré un général mis en disponibilité pour prosélytisme catholique en 1901, son « manque d’énergie anticléricale3. » Quant à l’arrêt des Inventaires, il n’était décidé que s’ils exigeaient l’emploi de la force publique. Mais, surtout, lorsque Clemenceau l’a annoncé, ils étaient déjà réalisés à 93 %4. La « modération » du Tigre, qui sera célébrée plus tard avec un peu de mauvaise foi par ses partisans, était bien tardive et traduisait déjà dans les faits son évolution inéluctable vers le conservatisme social. Car Clemenceau, devenu très conciliant avec l’Église, sera très brutal envers le mouvement ouvrier et avec les vignerons du Languedoc.





























