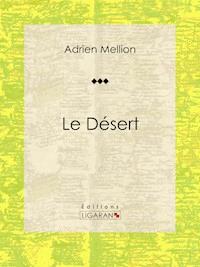
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Avec l'enchevêtrement de ses hautes vallées, avec sa forêt de pics neigeux, avec ses rochers jetés comme au hasard les uns sur les autres, et dont l'entassement prodigieux semble donner créance à la fable des Titans s'élançant à l'assaut du ciel, l'énorme nœud montagneux que forme, au cœur de l'Asie, le croisement de la chaîne himalayenne et de celle de l'Hindou-Kouch, présente au premier abord l'image du chaos."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335054644
©Ligaran 2015
On applique généralement le nom de déserts à de vastes territoires incultes et inhabités. Cette définition présente, entre autres défauts, celui de manquer d’exactitude. Il y a désert et désert. Comme le fait observer très justement M. de Tchihatchef, « tandis que plusieurs des régions désertes aujourd’hui ne l’ont pas toujours été et par conséquent pourraient devenir habitables de nouveau, il en est d’autres où ces conditions ont subi des modifications trop graves pour que l’homme puisse s’y soumettre, en sorte que ces régions sont condamnées à être des solitudes perpétuelles ».
Cette question d’habitabilité crée une différence profonde entre les déserts et les steppes. À vrai dire, les steppes occupent un degré intermédiaire entre les déserts et les régions cultivées. Ce sont d’immenses plaines dont le sol, remarquablement uni, est partout recouvert, à défaut d’arbres, d’une épaisse végétation herbacée, grâce à l’humidité dont il reste plus ou moins longtemps imprégné après les pluies printanières. Telles sont : en Asie, les toundras marécageuses de la Sibérie, les jungles impénétrables du bas Hindoustan, les steppes Kirghizes, et ceux de cette Mongolie si bien nommée « la terre de gazon, tsaoti », par les Chinois ; en Amérique, les prairies du Mississipi, les Ilanos du Vénézuela, le Grand Chaco du Brésil, les pampas de la République Argentine ; en Afrique, les savanes du Transwaal ; en Europe, les maremmes de la Toscane et l’Agro romano, la Campine belge, les sablonneux heiden du Brandebourg, la puzta magyare, immortalisée par les chants de Petœfi ; puis, en Russie, les steppes qui avoisinent le Don, le Dniéper et le Volga. On peut y ajouter, en France, les landes de Gascogne et de Bretagne, si célèbres, les premières par leurs bergers aux longues échasses, les secondes par leurs mystérieux monuments mégalithiques, les causses de la Lozère, les brandes de la Sologne, les tristes Dombes, et enfin la Crau provençale, ce paradis du mouton.
La plupart de ces mers herbeuses forment autant de pâturages naturels qui nourrissent de nombreux troupeaux. Leur stérilité est relative et tout accidentelle. Défrichées, elles sont susceptibles de culture, et quels beaux rendements donnent alors ces terres vierges ! Pour s’en rendre compte, il suffit de songer à ces steppes de la Nouvelle-Russie devenus en si peu de temps le grenier à blé de l’Europe, à ces prairies de l’Union, naguère encore le domaine du trappeur, et qui maintenant exportent leurs céréales sur tous les marchés du monde. En résumé, dans les pays de steppes la nature est loin de se montrer inclémente à l’homme : elle y attire même, sur certains points, des populations très denses, soit en vue de l’élevage du bétail, soit en vue de l’exploitation directe d’une glèbe toujours généreuse.
Tout autres sont les déserts. Ici le pays est non seulement inhabité, mais encore inhabitable. Ici, par suite de l’extrême et constante siccité de l’air ambiant, le sol est mu, presque partout irrévocablement stérile. Ici l’on peut marcher des heures et des jours sans découvrir autour de soi qu’une succession de plaines arides, déroulant à l’infini leurs champs de sables jaunes ou de pierres grisâtres sous un ciel d’une pureté désespérante, sans apercevoir le plus infime ruisselet, le moindre brin de verdure, l’ombre d’un être animé, sans entendre d’autre bruit que les sifflements de la poitrine tenaillée par la soif.
Ainsi considérés, les déserts n’occupent qu’une partie relativement restreinte de notre globe. Ils n’y sont pas d’ailleurs arbitrairement disséminés, et leur situation fournit une nouvelle preuve de cet ordre immuable qui caractérise à tous les degrés l’œuvre du grand architecte de l’Univers. Si l’on jette en effet les yeux sur une mappemonde, on remarque que les déserts forment une zone disposée en arc de cercle dont la convexité est tournée vers le nord-ouest, et qui traverse obliquement tout l’ancien continent, s’étendant presque sans interruption depuis la côte occidentale d’Afrique jusqu’aux montagnes de la Mandchourie. Ajoutons qu’un fragment de cette bande de terres sèches se retrouve dans l’Amérique du Sud, entre les Andes boliviennes et l’océan Pacifique.
La « zone désertique » n’offre pas le même aspect d’un bout à l’autre ; les conditions topographiques, la constitution du sol, la température moyenne, altèrent plus ou moins les traits communs, l’air de famille, pour ainsi dire, des divers pays qu’elle traverse, et leur donnent ainsi à chacun une physionomie spéciale. Telle de ces solitudes n’est qu’une suite de plateaux rocheux, tantôt nus, tantôt semés de pierrailles aiguës et tranchantes ; telle autre, couverte de galets, donne l’illusion d’une grève abandonnée ; telle autre encore, de formation argileuse, s’étend en nappes dures et lisses comme une aire battue par le fléau. Il en est dont les champs de lave trahissent l’origine volcanique ; d’autres, au contraire, où le sable domine, semblent le lit desséché de quelque ancien océan.
Au point de vue géographique, la zone désertique se divise également en plusieurs parties. Elle comprend : en Asie, les déserts de la Mongolie ; les déserts du Touran ou du Turkestan ; les déserts de l’Iran ou de la Perse ; les déserts de l’Arabie et de la Syrie ; en Afrique, les déserts de l’Égypte et le Sahara ; en Amérique, le désert d’Atacama.
§ 1. Topographie du plateau mongol. La « Terre des herbes. ». – Constitution géologique des déserts de la Mongolie. Les déserts de pierre : le Gohi. Les déserts de sable : régions de l’Ala-Chan et du Taklamakan ; les tingéri ; région de l’Ordoss : les Kouzouptchi. Le sel : lac de Dahsounnor. L’ancienne Méditerranée mongole. – § 2. Climat, ses variations. L’eau. Exagération de la chaleur et du froid – § 5. Flore : le dirissou, le soulkhir. Faune : mammifères, oiseaux. – § 4. Ethnographie. Les nomades de la Mongolie. Caractères physiologiques des Kalmouks. Habitation. Vêtements. Régime : le thé en briques. Animaux domestiques : les tinés. Le chameau existe-t-il à l’état sauvage ? – Vie morale des Kalmouks : l’hospitalité, la religion. – Vie intellectuelle : la poésie kalmouke ; les légendes de la « Prairie grise », les djangartchi. – § 5. Traversée du Gobi : La route du thé. Mode de transport.
Comme un voile de fiancée
La nuit tombe au front du désert,
Aux charmes de la nuit notre cœur s’est ouvert
Lorsque brillante aux cieux Vénus s’est élancée
(FÉLICIEN DAVID : Le Désert.)
Avec l’enchevêtrement de ses hautes vallées, avec sa forêt de pics neigeux, avec ses rochers jetés comme au hasard les uns sur les autres, et dont l’entassement prodigieux semble donner créance à la fable des Titans s’élançant à l’assaut du ciel, l’énorme nœud montagneux que forme, au cœur de l’Asie, le croisement de la chaîne himalayenne et de celle de l’Hindou-Kouch, présente au premier abord l’image du chaos.
Mais ce désordre n’est qu’apparent, car, si l’on jette les yeux sur une carte bien nette, telle que celle de Schrader ou de Vivien de Saint-Martin, on voit que la masse de ces hautes terres présente dans sa disposition une grande régularité. Elle est constituée par une série de terrasses qui s’étagent autour d’un plateau central, le Pamir, centre de gravité de tout le système. Le plateau de la Mongolie forme le palier inférieur de ce gigantesque escalier.
Ce plateau s’étend sur un espace de cent vingt millions d’hectares entre la Sibérie au nord, le Thibet au sud, la Chine à l’est. La chaîne des Monts-Célestes et celle de l’Altaï le séparent, à l’occident, du bassin de la mer d’Aral. C’est dans l’ensemble un plan incliné du nord-ouest vers le sud-est. Les nivellements barométriques exécutés par les derniers explorateurs, en 1832 par Füss et Bunge, en 1873 par Fritsche et Elias Ney, en 1875 par Préjvalsky, ont fait connaître que l’altitude moyenne du plateau pouvait être évaluée à 1200 mètres au sud-ouest, à 800 mètres seulement dans la partie orientale, et qu’il était creusé en son centre par une dépression de plus de cent lieues de large.
Il ne présente pas le même caractère d’uniformité dans toute son étendue. Le nord de la Mongolie est un pays habité, le Tsaoti, la « Terre des herbes, steppe verdoyant qui déroule à l’infini le moelleux tapis de ses pâturages. La région centrale et méridionale est au contraire aride et nue. Elle est occupée par le désert de Gobi ou Cha-Mo, qui comprend lui-même les déserts de Taklamakan au sud et de l’Ala-Chan au sud-est.
Bordé de ce dernier côté par le Hoang-Ho, il reparait au-delà sous le nom de plateau de l’Ordoss, vaste quadrilatère de plus de cent mille kilomètres carrés que le fleuve enveloppe de trois côtés et que la grande muraille sépare du Céleste Empire. Autrefois très fertile et très peuplé, l’Ordoss n’est devenu désert que par la faute des hommes : il a été ruiné, stérilisé à tout jamais par les guerres sans trêve ni merci que les Mongols et les Chinois s’y livrèrent au xiiie siècle, guerres terminées, on le sait, par l’écrasante défaite que Gengis-Khan fit subir aux fils du Ciel. C’est maintenant une morne solitude où reposent, dit-on, les restes mortels du conquérant, et qui a reçu des Mongols l’appellation de « prairie grise », par opposition aux verdoyants herbages de la grande vallée qui l’entoure.
La constitution géologique du Gobi n’est pas uniforme non plus : les terrains sédimentaires s’y rencontrent associés aux terrains plutoniques. Toutefois ces derniers prédominent : le corps du plateau est surtout formé de masses de granit, et le sens de « plaine de pierre », qu’exprime le mot Gobi dans la vieille langue mongole, est pleinement justifié.
Les formations granitiques se présentent elles-mêmes sous les aspects les plus divers : tantôt le sol est hérissé de gros blocs très durs, les uns complètement noirs, les autres d’une belle couleur pourpre ; tantôt il est pavé de graviers rougâtres au son métallique, à cassure cristalline, de cailloux quartzeux multicolores, agates, sardoines, carnéoles, cornalines et calcédoines, dont l’assemblage dessine parfois les plus admirables mosaïques. Ailleurs ce sont de nombreux bancs de grès, « qui se succèdent avec une monotonie désespérante aussi loin que la vue peut s’étendre ».
En maint endroit, particulièrement dans les dépressions, la roche primitive disparaît sous un tapis de sable, ou des stratifications argileuses empâtant des îlots de gneiss. Au nord-est, le sable se répand en longues coulées (cha-ho) qui, alternant pendant plusieurs lieues avec les dalles gréyeuses, produisent un singulier effet : on dirait une gigantesque peau de zèbre étalée à la surface du sol.
L’impression est bien différente dans les déserts du sud, dans l’Ala-Chan et le Taklamakan. C’est ici le désert par excellence, la région maudite dont l’implacable nudité arrête instinctivement le voyageur prêt à s’y aventurer. C’est ici le véritable Cha-mo, la « mer de sables » redoutée des Chinois. Ces sables, le plus souvent, s’amoncellent en dunes mouvantes, appelées tingéri et séparées, comme dans nos landes gasconnes, par des lizes assez larges. Elles ne s’élèvent pas généralement à plus de 15 mètres ; mais, dans le Taklamakan, elles vont jusqu’à 180 mètres. Ce sont donc les plus hautes dunes du monde.
Dans l’Ordoss ces collines aréneuses se brisent en mille petits tertres isolés qui, sous le souffle capricieux des vents, s’arrondissent et se groupent en cercles réguliers, semblables de loin, avec leurs jaunes mamelons luisant sous le ciel bleuâtre, à de superbes rivières de topazes. De là le nom de Kouzouptchi, colliers, que les indigènes ont donné à ces formations. Triste pays d’ailleurs où l’on peut marcher deux jours de suite sans rencontrer âme qui vive, sans entendre le moindre bruit, sinon la plainte du vent dans les dunes.
Argileuses ou sablonneuses, les terres basses du Gobi sont toujours imprégnées de sel. On aperçoit, éparpillées dans les fonds, les grandes taches brillantes des croûtes salines et aussi des goutchir, sortes d’efflorescences nitreuses que lèchent avidement les montures assoiffées. La partie la plus déclive du Trans-Ordoss est occupée par le lac salé de Djarataïdabassou. Tout autour, jusqu’à plus de cinquante kilomètres, s’étendent des couches de sel qui atteignent souvent deux mètres d’épaisseur, et dont la surface cristalline est d’une telle pureté que les oiseaux de passage s’y abattent instinctivement, la prenant pour une nappe d’eau. D’autres gisements salifères existent dans l’Ordoss : le plus important est le Dabsoun-nor, vaste dépôt de sel gemme, exploité de temps immémorial par les riverains du Hoang-Ho.
Les diverses particularités topographiques et géologiques du Gobi, son immense excavation médiane, l’étendue qu’occupent les lacs, les strates argileuses, les terrains sablonneux et salins ne permettent de concevoir aucun doute sur l’origine neptunienne de ce désert ou du moins de sa région méridionale. L’Histoire est en cela d’accord avec la Science : les traditions populaires chinoises ne désignent jamais cette région autrement que sous le nom de « Han-haï, mer desséchée ». Les géographes modernes considèrent le Cha-mo comme le fond d’une mer intérieure dont les flots auraient disparu sous l’influence des phénomènes météorologiques qui, au début de la période quaternaire, ont modifié si profondément le climat de l’ancien continent. C’est l’avis d’Élisée Reclus : « Jadis, écrit-il, lorsque les eaux que déversent les parois intérieures du cirque de plateaux étaient beaucoup plus abondantes, une vaste mer à peu près aussi longue que la Méditerranée, de l’ouest à l’est, mais un peu moins large, emplissait toute la partie basse de la cavité asiatique1 ».
Déjà défavorisée au point de vue géologique, la Mongolie méridionale n’est guère mieux partagée sous le rapport de la température. Son climat se montre des plus fantasques et des plus désagréables. On y passe presque sans transition d’un froid polaire à des chaleurs tropicales, et ces variations atmosphériques se succèdent parfois dans l’espace de quelques heures. Ainsi au printemps le thermomètre, qui, à midi, accuse 30 degrés à l’ombre, tombe, le soir venu, à – 12 et même – 18 degrés.
La direction des vents qui parcourent la Mongolie varie suivant les saisons : ils soufflent du sud-est en été, du nord-ouest en hiver. Mais si leur point de départ est diamétralement opposé, en revanche ces deux courants aériens ont un caractère commun : la sécheresse. La pluie est très rare dans ces déserts, surtout dans l’Ordoss ; là on ne rencontre que des lagunes ou des citernes remplies d’une vase puante ; souvent même des journées entières se passent sans qu’on puisse se procurer une seule goutte d’eau.
Dans le Gobi proprement dit, le précieux liquide n’existe que dans les fondrières formées par les pluies d’orages, dans certaines cavités naturelles ouvertes entre deux couches superposées de sable poreux et d’argile imperméable, et dont l’emplacement se reconnaît de loin aux taches sombres de la verdure qui croît sur les bords.
Pour bien comprendre le vrai caractère de la température estivale au désert, il faut en examiner les effets dans la partie la plus déprimée, dans le Gobi central. Prjévalsky l’a traversé vers la mi-juillet et il fait une peinture saisissante des souffrances causées par la chaleur à sa petite caravane : « Dès l’aube, dit-il, à peine le soleil se montrait à l’horizon que l’air devenait brûlant. Pendant la journée nous marchions entre deux fournaises : en haut le soleil, en bas le sol embrasé. Pas un seul nuage ne paraissait au ciel. L’atmosphère était terne et d’une couleur sale. Si, de loin en loin, quelques nuages se déchargeaient, les gouttes de pluie, par suite de l’horrible sécheresse, n’arrivaient même pas jusqu’à terre. » Un moment arriva où la température du sol atteignait 65 degrés centigrades à la surface et 26 degrés à deux pieds de profondeur. L’air est d’ailleurs tellement sec qu’une chaleur de 50 degrés n’excite pas la transpiration.
Cette extrême sécheresse des vents d’été se retrouve dans l’implacable rigueur des vents d’hiver. Ces courants qui, partis des mers polaires, s’abattent sur le Gobi après avoir balayé sur un espace de près de 800 lieues les toundras gelées de la Sibérie, viennent se briser sur les hautes terrasses des montagnes mandchoutes ; ils ne peuvent donc apporter au désert aucune particule aqueuse, aucune trace de vapeur humide. Leurs effluves glacés produisent l’effet d’une lame de rasoir sur la peau des voyageurs, qu’elles fendraient sans pitié si ceux-ci ne prenaient la précaution de se garantir les extrémités avec des fourrures et de se couvrir le visage d’épais masques de feutre. À cette époque de l’année, Prjévalsky a vu la colonne mercurielle du thermomètre centigrade descendre jusqu’à 57 degrés au-dessous du point de congélation !
De l’absence d’eau résulte l’absence de végétation ; la stérilité presque générale du Gobi en est une preuve indéniable. La flore de cet affreux pays se réduit presque partout à quelques fougères exhalant une odeur fétide, à quelques touffes de plantes basses et rampantes, comme l’armoise ou la petite absinthe (tchii), si bien collées à terre que pour les brouter les animaux sont obligés de labourer le sol de leur museau. Parfois aussi, mais de très loin en très loin, un arbuste épineux dresse sa maigre silhouette sur la nudité grise du désert. Certaines espèces végétales sont cependant intéressantes pour le botaniste : on peut citer entre autres ; ledirissou (Lasiagrostis splendens), qui vient dans les fonds argileux, où il forme des buissons de quatre à cinq pieds de haut, aux ramilles dures et cassantes comme du fil de fer ; le zax ou sacsaoul (Haloxylon ammodendron), assez commun dans les localités sablonneuses, notamment dans les dunes de l’Ala-Chan ; le soulkhir (Agriophyllum gobicum), que l’on trouve dans les districts salifères de l’Ordoss et dont les graines fournissent aux nomades un aliment nutritif. Mais la plante caractéristique de l’Ordoss est la réglisse, appelée « tchikir-bouia » par les Mongols. Elle abonde en certaines régions du plateau, et ses racines, fort recherchées en raison de leurs propriétés médicinales, s’expédient en nombreux fagots, par la voie du fleuve Jaune, dans toutes les provinces centrales du Céleste-Empire.
Quant aux arbres, ils sont regardés au Gobi comme de véritables phénomènes. Comment d’ailleurs pourraient-ils prendre racine au milieu de ces pierrailles et de ces sables mobiles ? Comment pourraient-ils se développer dans cet air desséché, résister à ces courants impétueux qui tourbillonnent au ras du sol, déchaussant les touffes les mieux adhérentes, arrachant jusqu’aux moindres herbes qu’ils emportent, qu’ils roulent comme en une valse folle sur le rude plancher des granits ? D’une extrémité à l’autre du désert, de Kalgan à Ourga, c’est-à-dire sur une étendue de plus de mille kilomètres, on compte cinq arbres, pas un de plus : c’est à la station de Boulaü, un vieil aune tordu par la chaleur et, près d’Ourga, quatre misérables ormeaux. Le Mongol vient les contempler au passage, et pieusement il orne leurs rameaux de banderoles ou autres amulettes. Dans la région sud-ouest du Gobi, sur les frontières du Taklamakan, Piattsetsky n’a découvert en dix jours de marche que quelques pieds de peuplier au tronc difforme et évidé. Et le fait est si rare qu’il l’a soigneusement noté comme un des principaux incidents de son voyage.
La vie animale est en corrélation étroite avec la vie végétale. Cela revient à dire que la faune des déserts tartares est presque aussi insignifiante que leur flore. En fait de gros mammifères, on n’y voit que des antilopes, traversant rapidement l’espace à la recherche d’une aiguade ou d’un pâturage problématiques. Ces jolies bêtes appartiennent à la même famille que nos cerfs européens. Elles leur ressemblent par la taille, par l’élégance et la souplesse de leur membrure, par la douceur de leur pelage fauve et ras ; elles s’en distinguent seulement par leurs cornes qui, au lieu d’être osseuses, ramifiées et soumises à des mues périodiques, sont persistantes et légèrement recourbées en arrière.
Deux espèces d’antilopes sont propres au Gobi : la dzeren ou antilope de Mongolie (Antilopa gutturosa) et l’antilope à queue noire (Antilopa kara soulta). Cette dernière, indépendamment du signe physique qui lui a valu sa dénomination, se fait remarquer par son humeur misanthropique et défiante à l’excès. Véritable anachorète de ces déserts, elle recherche instinctivement les endroits les plus sauvages et surtout les régions couvertes de dunes où, grâce à la couleur de sa robe qui se confond avec celle du sable, elle se soustrait plus aisément aux regards du chasseur. Elle y vit presque seule, et n’en sort le plus souvent qu’à la nuit pour se rendre à l’abreuvoir. Parfois alors on la voit de loin apparaître au sommet d’un monticule, semblable avec sa fine silhouette nettement découpée sur le fond d’or pâle du couchant au cerf mystérieux de la légende de saint Hubert.
Les dzerens fréquentent, les mêmes parages que la kara soulta, mais leur naturel est plus sociable. Elles errent ordinairement par troupes d’une douzaine, quelquefois même de plusieurs centaines de tôles. La chair de cette espèce d’antilope est, dit-on, des plus savoureuses et recherchée par les Mongols, qui sont de grands amateurs de venaison. Mais il ne leur est pas souvent donné d’y goûter. Aussi farouche que sa congénère, la dzeren se laisse difficilement aborder par l’homme dont son ouïe et son flair très subtils lui révèlent de fort loin la présence. Reniflant bruyamment les émanations que le vent lui apporte, elle détale, affolée, au moindre signe suspect. Digne rivale de ce coursier-fantôme, de ce « cheval blanc des prairies » qu’évoquent les récits de Fenimore Cooper et de Gustave Aimard, douée en outre d’une admirable force de résistance aux blessures, la dzeren est presque insaisissable et pourrait même, l’un de ses jarrets brisé, défier encore et fatiguer promptement le plus rapide étalon.
Les Nemrods du désert peuvent du reste se rabattre sur du gibier de moindre qualité, mais plus, facile à prendre. Tel est le lièvre nain (Lagomys ogotono), ainsi appelé à cause de sa parenté avec notre lièvre commun dont il a la dentition, et de sa taille minuscule égale à celle d’un rat. Aussi craintifs que leurs sosies européens, ces petits rongeurs se creusent des terriers où ils passent l’hiver, assoupis sur une épaisse litière de foin qu’ils ont amassée pendant l’été. Ils n’en sortent qu’aux premiers jours de printemps : alors on les voit, tantôt avancer avec précaution leur petite tête pâlotte à l’entrée de leur galerie, et fouiller d’un regard anxieux le terrain environnant, tantôt même au lever du soleil se risquer à sortir complètement et venir, la queue et les oreilles frétillantes, « faire leur cour à l’aurore », parmi l’armoise et la rosée, comme les lapins de nos garennes, tout prêts, comme eux aussi, à se couler dans leur trou, dès la moindre alerte.
Leur timidité est assez justifiée. Ils ont, sans compter l’homme, de nombreux ennemis parmi les animaux eux-mêmes : les buses et les corbeaux en font tous les jours un véritable carnage et, malheureusement pour les lagomys, ces minotaures emplumés abondent en Mongolie.
La gent ailée du Gobi ne comprend pas, il est vrai, que des oiseaux de sinistre augure. Il a ses hôtes charmants, dont les gazouillements égayent ses solitudes. Parfois, au matin des beaux jours, à pointe d’aube, une douce cantilène se fait entendre : c’est la baïline qui chante. La baïline est le nom chinois de l’alouette de Mongolie (Melanocorypha mongolica). Aussi mignonne que sa sœur de France, elle la surpasse en talent musical. Dans son gosier tient tout un orchestre aux vibrations cristallines, dont elle use pour imiter la voix de tous les autres oiseaux et pour agrémenter son propre chant de fioritures toujours nouvelles… Et c’est une puissante diversion à la fatigué, un réel apaisement aux angoisses de l’âme que ce concert des alouettes égrenant à la face du soleil levant leur collier de perles mélodieuses dans le grand silence du désert.
Parmi les curiosités ornithologiques de ces plaines tartares, on remarque encore le solitaire (Syrrhaptes paradoxus), sorte de pigeon appelé « boldourou » par les Mongols et « sadji » par les Chinois. Il appartient à la famille des Gangas.
L’aire de dispersion de ces oiseaux s’étend sur toute l’Asie centrale, mais leur patrie, le Gobi, est aussi leur séjour d’élection. Si, en hiver, la froidure et la faim les forcent à s’exiler dans les vallées bien abritées du Transbaïkal, ils n’y restent pas longtemps et la tiède baleine des brises d’avril les ramène aux plaines natales. Ils arrivent vers le milieu du mois, fendant l’air avec une rapidité vertigineuse et produisant avec leurs ailes un soin bruissement qui se perçoit à de longues distances.
Ces messagers du printemps ne se présentent pas sous des dehors bien séduisants. Leur voix est brève et rauque. Leur plumage, généralement d’un gris terne avec des ondes jaunâtres sur la tête, est couvert sur le dos de taches brunes en lunule. La structure bizarre de leurs pattes courtes et ramassées, aux doigts soudés et criblés de verrues, enlève toute grâce à leur démarche.
Les déserts de la Tartarie servent encore de lieu d’étape à plusieurs espèces d’oiseaux nomades, à des échassiers, grues, cigognes, outardes, et surtout à des palmipèdes gîtant particulièrement dans la zone limitrophe de la grande muraille. À la fin de la mauvaise saison on peut voir, sur les lagunes intermittentes de l’Ala-Chan, évoluer de nombreuses escadrilles de sarcelles et de canards sauvages.
Le youen-yang appartient vraisemblablement à cette dernière catégorie d’oiseaux aquatiques. Il les rappelle en effet par sa conformation générale et en diffère seulement par son bec, qui est rond au lieu d’être aplati. Toute classification à part, le youen-yang est, sans contredit, le plus brillant représentant de l’avifaune désertique. Par une heureuse dérogation à la loi qui a imposé aux animaux de ces pays désolés une couleur pâle et terne, en harmonie avec celle du sol, ce palmipède a été gratifié par la nature d’un plumage aux nuances vives et chatoyantes, roux avec un semis de taches blanches sur la tête, noir à la queue, d’un rouge éclatant sur tout le reste du corps. Le youen-yang n’a pas été moins gâté sous le rapport du ramage : sa voix est exempte de ces notes criardes qui écorchent si désagréablement l’oreille dans nos basses-cours : elle a, dit le P. Huc, quelque chose de mélancolique ; ce n’est pas un chant, mais un soupir clair et prolongé comme la plainte d’un homme en souffrance. Les mœurs des youen-yangs offrent une autre particularité non moins étrange : ils ne vivent que par couples, comprenant mâle et femelle, dont la mutuelle affection est à ce point étroite et passionnée qu’ils ne se quittent jamais. Il semblerait vraiment, à les voir ainsi toujours errer ensemble, ensemble voleter dans les airs pu folâtrer à la surface des eaux, que, par une sorte de métempsycose, l’âme fidèle des Philémon et des Baucis ait transmigré dans le corps de ces enfants du désert. Et, comme pour mieux réaliser la touchante fiction inventée par le poète Ovide, tellement profonde est leur tendresse matrimoniale qu’elle survit même à la mort. Si l’un de ces inséparables vient à succomber, son compagnon ne tarde pas à le suivre, consumé par la tristesse et l’ennui.
L’Ordoss nourrit un autre intéressant volatile, gros à peu près comme une perdrix et que les Chinois appellent loung-kio, littéralement « pied-de-dragon ». Celui-ci est franchement laid, et d’ailleurs difficile à classer avec ses formes hybrides qui rappellent à la fois le reptile et l’oiseau. Oiseau, il l’est assurément par son plumage d’un gris cendré piqueté de blanc ; mais ses pattes angulées et garnies de poils longs et rudes se terminent par des pieds griffus de lézard, couverts d’écailles d’une dureté à toute épreuve.
Les serpents abondent dans les parties rocheuses du Gobi : très venimeux pour la plupart, ils sont d’autant plus à craindre que leur peau bigarrée ne permet pas toujours de les distinguer des pierrailles multicolores au milieu desquelles ils se cachent.
Vaste champ d’études ouvert aux physiciens et aux naturalistes, les déserts de la Mongolie n’offrent pas un moins vif intérêt sous le rapport de l’histoire et de l’ethnographie. Ils ont un passé dont le sombre souvenir ne laisse pas d’émouvoir leurs explorateurs européens. Ces hautes plaines furent la patrie des Huns. C’est de là, c’est de ce triste Gobi, d’où les chassaient la faim et la soif du pillage, que s’élancèrent toutes ces hordes sauvages dont l’invasion fit rouler des torrents de feu et de sang à travers les riches campagnes de la Gaule romaine. Plus tard, au xiiie siècle, l’histoire montre les arrière-petits-fils des soldats d’Attila, formant sous le nom de Mongols une grande nation gouvernée par des Khans. Deux de ces derniers sont célèbres par leurs conquêtes en Asie : Temoudgin, dit Gengis-Khan, et Timour-Lang, qui vainquit le sultan Bajazet II à Ancyre, et dont les États démembrés devaient plus tard former dans les Indes l’empire du Grand Mogol.
Véritables descendants des Huns, les Kalmouks ont conservé dans leur conformation générale ce défaut de proportions, dans la physionomie ce cachet de laideur qui distinguait les compagnons du « Fléau de Dieu », au dire des historiens du temps, Jornandès, Procope, Ammien Marcellin, et leur avait fait donner par ce dernier le surnom de « bêtes à deux pieds ». Leur corps trapu, au torse large, à la taille épaisse, s’appuie sur des jambes courtes et tortues. La face, de couleur olivâtre, est aplatie, avec des pommettes saillantes, un nez écrasé, de petits yeux obliques, une grande bouche garnie de lèvres grasses et livides, des oreilles énormes, très écartées de la tête. Leurs cheveux, noirs et plats, sont rudes comme des crins. La barbe se réduit à un soupçon de moustaches. C’est le seul signe extérieur permettant de distinguer ici les hommes des femmes, les deux sexes ayant les mêmes traits et le même costume. Celui-ci se compose du labchik, sorte de houppelande croisant sur la poitrine, avec des manches serrées aux poignets, et d’un large pantalon qui s’enfonce dans des bottes à hautes tiges et sans talons. La coiffure consiste en un bonnet carré garni de peau d’agneau.
La vie du désert a développé à l’excès chez les Kalmouks les sens de la vue, de l’ouïe et de l’odorat. À des distances fabuleuses, ces nomades peuvent très facilement distinguer les moindres objets, percevoir le trot d’un cheval, et sentir la fumée d’un campement.
L’habitation des Kalmouks est la iourte, sorte de tente circulaire haute d’environ 3 mètres, avec un diamètre de 4 à 7 mètres, et dont le sommet s’arrondit en dôme surbaissé. Deux ouvertures y sont pratiquées : l’une, au pourtour, qui tient lieu de porte d’entrée ; l’autre, à la partie supérieure, pour laisser passer la lumière et la fumée. La iourte est construite de façon à pouvoir être aisément transportable : ses parois forment une cage cylindrique dont les barreaux flexibles sont reliés entre eux par des lanières de cuir qui permettent d’agrandir ou de rétrécir à volonté la circonférence, de sorte que cette charpente ressemble beaucoup, toutes proportions gardées, à ce qu’on appelle vulgairement un cache-pot. Quant à la toiture, elle se compose d’une série de perches recourbées, convergeant comme les baleines d’un parapluie vers le sommet de la tente. Le tout est recouvert de plusieurs peaux de mouton ou de chameau, rendues imperméables par le feutrage et solidement amarrées au moyen de cordes et de piquets.
L’intérieur de ces logis ambulants offre un coup d’œil des moins attrayants. C’est un taudis infect, auprès duquel l’humble chaumière en torchis de nos paysans et les plus misérables galetas de nos cités ouvrières pourraient être à bon droit considérés comme des salons. Au centre se trouve le foyer, simple trou creusé en terre où brûle constamment un feu d’argots, de fientes desséchées de chameau dont l’acre fumée remplit la pièce. Le mobilier est digne du cadre. À part une petite armoire carrée, à usage de garde-robe et aussi de reliquaire pour les mille fétiches de la religion bouddhique, il ne comporte que des objets de première nécessité. Et dans quel beau désordre ils s’étalent ! Les harnais, suspendus au treillis, y coudoient les viandes desséchées ; sur le sol gisent, éparpillés un peu partout, les ustensiles de ménage : gobelets et écuelles de bois, chaudrons et marmites de cuir. Au milieu de ce fouillis grouille, pêle-mêle avec de jeunes animaux, toute une marmaille crasseuse et déguenillée. Les peaux huileuses, les feutres mouillés, la vaisselle toujours grasse, les substances animales en décomposition, cet entassement de bêtes et de gens dans un étroit espace, tout cela dégage une odeur nauséabonde qui achève de rendre irrespirable l’atmosphère déjà viciée par la fumée.
Cette ignorance des plus élémentaires notions d’hygiène et de propreté est la caractéristique des Kalmouks : elle se retrouve dans leurs préparations culinaires et leur manière de manger.
Leur nourriture n’est pas très compliquée : elle se compose presque invariablement de bouillie d’orge, détrempée dans du lait de chamelle. Parfois cependant, à l’occasion de quelque heureux évènement ou de l’arrivée d’un hôte, ils y ajoutent un quartier de mouton ou de chameau préalablement désossé et cuit, avec des pierres rougies au feu, dans la peau même de l’animal. La friandise, ce produit d’une civilisation raffinée, ce mignon péché qui trouve son excuse et son absolution dans les irrésistibles amorces de la gastronomie, les nomades du Gobi ne la connaissent pas. Leur alimentation frugale ne les empêche pas cependant d’être gourmands et leur gourmandise dégénère plus souvent que de raison en véritable gloutonnerie. Certains consomment jusqu’à dix livres de viande en une seule journée, ils mangent avec leurs doigts, et ne se font aucun scrupule de lécher bestialement le fond des assiettes et des plats dont ils viennent de se servir. Ces ustensiles ne sont jamais autrement nettoyés !
Leur boisson habituelle est le thé. Ils en abusent, comme les Allemands de la bière. Trente, quarante tasses par jour ne sont rien pour eux.
Le thé des Kalmouks n’est plus cette foliole souple et perlée, chère aux Chinois comme aux Européens, réveillant chez les uns le souvenir troublant des visions entrevues dans la brume opiacée des « tea-gardens », déroulant aux yeux des autres la rose théorie des bonheurs intimes et des joies bénies du home familial, causeries abandonnées au coin du feu, cordiales réunions de parents et d’amis avec les enfants endormis effleurant de leurs boucles blondes la tête blanche des aïeules. Le thé des Kalmouks est une liqueur prosaïque et barbare. C’est le thé en briques. Il se compose des menues branches et des feuilles les plus grossières de l’arbre à thé, préalablement humectées avec du sang de mouton, puis pressées dans des moules d’où elles sortent taillées en une sorte de gâteau lourd et compact comme un pavé de pain d’épice, comme une brique. De là son nom. On le prépare en le faisant bouillir, avec de la graisse et quelques pincées de nitre.
La malpropreté n’est pas le seul défaut des Mongols et particulièrement des Kalmouks. Ils sont aussi paresseux que sales ; les hommes du moins. Leur fainéantise est telle que, pour franchir une distance de cent pas, ils enfourchent leur cheval toujours sellé à la porte de la iourte.
Il est bon d’ajouter à leur décharge qu’ils ont la passion du cheval. Ce sont de véritables Centaures dont les prouesses hippiques émerveillent tous les voyageurs. Les chevaux mongols se distinguent par leur petite taille, leurs membres nerveux et leur longue crinière. Leur robe est en général de couleur fauve, avec une raie brune sur le dos ; les crins sont d’un noir de jais. Ils rendent d’inappréciables services à leurs maîtres dans ces déserts pierreux de la Mongolie : ils ne bronchent jamais et peuvent faire aisément vingt-cinq lieues par jour sans autre nourriture qu’un peu de foin et de millet.
Un autre animal domestique, non moins utile aux peuplades du Gobi, c’est le chameau. On sait que les naturalistes reconnaissent deux espèces de chameaux : le chameau à une seule bosse ou dromadaire, qui ne se trouve qu’en Afrique et en Arabie, et le chameau à deux bosses, chameau proprement dit, ou chameau de la Bactriane, qui est spécial à l’Asie centrale et orientale.
Ce dernier diffère à première vue de son congénère africain par deux protubérances graisseuses placées l’une au niveau du garrot, l’autre au niveau du sacrum. Ses formes sont en outre plus trapues, son pelage brun-roussâtre est épais et rude, surtout aux épaules, autour des bosses et sur la tête. C’est le seul chameau connu des Mongols, qui l’appellent tiné.
Nous n’insisterons pas ici, nous réservant de le faire plus loin avec tous les développements que le sujet comporte, sur les qualités d’endurance et de sobriété qui donnent au chameau son importance locale. Bornons-nous à dire que le tiné en particulier peut faire une dizaine de lieues d’une seule traite avec une charge de sept à huit cents livres, et rester quinze jours, et même un mois sans manger.
Les chameaux constituent la principale richesse des Kalmouks ; aussi s’en inquiètent-ils plus que de leur propre famille. Quand deux Kalmouks se rencontrent, ils ne manquent jamais, après s’être salués du traditionnel « mendou se beïna, bonjour », de s’informer de la santé de leurs tinés. Cet animal leur procure une infinité de ressources : vivant, non seulement il porte la iourte, mais encore nourrit la famille de son lait. Sa fiente desséchée constitue un excellent combustible ; ses poils servent à fabriquer des étoffes pour les vêtements et les tentes. Mort, il a encore sa valeur : sa chair est saine et agréable, sa peau fournit un cuir épais, propre à la confection des chaussures, des harnais et des vases de cuisine.
Le tempérament du tiné est approprié au rude climat hivernal du Gobi. Loin d’aimer la chaleur, le tiné « fait ses délices de marcher contre le vent du nord, ou de se tenir immobile sur le sommet d’une colline pour être battu par la tempête et en respirer le souffle glacial ».
L’étude des faits biologiques relatifs à la race caméline a soulevé parmi les zoologistes un problème intéressant : le chameau existe-t-il à l’état sauvage ? Les opinions sont contradictoires. Au xviie siècle, le géographe turc Hadji-Chalfa parle déjà de chasse aux chameaux sauvages dans le nord-ouest de la Mongolie. D’autre part, le naturaliste Schott rapporte, d’après l’historien chinois Mad-Chi, qu’on en trouve à l’est du fleuve Jaune. Humboldt rappelle aussi que les Hioug-Nou de l’Asie orientale sont un des peuples qui ont donné l’exemple d’apprivoiser les chameaux sauvages. Enfin Prjévalsky, confirmant tous ces témoignages par l’observation des faits, déclare avoir vu des chameaux errant en toute liberté dans le sud du Gobi, aux environs du lac Lob-nor.
Toutefois notre immortel Cuvier, sans nier que le chameau puisse, comme le cheval et l’âne, vivre à l’état sauvage, prétend que l’espèce est aujourd’hui disparue. Ceux de ces animaux que l’on rencontre en certains parages de la Mongolie sont, d’après lui, « des chameaux redevenus sauvages, après avoir été volontairement relâchés par les Kalmouks et autres adhérents de Bouddha, jaloux de se créer des mérites par leurs bonnes œuvres ».
Cette opinion ne manque pas de vraisemblance. Les Mongols sont en effet les fidèles observateurs de cette belle morale bouddhique où se retrouvent, à un degré de perfection plus sublime encore peut-être, ces principes de fraternité universelle, de charité agissante et de renoncement à soi-même qui forment l’essence de la doctrine évangélique. Ce sont les fervents adeptes de ce Cakyâ-Mouni dont la tendre sollicitude, comme celle du grand ascète chrétien, « le séraphique » François d’Assise, s’étendait à toutes les créatures sans exception et jusqu’aux plus infimes animalcules.





























