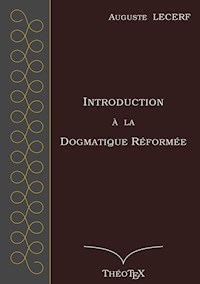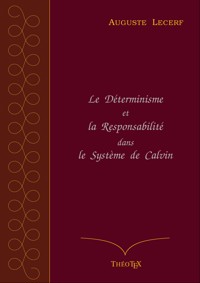
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Dieu a-t-il tout déterminé à l'avance ? Oui, répond Auguste Lecerf, traduisant la pensée de Calvin, le déterminisme divin est absolu, rien n'arrive que Dieu ne l'ait voulu. Mais dans ce cas, que devient la responsabilité humaine ? Elle reste entière, car la responsabilité de l'homme est indissociable du fait qu'il est un être volontaire. Ce petit livre de Lecerf, en réalité la thèse qu'il avait écrite à vingt-trois ans pour sa licence en théologie, éclaire merveilleusement la psychologie du grand réformateur français, et dissipe plusieurs préjugés assez communs, généralement entretenus à charge contre le calvinisme. Le déterminisme divin qu'il y défend apparaît bien différent du fatum des Stoïciens ou de la mathématique de Laplace ; écrit sans jargon philosophique insupportable, il constituera un puissant stimulant pour tous les chrétiens qui aiment réfléchir. Cette numérisation ThéoTeX reproduit le texte de 1895.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce fichier au format EPUB, ou livre numérique, est édité par BoD (Books on Demand) — ISBN : 9782322485475
Auteur Auguste Lecerf. Les textes du domaine public contenus ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusivité.Les notes, préfaces, descriptions, traductions éventuellement rajoutées restent sous la responsabilité de ThéoTEX, et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation.ThéoTEX
site internet : theotex.orgcourriel : [email protected]Auguste Lecerf (1872-1943) est le meilleur interprète français de la pensée de Calvin. Il a peu écrit, mais quelques pages de lui suffisent à se rendre compte de la supériorité évidente qu'il manifeste, aussi bien dans la connaissance des moindres œuvres du réformateur, que dans la compréhension de sa psychologie. Cette quasi-identification avec Calvin s'explique par la biographie religieuse de Lecerf.
Né à Londres dans un milieu familial athée et attaché aux idées de la Commune, tout jeune il était entré un jour par curiosité dans une église, durant un culte. Lorsque le pasteur termina par une invitation à donner sa vie à Jésus-Christ, il s'était senti appelé. Il se mit alors à lire le Nouveau Testament, et se convertit, touché par les chapitres 9 à 11 de l'épître aux Romains.
La famille déménage ensuite à Paris, d'où son père avait été exilé par la répression de la Commune. Se promenant sur les bords de la Seine, il achète à un bouquiniste un exemplaire de l'Institution Chrétienne. En jaillit pour lui une révélation spirituelle qui scelle sa vocation religieuse et ses convictions calvinistes. A dix-sept ans il entre à la Faculté de Théologie Protestante de Paris, boulevard Arago, alors dirigée par Auguste Sabatier. A vingt-trois ans, il présente sa thèse de bachelier en théologie (diplôme dont le niveau correspondrait à une licence ou à une maîtrise aujourd'hui) :
En réalité la Faculté de Paris était de tendance libérale (puisqu'elle avait été fondée en réaction à la Faculté de Montauban, de tendance évangélique) ; c-à-d que la majorité de ses professeurs, et son directeur en particulier, ne pouvaient plus prendre au sens propre les dogmes scripturaires qui avaient si vivement déterminé la foi du jeune calviniste. Dans les trente ans qui suivent, Auguste Lecerf exerce un ministère pastoral, en Normandie et en Lorraine ; il est aumônier militaire pendant la première guerre mondiale.
Cependant les dons intellectuels de Lecerf, en particulier linguistiques, étaient si patents que la Faculté l'invita à venir enseigner le grec à temps partiel, et un cours libre sur le calvinisme. A soixante-quatre ans, sans parcours académique extraordinaire, mais sur la seule base de son talent, Lecerf finit par être nommé Professeur de Dogmatique à la Faculté : Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, Il dispose favorablement à son égard même ses collègues, pourrait-on ajouter.
Le vœu le plus cher de Lecerf aurait été un retour de la foi réformée au calvinisme de … Calvin, qui pour lui se confond avec le paulinisme de l'Ecriture. L'Histoire ne l'a que maigrement exaucé, avec la naissance du mouvement dit néo-calviniste. Le nom d'Auguste Lecerf tinte aujourd'hui plus comme la clochette d'un certain snobisme protestant, qu'il ne retentit comme un gong solennel invitant à sonder sérieusement la théologie du salut. Chacun y va de sa petite citation d'Auguste Lecerf, histoire de montrer qu'on a de l'instruction, personne ne veut s'aventurer à discuter la seule chose qui compte pour lui, à savoir le déterminisme absolu de Dieu dans nos vies. On comprend pourquoi : le snobisme se satisfait du signe, mais se lancer dans l'arène demande conviction et courage, c'est s'exposer à la critique.
Les pages qui suivent traitent précisément cette question du déterminisme divin. Le don de Lecerf est d'y rendre la pensée de Calvin limpide. En les lisant le lecteur comprendra que la plupart des objections faites au calvinisme proviennent de ce que l'on en avait pas réellement saisi la théorie. Ainsi de l'argument récurrent, que si Dieu a tout prévu, l'homme ne peut être tenu responsable de rien. Lecerf répond, via Calvin, que l'homme est essentiellement responsable de sa volonté mauvaise, indépendamment de ce que Dieu a souverainement décidé. La reponsabilité ne gît pas pour Calvin dans ce qui arrive, mais uniquement dans la volonté, du fait même qu'elle est volonté. Il n'établit pas la preuve de la culpabiblité de l'homme par un raisonnement métaphysique, mais par une constatation expérimentale : l'homme se sent et se sait coupable.
Lecerf réussit à convaincre que le système de Calvin du déterminisme absolu est cohérent. S'en suit-il qu'il soit nécessairement vrai ? Il s'agit là d'une question philosophique et non spirituelle, dans le sens où sa solution n'a pas d'impact sur la foi chrétienne. Or tous ne possèdent pas une égale aptitude au raisonnement spéculatif, et il est regrettable que ceux qui en sont le plus dépourvus, veulent souvent à toute force faire valoir leur point de vue, parce qu'ils croient avoir affaire à une question spirituelle, de laquelle dépendrait la qualité de leur relation à Dieu.
Nous ne connaissons guère que Frédéric Godet qui ait su énoncer clairement une alternative au déterminisme de Calvin. Elle en diffère sur deux points essentiels :
Osons risquer un anachronisme inspiré de la physique moderne. Calvin, comme Einstein, est un partisan des variables cachées : si l'on ne sait pas prévoir pourquoi telle chose arrive, c'est parce qu'il existe des causes cachées, en Dieu. Pour Godet, comme pour Bohr, certaines choses sont imprévisibles par nature, parce que Dieu leur a accordé un indéterminisme foncier. Dans les deux systèmes toutefois, Dieu arrive à ses fins, car Il est tout-sage et tout-puissant ; la liberté partielle des atomes et des individus n'empêche pas le résultat global, par Lui voulu dès le départ.
Les attributs généraux de Dieu étant spontanément admis par tout vrai chrétien, on conçoit que l'interprétation intellectuelle de la manière dont Dieu gouverne le monde, n'engendre pas de différences de comportement sensibles. Ce qui fait qu'en pratique, l'arminien peut très bien vivre en se reposant sur la souveraineté de Dieu et le calviniste en étant taraudé par le sentiment d'urgence du devoir à accomplir. Lecerf répondrait sans doute qu'un arminien insouciant lui semble notoirement plus inconséquent qu'un calviniste anxieux. S'il avait raison, avouons que ce ne serait-là, somme toute, qu'un mince avantage.
« Il est, dit M. Naville dans son livre si remarquable sur le libre arbitre, il est une manière bien simple et absolument concluante de mettre en évidence le lien des deux idées de la responsabilité et de la liberté, c'est de montrer que ceux qui nient la valeur de la seconde sont inévitablement conduits, pour peu qu'ils aient de la logique dans l'esprit, à nier celle de la premièrea. »
Le but de ce travail est de montrer comment Calvin a privé les partisans du libre arbitre du droit d'user de ce genre de démonstration ; il suffira pour cela d'exposer la théorie par laquelle ce grand docteur, à qui nul ne contestera la puissance de la pensée et la rigueur inflexible du raisonnement, a su maintenir solidement les notions de devoir et de responsabilité, dans un système où il ne laisse aucune place à la contingence et où tout est rigoureusement déterminé par la volonté de Dieu « qui est, dit-il, la nécessité de toutes chosesb ».
Si nous nous sommes attaché à la personne de Calvin, c'est qu'il nous a paru que c'était celui des réformateurs à qui la question des rapports entre le serf arbitre et la prédestination d'une part, et entre le devoir et la responsabilité de l'autre, s'était posée le plus nettement, et que lui seul avait apporté à ce problème une solution nette, cohérente et capable de donner satisfaction aux légitimes exigences de la pensée et de la conscience. Pour Zwingle, peut-être, en tous cas pour Luther dans son De servo arbitrio, et pour Mélanchton, même après sa chute dans le synergisme, il semble que la responsabilité, qu'ils admettaient pourtant, soit toujours demeurée quelque chose d'extérieur et de surnaturel, un mystère incompréhensible pour la conscience humaine.
Luther affirme bien qu'il y a un lien nécessaire entre les décisions bonnes ou mauvaises d'une volonté, même immuablement déterminée, et la récompense ou la peine ; mais ce rapport n'a rien de véritablement moral, car le Réformateur allemand en exclut toute idée de mérite (dignitas). Pour lui la récompense et la peine sont purement et simplement une conséquence (sequela) naturelle et inévitable du péché, comme l'asphyxie est une conséquence de l'immersion prolongée dans l'eau (naturaliter sequitur)c.
Luther, emporté par les excès de la logique formelle, considère la damnation comme aussi gratuite que le salut ; aussi les réprouvés ne méritent-ils pas plus l'enfer que les élus le ciel. Cela lui paraît, à bon droit, incompréhensible même à la lumière de l'Evangile « in lumine gratiæ est insolibile, quomodo Deus damnet eum, qui non potest ullis suis viribus aliud facere, quam peccare et reus esse ; hic tam lumen naturæ, quam lumen gratiæ dictant, culpam esse non miseri hominis, sed iniqui Dei, nec enim aliud judicare possunt de Deo, qui hominem impium gratis sine meritis coronat, et alium non coronat, sed damnat, forte minus velsaltem non magis impium. » De servo arbitrio (p. 366).
Mélanchton, au moment même où il maintient que le péché n'a pas besoin d'être volontaire pour attirer sur nous la colère de Dieu, reconnaît que cela est incompréhensible, « ratio non cernit hanc infirmitatem esse rem damnatam, et philosophia nihil judicat esse vitiosum quod non est in potestate nostrad. » Dans les dernières éditions de ses Loci, il nous paraît tomber dans les plus étranges contradictions, tantôt il semble admettre que la nécessité exclut toute responsabilitée, tantôt il reprend son ancienne thèse, et maintient contre saint Augustin que le péché pour être repréhensible n'a pas besoin d'être volontaire. Il prend les scrupules, pourtant assez naturels, de la raison au sujet du péché originel pour des préoccupations de jurisconsulte, et se borne, pour justifier son affirmation, à dire que la maxime d'après laquelle le péché n'est péché que s'il est volontaire, n'est vraie qu'au point de vue légal : « satis est igitur hoc respondere sententiam illam loqui de forensi judiciof. »
Pour Calvin la responsabilité n'est pas seulement le résultat d'une décision surnaturelle de Dieu, en vertu de laquelle le châtiment suivrait nécessairement le péché ; c'est encore une évidence immédiate, un fait d'expérience interne, que la conscience humaine interrogée sincèrement ratifie et confirme.
L'effort constant qu'on remarque chez Calvin, pour se placer à un point de vue vraiment moral, justifiera, croyons-nous, la préférence que nous lui avons donnée sur les autres réformateurs, bien qu'il leur soit postérieur de plusieurs années et qu'il ait pu subir, dans une mesure plus ou moins grande, l'influence de tel ou tel d'entre eux.
Tous les éléments principaux de sa théorie du devoir et de la responsabilité se trouvent déjà exposés dans la première édition de son Institution Chrétienne et il la reproduit sans altération dans les éditions subséquentes. Mais c'est surtout sous l'impulsion des attaques d'aversaires habiles, qu'il a eu l'occasion d'exposer ses vues dans toute leur ampleur. En 1542, le Hollandais Albert Pighius publia un ouvrage en dix livres intitulé : « De libero arbitrio et gratia divina » qu'il dédia à Sadolet et dirigea surtout contre Calving. Celui-ci le jugea digne d'une réfutation en règle ; il répondit la même année aux six premiers livres par son traité intitulé : « Defensio sanæ et orthodoxæ doctrinæ de servitute et liberatione humani arbitrii, etc. » qu'il dédia à Mélanchton.
Absorbé par de nombreuses affaires, il ne put achever la réfutation des quatre derniers livres que dix ans après, dans son traité « De æterna Dei pædestinatione ». Il eut encore à revenir sur la question à propos du procès de Bolsec, et dans sa Congrégation sur l'élection éternelle, etc., il donne une exposition populaire et extrêmement lucide, quoiqu'un peu écourtée, de sa doctrine ; enfin en 1557 il publia une « Brevis responsio Johannis Calvini ad diluendas nebulonis cujusdam calumnias » et en 1558, il fit paraître le factum même de son adversaire inconnu avec une réfutationh. Ce qui rend ce dernier traité particulièrement intéressant, c'est que l'adversaire, bien qu'il manque parfois de droiture, est véritablement digne de Calvin par l'habileté et la vigueur qu'il déploie pour montrer l'absurdité et l'immoralité de la thèse du réformateur. C'est, peut-être, ce qu'on peut écrire de plus fort contre la prédestination.
Ajoutons que Calvin se montre à la hauteur de la situation et que son génie puissant fait éclater les mailles serrées de l'argumentation, parfois tortueuse, toujours prévenue et passionnée de son antagoniste.
D'ailleurs Calvin a eu souvent l'occasion de traiter plus ou moins incidemment la question dans ses autres écrits théologiques et surtout dans ses Commentaires sur le Nouveau Testament ; mais partout nous avons retrouvé la même doctrine défendue par les mêmes arguments. Fruit d'une expérience morale immédiate, sa conviction s'est trouvée formée du premier coup et il n'a jamais varié. On peut dire avec un de ceux qui ont le plus vécu dans son intimité qu'il est mort « sans avoir jamais rien changé, diminué, ni ajouté à la doctrine qu'il a annoncée dès le premier jour de son ministère, avec telle force de l'Esprit de Dieu, que jamais méchant ne le put ouïr sans troubles, ni homme de bien sans l'aimer et honoreri ».
Notre travail se divisera en deux parties principales.
Dans la première, nous donnerons une rapide exposition de la doctrine de Calvin sur le libre arbitre, la prédestination et la providence.
Dans la seconde, nous ferons connaître les arguments par lesquels Calvin défendait son système contre les objections les plus sérieuses qu'on élevait et qu'on élève encore au nom de la morale, et nous conclurons en appréciant d'une façon générale ce qui fait à nos yeux la supériorité de la solution calviniste du problème de la responsabilité, solution dont, nous en sommes persuadé, la valeur sera suffisamment établie par l'argumentation de Calvin lui-même, derrière lequel nous nous effacerons pour ne pas affaiblir la puissante apologie qu'il a su présenter d'une doctrine, dont les conséquences ont été si souvent méconnues.
Certes nous n'avons pas le mérite d'avoir découvert les préoccupations morales du Réformateur français ni la valeur des réponses qu'il a données.
Nous avons trouvé dans le cours de dogmatique, professé à la faculté de Paris par M. le professeur Sabatier, les plus précieuses indications à ce sujet.
Le livre si profond et si solide du grand théologien américain J. Edwardsj donne du calvinisme une puissante confirmation théorique, qui nous a beaucoup aidé à saisir le sens et la portée des arguments de celui dont nous avons essayé d'exposer la pensée.
Se plaçant à un point de vue presqu'exclusivement rationnel, Edwards s'appuie sur la logique formelle pour montrer les impossibilités rationnelles du libre arbitre. Il pressent dans leurs grandes lignes et combat à l'avance les transformations que cette notion subira sous l'influence de penseurs infiniment plus sérieux que ceux qu'il avait devant lui, et il a montré les difficultés que le libre arbitre soulevait en morale.
On trouvera plus d'une fois dans ces pages l'écho de ses observations pénétrantes.
Il ne sera pas difficile d'y reconnaître, en outre, le souvenir d'arguments déjà donnés par M. Lévy-Bruhl et par M. Fouillée ; nous avons fait pour les parties théoriques, d'ailleurs peu étendues dans ce travail essentiellement historique, un usage trop fréquent de tous ces auteurs pour songer à les citer chaque fois.
Comme tout semble avoir été dit contre le libre arbitre, nous espérons qu'on nous excusera de n'avoir apporté aucun argument original.
Si ceux qui se trouvent dans cet essai n'ont pas trop perdu de leur force, en passant par notre plume, nous nous estimerons amplement satisfait.
La doctrine du serf arbitre et de la prédestination absolue a été la thèse commune de tous les grands réformateurs du xvie siècle, qui remontaient ainsi à saint Augustin et à saint Paul, en suivant la trace lumineuse des Jean Huss, des Wiclef, des Abélard et des Gotschalk, pour protester contre la doctrine du libre arbitre et pour délivrer l'Église du vieux levain du pélagianisme catholique. Luther, et Mélanchton dans la première partie de sa vie, se rencontrent sur ce point avec Zwingle et Calvin. Toutefois leur accord n'est pas si complet qu'on ne puisse signaler des différences de détail, parfois assez importantes, et qui tiennent peut-être autant à la diversité des méthodes qu'ils ont suivies, qu'à l'influence de prémisses dogmatiques contraires.
Zwingle, Luther, Mélanchton suivent une méthode ou l'a priori, la déduction et le syllogisme tiennent une place encore considérable. Zwingle déduisait le déterminisme universel de sa notion de Dieuk.
En 1521, Mélanchton, lui aussi, concluait de la prédestination à la négation du libre arbitre. « Quandoquidem omnia quæ eveniunt necessario juxta divinam prædestinationem eveniunt, nulla est voluntatis nostræ libertasl.
Luther se fondait pour nier le libre arbitre sur sa notion de la toute puissance divine (providence) et sur la prescience, que ses adversaires eux-mêmes admettaient : « hæc inquam omnipotentia et præscientia Dei funditus abolent dogma liberi arbitriim. »
Cela n'implique pas d'ailleurs que les réformateurs allemands n'aient obéi qu'à des préoccupations purement philosophiques, ni même que l'expérience religieuse, pour Luther au moins, ne soit la cause principale de leurs thèses dogmatiques sur le libre arbitre. Mélanchton fait une place intéressante à l'analyse psychologique dans la première édition de ses Loci, et ce n'est certes pas un vain souci de spéculations métaphysiques, qui a inspiré au fondateur du protestantisme, à cet illustre apôtre du Christ comme l'appelait Calvin, ces paroles vibrantes : « Admonitos velim liberi arbitrii tutores ut sciant sese esse abnegatores Christi dum asserunt liberum arbitriumn