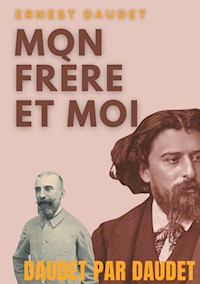Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le 13 avril 1840, à la suite du duc d'Orléans, son frère, le duc d'Aumale débarquait à Alger. Alger ! nom magique pour lui, terre promise si souvent entrevue, théâtre grandiose où, dans une chevaleresque épopée, allait fleurir sa jeune gloire. Là, il fera sa moisson de lauriers en révélant les brillantes qualités doit sa jeunesse relève l'éclat et qui lui vaudront l'admiration de tous les hommes de guerre de son temps !"
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
E. Plon, Nourrit & Cie Édit.
Sans tenir la première place dans les évènements qui ont marqué les temps où il a vécu, le duc d’Aumale en a occupé une considérable. Il la devait non seulement à sa naissance, mais encore à cette impression, qu’il donna sans cesse à ceux qui l’approchaient, que s’il lui eût été permis d’exercer quelque influence sur ces évènements, peut-être en eût-il changé le cours et les eût-il fait aboutir à d’heureuses issues. Parfois, quand on l’écoutait, il semblait dater d’un autre âge et appartenir à ces époques où les âmes françaises apparaissent plus hautes, plus fières, plus ardentes que de nos jours. Cependant tel que nous l’avons connu, avec son vibrant patriotisme, son libéralisme de pensée et d’action, l’universalité de ses connaissances, sa vivacité intellectuelle, sa bravoure militaire, ses goûts de grand seigneur et d’artiste, il était certes le plus moderne des princes, – une sorte de trait d’union entre le présent et le passé.
Comme pour grandir sa physionomie et la rendre digne de figurer au premier rang dans l’histoire, le destin mit sur sa route, en une suite d’évènements privés ou publics, tout cequi contribue à créer les légendes : la gloire précoce, les deuils cruels, l’exil amer, les rigueurs imméritées, celles du sort et celles des hommes. Il porta en chrétien, en prince, en Français, le faisceau de ses trop rares joies et le fardeau de ses trop nombreuses tribulations. Une fois rentré dans son pays, il parlait sans amertume de ceux qui, par deux fois, l’avaient proscrit, comme si, en touchant le sol natal, il s’était trouvé subitement consolé, guéri, et avait pardonné aux proscripteurs. À la fin de sa vie surtout, tout en lui témoignait de cette généreuse clémence, et, de même aussi, ses paroles, ses actes trahissaient l’immense joie qu’il ressentait à vivre dans sa patrie et à fouler de ses pieds « la poussière de France ».
Cependant, comme s’il n’eût pas épuisé toutes les douleurs du prince, du patriote, du fils, de l’époux, du père, du soldat, la destinée lui en réservait une autre dont, heureusement, il n’eut pas le temps de souffrir : celle d’expirer loin de cette patrie bien-aimée à laquelle, dès qu’il put sentir et comprendre, il avait donné tout son esprit et tout son cœur.
Ainsi tout a contribué, – ses origines, sa valeur personnelle, les circonstances de sa vie, – à lui créer un piédestal, d’où, vivant, il ne descendit jamais une fois qu’il y fut hissé et où, mort, il semblera de plus en plus grandi. On a pu déjà prévoir ces choses au moment de son trépas, dans les regrets et dans les hommages prodigués autour de son cercueil. L’histoire leur donnera plus de précision, un relief plus accusé. Peu d’hommes, depuis cinquante ans, ont été autant que le duc d’Aumale, un « personnage historique ».
Le premier souvenir que j’ai gardé de lui remonte à l’époque de sa rentrée en France, en 1871. Depuis, je le revis souvent, et j’ai toujours vécu parmi quelques-uns de ses amis les plus intimes et les plus chers. Historien, familiarisé par des études antérieures avec les grands épisodes où figurèrent ses parents, l’idée devait naturellement m’être suggérée d’écrire un livre en guise d’hommage à sa mémoire. Ce livre, mes souvenirs personnels et la bienveillance des amis du prince m’ont permis de l’entreprendre. J’adresse ici à tous ceux qui m’apportèrent leur concours le témoignage de ma vive et sincère gratitude.
Je n’ai pas la prétention d’avoir écrit sur le duc d’Aumale l’œuvre définitive à laquelle a droit sa mémoire, ni par conséquent d’avoir élevé le monument qu’elle mérite et qui perpétuera son souvenir. Comment aurais-je pu nourrir pareille ambition quand le dépouillement des volumineux papiers qu’il a laissés n’est pas achevé, et lorsque des années sans doute s’écouleront avant que, ces précieux documents étant mis au jour, son histoire puisse s’éclairer de leur lumière ? Moins prétentieuse a été ma tentative. Au lendemain de la mort du prince, lorsque tant de témoins de ses actions vivent encore et peuvent confirmer ou rectifier mes récits, je n’ai voulu, en le suivant dans sa longue carrière, qu’en fixer les principaux traits avant que le temps les effaçât.
Tel qu’est ce travail, quelque incomplet qu’il soit, je me rends ce témoignage que, dans son exécution, mon cœur n’a pas eu une moindre part que mon esprit. Entraîné par une admiration à laquelle venaient, à chaque pas, se mêler des regrets nés du spectacle de tant de dons rares et merveilleux inutilisés trop tôt et perdus pour la patrie, j’ai mis à écrire ce livre une ardeur passionnée, dévoré du souci de ne m’inspirerque de la vérité, de l’exprimer telle qu’elle m’apparaissait et de ne rien négliger pour la découvrir au milieu de dires parfois confus et souvent contradictoires. Durant six mois, il m’a pris tout entier, ce livre ; il a été mon tourment et ma joie.
En le présentant au public sans me dissimuler ce qui y manque, j’ose déclarer que quiconque sera plus tard en état d’entreprendre l’œuvre définitive dont je parlais plus haut, et le tentera, devra nécessairement ouvrir la mienne et se documenter peu ou prou dans ces pages sincères où, pour la première fois, est présentée dans son cadre, de son commencement à sa fin, dans un ensemble imposant de pièces historiques et tout au moins avec ses grandes étapes, sinon dans tous ses détails, la vie du duc d’Aumale. Sans doute, pourra-t-on la faire mieux connaître. Mais je ne pense pas qu’on parvienne à modifier sensiblement l’opinion que les lecteurs auront pu s’en faire d’après mes récits. Fort de cette conviction dont il m’a suffi de me sentir animé pour être payé de mes efforts et de ma peine, j’espère qu’on ne me contestera pas, à défaut d’autres mérites, celui d’avoir tracé et jalonné la route par laquelle le duc d’Aumale entrera dans l’histoire.
E.D.
15 décembre 1897.
La naissance. – Milieu familial. – Louis XVIII et le duc d’Orléans. – Mme de Genlis. – Le premier spectacle. – Éducation. – Les fils du roi, fonctionnaires. – Cuvillier-Fleury, précepteur du duc d’Aumale. – Le duc d’Aumale au collège. – Épisodes de ce temps. – Le goût pour l’histoire. – La famille d’Orléans aux Tuileries. – Un prince patriote. – Extraits de correspondances. – La folie de l’épée. – Ambition d’un sous-lieutenant. – Soldat et cocardier. – Fin des études. – La grâce de Barbès. – Le duc d’Orléans et le duc d’Aumale. – En vue de la Terre promise. – Départ pour l’Algérie.
Il existe aux Archives nationales un registre in-folio, doré sur tranches, relié en velours bleu, orné sur sa couverture d’un écusson fleurdelisé. C’est sur ce registre, confié à la garde des pairs du royaume, qu’étaient inscrits, au temps de la monarchie, les actes de l’état civil des princes de la maison de France. On y voit figurer, à la date du 16 janvier 1822, l’acte de naissance de Henri-Eugène-Philippe-Louis d’Orléans, duc d’Aumale, cinquième fils de Son Altesse Sérénissime Monseigneur le duc d’Orléans et de Son Altesse Royale Madame la duchesse d’Orléans.
La naissance a été constatée, aux termes de l’ordonnance du roi du 23 mars 1816, par M. le chancelier de France, accompagné du marquis de Sémonville, pair de France, grand référendaire de la Chambre des pairs, et du chevalier Cauchy, garde des archives de ladite chambre, greffier de l’état civil de la maison royale, en présence du marquis de Lauriston, pair de France, ministre secrétaire d’État de la maison du roi, et du marquis de Brézé, pair de France, grand maître des cérémonies de France.
Les témoins désignés par le roi et qui ont signé, en cette qualité, tant le procès-verbal que l’acte de naissance, sont : M. le marquis de Lally-Tollendal, pair de France, ministre d’État, et M. le prince duc de Poix, pair de France, capitaine des gardes du corps du roi. L’un et l’autre de ces actes ont été inscrits sur le double registre de l’état civil de la maison royale, déposé aux archives de la Chambre des pairs.
Le lendemain, 17 janvier, le Moniteur annonce dans sa partie officielle l’accouchement de la duchesse d’Orléans. Le 18, la partie non officielle ajoute : « Son Altesse Sérénissime Monseigneur le duc d’Orléans est venu annoncer au roi l’heureuse délivrance de Son Altesse Royale, son épouse, qui est accouchée d’un garçon. Madame, les princes et Son Altesse Royale Madame la duchesse de Berry se sont rendus au Palais-Royal pour rendre visite à Madame la duchesse d’Orléans. » Le même jour, le roi envoie le duc d’Avaray complimenter les parents du nouveau-né. Il sera tenu sur les fonts baptismaux par Mademoiselle d’Orléans et par le duc de Bourbon, fils du prince de Condé et père du duc d’Enghien. En attendant la cérémonie du baptême, il a été ondoyé par le curé de Saint-Roch.
Avant d’entrer dans le récit qui complétera ce qu’on sait déjà du prince dont les formalités d’une antique étiquette accueillaient ainsi la naissance, il convient de décrire le foyer familial où il allait vivre.
« Au milieu des grandeurs de la cour, disait-il plus tard en parlant de ses parents, le duc et la duchesse d’Orléans vivaient en gens simples. Montés sur le trône, ils se firent honneur de persévérer dans cette simplicité d’aspirations, de manières, de goûts, qui rendait leur intérieur agréable et charmant et qu’ils communiquèrent à leurs enfants. Un esprit de famille régnait parmi eux, créait entre eux cette solidarité qui naît de la tendresse réciproque de ceux qui vivent au même foyer. Les leçons d’urbanité, de modestie, de noble fierté, sortaient tout naturellement, grâce à la ferme bonté des parents, de cette existence où tout aboutissait à la conclusion que la valeur personnelle développée par le travail est nécessaire à tous. »
Il est aisé de comprendre, après avoir lu ces lignes, quels principes le duc d’Aumale suça avec le lait. Aussi garda-t-il toujours de son enfance, de la sollicitude dont elle avait été enveloppée par son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, un souvenir attendri en même temps qu’une admiration profonde pour ceux à qui il devait « le meilleur de lui-même » et de qui il aurait pu dire comme le poète :
La vie du duc et de la duchesse d’Orléans, quand il vint au monde, était aussi paisible qu’elle était simple, l’hiver au Palais-Royal, l’été à Neuilly, presque une vie bourgeoise, relevée par ces goûts rares et délicats que Louis-Philippe, quand il fut roi, manifesta en restaurant le palais de Versailles et en en faisant un musée historique et national. Le futur souverain des Français vivait à cette époque très en dehors de la politique. Louis XVIII l’en tenait systématiquement éloigné. Les relations entre les Tuileries et le Palais-Royal restaient correctes, mais sans cordialité. Les souvenirs de la Révolution pesaient toujours sur elles.
Bien que pendant l’émigration le roi eût exigé et accepté la soumission des princes d’Orléans et qu’elle eût été, de la part de ceux-ci, entière et complète, le seul d’entre eux qui fût encore vivant était toujours l’objet d’une défiance et de rancunes que ni le temps ni son attitude n’avaient effacées. Il ne paraissait donc à la cour que lorsque le roi ou les formalités d’une étiquette méticuleuse l’y appelaient. Il vivait chez lui, entouré de quelques amis fidèles, très soucieux de garder son rang, mais également préoccupé de ne pas paraître s’imposer aux Tuileries, suivant de haut et de loin les incidents de la vie publique, dissimulant de son mieux combien ils le passionnaient, se consacrant à sa femme et à ses enfants en homme pour qui les joies du foyer domestique sont les plus grandes qu’on se puisse donner ici-bas.
Tel est le milieu dans lequel le duc d’Aumale passa ses premières années, entendant parler à toute heure des devoirs auxquels, aux hauteurs où l’avait mis sa naissance, il était plus tenu que d’autres, et rarement des droits qu’elle lui donnait.
Le duc d’Orléans était soucieux de ne pas élever ses enfants ainsi qu’il avait été lui-même. Il avait trop souffert de l’abandon de son père, de l’intrusion, dans la vie de celui-ci, de femmes dont l’influence était une injure à sa mère et des singuliers procédés d’éducation qu’employait à son égard Mme de Genlis, pour ne pas craindre d’imposer à ses fils le même supplice.
Il se rappelait avec amertume le temps où, absolument livré à l’autorité de cette éducatrice, privé de tendresse et de conseils affectueux, il était contraint à mille servitudes qui le blessaient et l’humiliaient sans lui rien apprendre d’utile à l’état qui l’attendait dans le monde, sans améliorer son esprit et son cœur. Pourquoi Mme de Genlis exigeait qu’avec sa sœur il montât le bois, allât puiser de l’eau, cultivât un jardin et portât à ses chaussures des semelles de plomb, il ne l’avait jamais bien compris, et quand lui-même eut des enfants à élever, il se promit, d’accord avec la duchesse d’Orléans, et tout en leur donnant des maîtres, de ne jamais oublier que les meilleurs éducateurs sont encore le père et la mère, quand ils sont pénétrés des obligations que leur imposent la conscience et la loi naturelle.
Il entendait que leur intelligence et leur âme fussent cultivées dans une atmosphère familiale, dans la douceur fécondante des foyers unis. À toute heure, même quand il fut roi, il faisait trêve aux soucis, aux occupations dont il était accablé, pour s’occuper de ses enfants, se rendre compte des développements de leur raison, de leurs progrès intellectuels, de leur santé. Il ne dédaignait pas de partager leurs jeux, ou de les associer à ce qu’il considérait comme un plaisir pour lui-même.
« Le plus ancien souvenir que je conserve du théâtre est celui-ci, racontait un jour le duc d’Aumale dans l’atelier d’un peintre qui faisait son portrait. J’étais tout petit et je jouais, après dîner, sur le tapis du salon, au Palais-Royal. Mon père entra et dit à ma mère :
Je vais emmener Henri voir Talma. »
« Il me prit dans ses bras et, par le corridor qui reliait le Palais-Royal à la loge de la cour, me fit faire ma première entrée à la Comédie-Française. Il m’installa dans un coin de la loge, en me recommandant d’être bien sage. Je le lui promis, et d’abord je n’eus pas grand-peine à tenir ma promesse. J’étais ravi d’apercevoir devant la rampe à quinquets se promener de belles dames qui s’avançaient majestueusement, en faisant des gestes magnifiques pour raconter des choses que je ne comprenais pas. Hélas ! à l’entrée de Talma, tout se gâta. Le sublime artiste jouait Oreste. Au moment de ses fureurs, je me mis à pousser des cris horribles à la vue de cet homme terrifiant. Mon père n’eut que le temps de me rapporter au plus vite près de ma mère, qui, avec beaucoup de peine, réussit à me consoler. Telle fut ma première et tragique apparition au Théâtre-Français. »
Le duc d’Aumale goûta donc, en venant au monde, et dans toute sa douceur, le miel des tendres caresses qui, non moins que l’exemple et mieux que les trop dures leçons, façonnent l’âme et la préparent à la vie, quand elles ont pour contrepoids une discipline morale de tous les instants, d’autant plus efficace qu’elles sont assez intelligemment prodiguées pour en alléger le poids et la rigueur. À cet égard, on peut dire que Louis-Philippe était passé maître. Nul n’eut à un plus haut degré que lui l’art de corriger, par la discipline, dans sa famille, les excès de la tendresse, et de tempérer, par les témoignages incessants de cette tendresse, les sévérités nécessaires. Pour remplir ce devoir, il trouva dans la noble princesse qu’il avait associée à sa vie une collaboratrice intelligente qui toujours l’approuva dans ses vues sur leurs fils et n’eut jamais à le désavouer.
Un des anciens condisciples du duc d’Aumale a raconté que l’expérience du roi Louis-Philippe avait établi, pour le bien commun de son intérieur et de l’État, une hiérarchie sérieuse entre ses fils. Rien n’est plus vrai. Il ne voulait pas que l’aîné, l’héritier de son trône, pût être gêné par les autres. D’après les lois de cette hiérarchie, cet aîné, le duc d’Orléans, celui qu’on appelait le Prince royal, avait seul le droit de s’occuper des questions courantes de la politique. Seul il était admis à les discuter, à en poursuivre l’étude, à les critiquer, le cas échéant.
D’autre part, ses frères, dans la pensée de leur père, lui devaient le respect. Ils le lui accordèrent sans peine et sans cesser de l’aimer. Le duc d’Aumale, notamment, conçut pour son aîné, doué de qualités si variées et si fortes, une déférence mêlée de fraternel amour, qui le lui fit toujours considérer comme un chef digne de vénération. Après le tragique évènement où périt ce prince sur qui reposaient tant de légitimes et radieux espoirs, cette déférence se transforma en une sorte de culte que le duc d’Aumale a conservé toujours aussi vivace jusqu’à la fin de sa vie. On peut dire que son frère fut le modèle qu’il s’était proposé et de la conduite duquel il lui était doux de s’inspirer dans les diverses circonstances de sa longue carrière, où il eut à prendre des résolutions importantes. Il aimait alors à se demander : « Qu’aurait fait d’Orléans ? Que m’eût-il conseillé ? »
Du reste, il avait ce bonheur de pouvoir se reporter avec la même confiance au souvenir de ses parents. Il savait que de là aussi n’auraient pu lui venir que de bons conseils, et ces conseils il les eût suivis avec la docilité d’un enfant plié à l’obéissance dès le berceau. Plus tard, le roi Louis-Philippe résumera comme suit les effets de l’éducation qu’il a donnée à ses fils.
« Ne vous y trompez pas, dira-t-il un jour à M. Guizot, mes fils sont d’excellents fonctionnaires. »
Et c’est bien là ce qu’il avait voulu qu’ils fussent, à l’exception du duc d’Orléans, qui, devant régner un jour, avait droit à une initiative que ses parents n’eussent pas tolérée de la part de ses frères. Fonctionnaires ! Ceux-ci ne considéraient pas que l’épithète fût offensante pour eux. Il est arrivé au duc d’Aumale de se l’appliquer à lui-même dans des entretiens avec ses amis, sans croire se diminuer en se qualifiant de la sorte. Plusieurs actes de sa vie que nous aurons à rappeler au cours de ce récit, lesquels ont surpris ou affligé ceux de ses familiers qui auraient voulu le voir alors plus net et plus résolu, se peuvent expliquer par cette première éducation. Elle le poussa à considérer que sa volonté devait céder à celle des dépositaires du pouvoir. Il s’est toujours énergiquement prononcé à ce sujet. Et sans doute est-ce là ce qui a pu faire supposer parfois, à l’étudier à travers certains de ses actes, qu’il était dépourvu de résolution.
Il ne serait pas cependant impossible d’établir que ce défaut de résolution n’existait chez lui qu’en apparence. Il lui a été surtout reproché par ceux qui trouvaient mauvais qu’il se fût refusé à jouer un rôle de prétendant ou d’aspirant au gouvernement, alors qu’élevé en cadet, destiné à obéir à l’aîné de la famille, il n’était qu’un prince de sang royal sans droits personnels. On en pourrait mieux juger s’il se fût trouvé, de par sa naissance, le chef de sa maison et, par exemple, à la place du comte de Chambord. Un jour, comme il revenait de Versailles en chemin de fer, un de ses compagnons de route citait devant lui cette parole de l’auguste exilé de Frohsdorf :
« Je ne peux oublier que je suis le descendant de saint Louis. »
– Eh ! sacrebleu ! s’écria le duc d’Aumale, il devrait bien aussi ne pas oublier qu’il est le descendant de Henri IV.
On peut en conclure que lui ne l’eût pas oublié. Mais s’il fut trop hiérarchisé, au gré de quelques-uns de ses amis, on ne saurait perdre de vue que c’était le fait de son éducation, des leçons qu’il avait reçues de son père, lequel avait voulu qu’il en fût ainsi.
Le duc d’Aumale venait d’atteindre sa cinquième année, lorsque, en 1827, Louis-Philippe, encore duc d’Orléans, songea à lui donner un maître qui devait commencer son instruction et la continuer jusqu’au bout. Trouver ce maître digne d’élever son fils n’était pas chose aisée. Mais la difficulté fut promptement vaincue. Le hasard amena au Palais-Royal, du premier coup, l’homme qui convenait le mieux à ces fonctions. C’était un jeune professeur, nommé Cuvillier-Fleury, naguère attaché comme secrétaire particulier au roi Louis, frère de l’empereur Napoléon. « Vous étiez un enfant, disait, quarante-six ans plus tard, au duc d’Aumale, Cuvillier-Fleury, en le recevant à l’Académie française ; j’étais un jeune homme. Nous allions être, vous, mon disciple, moi, votre maître. Nous avons vécu ainsi douze ans, tout le cours d’une éducation classique, dans ces rapports où la subordination vous était facile, moins par mon fait que par le vôtre. J’avais accepté une tâche, celle d’élever un prince français, que les plus grands docteurs de l’Église chrétienne n’abordaient qu’en tremblant ; l’Université me prêtait la force qui m’eût manqué. Vous aviez une mère admirable qui a fait l’éducation de votre âme. Le roi Louis-Philippe vous apprenait la vie humaine, dont il avait l’expérience déjà longue et la pratique toujours active. L’Université était la véritable institutrice de votre esprit. »
Ces quelques lignes ne contribuent pas peu à caractériser l’enseignement du jeune maître à son élève. Ce fut au plus haut degré un enseignement universitaire et démocratique, ce dernier mot étant pris dans son sens le plus juste et le plus élevé. Louis-Philippe avait en ces matières, on l’a vu, des idées très personnelles, très audacieuses même pour le temps où il les exprimait et les pratiquait.
« Il faut que mes fils restent princes, disait-il à M. Cuvillier-Fleury ; le métier est rude aujourd’hui ; je ne veux pas, sous prétexte de renoncer à quelques avantages de leur état, qu’ils échappent à ses devoirs ou à ses dangers ; mais il faut élever les princes comme s’ils ne l’étaient pas. »
La doctrine était téméraire autant que neuve. « Les grands, prêchait jadis Massillon, ne doivent leur élévation qu’aux besoins publics… et ils sont faits pour le peuple. » À la faveur de ces paroles, il est permis de se demander si Louis-Philippe, lorsqu’il souhaitait que les princes fussent élevés comme s’ils ne l’étaient pas, n’anticipait pas sur son temps ; si, même encore aujourd’hui, il n’est pas nécessaire qu’un prince soit élevé comme tel et spécialement pour sa fonction, pour son office social, avec l’idée supérieure que, de la place où ils sont, les princes voient des motifs de décision et d’action qui sortent de la règle commune, dans les circonstances critiques. Mais ceci est la doctrine aristocratique, et Louis-Philippe en professait une toute différente qui, mise en pratique à l’égard de tous ses fils, lui a si bien réussi qu’on ne saurait le blâmer, après l’expérience faite pour l’aîné, d’avoir continué pour les autres. Le duc d’Orléans avait été mis au collège. Ses frères y allèrent après lui, et le collège Henri IV s’ouvrit pour le duc d’Aumale, quand il eut l’âge d’y entrer, comme il s’était ouvert pour eux. Il en devint bientôt un des plus brillants élèves, toujours à la tête de sa classe et, à partir de 1834 jusqu’en 1839, annuellement nommé ou couronné au concours général. Il y obtint, étant en rhétorique, le deuxième prix d’histoire et le deuxième prix de discours français. Cette année-là, le roi se rendit à la Sorbonne pour voir couronner son fils. Quant à la reine, elle ne manquait jamais à la distribution du grand concours
Très assidu et très appliqué, le prince était adoré de ses camarades. Mêlé à eux à toutes les heures de la vie scolaire, il donnait libre cours à son exubérante jeunesse, aussi ardent au plaisir qu’au travail. Ses maîtres lui reprochaient même de troubler par d’incessantes conversations le silence des classes. « Conduite légère, écrivait sur le cahier de notes Victor Duruy, son professeur d’histoire, qui néanmoins savait rendre justice à son application ; beaucoup trop de gaieté et de mouvement. » Un autre de ses maîtres disait : « Bien, sauf qu’il aime trop les oreilles de ses voisins. »
Il y a de ces temps quelques jolis souvenirs. Comment ne pas rappeler celui que, dans un discours prononcé le 2 juillet 1870, à la tribune du Corps législatif impérial, évoquait un vaillant défenseur des princes d’Orléans proscrits ? Leur éducation a été celle de tous les citoyens. Vous les avez vus se mêler sur les bancs de nos écoles aux jeunes gens de leur âge, et, il y a quelque temps, siégeait dans cette enceinte un ministre qui, au collège, avait pu dire à l’un d’eux : « Monsieur d’Aumale, vous ne savez pas votre leçon ; allez-vous-en à votre place ! » Et des hommes qui sont aujourd’hui dans l’armée, dans la magistrature, et j’en vois même ici, pouvaient dire aussi : « Montpensier, passe-moi ton dictionnaire ! – Joinville, prête-moi ta balle ! »
M. Cuvillier-Fleury avait quelquefois à réprimer les révoltes de son élève, soit que celui-ci lui tînt tête avec opiniâtreté, soit qu’il lui présentât des devoirs mal faits. Alors le professeur se fâchait, affectait de l’appeler « Monsieur d’Aumale », d’un ton sévère et dédaigneux, ce qui indignait le jeune Estancelin, camarade du prince. Il eût voulu que M. Cuvillier-Fleury témoignât plus d’égards à son élève. Un jour que le duc d’Aumale avait été traité avec la plus grande dureté par son précepteur, il se plaignit à son ami :
« À ta place, s’écria ce dernier, je l’enverrais faire lanlaire et je lui flanquerais mon dictionnaire à la figure. »
Le mot ayant été entendu et répété, Estancelin, à la demande de M. Cuvillier-Fleury, fut séparé de son condisciple pour la durée d’un mois et privé de l’occasion de lui donner de mauvais conseils. Ce n’étaient là, d’ailleurs, que des crises accidentelles. Le prince était intelligent, docile, studieux, appliqué, et ses rapports avec son maître, surtout au fur et à mesure qu’il entrait plus avant dans la période des hautes études, empreints de cordialité.
Déjà le jeune collégien manifestait un goût prononcé pour l’histoire et pour les littératures étrangères. « J’ai grandi en France, disait-il plus tard à des savants anglais dans la compagnie desquels il cherchait quelque allègement aux douleurs de l’exil, j’ai grandi avec une des premières générations qui ont commencé à étudier les littératures étrangères. On commentait, on citait Shakespeare ; on l’imitait même quand il se trouvait quelqu’un d’assez audacieux pour tenter l’épreuve. Vos livres étaient dans toutes les mains, et je me souviens que plus d’une fois, au collège, j’ai caché un des romans de Walter Scott sous mon pupitre. Tel est notre goût en France pour ce que nous appelons le fruit défendu. »
Aimer Walter Scott, c’était aimer l’histoire plus encore que le roman. Dès son adolescence, le duc d’Aumale se passionnait pour les études historiques, pour ces visions du passé dont il a tenté avec tant de succès la reconstitution dans son livre sur les princes de Condé. Mais, quelle que fût sa passion pour les grandes choses d’autrefois, celles du présent et de l’avenir le captivaient aussi. La politique même, bien qu’il lui fût interdit d’y toucher, l’attirait. Entre-temps, son père avait ceint la couronne. Les incidents de la vie publique arrivaient au duc d’Aumale, à toute heure, sous mille formes ; il les suivait à travers les préoccupations de ses parents, dont il recueillait les échos aux heures où la vie familiale le réunissait à eux. Quoi d’étonnant qu’il lui soit arrivé souvent de lire en cachette les débats des Chambres ou les articles à sensation que publiaient les journaux ?
Quoique son père fût devenu roi, rien n’était changé au foyer, rien, si ce n’est le cadre. On avait quitté le Palais-Royal ; on était maintenant aux Tuileries ; mais là encore, en dépit de tant d’impérieux devoirs qui les absorbaient, le roi et la reine ne semblaient pas en avoir de plus impérieux que ceux qu’ils avaient contractés envers leurs enfants. Malgré les criminels attentats dirigés contre Louis-Philippe et auxquels toujours il échappait miraculeusement, malgré les troubles de la rue, malgré les violences de la tribune, malgré les innombrables méfaits commis contre la couronne au nom de la liberté, le roi ne tenait jamais à ses fils un langage moins libéral, moins humain, moins modéré que celui qu’il leur avait toujours tenu. Il les élevait dans le goût et le culte de la liberté. Peut-être eurent-ils l’occasion d’entendre dans sa bouche ces grandes paroles de Montesquieu : « Les dieux, qui ont donné à la plupart des hommes une lâche ambition, ont attaché à la liberté presqu’autant de malheurs qu’à la servitude. Mais, quel que doive être le prix de cette noble liberté, il faut bien le payer aux dieux. »
Le duc d’Aumale n’eût-il pas été convaincu de cette vérité par l’enseignement et les exemples qui lui étaient donnés qu’il s’en serait bien rapidement pénétré au contact de l’aîné de ses frères, le duc d’Orléans. Il est certain que c’est de cet aîné, qu’il vénérait, autant que de son père, qu’il apprit à être le libéral qu’il a toujours été. À l’âge qu’il avait alors, les idées libérales creusent naturellement dans les âmes généreuses une empreinte plus profonde que les idées autocratiques. Quand on se souvient du testament du duc d’Orléans, de cette recommandation faite à ses fils, et surtout à celui qui devait hériter de la couronne, « d’être avant tout des hommes de leur temps et de la nation », et quand on sait quelle aveugle foi avait le duc d’Aumale dans son frère aîné, on n’a pas besoin de chercher longtemps pour découvrir quels étaient les principes auxquels il s’était attaché sous l’influence des fréquentations de collège, à la faveur de l’atmosphère en laquelle il vivait aux Tuileries, comme des formules dont il était en quelque sorte quotidiennement nourri.
C’est encore là qu’il puisa, en même temps que son libéralisme de pensée et d’action, ce patriotisme ardent et éclairé qui a dominé toute sa vie, inspiré tous ses actes, toutes ses paroles, et auquel il les a tous subordonnés. Washington disait : « J’ai toujours dormi, parce que je n’ai jamais rien écrit qui ne pût être lu sur la place publique. » Le duc d’Aumale eût été en droit de tenir le même langage, et il aurait eu raison d’ajouter :
« Je n’ai jamais rien fait dont le patriotisme le plus rigoureux aurait pu s’offenser. » Non seulement il a personnifié ce que, dans la langue du dix-huitième siècle, on appelait un prince, mais encore il a été le patriote qui met au-dessus de tout les intérêts de son pays. C’est ainsi qu’il a conquis ce titre de bon Français en qui semblent, quand on regarde sa vie, du commencement à la fin, se résumer les mérites par lesquels il s’est distingué. On le verra, à toutes les heures de cette vie si pleine, dans les crises les plus graves, en 1848, en 1870, dans l’exil, partout, se souvenir toujours qu’il est Français.
Aux jours les plus sombres, quand tout est autour de lui défaites sanglantes, catastrophes irréparables, amers découragements, il aura foi dans l’avenir de sa patrie ; il dira : « La France est cassée ; mais les morceaux en sont bons », et il répétera le cri qu’un de ses aïeux poussait au lendemain d’Azincourt « le cri chrétien et français : Espérance ! » Et en agissant, en parlant ainsi, il ne fera que révéler et trahir ce que l’éducation qu’il a reçue, les exemples des siens, les leçons qu’ils lui prodiguaient, ont mis dans son cœur d’admiration pour sa patrie, d’orgueilleuse confiance dans ses destinées. Fils respectueux, il honorera toujours en elle, même quand elle le traitera durement, le sol natal que ses aïeux ont arrosé de leur sang et dont, par de glorieuses conquêtes, ils ont incessamment reculé les frontières, l’alma mater à qui on ne donne jamais assez de dévouement et d’amour, la terre sacrée loin de laquelle on ne peut vivre heureux et pour laquelle il est doux de mourir.
Dans l’exil auquel elle l’a condamné, oublieuse de ses services et de sa patriotique abnégation, loin de chercher à tirer vengeance de ceux qui la gouvernent et qui l’ont si cruellement méconnu, loin d’intriguer contre eux, il suivra, anxieux, ému, troublé parfois, comme disait Mme de Sévigné, « au-delà de la raison », les péripéties de son histoire. Il refusera énergiquement de conspirer contre elle ; il s’associera à ses douleurs comme à ses joies, saignera de ses blessures, appellera l’heure des suprêmes revanches et du relèvement final, incapable de se résigner à rester indifférent à ses maux ou à n’être plus pour elle qu’un étranger.
Le 9 août 1855, tandis que sa pensée attentive accompagne sur les rivages de Crimée l’armée française, il écrit : « La guerre de Crimée absorbe en ce moment toute l’attention, et je fais un peu comme tout le monde ; je ne pense guère qu’à cela. Vous qui nous connaissez, vous devez comprendre ce que nous souffrons en assistant de si loin à ces batailles livrées sans nous, en voyant nos soldats se couvrir de gloire, nos amis tomber sans que nous soyons là. J’ai tout supporté en philosophe depuis 1848 ; mais cette épreuve-ci a passé mes forces ; l’exil n’a pas changé mon cœur ; il est inséparable du drapeau. Il y aurait cependant beaucoup à dire sur l’expédition de Crimée. Je crois, quoi qu’on en dise, que le commandement local a fait à peu près ce qu’il pouvait ; l’armée a fait peut-être plus qu’on ne pouvait attendre ; jamais la France n’en a eu de meilleure. Mais tout le monde est-il aussi à l’abri de la critique ? Ce n’est pas à moi qu’il appartient de prononcer. Le détail du siège de Sébastopol doit vivement vous intéresser. Mon Dieu ! que j’aimerais à en causer avec vous ; car, malgré tout, je suis soldat dans l’âme. »
En 1859, au moment où se prépare la guerre d’Italie, son patriotisme éclate encore dans sa correspondance. « Aurons-nous la paix ou la guerre ? Dépenserons-nous le plus pur de notre sang ? Exposera-t-on la France aux plus grands périls sous le prétexte d’importer en Italie les libertés que nous n’avons pas et qu’en fin de compte on se garderait bien d’établir ailleurs ? Je crains fort que la réponse ne soit affirmative. Je dis : Je crains, et cependant, si je n’étais qu’un ennemi passionné de l’empereur, je désirerais la guerre. Mais je suis bon Français avant tout, et en ce moment je forme des vœux ardents pour le maintien de la paix. »
Enfin, lorsque la guerre a éclaté, c’est encore un patriotique souci qui le poursuit dans sa retraite de Twickenham. « J’avoue qu’en ce moment un seul souci m’absorbe et m’ôte toute liberté d’esprit. Je n’ai nul goût pour les airs de bravache, et je n’ai pas l’habitude de m’exciter à froid. Mais l’idée que mon pays est lancé dans toutes les incertitudes de la guerre et que je ne puis le servir, que l’armée française se bat et que je ne suis pas avec elle, cette idée est un ver rongeur qui ne me laisse pas de repos. »
En tenant ce langage, le duc d’Aumale ne parlait pas seulement en patriote, il parlait aussi en soldat. Soldat ! il l’était « dans l’âme » ; il l’était jusqu’aux moelles. Sur les bancs du collège, avant même d’avoir revêtu l’uniforme auquel le destinaient, comme tous les princes de son nom, les traditions séculaires de sa race, il avait déjà la « folie de l’épée ». Ses camarades, pour qui c’était une récompense de jouer avec lui, – cette récompense n’était accordée qu’aux dix premiers de la classe, – nous le montrent choisissant, durant les récréations, et préférablement à d’autres jeux, ceux qui simulent la guerre. Il se grisait au récit des batailles. Il aimait à en mettre en action les épisodes, à feindre les résistances désespérées ou les attaques héroïques. Il s’élançait à l’assaut de forteresses improvisées ou défendait le drapeau qui flottait à leur sommet, et sa jeune imagination paraît de grandeur et de poésie ces simulacres d’épopées guerrières.
Encore quelques mois et quand, au moment d’atteindre ses quinze ans, il recevra en guise d’étrennes – le 1er janvier 1837 – le grade de sous-lieutenant d’infanterie et pourra enfin revêtir cet uniforme si passionnément souhaité, on l’entendra formuler ce souhait :
« Moi, je n’ai d’autre ambition que d’être le quarante-troisième Bourbon tué sur le champ de bataille. »
Il se sent entraîné par un attrait de nature « pour la guerre, pour cette vieille passion de ses pères qui avait conquis son âme ». « Vois-tu, écrit-il à un ami, je ne le dis qu’à toi, parce que, toi seul, tu ne me trouveras ni vain ni ridicule ; quand, confondu dans le rang, j’entends tonner le canon, quand mes naseaux s’ouvrent à l’odeur de la poudre, j’oublie que nous jouons la comédie, une sorte de délire s’empare de moi ; il me semble que j’aurais dans les batailles cette fièvre qui fait réussir, et je reste en extase jusqu’à ce que la voix monotone du chef de bataillon me rappelle à la réalité. »
Et ces paroles ne sont point une fanfaronnade, un air de bravoure chanté en un jour d’enthousiasme où la gloire de ses ancêtres échauffait son sang et électrisait sa jeunesse. Souvent, encore, il les répétera, et plus tard, beaucoup plus tard, quand la neige des ans commencera à blanchir ses cheveux, les fatigues des campagnes africaines à bronzer sa peau, à sillonner son visage de rides précoces, à assombrir ses yeux bleus ; quand, par de mémorables actions d’éclat, il aura prouvé qu’il était digne des grades qu’il ne dut, au début de sa carrière, qu’à sa naissance et à la faveur ; quand, revenu d’exil, réintégré dans le rang, il sera parvenu au sommet des honneurs militaires ; quand il commandera le corps d’armée le plus proche de la frontière, celui qu’en cas de guerre il devra conduire à l’ennemi, on l’entendra encore formuler ce même vœu d’une mort glorieuse, les armes à la main.
« Oui, certes, c’est beau de commander une armée, dira-t-il un soir à quelques-uns de ses officiers réunis autour de lui. Mais, commander une division de cavalerie et tomber comme un Condé, en menant une charge, voilà qui est encore plus beau. »
Ce n’est pas qu’il aime à verser le sang ; c’est l’amour de l’armée, amour du métier. Il est « cocardier ». Ce mot revient souvent dans sa bouche, ce qui ne l’empêche pas de ne pas vouloir que le sang soit inutilement versé. Il professe ce principe qu’« à la guerre, on ne doit tuer que par nécessité ». Mais il est soldat. Il le fut dès l’âge le plus tendre, il le sera toujours, et lorsque d’abominables et arbitraires lois l’auront dépouillé de son uniforme et privé du droit de porter l’épée, il pleurera de douleur et ne se consolera jamais.
Avant que ses quinze ans fussent révolus, il avait été, nous l’avons dit, nommé sous-lieutenant d’infanterie ; l’année suivante, il reçut le grade de lieutenant. En cette qualité, il suivait les manœuvres du camp de Fontainebleau, dirigeait l’école de tir de Vincennes, ne faisant d’ailleurs qu’un peu accidentellement, comme un surnumériat, son apprentissage de la vie militaire. Ses études classiques, coupées de quelques voyages en compagnie de M. Cuvillier-Fleury et qui contribuaient à son instruction, le retenaient encore. Il apparaissait souvent à la Faculté des lettres, consacrant plusieurs heures par jour à la littérature, à l’histoire, aux arts, complétant son éducation intellectuelle en commençant son éducation de soldat, non encore entièrement émancipé de cette vie de famille à laquelle d’autres devoirs allaient bientôt le soustraire, vie très douce dont il nous a permis d’entrevoir le cadre souvent traversé par les émotions, les deuils, les alarmes, et de deviner le caractère tendre, confiant et affectueux, dans un récit qu’il a écrit aux derniers temps de sa vie, en mémoire de son père :
« Le 12 mai 1839, – c’était un dimanche, – mon frère Montpensier et moi nous faisions une partie à Neuilly avec nos camarades de classe. En montant en char à bancs pour retourner aux Tuileries, nous vîmes un peloton de lanciers qui venait nous chercher. Un mouvement révolutionnaire avait éclaté ; le chef du poste du Palais de justice, le lieutenant Drouineau, venait d’être assassiné par le chef d’une bande d’insurgés. Barbès, auteur du crime, fut condamné à mort par la Cour des pairs. Le conseil des ministres insistait pour l’exécution. Un dimanche après-midi, j’étais dans le petit cabinet de ma mère qu’on appelait la Scrivania. Mon père entra tout en larmes ; il me tendit un papier : « Tiens ! lis cela à ta mère. » Et je lus :
VICTOR HUGO.
12 juillet, minuit.
« Le comte de Paris n’avait pas un an ; ma sœur Marie, l’artiste inspirée, venait de mourir. »
Ce n’est pas pour rappeler que le roi des Français, à la prière du poète, fit grâce à Barbès que nous avons reproduit, d’après le duc d’Aumale, cet émouvant épisode, mais parce que ces quelques lignes, en même temps qu’elles constituent un délicieux et vivant tableau de l’intérieur de la famille royale, nous prouvent combien les membres de cette famille vivaient solidaires, associés et étroitement unis dans la joie et dans la douleur, et qu’ils permettent de préciser ce qu’était alors la vie du duc d’Aumale.
À la date où se place son récit, il avait été promu depuis quelques mois capitaine au 4e de ligne. Mais il ne semble pas qu’il fût encore autre chose qu’un officier honoraire, ni qu’en dehors des écoles spéciales il eût figuré ailleurs qu’aux revues où souvent l’emmenait le roi. En dépit de ses épaulettes, il n’avait pas renoncé aux jeux de son âge. La surveillance maternelle s’exerçait toujours sur lui. À la première alerte, il redevenait l’enfant à qui la sollicitude des parents est encore nécessaire, et on l’envoyait chercher « par un peloton de lanciers ». N’empêche qu’il touchait au moment où cette période de la première jeunesse allait se clore pour lui. L’Afrique, où depuis dix ans l’armée française, au milieu de difficultés et de périls, se couvrait de gloire, attirait et fascinait le prince. Il brûlait d’y faire ses premières armes et d’y gagner ses éperons. Ce désir ne devait pas tarder à être exaucé.
Vers la fin de 1839, le duc d’Orléans, qui avait exercé déjà un commandement en Algérie, se préparait à y retourner, lorsque à sa demande le roi décida que le duc d’Aumale s’y rendrait avec lui. « Je partirai d’ici avec mon frère d’Aumale, qui fera ses premières armes sous vos ordres », écrivait, le 4 décembre, le duc d’Orléans au maréchal Valée, gouverneur général de l’Algérie. Et quelques semaines plus tard, le 17 mars 1840, il ajoutait : « Excepté le général Baudrand, j’aurai les mêmes officiers ; et mon frère, le duc d’Aumale, ne sera accompagné que par un des officiers d’ordonnance du roi. » C’était le quatrième fils de Louis-Philippe qui entrait en ligne, et, comme le disait son frère aîné, il entrait par la bonne porte : « Il tiendra toujours bien sa place, car je vous le donne comme étant des plus solides et des plus intelligents. »
Durant les quelques mois qui précédèrent son départ, le duc d’Aumale vécut comme en une sorte d’exaltation et de griserie. Avec plus de passion que jamais, il suivait la marche de nos soldats sur la terre africaine, se figurant déjà qu’il partageait leurs dangers et leur gloire, étudiant la topographie algérienne, suivant sur les cartes géographiques les itinéraires qu’il espérait parcourir bientôt en combattant. Le cabinet de travail qu’il occupait au second étage des Tuileries regardant la Seine du côté du Pont-Royal était rempli de livres techniques, de cahiers sur le tir, les marches en campagne, les fortifications, la tactique militaire. Il y passait de longues heures, impatient de partir, franchissant par la pensée la route des mers et puisant, dans une incessante préparation à la destinée qui s’ouvrait pour lui, la force de se résigner à l’attente.
Parfois, dans le silence de ce cabinet, une voix jeune et mâle s’élevait. C’était le prince qui répétait les formules de commandement ou qui chantait joyeusement : la Casquette du père Bugeaud. Peut-être marquait-il le pas en la chantant. Ses amis venaient-ils le voir, il ne pouvait les entretenir d’autre chose que de l’Algérie, du voyage qu’il allait y faire, de l’espoir qu’il caressait de prendre part, dès son arrivée, à quelque action militaire, à quelque combat qui le mettrait en face d’Abd-el-Kader.
« Pourvu qu’une fois là-bas, sous prétexte que je suis trop jeune, on ne veuille pas me retenir, m’empêcher d’aller de l’avant ! » disait-il.
Le fait est qu’il avait à peine dix-sept ans, et, quoiqu’il eût été décidé par le roi qu’il verrait le feu, on n’entendait pas le laisser encore se jeter au plus épais des mêlées. Mais il se promettait bien de tromper la surveillance dont il serait l’objet et de n’en faire qu’à sa tête. Cela, il ne le confiait qu’à de rares amis, les amis de cœur, choisis parmi ses condisciples de Henri IV, et qu’il conviait souvent à venir le voir aux Tuileries.
L’un d’eux nous rapporte le trait suivant, qui nous ouvre le cabinet de travail du prince et nous permet de l’y surprendre au milieu de ses camarades, venus à son appel pour y passer quelques heures auprès de lui.
« Ce jour-là, nous étions à peine réunis, lorsque son valet de chambre, Damonville, frappa discrètement à la porte.
– Entrez, s’écria le prince.
Et, reconnaissant son serviteur, il reprit :
– Qu’est-ce ?
– Monseigneur, c’est le tailleur qui vient essayer les habits que Monseigneur désire emporter en Afrique.
– Qu’il attende.
Le prince était en verve, heureux de se trouver parmi ses amis de collège, et il eut bientôt oublié qu’il était attendu. Une demi-heure s’écoula, et Damonville de revenir :
– Monseigneur, le tailleur est toujours là.
Cette fois, le prince se fâcha :
– Je n’aime pas à être dérangé quand je suis avec des Henri IV.
Et il reprit l’entretien ; il parlait de la guerre d’Alger, Dieu sait avec quelle émotion profonde et communicative. Puis, comme son récit amenait l’histoire de l’incident à propos duquel fut inventée "la casquette à Bugeaud", il se mit à chanter la chanson populaire chère aux soldats africains. Damonville, qui était resté dans l’antichambre, eut alors une inspiration. Il ouvrit à moitié la porte, et, dans l’entrebâillement, on l’aperçut tendant au prince une casquette :
– Monseigneur demande sa casquette ? fit-il.
Le duc d’Aumale ne put s’empêcher de rire, et, se levant, il dit :
– Allons essayer nos habits, puisque Damonville le veut. »
Quelques jours après, il voguait vers Alger, sous la protection de ce frère aîné qu’il admirait autant qu’il l’aimait et que déjà guettait ironiquement la mort impitoyable. J’aime à me les figurer tous deux, à cette heure fortunée, où le plus jeune rêve de gloire et d’aventures de guerre, où l’aîné, le prince royal, homme déjà depuis longtemps, par conséquent plus grave, de raison plus mûre, envisage les pesants soucis du pouvoir qui lui est destiné, à cette heure qui précède de si peu de jours celle d’un nouveau et irréparable deuil. Je les vois l’un et l’autre, assis, le soir venu, à la proue du navire qui les emporte vers les terres lointaines. À la clarté des étoiles qui deviennent plus brillantes du côté de l’orient, au bruit monotone des flots qui s’ouvrent devant eux, ils causent librement, en amis, en frères.
L’aîné développe cette idée que la guerre d’Afrique est aujourd’hui la première affaire de la France, non seulement parce que l’honneur de nos armes y est engagé, non seulement par l’importance intrinsèque de la question, mais aussi par le contrecoup qu’elle aura sur toutes les autres questions qui touchent le pays et où se trouvent mêlés des intérêts français. Et il dit les incidents, les épisodes, les périls de cette guerre si nouvelle, si différente de toutes celles où la patrie a été jusque-là engagée : les marches dans les gorges sauvages, l’ennemi surgissant à l’improviste de derrière chaque buisson, la barbarie de ses coutumes ; il en célèbre les héros, morts ou vivants, cet Abd-el-Kader, grandiose figure, guerrier indomptable, champion de patriotisme et de fanatisme religieux, avec ses allures d’insaisissable sphinx, si souvent vaincu et jamais abattu, dont l’héroïsme n’est égalé que par celui des adversaires qu’on lui oppose : Bugeaud, Duvivier, Négrier, Baraguey d’Hilliers, Lamoricière, Bedeau, Changarnier, Cavaignac, Yusuf et tant d’autres, phalange glorieuse que grossiront les années qui viennent et qui ajoutera aux fastes de la France des pages immortelles.
Le plus jeune des deux frères écoute l’autre. Électrisé par ce qu’il entend, l’âme gonflée de l’espoir de se montrer égal à ses aïeux et aux chefs dont il connaît les prouesses, il s’exalte à ces récits. Sa taille svelte, serrée dans la tunique d’uniforme, se redresse, et, sous le képi d’où s’échappent les boucles de ses cheveux blonds, son jeune visage à l’expression martiale, aux yeux bleus, trahit toutes les émotions qui se pressent dans son cœur.
Et peut-être, au même moment, là-bas, bien loin, dans une chambre du palais des Tuileries, leur père et leur mère les suivent-ils par la pensée. Peut-être, au fond, tout au fond d’eux-mêmes, le roi et la reine maudissent-ils la loi compensatrice qui fait des fils des rois des otages et des victimes expiatoires sacrifiés aux intérêts de la couronne et au bonheur des peuples. Mais, s’ils ressentent quelque tristesse en songeant à ces fils chéris qui s’éloignent d’eux, à celui surtout qui n’avait pas encore quitté le foyer et qui vient d’en partir pour la première fois, ils savent du moins que dans ce cadet, comme dans l’aîné, tout est nobles aspirations, grandeur, dévouement à la patrie. Ils se rassurent, convaincus qu’ils n’auront jamais à rougir de l’avoir mis au monde. Et partagée entre la crainte des dangers qu’il va courir et l’espérance de son heureux retour, la mère s’agenouille et elle prie Dieu pour ses enfants.
Arrivée du duc d’Aumale en Algérie. – Signes caractéristiques de sa personnalité militaire. – Ses premières armes. – Le col de Mouzaïa. – Chevalier de la Légion d’honneur. – Une lettre du général Ducrot. – Bugeaud gouverneur général. – Colonel du 17e léger. – L’attentat Quénisset. – Retour en Algérie comme maréchal de camp. – Une lettre du roi. – Ascendant du prince sur les troupes. – La prise de la smalah. – Lieutenant général et commandant de la province de Constantine. – Un voyage en Italie. – Séjour à Turin et à Naples. – Le duc d’Aumale fiancé à la fille du prince de Salerne. – Nouveaux combats. – Son mariage. – Il est nommé gouverneur général de l’Algérie. – Son portrait à cette époque. – La reddition d’Abd-el-Kader. – Les dernières semaines du gouvernement du duc d’Aumale. – Résumé de sa carrière en Algérie.
Le 13 avril 1840, à la suite du duc d’Orléans, son frère, le duc d’Aumale débarquait à Alger. Alger ! nom magique pour lui, terre promise si souvent entrevue, théâtre grandiose où, dans une chevaleresque épopée, allait fleurir sa jeune gloire. Là, il fera sa moisson de lauriers en révélant les brillantes qualités dont sa jeunesse relève l’éclat et qui lui vaudront l’admiration de tous les hommes de guerre de son temps !
Le maréchal Valée, gouverneur général de la colonie, était venu au débarcadère recevoir les fils du roi. Au bruit des salves d’artillerie, ils montèrent en voiture avec lui pour se rendre au palais du Gouvernement. Derrière eux se pressaient les officiers de leur état-major : le baron de Marbot, aide de camp de Louis-Philippe, un des survivants des guerres de l’empire qu’il se préparait à raconter en d’inoubliables et parfois romanesques Mémoires, le chef de bataillon du génie de Chabaud La Tour, déjà le confident et le fidèle ami du duc d’Aumale, les chefs d’escadron d’Elchingen et Bertin de Vaux, les lieutenants-colonels Gérard et Jamin, toute une élite. On traversa ainsi la ville d’Alger, entre deux haies de soldats, derrière lesquelles se pressait une foule qui acclamait les princes. Le duc d’Aumale goûta, ce jour-là, à l’aube de son rêve en train de se réaliser, la première des ivresses que lui réservait l’avenir.
Chef de bataillon du 4e léger, nommé officier d’ordonnance de son frère, il entrait en campagne dès le lendemain. Bientôt, aux environs de Médéah et de Blidah, il prenait part aux divers combats, étapes incessantes et périlleuses de la conquête, qu’à tout instant il fallait livrer aux Arabes. C’est à grands traits qu’il convient de retracer ces glorieux souvenirs. Ils ont eu plusieurs narrateurs, et les détails en sont trop connus pour qu’il y ait lieu de les raconter à nouveau, si ce n’est sous une forme sommaire. Ce qui importe dans ce livre où se déroule rapidement la vie du duc d’Aumale, c’est de le montrer sur les champs de bataille, tel qu’il apparut dès le premier jour aux troupes et à leurs chefs.
Les signes caractéristiques de sa personnalité militaire étaient son impatience toujours bouillonnante, son ardeur, sa témérité. Les responsabilités du général ne pesaient pas encore sur lui ; il n’avait ni les obligations, ni les devoirs du commandement. Il marchait dans le rang. Rien, par conséquent, ne pouvait le détourner de donner carrière à son impétuosité. Il se mettait donc toujours en avant, se dérobant sans cesse à la surveillance qu’on exerçait sur lui et arrachant en quelque sorte à ses chefs les missions les plus périlleuses que d’abord ils voulaient lui refuser, par égard pour son âge et dans la crainte qu’il ne s’exposât par excès d’audace.
« Nous sommes responsables de vous devant le roi, mon prince », lui disaient-ils.
Ces paroles, témoignage d’une sollicitude qui lui pesait, avaient le don de l’exaspérer. S’il fut jamais tenté d’enfreindre les lois de la discipline, c’est bien en ces circonstances où l’on semblait douter non de son courage, mais de sa vigueur et de son sang-froid. D’ailleurs, en peu de temps, il devint impossible de le contenir. Il devait à sa naissance d’avoir obtenu, sans coup férir, ses premiers grades. Il tenait à prouver que son mérite égalait la faveur qui les lui avait donnés.
Cette preuve, il la fit, et de telle sorte que son avancement ne souleva ni protestations ni critiques parmi les témoins de sa belle vaillance. On pouvait déjà pressentir que, soldat dans l’âme, nature de héros, avide de faire acte d’héroïsme, inspiré par une foi robuste dans son étoile, dominé par les influences héréditaires, il irait toujours au-delà du devoir.
Dès son premier contact avec les Arabes, il gagne ses éperons. C’est le 27 avril. La division que commande le duc d’Orléans a reçu l’ordre de marcher à l’ennemi, au-delà de la Chiffa. Après douze heures de marche, on ne l’a pas rencontré. Les soldats exténués espèrent un repos bien gagné, quand soudain apparaissent les troupes du bey de Milianah, trois à quatre mille hommes. On court aux armes. « Là, je vis avec admiration cette poignée de braves gens, harassés par une longue marche et par une nuit sans sommeil, secouer leur fatigue en présence de l’ennemi et courir aux armes avec une ardeur, une gaieté qui faisaient battre le cœur. » Le duc d’Orléans fait ordonner à la cavalerie de hâter le pas et d’aller en avant.
« C’était à moi de porter l’ordre, écrit encore le duc d’Aumale. Je ne me le fis pas dire deux fois ; quand j’arrivai aux chasseurs, ils marchaient en bataille au galop. Je cherchai le colonel, je ne le vis pas. La charge commençait. Ma foi ! je ne pouvais ni ne voulais m’en aller. Je poussai mon cheval et je tâchai d’aller de mon mieux. C’était magnifique ; tous les hommes, l’œil en feu, le sabre à la main, couchés sur leurs chevaux ; devant nous, à cinq ou six pas, les burnous blancs des Arabes qui se retournaient pour nous tirer des coups de fusil ou de pistolet. La charge fut très brillante. On l’arrêta au moment où nous allions tenter le passage de la rivière. Je trouvai derrière moi Jouve, sous-lieutenant de spahis, qui avait cherché à m’arrêter et qui m’avait constamment suivi ; Jamin ; un peu après, Gérard, Montguyon, toute la compagnie que mon frère avait mise à mes trousses. Je revins alors à mon poste, où je n’eus pas de peine à me disculper. »
Quand, au bout de quelques semaines, prirent fin ses débuts militaires, il fut, comme chef de bataillon du 4e léger, mis à l’ordre du jour de l’armée « pour avoir, à l’expédition de Médéah : 1° chargé volontairement le 27 avril (combats de l’Affroun) à la tête du 1er régiment de chasseurs d’Afrique ; 2° le 12 mai, donné son cheval au colonel Gueswiller démonté, et marché avec les grenadiers du 23e à l’assaut du col de Mouzaïa. »
Ce que cet ordre du jour ne dit pas, c’est que le jeune officier arriva sur le col avec les premiers soldats qui y plantèrent le drapeau tricolore. Écoutons-le, d’ailleurs, raconter lui-même ce glorieux épisode du 12 mai, l’enlèvement de la formidable redoute au sommet de laquelle s’était établi Abd-el-Kader avec cinq mille hommes pour empêcher les Français de s’établir à Médéah.
Durant la nuit, le duc d’Orléans avait placé ses troupes à leur poste de combat, et, au lever du jour, il les lance sur les hauteurs que défendent six pièces de canon. « On fit poser les sacs, et nos admirables soldats partirent pleins de joie, bondissant comme des chèvres, avec une ardeur qu’on ne peut décrire, mais qu’on n’oublie pas. À peine étaient-ils lancés dans la montagne qu’une fusillade épouvantable se fit entendre sur le pic de Mouzaïa et, en levant la tête, nous vîmes la brigade Duvivier s’avancer au pas de course au milieu d’un nuage de fumée. Un instant, on crut l’attaque compromise ; on ne voyait plus nos troupes ; mais la fusillade continuait derrière un pli de terrain ; le feu plongeant de l’artillerie et de la mousqueterie arabe infligeait des pertes cruelles à nos soldats, mais n’arrêtait pas leur élan. On les vit reparaître. On battit la marche du 23e, et nos petits fantassins débouchèrent, grandis par le danger, plus droits qu’à la parade, l’œil en feu, le jarret tendu, comme s’ils allaient à la fête. Quand on arriva à la montée la plus raide, le 2e bataillon monta tout droit au milieu des broussailles ; les tambours et les clairons battaient la charge, et les derniers coups de feu leur servaient de basse : c’était superbe. Je trouvai Gueswiller épuisé, assis par terre, sans pouvoir avancer ; je me jetai à bas de mon cheval, je le forçai d’y monter, et, me fiant à mes jambes de dix-huit ans, je rejoignis à la course les grenadiers qui marchaient en avant des tambours. J’arrivai au moment où l’on plantait sur la position le drapeau du 23e ; l’autre colonne débouchait en même temps par la gauche. Quand je vis ces braves soldats de tous les régiments confondus, courant encore pour lancer quelques derniers coups de feu aux ennemis qui s’enfuyaient, quand je vis avec cela cette scène imposante de la nature éclairée par le soleil couchant, le délire me prit comme les autres…