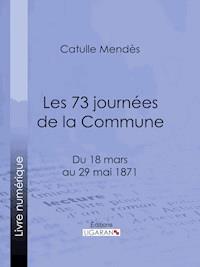Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Jeune homme, as-tu seulement cette puissance indispensable, sans laquelle ne saurait naître en aucun cas ni subsister le vrai amour : la puissance de l'imperturbable et continu mensonge ? Car l'Amant, même quand il adore, ne doit jamais être sincère ; qui ne sait pas mentir n'est pas digne d'être aimé, je vais plus loin : ne peut pas être aimé. Écoute enfant."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Donc, jeune homme, cela est vrai, tu as pris cette résolution terrible ? Dès l’adolescence, tu prétends vouer ta vie aux implacables devoirs de l’amour ? Ainsi que d’autres veulent être médecins, avocats, banquiers, toi, tu veux être Amant ? Sache que tu m’épouvantes. Car, être Amant, ce n’est point, comme l’imaginent certains esprits superficiels, avoir une maîtresse, deux maîtresses, trois maîtresses, les aimer plus ou moins, l’une après l’autre, ou toutes ensemble, selon les occasions, selon le temps qu’on, a, sans nuire à ses autres affaires ; ce n’est pas être épris, enfant, d’une petite cousine plus fraîche que les violettes du bois propice aux premiers rendez-vous, s’affoler à vingt ans d’une impitoyable mondaine, convoiter, plus tard, les belles filles complaisantes dont les corsages très pleins se dégrafent si vite, arriver, plus tard encore, à considérer d’un œil paternellement infâme le mollet des fillettes qui sautent à la corde, ce n’est pas, en un mot, obéir à la loi commune de l’instinct viril, instinct qui implique, chez la plupart des hommes, aux mêmes époques, les mêmes emportements, les mêmes intermittences, les mêmes évolutions. Non ! le mortel digne d’être appelé Amant est celui qui, à tout âge, à toute heure, en toute rencontre, – sans que jamais aucune catastrophe puisse interrompre sa fonction, – se montre capable de désirer, d’adorer, de posséder toutes les belles femmes que le divin hasard place à la portée de ses lèvres, accomplit en effet, dans un absolu mépris du reste des choses humaines, ce dont il est capable, et, se diversifiant non pas selon les mutations de son être personnel mais selon la variété des natures féminines, sait être pour chacune de ses maîtresses l’amoureux même que chacune d’elles a rêvé. As-tu bien réfléchi, jeune homme, aux obligations que t’impose cette façon de concevoir le rôle de l’Amant ? Il va sans dire que tu es opulent et plein de bravoure, car celui qui s’aviserait d’aimer même une pauvresse sans avoir la possibilité de la faire plus riche que la favorite d’un radjah, ou d’aimer même une prostituée sans se connaître assez de courage pour réduire au silence tous ceux qui se vanteraient de lui avoir baisé le bout des doigts, ne serait en vérité qu’un pleutre indigne de tout conseil. Tu es donc, c’est convenu, le plus riche, le plus valeureux des hommes. Quelles difficultés redoutables et sans nombre, cependant, tu rencontreras à chaque baiser ! Tu souris, tu réponds que tu as interrogé ton cœur, sondé tes reins ; tu affirmes que tu te sens à la hauteur de la tâche que tu assumes. Je voudrais te croire, afin de t’admirer ! J’ai groupé dans ce livre quelques conseils qui te permettront peut-être d’affronter sans trop de désavantage notre ennemie adorable, la femme. Je n’ose te promettre la victoire ; je t’aurai du moins armé pour le combat.
Jeune homme, as-tu seulement cette puissance indispensable, sans laquelle ne saurait naître en aucun cas ni subsister le vrai amour : la puissance de l’imperturbable et continu mensonge ?
Car l’Amant, même quand il adore, ne doit jamais être sincère ; qui ne sait pas mentir n’est pas digne d’être aimé, je vais plus loin : ne peut pas être aimé.
Écoute, enfant.
Ne penses-tu pas qu’il est chimérique d’espérer la tendresse entière d’une femme, – la seule qui vaille la peine d’être ambitionnée, – si l’on ne réunit toutes les qualités dont son imagination avait paré d’avance, bien longtemps avant de le connaître, celui qui devait venir ? Si tu n’es pas absolument pareil à l’attendu, résigne-toi au dédain de la bien-aimée, ou, pis encore, – dans le cas où un mauvais hasard t’aurait permis de triompher d’elle, – à un abandon plein de réticence et d’arrière-pensée. Ne pas charmer totalement, esprit, cœur et sens, celle que l’on tient entre ses bras, l’homme n’a pas de plus cruel enfer. Donc il importerait que tu fusses de tout point semblable à l’amoureux imaginé, que tu fusses, pour chaque femme tour à tour, son idéal lui-même. Cela est-il possible ? non. Tu peux ressembler, plus qu’un autre, à cet idéal, mais l’être tout à fait, quel qu’il soit, je t’en défie. De là l’obligation de paraître ce que tu n’es pas ; de là la nécessité d’une perpétuelle imposture. Mentir sans trêve, et de toute façon, mentir par la parole, par le geste, par le regard, mentir dans l’aveu, mentir dans l’étreinte ; produire toujours – grâce à une prestigieuse maîtrise de soi-même – non pas l’homme que tu es mais l’homme que tu devrais être ; te métamorphoser physiquement même, par un effort de volonté qui réussit à modifier les traits du visage ou par des moyens plus matériels, au point d’avoir le front mélancolique d’un Werther si tu portes la face réjouie d’un Roger Bontemps, au point d’avoir les moustaches noires quoique tu les aies rousses ; user, enfin, de toutes les ruses, de tous les masques, de tous les déguisements pour que ta maîtresse, en Toi, ne trouve que Lui, tel est ton premier et ton plus inévitable devoir ! Qu’un seul instant, dans un élan de désir, dans la pâmoison du délice, – ou dans la façon de soulever le rideau de la fenêtre pour regarder le temps qu’il fait, – se révèle le moindre je ne sais quoi de ton être réel, et tout est fini : tu n’es plus aimé. Certes, cette comédie de tous les instants exige un comédien extraordinaire ; c’est une gêne cruelle que cette incessante simulation. Mais quoi ! exprimer le contraire de la pensée, telle est la fonction la plus habituelle de la parole ; pour s’enrichir, pour se pousser dans le monde, pour conquérir l’estime, l’homme le plus loyal consent à des stratagèmes, à des faussetés ; et l’on hésiterait à mentir pour obtenir cet incomparable enchantement : la bouche d’une femme baisant sur votre bouche son désir réalisé ? On a, avec sa conscience, des accommodements pour ne point froisser, dans le monde, les gens qu’on y rencontre, et l’on serait moins « poli » dans le boudoir que dans le salon ? On ne laisse pas entrer un visiteur sans avoir, après un coup d’œil à la glace, noué la cordelière de sa robe de chambre, assuré le nœud de sa cravate, et on laisserait voir son cœur, son âme, ses sens, en déshabillé ? À ce proverbe : « On ne se gêne pas avec ses amis », on ajouterait cet autre proverbe plus absurde : « On ne se gêne pas avec ses maîtresses ? » Il y a l’étiquette des cours, il n’y aurait pas l’étiquette des alcôves ; ce qu’on fait pour les rois, on ne le ferait pas pour les femmes ! Erreur impardonnable des personnes qui aiment à se mettre à leur aise. Quant à prétendre que le mensonge dans l’intimité amoureuse a quelque chose de répréhensible, c’est la vaine excuse de ces paresseux incapables d’effort. Le vrai crime, dans l’ordre d’idées où nous sommes, serait de ne pas tromper celle qu’on aime. Celui-là est un coupable, en même temps qu’un imbécile, qui, au lieu du faux qui l’enivre, lui offre le vrai qui l’écœure ; et, jusqu’à la fin de mes jours, je mentirai, mentirai, mentirai pour qu’Elle m’écoute, heureuse, pour qu’Elle s’approche de mes hypocrites lèvres avec un sourire qui va devenir un baiser !
Mais il ne suffit pas à l’Amant de pratiquer le mensonge sans intervalle ni lassitude ; il faut encore que, tout en feignant de ne point s’en rendre compte, il l’approuve et le respecte chez sa maîtresse. Vous mentez aussi, bien-aimées ; et comme vous avez raison ! Pour vous rendre pareilles à celles que nous avons rêvées, pour nous épargner l’amertume des déceptions, vous feignez délicieusement, toujours. Avec vos baisers qui se font tels que nous les voulons et vos lèvres qui demandent au fard la rougeur qui nous plaît ; avec vos regards où vous nous offrez une âme qui n’est pas la vôtre et vos yeux que le k’hol fait plus amoureusement mourants ; avec vos bras rosés de veloutine qui mesurent l’ardeur de l’enlacement à notre désir d’étreinte ; avec votre sein qui se gonfle à propos et votre cœur qui bat fort quand il convient ; avec tout votre charme fait d’adorables artifices, vous nous permettez de connaître la plénitude de la satisfaction. Soyez remerciées, ô clémentes trompeuses ! Il serait un brutal et un sot, – un casseur de son jouet, – l’homme qui, dans l’inepte curiosité du vrai, dérangerait les tendres calculs de votre fausseté, vous forcerait à vous montrer telles que vous êtes, ferait irruption dans le mystère de vos chères supercheries, et de votre cabinet de toilette. Il y avait une fois un Amant qui adorait sa maîtresse à cause des merveilleux cheveux blonds qui la coiffaient d’un casque d’or. Qu’elle fût brune, il ne l’ignorait pas ; qu’elle dût sa chevelure de soleil à de puissantes mixtures, il l’avait deviné tout de suite ; mais, ce qu’il savait, ne voulant pas s’en souvenir, il l’oubliait ; et c’était avec une infinie ivresse qu’il maniait, baisait, mordait les boucles de flamme crespelée. Elle mourut, hélas, la chère blonde, après une courte maladie, pendant un voyage de l’Amant ; le jour où il revint, elle était couchée sans vie sur le lit où tant de fois il l’avait enlacée, vivante. Les yeux pleins de larmes, la gorge gonflée de sanglots, il se précipita vers la chambre à présent terrible. Mais, malgré son douloureux désir de baiser une dernière fois le front de son amie, il ne poussa pas la porte ; il se pouvait que, malade, elle eût laissé ses cheveux reprendre leur couleur naturelle ; il n’entra qu’une heure après, quand, sur son ordre, des femmes qui étaient là eurent teinté d’or la chevelure. Car, à aucun prix, il n’aurait voulu voir celle qu’il avait tant aimée, celle dont le souvenir l’accompagnerait toujours, différente de ce qu’elle avait daigné être pour lui, ni surtout lui faire l’injure de confondre le blond mensonge auquel elle avait dû la joie de le rendre si heureux.
Mais il ne suffit pas de mentir à l’Amie : il est indispensable que tu te mentes à toi-même.
Sans l’illusion, nul ne saurait aimer ; et vraiment, elle est divine, puisqu’elle nous donne le seul bonheur qui légitime la haine du tombeau. Qui donc détesterait la mort si ne fleurissait parfois, parmi les tristesses de la vie, comme une églantine dans les noires broussailles, la rose miraculeuse du baiser ? Ceux qui pensent que le dieu Amour est aveugle parce qu’il porte un bandeau sur les yeux se trompent probablement ; aveugle, non, je l’accorde ; comment pourrait-il, enveloppé d’ombre, admirer et convoiter la bouche et le sein des femmes ? Il regarde, et il voit, puisqu’il désire. Seulement le bandeau qui lui voile les prunelles, sans les obscurcir, – étoffe tramée d’espoir, de désir et de rêve, dont les modistes se souvinrent quand elles inventèrent le tulle-illusion, – est fait de telle sorte qu’à travers lui toutes les choses dont s’éprennent le cœur et les sens apparaissent transformées et embellies. Malheur à toi, jeune homme, qui te destine à la fonction redoutable d’aimer, si tu ne portes pas ou si jamais tu arraches le bandeau symbolique du jeune dieu Éros !
Car le vrai est épouvantable ; quiconque étudie sa joie au microscope sent l’écœurement lui monter aux lèvres. Quoi ! sachant les traîtrises qui grouillent comme des nœuds de vipères sous la gorge adorée de la femme ; connaissant la duplicité de son sourire, de son regard, de sa caresse, et que ses serments sont pareils à tout ce qui dure peu ; ayant démêlé ce qu’il y a de bassesse dans ses élans, d’instinct dans sa passion ; sûr enfin qu’elle est semblable à toi-même, tu enlacerais sans mépris ton éternelle ennemie, ta sœur ? Tâche d’ignorer, ignore, ignore à jamais tout ce qui se dérobe sous les éblouissements de la forme, crains la nudité des âmes, si tu tiens à ton bonheur, si tu ne veux pas exécrer et maudire l’heure sacrée du premier rendez-vous, si tu ne veux pas confondre dans ton souvenir, avec le sofa des mauvais lieux, l’auguste lit nuptial ! Je sais un homme qui, un jour, fut un sage. Celle dont il était le reconnaissant époux, à qui, pendant dix années, il avait dû toutes les pures félicités, se mourait, sans souffrance, dans l’agonie des saintes ; un prêtre, près du chevet, prêtait l’oreille à la confession de la moribonde. Lui cependant, le mari bientôt veuf, il se tenait dans la chambre voisine, sanglotant contre le bois de la porte. Il recula tout à coup, à cause d’une voix faible qui parlait. Il recula, et il s’enfuit ; car il ne voulait pas entendre les aveux de la confession suprême ! Il était certain que sa femme avait une âme d’ange, qu’elle dirait seulement des péchés pareils à ceux d’une nonne ingénue ; il savait la vertu parfaite de cette épouse chrétienne ; il ne se pouvait pas que jamais, en aucun cas, elle eût été coupable ! Il s’éloigna pourtant, plein de prudence ; et il eut cette consolation, dans sa douleur bénie, de garder intacte au fond de son souvenir la vision de sa chère compagne, de verser des larmes sans amertume sur les lys pâles de la tombe où elle dort, immaculée comme eux.