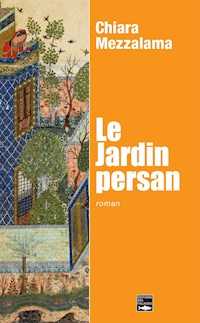
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Falaises
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Quand l'enfance s'apparente à une bulle au milieu du chaos.
Été 1981, une famille prépare ses bagages pour partir en Iran. Le père est un diplomate nommé ambassadeur d'Italie à Téhéran. Dès leur arrivée, la famille est confrontée à la violence et au chaos de la révolution islamique dirigée par l'Ayatollah Khomeini. Pourtant, dans ce cadre sombre se cache un espace enchanteur : les jardins de l'ambassade, ancienne résidence des princes persans, qui abriteront les rêves et les jeux des enfants.
Roman autobiographique, Le Jardin persan raconte avec justesse et candeur la situation politique et historique de l'Iran révolutionnaire. Le regard d'une enfant transforme alors le quotidien en une grande aventure. L'écriture de Chiara Mezzalama nous promène dans ce jardin intérieur où résonnent les bruits de la guerre.
Le récit autobiographique d'une fille de diplomate italien en Iran.
EXTRAIT
"Ce n’était pas la première fois que nous nous retrouvions dans un endroit aussi bondé de monde. Nous nous étions déjà trouvés dans d’autres aéroports du Moyen-Orient, mais là, à Téhéran-Mehrabad, il y avait quelque chose de différent. Les hommes avaient le visage sombre, à cause de la barbe, beaucoup étaient habillés en soldats et portaient un fusil en bandoulière à la manière d’une sacoche. Les femmes étaient en noir, voilées de la tête aux pieds dans leurs tchadors. Certaines serraient le voile entre leurs dents pour avoir les mains libres et tenir enfants et valises. J’avais de la chance, à neuf ans on est encore considéré comme une petite fille, mais beaucoup de fillettes de mon âge portaient déjà un foulard. Ce qu’il y avait de différent, c’est que nous étions les seuls Occidentaux. Raison pour laquelle tout le monde, mais vraiment tout le monde, nous regardait. C’est cela qui m’effraya, plus que les kalachnikovs, les bottes en cuir, les voiles noirs, le bruit et le climat de tension perceptible dès notre descente d’avion. Les haut-parleurs grésillaient en farsi, la langue de la Perse, et mon père avait beau répéter qu’il n’y avait pas de problème, que nous avions le passeport diplomatique et que rien ne pouvait nous arriver, je n’étais pas tranquille du tout, et je crois bien que lui non plus ne l’était pas. En effet, malgré ses véhémentes protestations, on nous fit passer dans une petite pièce où on commença à fouiller nos personnes et nos bagages. Mon père agitait sous le nez d’un barbu son passeport bleu portant le sceau de la République italienne tandis que celui-ci continuait à ouvrir tous les sacs comme si de rien n’était. Ma mère et moi, on nous emmena dans une autre pièce où une femme, entièrement recouverte d’un voile noir, les mains gantées de noir, se mit à nous palper.
« C’est pour la sécurité, dit ma mère, nous sommes dans un pays en guerre, c’est normal qu’on nous fouille.
– Mais pourquoi est-ce qu’elles sont toutes habillées en noir ? » lui demandai-je."
À PROPOS DE L'AUTEURE
Chiara Mezzalama, italienne, vit et travaille à Paris. Fille de diplomate, elle a passé son enfance à l'étranger. Le jardin persan est son deuxième roman après Avro'cura di te (2009), Tre donne su un'isola et Je veux être Charlie, journal d'une écrivaine italienne à Paris.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Les faits et les personnages représentés dans l’oeuvre qui suit, ainsi que les prénoms et les dialogues qui y sont contenus, sont le seul fruit de l’imagination et de la libre expression artistique de l’auteure. Toute ressemblance ou identification avec des faits, personnes, noms ou lieux réels est involontaire et relève strictement du hasard.
Avertissement de la traductrice :
En accord avec l’auteur, le texte français présente quelques modifications par rapport à la version italienne.
« … dans notre monde matérialiste, agir pour le plaisir c’est faire preuve de légèreté, voire d’immoralité. Cette idée me semble fausse, et je suis intimement convaincue que la meilleure des raisons d’agir est d’aimer ce que l’on fait. »
Freya Stark, préface à La Vallée des assassins1
1. Freya Stark, La Vallée des assassins, traduit de l’anglais par M. Metzger et Yves Coleman, Editions Payot, Paris, 1991.
1
La voiture était à l’arrêt. Un fleuve ininterrompu de voitures, un unique ruban de tôles déglinguées. Le chauffeur Jafar, avec ses moustaches, nous regardait dans le rétroviseur et n’arrêtait pas de sourire et de répéter en anglais qu’il était heureux que la famille de l’Ambassador soit enfin arrivée. Tout le monde klaxonnait. Ce vacarme infernal nous parvenait malgré les vitres fermées à cause de l’air conditionné qui nous permettait de supporter la chaleur. Cette chaleur sèche, brûlante à vous cuire la tête nous avait enveloppés comme une couverture à l’instant même où nous sortions de l’avion. Sueur, cigarettes, nourriture, sueur : l’odeur de l’aéroport international de Téhéran Mehrabad. Impossible de l’oublier quand vous l’avez sentie.
Tout le monde klaxonnait, même si cela ne servait à rien. Notre voiture aurait pu marquer sa différence avec les autres, car elle était équipée d’une sirène, dont le son prolongé avait quelque chose d’une plainte. Mais mon père ne voulait pas. Je regardais à travers les vitres les autres voitures bondées d’enfants. Des enfants comme nous, à la différence près que si nous pouvions les regarder, l’inverse était impossible car les vitres de notre voiture étaient fumées et blindées tandis que celles des autres étaient baissées. Et on voyait des bras qui dépassaient, on entendait des voix qui braillaient, des musiques qui jouaient, mais tout était amorti. Comme si notre voiture avait été bourrée de ouate.
Maman enleva son foulard d’un geste nerveux.
« Comment font-elles pour ne pas crever de chaud, ces pauvres femmes ?
– Elena, ne commence pas à te plaindre, répondit mon père, et sois reconnaissante du fait qu’on a l’air conditionné dans cette voiture-ci, parce que ce n’était pas le cas de la précédente. S’il n’y avait pas eu cet attentat contre l’Allemand…
– Oui, tu as raison, mais je n’avais pas imaginé cet air suffocant, cette pollution… impossible de respirer. »
La carrosserie de la voiture était blindée elle aussi, sauf en quatre points, quatre petits tubes dans lesquels on pouvait glisser le canon d’une mitraillette pour tirer vers l’extérieur. C’est Jafar, le chauffeur, qui nous l’expliqua tout en nous montrant les trous.
« These are the vulnerable points ». Mon frère et moi, on commença à tirer en direction des autres enfants. On en tuait beaucoup, on les comptait un à un, mais il n’y eut aucun mort. Maman nous demanda de cesser.
« Je n’aime pas ces jeux violents, nous réprimanda-t-elle.
– Maman, peut-être que tu n’as pas compris, rétorqua Paolo, c’est la guerre. »
Paolo, mon frère. Les yeux encore rouges d’avoir pleuré à cause de ce qui s’était passé à l’aéroport.
Ce n’était pas la première fois que nous nous retrouvions dans un endroit aussi bondé de monde. Nous nous étions déjà trouvés dans d’autres aéroports du Moyen-Orient, mais là, à Téhéran-Mehrabad, il y avait quelque chose de différent. Les hommes avaient le visage sombre, à cause de la barbe, beaucoup étaient habillés en soldats et portaient un fusil en bandoulière à la manière d’une sacoche. Les femmes étaient en noir, voilées de la tête aux pieds dans leurs tchadors. Certaines serraient le voile entre leurs dents pour avoir les mains libres et tenir enfants et valises. J’avais de la chance, à neuf ans on est encore considéré comme une petite fille, mais beaucoup de fillettes de mon âge portaient déjà un foulard. Ce qu’il y avait de différent, c’est que nous étions les seuls Occidentaux. Raison pour laquelle tout le monde, mais vraiment tout le monde, nous regardait. C’est cela qui m’effraya, plus que les kalachnikovs, les bottes en cuir, les voiles noirs, le bruit et le climat de tension perceptible dès notre descente d’avion. Les haut-parleurs grésillaient en farsi, la langue de la Perse, et mon père avait beau répéter qu’il n’y avait pas de problème, que nous avions le passeport diplomatique et que rien ne pouvait nous arriver, je n’étais pas tranquille du tout, et je crois bien que lui non plus ne l’était pas. En effet, malgré ses véhémentes protestations, on nous fit passer dans une petite pièce où on commença à fouiller nos personnes et nos bagages. Mon père agitait sous le nez d’un barbu son passeport bleu portant le sceau de la République italienne tandis que celui-ci continuait à ouvrir tous les sacs comme si de rien n’était. Ma mère et moi, on nous emmena dans une autre pièce où une femme, entièrement recouverte d’un voile noir, les mains gantées de noir, se mit à nous palper.
« C’est pour la sécurité, dit ma mère, nous sommes dans un pays en guerre, c’est normal qu’on nous fouille.
– Mais pourquoi est-ce qu’elles sont toutes habillées en noir ? » lui demandai-je.
En dépit de son aspect inquiétant, la femme fut aimable, elle tâta nos corps et, après avoir vidé le sac de maman, nous laissa repartir. Maman avait remarqué qu’elle regardait intensément son rouge à lèvres Chanel et le lui offrit. La femme sourit, ses yeux étaient sombres comme la nuit.
« Ces femmes ne peuvent parler qu’avec leurs yeux, dit ma mère, mais si tu fais attention, tu comprends ce qu’elles pensent ou désirent rien qu’à leur regard. »
C’est ainsi que j’appris à observer les yeux des femmes et à découvrir leur langage silencieux. Tout était concentré là, dans ces yeux d’obsidienne ou d’émeraude, encadrés par le voile, toujours lourdement maquillés de kajal et de mascara, et je les admirais, fascinée. Croiser leurs regards, c’était comme connaître un monde secret à travers une fente. Comment elles arrivaient à tracer des lignes aussi parfaites autour de l’œil, je l’appris plus tard avec les filles de Jafar, le chauffeur.
« Mais le rouge à lèvres, à quoi ça lui sert puisqu’elle est entièrement couverte ?
– A la maison, devant son mari ou ses amies, elle peut enlever son voile et montrer son sourire. Mais elle ne peut pas le faire en public, c’est interdit par la loi islamique. »
J’allais répliquer, mais elle m’arrêta.
« Écoute-moi bien, Chiara, je ne suis pas capable de répondre à toutes tes questions. Ici ça fonctionne comme ça, que ça te plaise ou non. Nous avons décidé de suivre ton père et ça signifie avant toute chose qu’il faut apprendre à s’adapter. »
Il fallait que je me fasse une raison, point.
Mon père était hors de lui, il était encore en train de batailler avec le barbu qui ne voulait rien entendre. Papa n’était pas du genre à s’énerver facilement, et le voir dans cet état m’impressionna. Mon frère, Paolo, à côté de lui, était pétrifié. Pâle comme un linge.
« Call the police ! Appelez la police, hurlait mon père, I’m a diplomat, Italian diplomat, ambassador, am-ba-ssa-dor, do you understand, je suis l’Ambassadeur d’Italie, vous comprenez ? »
Rien à faire, le barbu ne voulait pas rendre son jeu de cartes à mon frère.
« Islam prohibition, continuait à répéter le barbu, no cards, no game… prohibit, religion. » C’est interdit par la loi islamique. Encore cette loi islamique. Mais qu’est-ce qu’il veut dire ?
« But it’s for a child, not for gambling ! (Nous n’avons pas l’intention de monter un tripot !). Ces types ne comprennent vraiment rien de rien. »
Toutes nos affaires étaient sens dessus dessous. Les valises grandes ouvertes laissaient voir nos vêtements, la lingerie intime, les chaussures, les livres, les jouets, l’appareil photo. Il y avait quelque chose de violent dans cette exhibition d’objets personnels, quelque chose qui n’allait pas.
Ma mère s’approcha de mon frère pour essayer de le rassurer.
« Ne t’inquiète pas, Paolino, nous trouverons un autre jeu de cartes à l’ambassade. Par contre j’espère qu’ils ne vont pas me confisquer l’appareil photo avant même que j’aie pu m’en servir. »
Paolo ne disait rien, il n’arrêtait pas de passer nerveusement sa langue sur la dent qui bougeait et, sur le point de tomber, dépassait de travers entre ses lèvres serrées.
« C’est une question de principe, hurlait mon père, ces types ne peuvent pas systématiquement ignorer ou violer les accords internationaux. Il y a des règles à respecter ! »
Par chance, le chef de la police arriva et, après une rapide altercation en farsi avec le gardien de la révolution, il nous aida à ranger nos affaires, s’excusa en anglais auprès de mon père, et l’incident fut clos. Mais les cartes ne nous furent pas rendues. Jafar, le chauffeur, nous attendait dehors, et avec lui le conseiller d’ambassade qui nous salua très chaleureusement. Mon père grommelait encore.
« Ce n’est pas possible, chaque fois il y a quelque chose qui ne va pas. Venir à l’aéroport, c’est une angoisse. Les otages américains ont été libérés il y a quatre mois ! Mais qu’est-ce qu’ils croient trouver, dans nos affaires ? Une tête nucléaire, peut-être ?
– Peut-être qu’eux aussi ils aiment jouer aux cartes, dit timidement Paolo en reniflant.
– Calmez-vous, Monsieur l’Ambassadeur, votre famille est là maintenant, tâchez d’en profiter, lui répétait le conseiller, à la maison, j’ai des tas de jeux de cartes. Je passe mes soirées à faire des solitaires… D’ailleurs, les enfants, si un jour vous avez envie de venir jouer chez moi, j’ai un chien magnifique ! »
L’atmosphère se détendait. Le conseiller avait l’air d’être un homme sympathique. Il était gros, avec une barbe noire qui le faisait ressembler à un Iranien. Il s’était adapté, lui. Mon père, par contre, était toujours parfaitement rasé. Le matin, il mettait du temps à faire sa toilette parce qu’il tenait à être impeccable. Pour se raser, il utilisait un blaireau avec lequel il étalait la mousse blanche sur son visage, puis il passait lentement le rasoir sur ses joues et son cou, ensuite il mettait une eau de Cologne qu’il se faisait envoyer d’Espagne. Il en avait fait expédier une caisse entière avec le déménagement, pour être sûr de ne pas en manquer. Moi j’aimais son odeur d’eau de Cologne. Et j’aimais le regarder quand il se rasait avec tant de soin.
*
Une fois dans la voiture, mon frère éclata en sanglots. Nous avions mis des jours à décider quels jeux nous emporterions. Nous allions être isolés pendant plusieurs mois. Sans télévision, sans radio, sans amis, sans jeux. Nous n’avions pu choisir que peu de choses, deux ou trois poupées, notre collection de Playmobil, quelques livres et magazines, les feutres, le mange-disque, le jeu de dames, et puis les cartes justement, avec lesquelles nous comptions jouer à la briscola avec papa. La confiscation du jeu de cartes jetait une lueur sinistre sur la possibilité d’établir de bons rapports avec les Iraniens, au moins en ce qui concernait mon frère. Il se calma peu à peu, conquis par les merveilles de l’Alfetta blindée marron qui nous accueillit comme une tanière protectrice. La voiture fit le tour de la place Azadi, où la tour de la liberté ressemblait à un géant aux jambes immenses, sans corps et sans visage. Jafar parvint à se faufiler dans la circulation et nous conduisit à l’ambassade, avenue Neauphle-Le Château, dans le centre de la ville.
2
La voiture franchit un portail de fer où montait la garde un carabiniere qui salua : « Son Excellence. Madame. » Le portail se referma derrière nous, Jafar descendit de la voiture et alla ouvrir la portière de ma mère. Des personnes s’empressèrent pour décharger les bagages. La lumière aveuglante m’obligea à baisser les yeux. Je mis un moment à m’y habituer avant de pouvoir regarder autour de moi.
Dans le jardin, il y avait un étang qui entourait un îlot relié à la terre par un petit pont en fer. Sur l’île, quatre saules pleureurs agitaient lentement leurs branches dans la touffeur estivale, comme de vieux arbres fatigués, trop proches de la terre. La résidence était blanche, les colonnes néo-classiques de la façade lui donnaient l’air d’un temple.
Je compris tout de suite que ce n’était pas un endroit fait pour les enfants. En voyant mon visage perplexe, ma mère intervint :
« Ne t’inquiète pas, on ne va pas rester longtemps ici, ce n’est même pas la peine de défaire toutes les valises. Nous allons bientôt partir pour Farmanieh, la résidence d’été, là bas, tu verras, on sera bien. »
Paolo et moi, nous nous aventurâmes à travers les salles gigantesques de cette étrange maison-temple complètement vide. Dans la salle de bal, il y avait un tapis qui recouvrait toute la surface de la pièce, un énorme lustre en verre et un piano solitaire, souvenir de fêtes passées, de réceptions dont il ne restait qu’un écho lointain, chargé de mélancolie.
Mon père s’arrêta et égrena quelques notes.
« Je n’ai pas réussi à trouver un accordeur dans tout Téhéran. Mais j’ai joué quand même, de toute façon il n’y avait personne pour m’écouter. Ça me faisait passer le temps. Les soirées d’hiver n’en finissaient pas. Depuis que je suis arrivé, en octobre dernier, je crois que je ne me suis jamais senti aussi seul.
– Papa, nous sommes là maintenant, dit Paolo.
– Ça a dû être dur pour toi, commenta ma mère avant d’ajouter : Mais ça fait des siècles que ces lustres n’ont pas été nettoyés ! La poussière remonte à l’époque du Shah ! »
Ma mère avait la manie des lustres.
Cet hiver 1981 avait été dur pour nous tous. Dur pour mon père qui était arrivé dans ce pays chamboulé par la révolution khomeyniste, dur pour les otages américains qui avaient été prisonniers dans leur ambassade pendant 444 jours, dur pour les Iraniens eux-mêmes qui s’étaient retrouvés en guerre contre l’Irak, dur aussi pour nous qui étions restés à Rabat afin de terminer l’année scolaire tandis que notre père rejoignait son nouveau poste. Ma mère avait vécu des mois d’inquiétude, ne sachant si elle devait rester au Maroc, rentrer à Rome ou bien le suivre en Iran. Elle passait son temps à feuilleter les journaux, les communiqués de l’Agence de presse italienne, en quête de nouvelles de ce pays en proie au chaos. Nous attendions les coups de téléphone de papa, le soir au salon, Paolo et moi déjà en pyjama. Sa voix était tellement lointaine et brouillée qu’on ne comprenait pratiquement rien de ce qu’il disait. J’essayais de lui parler de l’école, des notes que j’avais eues, des livres que je lisais, et j’entendais sa voix qui résonnait, comme si je parlais toute seule ou avec un fantôme. Inutile de faire semblant que tout allait bien. Je m’en allais au lit le cœur gros. Le Maroc, ce pays où nous avions été si bien tous les quatre ensemble, était tout d’un coup devenu exigu. Une fois nos affaires parties dans les grands cartons du déménagement, la résidence s’était peu à peu dépouillée de ce qui nous appartenait, comme si cela n’avait jamais vraiment été notre chez nous, et moi je me sentais trahie, abandonnée.
Papa nous montra son nouveau bureau, le seul lieu qui semblait conserver un peu de vie, avec ses documents, les journaux, quelques livres, une photo de Paolo et moi en train de jouer aux cartes autour d’une table.
« Par désespoir je me suis mis à écrire des poèmes, dit mon père, écoutez celui-ci :
Femme au regard oblique
qui retiens de tes dents
le bord de ton manteau,
noire enveloppe.
Tu n’as pas l’élégance irisée
des femmes de Delhi
Tu voudrais cacher les beautés
que t’a données la nature
Mais tu ne cèles pas ton visage
Où se concentre dans cet ovale de camée
Ton charme mortifié
Et en un regard intense
tu laisses tomber le rideau de ton voile.
Tu sais te découvrir,
c’est ta façon orientale d’aimer. »
Récité de mémoire. Mon père avait une mémoire étonnante.
« Papa, je n’ai pas bien compris de quoi parle ton poème, dit Paolo.
– La poésie, ce n’est pas la peine de la comprendre, répondit mon père, il faut l’écouter, comme une musique. »
Moi j’avais compris qu’à travers les mots, mon père avait cherché à tromper la solitude et la peur. Lui, il nous regarda comme s’il n’arrivait encore pas à croire que nous soyons tous là, enfin réunis. Maman allait verser une larme, alors je lui demandai :
« Maman, mais comment est-ce qu’ils font pour sortir ce tapis de la pièce et enlever la poussière en le battant ?
– Ils ne le font pas, répondit ma mère. »
Voilà pourquoi j’avais l’impression de suffoquer là-dedans, c’était la poussière et l’odeur de vieux du tapis.
« Un jour je vous ferai un cours sur les tapis persans, dit mon père, mais maintenant il vaudrait mieux que nous allions manger, j’imagine que vous avez faim. »
Entre une réception et un bal dans la résidence des princes Kadjar – devenue l’ambassade italienne dans les années trente –, la musique, les cocktails, et puis nous qui étions là en train de manger dans une pièce sans meubles, servis par une employée russe portant un tablier noir, il y avait eu la Révolution islamique et, en 1979, le retour au pays de l’Ayatollah Khomeyni après quinze ans d’exil. Entre-temps le Shah Reza Pahlavi, atteint d’un cancer, s’était enfui et était mort en Egypte quelques mois plus tard.
L’Ayatollah Khomeyni. Son portrait était partout, comme une espèce d’avertissement. Mon père, quand on se tenait mal à table, nous menaçait : « Je vais vous envoyer chez l’Ayatollah Khomeyni, il va vous apprendre comment on doit se comporter. »
L’Ayatollah Khomeyni portait un turban noir et était enveloppé d’une cape noire, comme les sorciers des contes des Mille et Une Nuits. J’avais vu sa photo au moment où il descendait de l’avion d’Air France, le 1er février 1979, et ce que j’avais remarqué tout de suite, c’est qu’il était chaussé de babouches : c’était un sorcier en pantoufles. Il avait la barbe blanche et les sourcils noirs, et ça aussi c’était bizarre. Des cernes profonds soulignaient son regard qui semblait vous transpercer de part en part. C’était une espèce de divinité qui pouvait vous voir tout le temps, même si vous, vous ne pouviez pas. Et surtout il pouvait vous voir quand vous étiez en train de faire quelque chose de mal. Les Occidentaux étaient le mal. Les États-Unis étaient le diable en personne, le « Grand Satan ». Souvent on entendait des hurlements dans la rue. Les gens criaient son nom. Ils criaient, manifestaient, tiraient en l’air. Ces coups de feu semblaient dire : « Nous sommes prêts à vous tuer tous si vous ne pensez pas comme nous ». Traduit par mon père, c’était : « Ici il n’y a plus personne qui travaille. Ils passent leurs journées à manifester. Le pays est en pleine débandade. Premier producteur de pétrole au monde, et il n’y a pas d’essence dans les stations services. Ils sont assis sur une mine d’or et ils meurent de faim. C’est vraiment absurde. »
Le soir venu, un silence spectral tomba sur la résidence. L’heure du couvre-feu avait sonné. Tous ceux qui avaient festoyé les années précédentes avaient été contraints au silence, ils avaient fui en Occident, ou alors ils avaient été emprisonnés, torturés, assassinés. Nos voix ne suffisaient pas à remplir le vide des pièces. Notre petit mange-disque orange sur lequel nous passions les chansonnettes des émissions pour enfants ne suffisait pas à rendre l’atmosphère moins lugubre, pas plus que le tourne-disque de mon père avec les symphonies de Beethoven, ou les sonates de Schubert qu’il jouait sur le piano désaccordé. Maman nous accompagna dans notre chambre à l’étage. Elle nous lut une histoire et nous fit réciter notre prière, mais cette première nuit-là, je ne parvins pas à m’endormir. Tout était étranger, trop grand, même nos lits. Il me manquait notre maison du Maroc, ma chambre, mon lit, l’air frais du jardin qui pénétrait à travers les voilages légers. Ici il y avait des barreaux aux fenêtres et j’entendais le souffle de la ville. Un souffle lourd, monstrueux, fait de bruits de voitures, de coups de feu, de chaleur gluante que le bourdonnement de l’air conditionné ne parvenait pas à annihiler.
Mon frère se réveilla en hurlant.
« J’ai perdu ma dent », cria-t-il, désespéré. J’allumai la lumière et l’aidai à chercher. Sur le drap de lin empesé, il y avait une petite tache de sang.
« La voilà, ta dent, ne t’énerve pas ». C’était une dent toute petite, minuscule, on aurait dit un grain de riz.
Mais il continuait à pleurer.
« Arrête, tu vas réveiller maman et papa, c’est rien !
– J’ai le goût du sang dans la bouche.
– Attends, je vais te chercher un verre d’eau.
– J’ai peur, j’ai peur qu’il y ait pas de petite souris pour me porter une pièce », murmura-t-il en recommençant à pleurer.
La situation était grave, il fallait que j’aille chercher de l’eau. Je m’aventurai hors de la chambre, le dallage était frais et ce fut un léger soulagement pour moi. Dans le long couloir sombre, je rencontrai l’ombre de Maria, la femme de chambre, et je faillis m’évanouir. Maria ne parlait que le russe, en chemise de nuit elle était encore plus effrayante qu’avec son tablier de travail noir. On aurait dit la Baba Yaga, celle qui mange les enfants. Elle prononça quelques mots que je ne compris pas. Ses paroles, au lieu de me tranquilliser, m’effrayèrent encore plus, et quand elle s’approcha pour me prendre, je ne pus m’empêcher de hurler. A ce moment-là, c’est elle qui prit peur et s’enfuit par où elle était venue. Maman arriva et me raccompagna dans la chambre et je lui expliquai ce qui se passait.
« Je suis sûre qu’ici aussi, il y a la petite souris. Les enfants iraniens perdent les dents comme vous, alors, Paolo, tu verras qu’elle va venir. »
Mon frère se calma sur-le-champ.
« Elle m’apportera des lires ou des tomans ? demanda-t-il après avoir réfléchi un instant.
– Ça, on le saura demain. Maintenant il faut dormir, mon chéri. »
La voix douce de maman. J’aurais voulu lui dire que cette résidence ne me plaisait pas, qu’elle était trop grande, que Maria me faisait peur et que je voulais revenir à Rabat, ou bien à Rome, et que je ne me sentais pas tranquille, que j’avais chaud, qu’il y avait dans l’air quelque chose qui m’empêchait de bien respirer, j’avais la gorge irritée, et malgré l’eau que j’avais bue cela ne passait pas, et le climatiseur faisait un bruit qui m’empêchait de dormir. Mais je ne dis rien. Je savais qu’elle avait ses propres soucis. Et papa aussi. Je pensai au piano, tout seul dans ce gigantesque salon, et je pensai que j’aurais aimé apprendre à en jouer. Je pensai aux saules pleureurs là-dehors, à cette façon paisible qu’ils ont d’agiter leurs branches, et tout doucement je glissai dans le sommeil de cette première nuit de l’été iranien.
Au réveil, Paolo trouva la pièce. Mais il fit aussi une amère découverte : on ne pouvait rien acheter parce qu’on ne pouvait pas sortir de l’ambassade.
« Maman, qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui ? », telle fut notre question pendant le petit-déjeuner, tandis que nous étalions la confiture sur des tranches de pain parfaitement grillées par Baroua, le cuisinier bengali, servies dans de petites corbeilles garnies de serviettes brodées aux initiales de la République italienne, avec les tasses en porcelaine blanches bordées d’un filet d’or et les couverts en argent du service officiel. On ne trouvait pas de lait à acheter, alors on buvait du jus d’orange dans des verres bleus si fragiles qu’un souffle aurait pu les briser, semblait-il. Mon père souriait, ma mère avait les yeux cernés. Sans doute n’avait-elle pas dormi, elle non plus.
Se procurer la nourriture devint un de ses soucis majeurs. La viande était une denrée rare, presque autant que l’essence, et il fallait l’acheter au marché noir à prix d’or. Habituellement c’est le cuisinier qui y allait, avec le chauffeur, mais un jour ma mère insista pour les accompagner.
« Il faut quand même que je mette un peu le nez dehors », dit-elle, agacée. Elle mit d’épais collants noirs, un foulard, et s’empara du panier à provisions comme si elle partait à la guerre. « Je veux aller voir ce maudit Téhéran. »
Et nous en chœur : « Nous aussi ! »
« Too dangerous », dit Jafar en secouant la tête, trop dangereux.
« Too hot », ajouta Baroua en tirant le caddie et en s’appuyant sur sa canne. Il boitait. Trop chaud.
Nous étions prisonniers. La chaleur nous enserrait, ainsi que la ville entière, dans une étreinte implacable. Après dix heures du matin, impossible de rester dans le jardin. Les saules pleureurs eux-mêmes n’avaient pas le courage d’agiter leurs branches dans la canicule estivale. L’étang était relié aux égouts de la ville et commençait à dégager une odeur nauséabonde et à produire des détritus qui flottaient comme des morceaux de cadavres. Quelquefois nous nous amusions à lancer des cailloux pour toucher ces objets flottants. Il n’y eut jamais moyen de nettoyer cet étang et il fut par la suite décidé de le combler. Il allait, quelques mois plus tard, être le décor d’une tragédie
En attendant le retour de maman, Paolo et moi commençâmes à lire Mickey, allongés sur le sol dans le salon. Tout était immobile, le temps même semblait ne jamais passer. Tout était étranger, lourd, irréel.
Des heures plus tard, maman revint de sa mission avec les deux hommes. Elle était bouleversée.
« Je suis en nage, il faut que j’aille me doucher tout de suite. »
Elle arracha le foulard de sa tête, enleva ses chaussures et ses collants noirs.
« Je ne sais pas comment font les autres femmes. Elles portent dans leurs bras les enfants, les provisions… Et puis il y a une de ces pollutions, l’air vous colle à la peau, sans parler des regards. Il me tarde qu’on parte à Farmanieh, ici je ne supporte pas. »
Elle revint après s’être rafraîchie.
« Au marché, c’est une queue interminable, raconta-t-elle, tout est rationné et il faut des bons pour avoir le droit d’acheter. Il y a des gens, des femmes surtout mais aussi des enfants et des fillettes, qui passent toute leur journée à faire la queue pour avoir un peu de riz, de sucre ou de viande, et puis il y a aussi le marché noir, mais c’est tellement cher que rares sont ceux qui peuvent se le permettre. J’étais la seule étrangère et tout le monde me regardait. Ils se sont sûrement dit : « Mais qu’est-ce qu’elle fait ici, cette folle ? ». Heureusement que Jafar et Baroua étaient là, toute seule je n’aurais pas supporté ça.
– On pourra venir avec toi, la prochaine fois ? lui demandai-je, parce qu’ici, nous, on s’est ennuyés à mort. » Je sentais grandir en moi la curiosité pour ce monde extérieur si hostile et pourtant fascinant, comme toutes les choses interdites.
A peine mon père était-il rentré de son bureau que ma mère attaqua : « Quand est-ce qu’on part à Farmanieh, Francesco ? Ici, ça ne va pas pour les enfants, pour moi non plus d’ailleurs.
– A Farmanieh, on ne peut pas y aller parce qu’on ne trouve personne capable de faire le branchement de gaz, et sans le gaz il n’y a pas d’eau chaude et on ne peut pas faire la cuisine, répondit-il d’un ton irrité, plus personne ne travaille dans ce pays, je te l’ai dit.
– Mais tu ne pourrais pas demander à un collègue diplomate ?
– Tu crois que je n’ai pas déjà essayé ? Tu crois que ça me plaît de vous garder ici ? Dans un endroit qui n’est pas sûr, où les enfants ne peuvent même pas jouer dans le jardin. Je t’en prie, Elena, c’est déjà assez difficile. Si tu savais tous les problèmes que j’ai au bureau. Peut-être qu’il aurait mieux valu que vous alliez en Italie chez ta mère, ça aurait été mieux pour tout le monde.
– Excuse-moi, ce n’est pas ce que je voulais dire, nous sommes contents d’être avec toi, n’est-ce pas, les enfants ? Nous allons nous adapter, tu vas voir !
– Je ne suis pas tranquille. Il y a des manifestations prévues en ville aujourd’hui, et on ne sait jamais comment ça se termine, ces choses-là. »
Nous mangeâmes notre riz en silence, les coudes collés au corps et les épaules bien droites, comme papa nous l’avait appris. Nous tenir correctement à table, c’était la seule chose en notre pouvoir pour lui faire plaisir. Mais moi, en dedans, je me sentais toute chamboulée.
Nous fûmes sauvés par les Français. L’ambassadeur français était arrivé en même temps que mon père, à l’automne 1980, durant ce fameux voyage que mon père ne cessait de raconter.
En général, c’est le soir qu’il racontait. Je crois qu’il avait besoin de répéter cette histoire pour se convaincre qu’elle était vraie et pour avoir des témoins. Comme s’il avait peur que personne n’y croie. Moi, j’aimais l’écouter. D’ailleurs il n’y avait pas grand-chose d’autre à faire le soir. A six heures, c’était le début du couvre-feu, et c’était comme si tout à coup la ville se vidait de ses habitants. Le bruit incessant de la circulation s’amenuisait et il ne restait que les muezzins qui hurlaient dans leurs haut-parleurs à plat, et les coups de mortiers qui explosaient dans un lieu indéfini, pas très loin de là où nous étions.
Maria nous aidait à faire notre toilette. La salle de bains était immense elle aussi, et j’imaginais que la baignoire à pattes de lion allait tout d’un coup se mettre à marcher et nous emporter. Comme ma mère n’avait pas réussi à trouver de l’adoucissant, les serviettes, blanches et rêches, au lieu de sentir la lessive, avaient cette odeur de vieux des choses restées trop longtemps dans une armoire. Alors nous tentions de compenser en nous saupoudrant abondamment de talc, à travers le couvercle perforé de la boîte verte. Lavés et parfumés, en pyjama, nous attendions papa pour le dîner. Nous portions des peignoirs chinois rouges à ceinture noire qu’il nous avait rapportés d’un de ses voyages, quand il accompagnait le Président de la République à travers le monde. Après le dîner, nous nous installions dans le salon, sous la lumière faible et tremblotante de l’abat-jour. Et il racontait.
« La première fois que je suis venu en Iran, tous les aéroports étaient fermés. Il n’était d’ailleurs pas prudent de traverser l’espace aérien du pays. Il aurait suffi d’un quelconque petit missile antiaérien et adieu papa, il ne faut pas plaisanter avec ces barbus. « Eh bien, monsieur l’ambassadeur, s’il n’est pas possible d’arriver là-bas par voie aérienne, il n’y a qu’à y aller par voie maritime, en passant par l’Union soviétique ». Ah, ce ministre, quel sens de l’humour ! C’était le 28 octobre 1980. Je me suis embarqué à Fiumicino pour Moscou avec un avion de l’Aeroflot, en ces années sombres où le communisme commençait à donner des signes de faiblesse. La flotte aérienne soviétique ne m’inspirait pas, je dois le reconnaître, la plus grande confiance. Je ne vous raconte pas ce qu’on nous a servi à manger. L’odeur m’a suffi. Voilà, les enfants, je vais vous donner une règle d’or : quand on voyage dans des pays lointains, il ne faut jamais manger dans l’avion. Jamais. N’oubliez pas ça. Beaucoup de mes collègues ont commis cette erreur et l’ont payé cher… je vous laisse imaginer… Je suis arrivé à Moscou avec un temps horrible, j’avais très faim. Évidemment, impossible de manger, parce que nous avons été obligés de nous transférer dans un autre aéroport où se faisaient les vols intérieurs. Déjà que je n’avais pas tellement confiance dans cette compagnie soviétique pour un vol international, imaginez un peu, pour un vol intérieur ! Avec un bus mis à notre disposition, on a commencé à errer dans la nuit d’un aéroport à l’autre, parce que la pluie les avait rendus inutilisables. Les Russes, ils allaient sur la lune, mais quand il pleuvait, les aéroports fermaient et le pays était complètement paralysé… La faim m’avait passé, car mon inquiétude grandissait d’heure en heure. Est-ce que j’allais arriver à destination ? Est-ce que j’étais vraiment certain de vouloir y arriver ? La situation en Iran était des pires, révolution islamique, guerre contre l’Irak, otages américains. En résumé, le chaos complet au niveau mondial, et moi avec ma petite valise diplomatique qui m’obstinais en compagnie de quelques autres fous à vouloir atteindre ce lieu sinistre. « J’insiste, monsieur l’ambassadeur, la plus grande prudence ». Ah, ce ministre des Affaires étrangères, quelle ironie !
Pour finir nous avons trouvé un aéroport ouvert, mais nous avons dû attendre des heures avant qu’un vol puisse décoller : destination Bakou. Vous savez où c’est, Bakou ? C’est la capitale de l’Azerbaïdjan, qui est ensuite devenue une province méridionale de l’Union soviétique, un endroit stratégique parce qu’il a une façade sur la mer Caspienne, et que la mer Caspienne est l’un des endroits du monde le plus riche en pétrole. Je vous y emmènerai un jour, on ira faire une balade sur la mer Caspienne, n’est-ce pas, maman ? Combien d’enfants italiens pourront dire qu’ils se sont baignés dans la mer Caspienne ? Bien, alors nous montons dans cet avion à destination de Bakou. Je n’avais jamais vu un avion comme ça : il était bondé de gens, d’objets, d’enfants et d’animaux, quelque chose d’incroyable. Il n’y avait pas la moindre place libre, même pour marcher dans les couloirs qui étaient encombrés de sacs, de paquets, de valises. A peine étais-je assis – évidemment pas l’ombre d’une ceinture de sécurité – que je vis arriver un monsieur transportant un pare-brise de voiture. C’est l’économie du troc : si tu ne peux pas acheter les choses, tu essaies de les échanger, et en Union soviétique, à l’époque, il n’y avait pratiquement rien à acheter. Raison pour laquelle les gens faisaient la navette chaque semaine entre Moscou et Bakou. Nous sommes restés des heures et des heures dans l’avion immobilisé au sol. Il faisait jour maintenant. Je commençais à penser que je n’arriverais jamais à destination. De temps à autre, les gardes soviétiques montaient dans l’avion et faisaient descendre quelqu’un et monter quelqu’un d’autre, comme ça, sans raison apparente, et personne n’osait protester. Les hommes sont capables de supporter n’importe quoi. C’est leur chance, mais aussi leur malheur. »
A ce point de l’histoire, mon frère commençait à enchaîner les baîllements. Quelques minutes de plus, et il allait s’endormir dans les bras de maman. Moi, au contraire, je voulais écouter la suite.
« Papa, dans l’avion, il y avait aussi des poules ?
– Bien sûr. Et même, si je me souviens bien, il y en a une qui a fait deux beaux œufs, et je ne te cache pas que je les aurais volontiers mangés, parce que j’étais à jeun depuis des heures et des heures.
– Mais tu n’aurais pas respecté ta règle d’or.
– C’est vrai, d’ailleurs je ne l’ai pas fait. Et puis ces gens-là avaient tous l’air tellement morts de faim, il valait mieux que ce soient eux qui mangent les œufs.
A la fin, l’avion a quand même réussi à décoller et nous sommes arrivés à Bakou juste après l’aube. Un fonctionnaire est venu nous chercher pour nous emmener à l’hôtel. Mais à ce moment-là je n’avais plus du tout envie de dormir, il me tardait d’arriver. Je suis descendu dans le hall et j’ai rencontré une autre âme en peine : c’était l’ambassadeur de France.
– Celui qui doit nous aider pour la bouteille de gaz ?
– Oui, exactement.
– On dirait une de ces blagues, tu sais, il y a un Italien, un Français et un Allemand…, dit ma mère en riant.
– Oui, sauf que nous n’avions vraiment pas envie de rire à ce moment-là. Mais nous sommes devenus amis. Et puis nos ambassades sont l’une à côté de l’autre. Il y avait aussi un photographe de l’Agence nationale de presse, regarde ici. »
Il nous montra une petite photo. On voyait mon père assis sur une valise sur la jetée de Bakou. Il avait un visage inquiet et fatigué, on aurait dit un de ces émigrants qui partaient pour l’Amérique avec leur valise en carton. Mais dans ses yeux, on devinait une drôle de lumière, une chose que j’appris à reconnaître au fil des années et qui a à voir avec la soif d’aventure, avec le désir de s’en sortir en dépit des dangers et des difficultés.
« Ensuite on s’est embarqués sur le bateau russe. La mer Caspienne était grise, elle est toujours grise, et très salée. En plus des nombreuses plateformes pétrolières, il y a des poissons qui s’appellent esturgeons, de gros poissons affreux mais dont les œufs sont une richesse. Je pensais trouver à bord du bon caviar, peut-être même de la vodka, mais rien, nous allions en Iran, un lieu où les plaisirs de la chair étaient bannis.
– Qu’est-ce que ça veut dire, papa ?
– Eh bien, disons que beaucoup de choses sont interdites, dans ce pays. Comme par exemple les cartes à jouer qu’on a confisquées à ton frère, mais aussi les boissons alcoolisées, la viande de porc, ce sont les préceptes du Coran. Certains pensent que pour vénérer Dieu, il faut renoncer à tous les plaisirs. Alors donc, sur ce sacré bateau, il n’y avait rien de bon à manger ni à boire, rien que d’écœurants jus d’orange russes et des galettes dures comme des pierres qui devaient être périmées depuis des mois. J’avais fini par renoncer, je comptais manger en arrivant. Par bonheur, nous sommes arrivés sains et saufs au port de Noshar. Il y avait de la boue partout, nos valises ont été jetées du bateau comme de dangereux détritus, à la douane on n’y comprenait rien. C’est le conseiller d’ambassade qui est venu me sauver. J’ai salué mon compagnon de voyage et nous sommes partis en voiture. Nous nous sommes arrêtés pour manger dans une espèce de restaurant et je dois dire que, sans doute parce que j’étais mort de faim, le riz que j’ai mangé m’a semblé délicieux. Il y avait de tout dedans : des raisins secs, des amandes, des pistaches, des petits pois, des épices dont je ne connaissais même pas l’existence. Finalement j’ai commencé à me sentir mieux. L’entrée dans Téhéran n’a pas vraiment ressemblé à la conquête de la terre promise. J’ai compris tout de suite que les années à venir allaient être difficiles. Ce n’est pas par hasard que je suis arrivé la veille du Jour des morts… Allez vous coucher maintenant, ton frère a déjà sombré. »





























