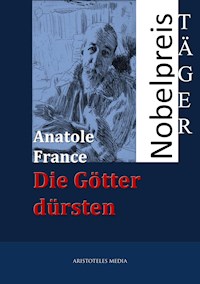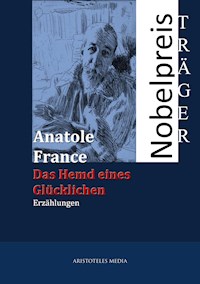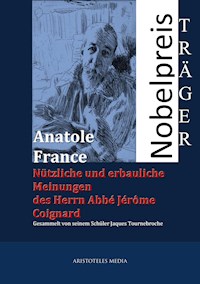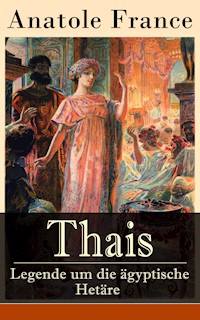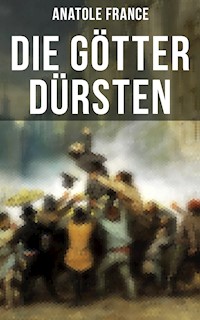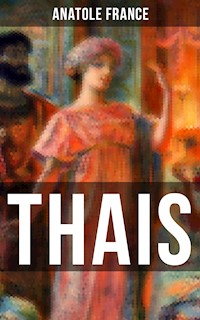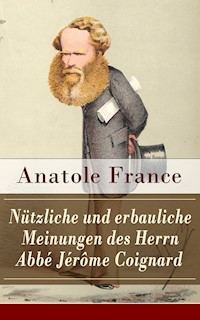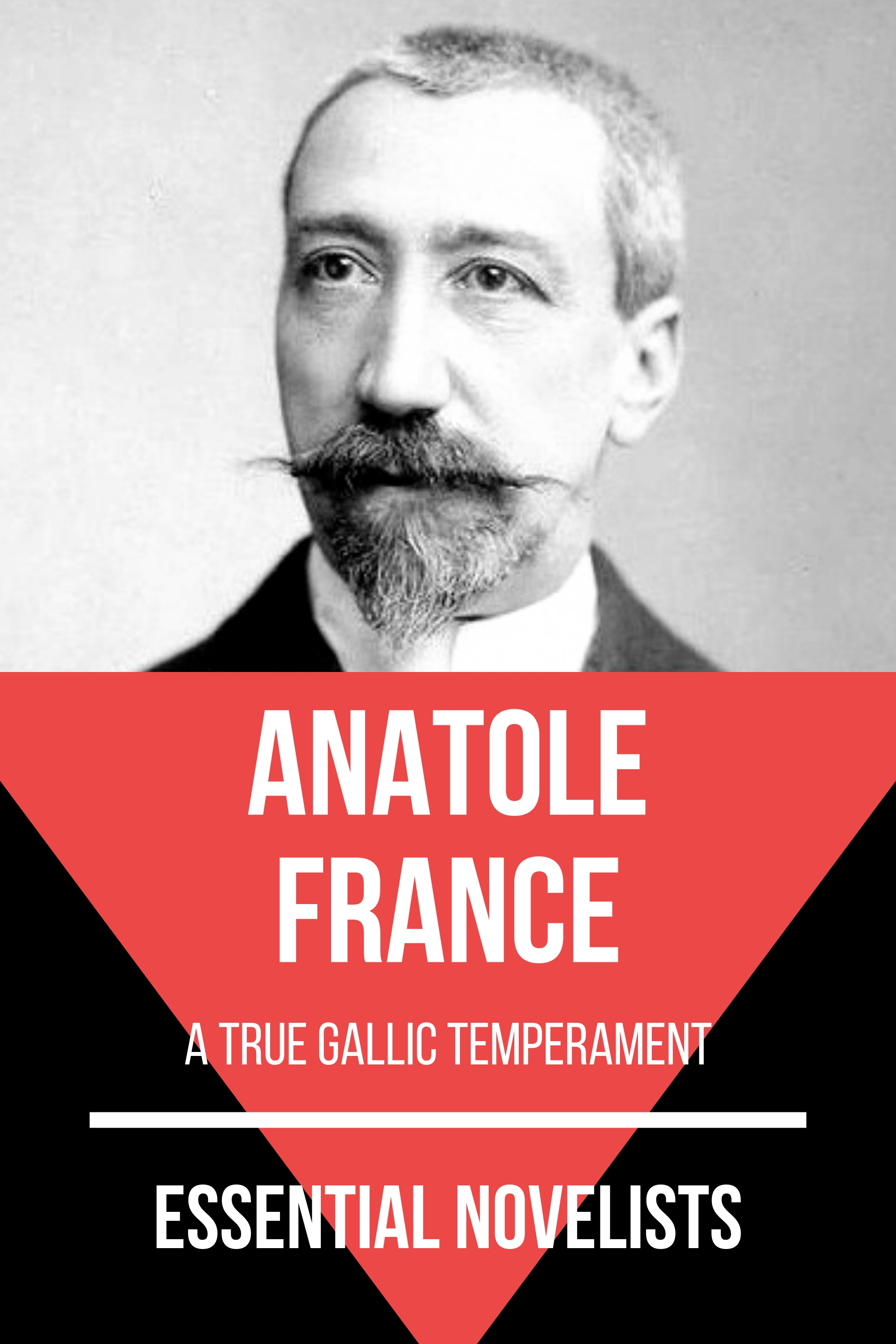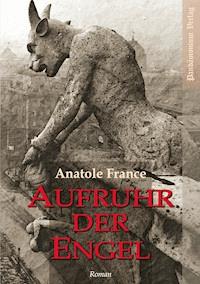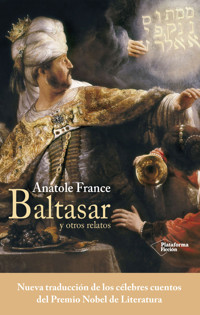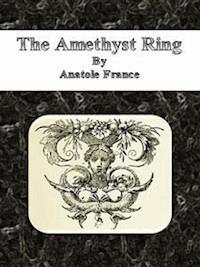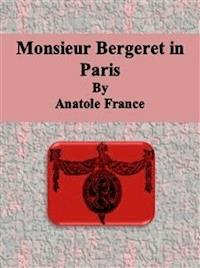Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Extrait : "Au milieu du chemin de la vie... Ce vers, par lequel Dante commence la première cantique de la Divine comédie, me vient à la penséec ce soir, pour la centième fois peut-être. Mais c'est la première fois qu'il me touche. Avec quel intérêt je le repasse en esprit, et comme je le trouve sérieux et plein !"
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
31 décembre 188…
Ce vers, par lequel Dante commence la première cantique de la Divine Comédie, me vient à la pensée, ce soir, pour la centième fois peut-être. Mais c’est la première fois qu’il me touche.
Avec quel intérêt je le repasse en esprit, et comme je le trouve sérieux et plein ! C’est qu’à ce coup j’en puis faire l’application à moi-même. Je suis, à mon tour, au point où fut Dante quand le vieux soleil marqua la première année du XIVe siècle. Je suis au milieu du chemin de la vie, à supposer ce chemin égal pour tous et menant à la vieillesse.
Mon Dieu ! je savais, il y a vingt ans, qu’il faudrait en arriver là : je le savais, mais je ne le sentais pas. Je me souciais alors du milieu du chemin de la vie comme de la route de Chicago. Maintenant que j’ai gravi la côte, je retourne la tête pour embrasser d’un regard tout l’espace que j’ai traversé si vite, et le vers du poète florentin me remplit d’une telle rêverie, que je passerais volontiers la nuit devant mon feu à soulever des fantômes. Les morts sont si légers, hélas !
Il est doux de se souvenir. Le silence de la nuit y invite. Son calme apprivoise les revenants, qui sont timides et fuyants par nature et veulent l’ombre avec la solitude pour venir parler à l’oreille de leurs amis vivants. Les rideaux des fenêtres sont tirés, les portières pendent à plis lourds sur le tapis. Seule une porte est entrouverte, là, du côté où mes yeux se tournent par instinct. Il en sort une lueur d’opale ; il en vient des souffles égaux et doux, dans lesquels je ne saurais distinguer moi-même celui de la mère de ceux des enfants.
Dormez, chéris, dormez !
Au coin du feu qui meurt, je rêve et je me figure que cette maison de famille, avec la chambre où luit en tremblant la veilleuse et d’où s’exhalent ces souffles purs, est une auberge isolée sur cette grand-route dont j’ai déjà suivi la moitié.
Dormez, chéris ; nous repartirons demain !
Demain ! Il fut un temps où ce mot contenait pour moi la plus belle des magies. En le prononçant, je voyais des figures inconnues et charmantes me faire signe du doigt et murmurer : « Viens ! » J’aimais tant la vie, alors ! J’avais en elle la belle confiance d’un amoureux, et je ne pensais pas qu’elle pût me devenir sévère, elle qui pourtant est sans pitié.
Je ne l’accuse pas. Elle ne m’a pas fait les blessures qu’elle a faites à tant d’autres. Elle m’a même quelquefois caressé par hasard, la grande indifférente ! En retour de ce qu’elle m’a pris ou refusé, elle m’a donné des trésors auprès desquels tout ce que je désirais n’était que cendre et fumée. Malgré tout, j’ai perdu l’espérance, et maintenant je ne puis entendre dire : « à demain ! » sans éprouver un sentiment d’inquiétude et de tristesse.
Non ! je n’ai plus confiance en mon ancienne amie la vie. Mais je l’aime encore. Tant que je verrai son divin rayon briller sur trois fronts blancs, sur trois fronts aimés, je dirai qu’elle est belle et je la bénirai.
Il y a des heures où tout me surprend, des heures où les choses les plus simples me donnent le frisson du mystère.
Ainsi, il me paraît, en ce moment, que la mémoire est une faculté merveilleuse et que le don de faire apparaître le passé est aussi étonnant et bien meilleur que le don de voir l’avenir.
C’est un bienfait que le souvenir. La nuit est calme, j’ai rassemblé les tisons dans la cheminée et ranimé le feu.
Dormez, chéris, dormez !
J’écris mes souvenirs d’enfance et c’est
POUR VOUS TROIS
Les personnes qui m’ont dit ne se rien rappeler des premières années de leur enfance m’ont beaucoup surpris. Pour moi, j’ai gardé de vifs souvenirs du temps où j’étais un très petit enfant. Ce sont, il est vrai, des images isolées, mais qui, par cela même, ne se détachent qu’avec plus d’éclat sur un fond obscur et mystérieux. Bien que je sois encore assez éloigné de la vieillesse, ces souvenirs, que j’aime, me semblent venir d’un passé infiniment profond. Je me figure qu’alors le monde était dans sa magnifique nouveauté et tout revêtu de fraîches couleurs. Si j’étais un sauvage, je croirais le monde aussi jeune ou, si vous voulez, aussi vieux que moi. Mais j’ai le malheur de n’être point un sauvage. J’ai lu beaucoup de livres sur l’antiquité de la terre et l’origine des espèces, et je mesure avec mélancolie la courte durée des individus à la longue durée des races. Je sais donc qu’il n’y a pas très longtemps que j’avais mon lit à galerie dans une grande chambre d’un vieil hôtel fort déchu, qui a été démoli depuis pour faire place aux bâtiments neufs de l’École des Beaux-Arts. C’est là qu’habitait mon père, modeste médecin et grand collectionneur de curiosités naturelles. Qui est-ce qui dit que les enfants n’ont pas de mémoire ? Je la vois encore, cette chambre, avec son papier vert à ramages et une jolie gravure en couleur qui représentait, comme je l’ai su depuis, Virginie traversant dans les bras de Paul le gué de la rivière Noire. Il m’arriva dans cette chambre des aventures extraordinaires.
J’y avais, comme j’ai dit, un petit lit à galerie qui restait tout le jour dans un coin et que ma mère plaçait, chaque nuit, au milieu de la chambre, sans doute pour le rapprocher du sien, dont les rideaux immenses me remplissaient de crainte et d’admiration. C’était toute une affaire de me coucher. Il y fallait des supplications, des larmes, des embrassements. Et ce n’était pas tout : je m’échappais en chemise et je sautais comme un lapin. Ma mère me rattrapait sous un meuble pour me mettre au lit. C’était très gai.
Mais à peine étais-je couché, que des personnages tout à fait étrangers à ma famille se mettaient à défiler autour de moi. Ils avaient des nez en bec de cigogne, des moustaches hérissées, des ventres pointus et des jambes comme des pattes de coq. Ils se montraient de profil, avec un œil rond au milieu de la joue et défilaient, portant balais, broches, guitares, seringues et quelques instruments inconnus. Laids comme ils étaient, ils n’auraient pas dû se montrer ; mais je dois leur rendre une justice : ils se coulaient sans bruit le long du mur et aucun d’eux, pas même le plus petit et le dernier, qui avait un soufflet au derrière, ne fit jamais un pas vers mon lit. Une force les retenait visiblement aux murs le long desquels ils glissaient sans présenter une épaisseur appréciable. Cela me rassurait un peu ; d’ailleurs, je veillais. Ce n’est pas en pareille compagnie, vous pensez bien, qu’on ferme l’œil. Je tenais mes yeux ouverts. Et pourtant (cela est un autre prodige) je me retrouvais tout à coup dans la chambre pleine de soleil, n’y voyant que ma mère en peignoir rose et ne sachant pas du tout comment la nuit et les monstres s’en étaient allés.
– Quel dormeur tu fais ! disait ma mère en riant.
Il fallait, en effet, que je fusse un fameux dormeur.
Hier, en flânant sur les quais, je vis dans la boutique d’un marchand de gravures un de ces cahiers de grotesques dans lesquels le lorrain Callot exerça sa pointe fine et dure et qui se sont fait rares. Au temps de mon enfance, une marchande d’estampes, la mère Mignot, notre voisine, en tapissait tout un mur, et je les regardais chaque jour, en allant à la promenade et en en revenant ; je nourrissais mes yeux de ces monstres, et, quand j’étais couché dans mon petit lit à galerie, je les revoyais sans avoir l’esprit de les reconnaître. Ô magie de Jacques Callot !
Le petit cahier que je feuilletais réveilla en moi tout un monde évanoui, et je sentis s’élever dans mon âme comme une poussière embaumée au milieu de laquelle passaient des ombres chéries.
En ce temps-là, deux dames habitaient la même maison que nous, deux dames vêtues l’une tout de blanc, l’autre tout de noir.
Ne me demandez pas si elles étaient jeunes : cela passait ma connaissance. Mais je sais qu’elles sentaient bon et qu’elles avaient toute sorte de délicatesses. Ma mère, fort occupée et qui n’aimait pas à voisiner, n’allait guère chez elles. Mais j’y allais souvent, moi, surtout à l’heure du goûter, parce que la dame en noir me donnait des gâteaux. Donc, je faisais seul mes visites. Il fallait traverser la cour. Ma mère me surveillait de sa fenêtre, et frappait sur les vitres quand je m’oubliais trop longtemps à contempler le cocher qui pansait ses chevaux. C’était tout un travail de monter l’escalier à rampe de fer, dont les hauts degrés n’avaient point été faits pour mes petites jambes. J’étais bien payé de ma peine dès que j’entrais dans la chambre des dames ; car il y avait là mille choses qui me plongeaient dans l’extase. Mais rien n’égalait les deux magots de porcelaine qui se tenaient assis sur la cheminée, de chaque côté de la pendule. D’eux-mêmes, ils hochaient la tête et tiraient la langue. J’appris qu’ils venaient de Chine et je me promis d’y aller. La difficulté était de m’y faire conduire par ma bonne. J’avais acquis la certitude que la Chine était derrière l’Arc de Triomphe, mais je ne trouvais jamais moyen de pousser jusque-là.
Il y avait aussi, dans la chambre des dames, un tapis à fleurs, sur lequel je me roulais avec délices, et un petit canapé doux et profond, dont je faisais tantôt un bateau, tantôt un cheval ou une voiture. La dame en noir, un peu grasse, je crois, était très douce et ne me grondait jamais. La dame en blanc avait ses impatiences et ses brusqueries, mais elle riait si joliment ! Nous faisions bon ménage tous les trois, et j’avais arrangé dans ma tête qu’il ne viendrait jamais que moi dans la chambre aux magots. La dame en blanc, à qui je fis part de cette décision, se moqua bien un peu de moi, à ce qu’il me sembla ; mais j’insistai et elle me promit tout ce que je voulus.
Elle promit. Un jour pourtant, je trouvai un monsieur assis dans mon canapé, les pieds sur mon tapis et causant avec mes dames d’un air satisfait. Il leur donna même une lettre qu’elles lui rendirent après l’avoir lue. Cela me déplut, et je demandai de l’eau sucrée parce que j’avais soif et aussi pour qu’on fît attention à moi. En effet, le monsieur me regarda.
– C’est un petit voisin, dit la dame en noir.
– Sa mère n’a que celui-là, n’est-il pas vrai ? reprit le monsieur.
– Il est vrai, dit la dame en blanc. Mais qu’est-ce qui vous a fait croire cela ?
– C’est qu’il a l’air d’un enfant bien gâté, reprit le monsieur. Il est indiscret et curieux. En ce moment, il ouvre des yeux comme des portes cochères.
C’était pour le mieux voir. Je ne veux pas me flatter, mais je compris admirablement, après la conversation, que la dame en blanc avait un mari qui était quelque chose dans un pays lointain, que le visiteur apportait une lettre de ce mari, qu’on le remerciait de son obligeance, et qu’on le félicitait d’avoir été nommé premier secrétaire. Tout cela ne me contenta pas et, en m’en allant, je refusai d’embrasser la dame en blanc, pour la punir.
Ce jour-là, au dîner, je demandai à mon père ce que c’était qu’un secrétaire. Mon père ne me répondit point, et ma mère me dit que c’était un petit meuble dans lequel on range des papiers. Conçoit-on cela ? On me coucha, et les monstres, avec un œil au milieu de la joue, défilèrent autour de mon lit en faisant plus de grimaces que jamais.
Si vous croyez que je pensai le lendemain au monsieur que j’avais trouvé chez la dame en blanc, vous vous trompez ; car je l’avais oublié de tout mon cœur, et il n’eût tenu qu’à lui d’être à jamais effacé de ma mémoire. Mais il eut l’audace de se représenter chez mes deux amies. Je ne sais si ce fut dix jours ou dix ans après ma première visite. J’incline à croire aujourd’hui que ce fut dix jours. Il était étonnant, ce monsieur de prendre ainsi ma place. Je l’examinai, cette fois, et ne lui trouvai rien d’agréable. Il avait des cheveux très brillants, des moustaches noires, des favoris noirs, un menton rasé avec une fossette au milieu, la taille fine, de beaux habits, et sur tout cela un air de contentement. Il parlait du cabinet du ministre des Affaires étrangères, des pièces de théâtre, des modes et des livres nouveaux, des soirées et des bals dans lesquels il avait vainement cherché ces dames. Et elles l’écoutaient ! Était-ce une conversation, cela ? Et ne pouvait-il parler comme faisait avec moi la dame en noir, du pays où les montagnes sont en caramel, et les rivières en limonade ?
Quand il fut parti, la dame en noir dit que c’était un jeune homme charmant. Je dis, moi, qu’il était vieux et qu’il était laid. Cela fit beaucoup rire la dame en blanc. Ce n’était pas risible, pourtant. Mais voilà, elle riait de ce que je disais ou bien elle ne m’écoutait pas parler. La dame en blanc avait ces deux défauts, sans compter un troisième qui me désespérait : celui de pleurer, de pleurer, de pleurer. Ma mère m’avait dit que les grandes personnes ne pleuraient jamais. Ah ! c’est qu’elle n’avait pas vu comme moi la dame en blanc, tombée de côté sur un fauteuil, une lettre ouverte sur ses genoux, la tête renversée et son mouchoir sur les yeux. Cette lettre (je parierais aujourd’hui que c’était une lettre anonyme) lui faisait bien de la peine. C’était dommage, car elle savait si bien rire ! Ces deux visites me donnèrent l’idée de la demander en mariage. Elle me dit qu’elle avait un grand mari en Chine, qu’elle en aurait un petit sur le quai Malaquais ; ce fut arrangé, et elle me donna un gâteau.
Mais le monsieur aux favoris noirs revenait bien souvent. Un jour que la dame en blanc me contait qu’elle ferait venir pour moi de Chine des poissons bleus, avec une ligne pour les pêcher, il se fit annoncer et fut reçu. À la façon dont nous nous regardâmes, il était clair que nous ne nous aimions pas. La dame en blanc lui dit que sa tante (elle voulait dire la dame en noir) était allée faire une emplette aux Deux Magots. Je voyais les deux magots sur la cheminée et je ne concevais pas qu’il fallût sortir pour leur acheter quoi que ce fût. Mais il se présente tous les jours des choses si difficiles à comprendre ! Le monsieur ne parut nullement affligé de l’absence de la dame en noir, et il dit à la dame en blanc qu’il voulait lui parler sérieusement. Elle s’arrangea avec coquetterie dans sa causeuse et lui fit signe qu’elle l’écoutait. Cependant il me regardait et semblait embarrassé.
– Il est très gentil, ce petit garçon, dit-il enfin, en me passant la main sur la tête ; mais…
– C’est mon petit mari, dit la dame en blanc.
– Eh bien ! reprit le monsieur, ne pourriez-vous le renvoyer à sa mère ? Ce que j’ai à vous dire ne doit être entendu que de vous.
Elle lui céda.
– Chéri, me dit-elle, va jouer dans la salle à manger, et ne reviens que quand je t’appellerai. Va, chéri !
J’y allai le cœur gros. Elle était pourtant très curieuse, la salle à manger, à cause d’un tableau à horloge qui représentait une montagne au bord de la mer avec une église, sous un ciel bleu. Et quand l’heure sonnait, un navire s’agitait sur les flots, une locomotive avec ses voitures sortait d’un tunnel et un ballon s’élevait dans les airs. Mais, quand l’âme est triste, rien ne peut lui sourire. D’ailleurs, le tableau à horloge restait immobile. Il paraît que la locomotive, le navire et le ballon ne partaient que toutes les heures, et c’est long, une heure ! Du moins, ce l’était en ce temps-là. Par bonheur, la cuisinière vint chercher quelque chose dans le buffet et, me voyant tout triste, me donna des confitures qui charmèrent les peines de mon cœur. Mais, quand je n’eus plus de confitures, je retombai dans le chagrin. Bien que le tableau à horloge n’eût pas encore sonné, je me figurais que des heures et des heures s’amoncelaient sur ma triste solitude. Par moments, il me venait de la chambre voisine quelques éclats de la voix du monsieur ; il suppliait la dame en blanc, puis il semblait en colère contre elle. C’était bien fait. Mais n’en finiraient-ils donc jamais ? Je m’aplatis le nez contre les vitres, je tirai des crins aux chaises, j’agrandis les trous du papier de tenture, j’arrachai les franges des rideaux, que sais-je ? L’ennui est une terrible chose. Enfin, n’y pouvant plus tenir, je m’avançai sans bruit jusqu’à la porte qui donnait accès dans la chambre aux magots et je haussai le bras pour atteindre le bouton. Je savais bien que je faisais une action indiscrète et mauvaise ; mais cela même me donnait une espèce d’orgueil.
J’ouvris la porte et je trouvai la dame en blanc debout contre la cheminée. Le monsieur, à genoux à ses pieds, ouvrait de grands bras comme pour la prendre. Il était plus rouge qu’une crête de coq ; les yeux lui sortaient de la tête. Peut-on se mettre dans un état pareil ?
– Cessez, monsieur, disait la dame en blanc, qui était plus rose que de coutume et très agitée… Cessez, puisque vous me dites que vous m’aimez ; cessez… et ne me faites pas regretter…
Et elle avait l’air de le craindre et d’être à bout de forces.
Il se releva vite en me voyant, et je crois bien qu’il eut un moment l’idée de me jeter par la fenêtre. Mais elle, au lieu de me gronder comme je m’y attendais, me serra dans ses bras en m’appelant son chéri.
M’ayant emporté sur le canapé, elle pleura longtemps et doucement sur ma joue. Nous étions seuls. Je lui dis, pour la consoler, que le monsieur aux favoris était un vilain homme et qu’elle n’aurait pas de chagrin si elle était restée seule avec moi, comme c’était convenu. Mais, c’est égal, je trouvai que les grandes personnes étaient quelquefois bien drôles.
À peine étions-nous remis, que la dame en noir entra avec des paquets.
Elle demanda s’il n’était venu personne.
– Monsieur Arnould est venu, répondit tranquillement la dame en blanc ; mais il n’est resté qu’une seconde.
Pour cela, je savais bien que c’était un mensonge ; mais le bon génie de la dame en blanc, qui sans doute était avec moi depuis quelques instants, me mit son doigt invisible sur la bouche.
Je ne revis plus M. Arnould, et mes amours avec la dame en blanc ne furent plus troublées ; c’est pourquoi, sans doute, je n’en ai pas gardé le souvenir. Hier encore, c’est-à-dire après plus de trente ans, je ne savais pas ce qu’elle était devenue.
Hier, j’allai au bal du ministre des Affaires étrangères. Je suis de l’avis de lord Palmerston, qui disait que la vie serait supportable sans les plaisirs. Mon travail quotidien n’excède ni mes forces, ni mon intelligence, et j’ai pu parvenir à m’y intéresser. Ce sont les réceptions officielles qui m’accablent. Je savais qu’il serait fastidieux et inutile d’aller au bal du ministre ; je le savais et j’y allai, parce qu’il est dans la nature humaine de penser sagement et d’agir d’une façon absurde.
À peine étais-je entré dans le grand salon, qu’on annonça l’ambassadeur de *** et madame ***. J’avais rencontré plusieurs fois l’ambassadeur, dont la figure fine porte l’empreinte de fatigues qui ne sont point toutes dues aux travaux de la diplomatie. Il eut, dit-on, une jeunesse orageuse et il court sur son compte, dans les réunions d’hommes, plusieurs anecdotes galantes. Son séjour en Chine, il y a trente ans, est particulièrement riche en aventures qu’on aime à conter à huis clos en prenant le café. Sa femme, que je n’avais pas l’honneur de connaître, me sembla passer la cinquantaine. Elle était tout en noir ; de magnifiques dentelles enveloppaient admirablement sa beauté passée, dont l’ombre s’entrevoyait encore. Je fus heureux de lui être présenté ; car j’estime infiniment la conversation des femmes âgées. Nous causâmes de mille choses, au son des violons qui faisaient danser les jeunes femmes, et elle en vint à me parler par hasard du temps où elle logeait dans un vieil hôtel du quai Malaquais.
– Vous étiez la dame en blanc ! m’écriai-je.
– En effet, monsieur, me dit-elle ; je m’habillais toujours en blanc.
– Et moi, madame, j’étais votre petit mari.
– Quoi ! monsieur, vous êtes le fils de cet excellent docteur Nozière ? Vous aimiez beaucoup les gâteaux. Les aimez-vous encore ? Venez donc en manger chez nous. Nous avons tous les samedis un petit thé intime. Comme on se retrouve !
– Et la dame en noir ?
– C’est moi qui suis aujourd’hui la dame en noir. Ma pauvre tante est morte l’année de la guerre. Dans les derniers temps de sa vie elle parlait souvent de vous.
Tandis que nous causions ainsi, un monsieur à moustache et à favoris blancs salua respectueusement l’ambassadrice, avec toutes les grâces raides d’un vieux beau. Il me semblait bien reconnaître son menton.
– Monsieur Arnould, me dit-elle, un vieil ami.
Nous habitions un grand appartement plein de choses étranges. Il y avait sur les murs des trophées d’armes sauvages surmontés de crânes et de chevelures ; des pirogues avec leurs pagaies étaient suspendues aux plafonds, côte à côte avec des alligators empaillés ; les vitrines contenaient des oiseaux, des nids, des branches de corail et une infinité de petits squelettes qui semblaient pleins de rancune et de malveillance. Je ne savais quel pacte mon père avait fait avec ces créatures monstrueuses, je le sais maintenant : c’était le pacte du collectionneur. Lui, si sage et si désintéressé, il rêvait de fourrer la nature entière dans une armoire. C’était dans l’intérêt de la science ; il le disait, il le croyait ; en fait, c’était par manie de collectionneur.
Tout l’appartement était rempli de curiosités naturelles. Seul, le petit salon n’avait été envahi ni par la zoologie, ni par la minéralogie, ni par l’ethnographie, ni par la tératologie ; là, ni écailles de serpents, ni carapaces de tortues, point d’ossements, point de flèches de silex, point de tomahawks, seulement des roses. Le papier du petit salon en était semé. C’étaient des roses en bouton, closes, modestes, toutes pareilles et toutes jolies.
Ma mère, qui avait des griefs sérieux contre la zoologie comparée et la mensuration des crânes, passait sa journée dans le petit salon, devant sa table à ouvrage. Je jouais à ses pieds sur le tapis, avec un mouton qui n’avait que trois pieds, après en avoir eu quatre, en quoi il était indigne de figurer avec les lapins à deux têtes dans la collection tératologique de mon père ; j’avais aussi un polichinelle qui remuait les bras et sentait la peinture : il fallait que j’eusse en ce temps-là beaucoup d’imagination, car ce polichinelle et ce mouton me représentaient les personnages divers de mille drames curieux. Quand il arrivait quelque chose de tout à fait intéressant au mouton ou au polichinelle, j’en faisais part à ma mère. Toujours inutilement. Il est à remarquer que les grandes personnes ne comprennent jamais bien ce qu’expliquent les petits enfants. Ma mère était distraite. Elle ne m’écoutait pas avec assez d’attention. C’était son grand défaut. Mais elle avait une façon de me regarder avec ses grands yeux et de m’appeler « petit bêta », qui raccommodait les choses.
Un jour, dans le petit salon, laissant sa broderie, elle me souleva dans ses bras et, me montrant une des fleurs du papier, elle me dit :
– Je te donne cette rose.
Et, pour la reconnaître, elle la marqua d’une croix avec son poinçon à broder.
Jamais présent ne me rendit plus heureux.
– Il a l’air d’un brigand, mon petit garçon, avec ses cheveux ébouriffés ! Coiffez-le « aux enfants d’Édouard », monsieur Valence.
M. Valence, à qui ma mère parlait de la sorte, était un vieux perruquier agile et boiteux, dont la seule vue me rappelait une odeur écœurante de fers chauds, et que je redoutais, tant à cause de ses mains grasses de pommade que parce qu’il ne pouvait me couper les cheveux sans m’en laisser tomber dans le cou. Aussi, quand il me passait un peignoir blanc et qu’il me nouait une serviette autour du cou, je résistais, et il me disait :
– Tu ne veux pourtant pas, mon petit ami, rester avec une chevelure de sauvage, comme si tu sortais du radeau de la Méduse.
Il racontait à tout propos, de sa voix vibrante de Méridional, le naufrage de la Méduse, dont il n’avait échappé qu’après d’effroyables misères. Le radeau, les inutiles signaux de détresse, les repas de chair humaine, il disait tout cela avec la belle humeur de quelqu’un qui prend les choses par leur bon côté ; car c’était un homme jovial, M. Valence !
Ce jour-là, il m’accommoda trop lentement la tête à mon gré, et d’une façon que je jugeai bien étrange dès que je pus me regarder dans la glace. Je me vis alors les cheveux rabattus et taillés droit comme un bonnet au-dessus des sourcils et tombant sur les joues comme des oreilles d’épagneul.
Ma mère était ravie : Valence m’avait véritablement coiffé aux enfants d’Édouard. Vêtu comme je l’étais d’une blouse de velours noir, on n’avait plus, disait-elle, qu’à m’enfermer dans la tour avec mon frère aîné…
– Si l’on ose ! ajouta-t-elle, en me soulevant dans ses bras avec une crânerie charmante.
Et elle me porta, étroitement embrassé, jusqu’à la voiture. Car nous allions en visite.
Je lui demandai quel était ce frère aîné que je ne connaissais pas et cette tour qui me faisait peur.
Et ma mère, qui avait la divine patience et la simplicité joyeuse des âmes dont la seule affaire en ce monde est d’aimer, me conta, dans un babil enfantin et poétique, comment les deux enfants du roi Édouard, qui étaient beaux et bons, furent arrachés à leur mère et étouffés dans un cachot de la tour de Londres par leur méchant oncle Richard.
Elle ajouta, s’inspirant selon toute apparence d’une peinture à la mode, que le petit chien des enfants aboya pour les avertir de l’approche des meurtriers.
Elle finit en disant que cette histoire était très ancienne, mais si touchante et si belle, qu’on ne cessait d’en faire des peintures et de la représenter sur les théâtres, et que tous les spectateurs pleuraient, et qu’elle avait pleuré comme eux.
Je dis à maman qu’il fallait être bien méchant pour la faire pleurer ainsi, elle et tout le monde.
Elle me répondit qu’il y fallait, au contraire, une grande âme et un beau talent, mais je ne la compris pas. Je n’entendais rien alors à la volupté des larmes.
La voiture nous arrêta dans l’Île Saint-Louis, devant une vieille maison que je ne connaissais pas. Et nous montâmes un escalier de pierre, dont les marches usées et fendues me faisaient grise mine.
Au premier tournant, un petit chien se mit à japper : « C’est lui, pensai-je, c’est le chien des enfants d’Édouard ». Et une peur subite, invincible, folle, s’empara de moi. Évidemment, cet escalier, c’était celui de la tour, et, avec mes cheveux découpés en bonnet et ma blouse de velours, j’étais un enfant d’Édouard. On allait me faire mourir. Je ne voulais pas ; je me cramponnai à la robe de ma mère en criant :
– Emmène-moi, emmène-moi ! Je ne veux pas monter dans l’escalier de la tour.
– Tais-toi donc, petit sot… Allons, allons, mon chéri, n’aie pas peur… Cet enfant est vraiment trop nerveux… Pierre, Pierre, mon petit bonhomme, sois raisonnable.
Mais, pendu à sa jupe, raidi, crispé, je n’entendais rien ; je criais, je hurlais, j’étouffais. Mes regards, pleins d’horreur, nageaient dans les ombres animées par la peur féconde.
À mes cris, une porte s’ouvrit sur le palier et il en sortit un vieux monsieur en qui, malgré mon épouvante et malgré son bonnet grec et sa robe de chambre, je reconnus mon ami Robin, Robin mon ami, qui m’apportait une fois la semaine des gâteaux secs dans la coiffe de son chapeau. C’était Robin lui-même ; mais je ne pouvais concevoir qu’il fût dans la tour, ne sachant pas que la tour était une maison, et que, cette maison étant vieille, il était naturel que ce vieux monsieur y habitât.
Il nous tendit les bras avec sa tabatière dans la main gauche et une pincée de tabac entre le pouce et l’index de la main droite. C’était lui.
– Entrez donc, chère dame ! ma femme va mieux ; elle sera enchantée de vous voir. Mais maître Pierre, à ce qu’il me semble, n’est pas très rassuré. Est-ce notre petite chienne qui lui fait peur ? – Ici, Finette.
J’étais rassuré ; je dis :
– Vous demeurez dans une vilaine tour, monsieur Robin.
À ces mots, ma mère me pinça le bras dans l’intention, que je saisis fort bien, de m’empêcher de demander un gâteau à mon bon ami Robin, ce que précisément j’allais faire.
Dans le salon jaune de monsieur et madame Robin, Finette me fut d’un grand secours. Je jouai avec elle et ceci me resta dans l’esprit qu’elle avait aboyé aux meurtriers des enfants d’Édouard. C’est pourquoi je partageai avec elle le gâteau que M. Robin me donna. Mais on ne peut s’occuper longtemps du même objet, surtout quand on est un petit enfant. Mes pensées sautèrent d’une chose à l’autre, comme des oiseaux de branche en branche, puis se reposèrent de nouveau sur les enfants d’Édouard. M’étant fait à leur égard une opinion, j’étais pressé de la produire. Je tirai M. Robin par la manche.
– Dis-donc, monsieur Robin, vous savez, si maman avait été dans la tour de Londres, elle aurait empêché le méchant oncle d’étouffer les enfants d’Édouard sous leurs oreillers.