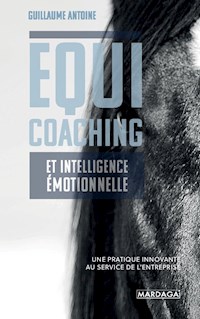Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Quand le souvenir de la grande amitié de son adolescence ressurgit, Antoine Guillaume en revit l’histoire pour mieux la partager. Construit sur une passion commune pour l’art, ce récit puise son sel dans l’insouciance de la jeunesse et confronte l’auteur à la découverte de la différence. Bien que l’ombre de la maladie en contrarie brusquement la trajectoire, la narration se veut tranquille et débarrassée de la rage impuissante que nourrit l’injustice du destin.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Antoine Guillaume exerce comme médecin anesthésiste-réanimateur en région lyonnaise. Dans Le loup y était, il nous livre une partie de sa mémoire au travers d’un récit intime et dramatique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antoine Guillaume
Le loup y était
© Lys Bleu Éditions – Antoine Guillaume
ISBN : 979-10-377-7152-0
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
À toi
À Geneviève,
À monsieur Lion,
À Laurence,
À Claire, indéfectible complice…
Je me réveille et plane sur mes rêves
Les cadavres debout de mes amis d’enfance
Et je me réveille dans l’éther acide de la mort
Qui ronge ma peau, mon moral.
On y passera tous, tous.
Les petits lutins de ma mémoire,
Mes compagnons d’histoire,
Qui me dira pourquoi, tous ?
Étions-nous si méchants
Qu’on doive le payer si chèrement ?
Étions-nous vraiment de trop
Que cette vie nous efface si tôt ?
Mano Solo, Mes amis d’enfance
(Les années sombres, 1995)
Didier
Nous nous rendons chez la sœur de mon amie Laurence, Hélène, dont le pauvre corps est rongé par le « crabe ». Il ne s’agit pas de lui dire au revoir, mais bien de passer un dernier moment ensemble.
D’un trait, notre voiture enjambe l’île de la Jatte. Après avoir traversé la Seine, Claire m’agrippe le bras : « Ce n’est pas là qu’habitait Didier ? » Effectivement, la petite boutique de décoration « Diagonale » a toujours pignon sur rue. Comment ne l’avons-nous pas vue la dernière fois que nous sommes venus ici ? Étrange coïncidence car nous avons évoqué le souvenir de Didier quelques jours auparavant. Nous gardons sur une étagère la boîte en bois peint que Jean-Marie et lui nous avaient offerte quand nous nous sommes mariés. Pour moi, Didier est sans doute mort depuis longtemps, sous le regard impuissant d’une médecine désemparée, comme toute cette première génération de victimes du SIDA, pestiférés des temps modernes. Nous nous garons dans une petite rue tout près puis nous nous plantons devant cette petite maison que nous connaissons bien. Rien n’a changé.
Claire remarque que le numéro de téléphone n’a toujours que six chiffres. Nous en déduisons que le lieu n’a peut-être pas changé de propriétaire et je me prends à espérer que je me suis trompé et que Didier est toujours de ce monde. Nous sonnons. Personne ne nous répond. Pourtant, la fenêtre du premier étage est entrouverte. Je me promets d’appeler Didier la prochaine fois que nous viendrons à Paris. Imaginer qu’il est bien vivant faisant, du même coup, un somptueux pied de nez à la maladie et à l’injustice me met du baume au cœur. J’ai une pensée pour toi en repartant. J’imagine que, là où tu es, tu t’amuses encore. Tu aimais tant rire…
Hélène
Gonflés par ce souffle d’espoir inattendu, nous arrivons chez Hélène. Son jardin est merveilleux, toujours aussi coquet. Elle nous accueille d’un lumineux sourire. Elle est maigre, frêle, si pâle. Son corps décharné apparaît tellement fragile qu’il s’en échappe une étrange légèreté.
Tout se déroule comme si la maladie était un passager clandestin : ni invitée ni désirée. Hélène fait manger ses enfants. Nous parlons de tout et de rien. Par moment, la lassitude tente de reprendre ses droits sur notre pauvre amie. Son esprit semble s’envoler puis elle revient à notre conversation avec toute sa vivacité. Qui irait imaginer son cerveau truffé de métastases ? Olivier, son mari, est calme et paisible. Il continue de vivre comme si rien ne se passait. Tous deux impressionnent. Leur élégance dans l’adversité est une leçon. Personne n’est dupe. Nous savons tous que le fil fragile de la vie d’Hélène va se rompre incessamment.
Sur le mur du bureau sont affichés les résultats d’un test ADN : alors qu’elles vont se quitter, Laurence et Hélène ont voulu savoir si elles étaient de vraies jumelles. Elles sont les seules à en douter. Pourquoi une telle démarche ? Savoir que l’être qui s’éteint était bien son double donnera-t-il à Laurence du courage ou au contraire augmentera plus encore sa douleur ? Aura-t-elle le sentiment de perdre une part d’elle-même ou trouvera-t-elle la force de continuer à faire vivre en elle cette sœur qu’elle aimait tant ?
Leur maman est morte de la même maladie. Laurence m’a confié sa souffrance d’assister, impuissante, à ce jeu de miroirs où sombrent dans la même spirale celles qui lui sont si proches. J’ai vu les larmes de l’incompréhension lui monter aux yeux. Je l’ai entendue implorer le miracle qui ne viendra pas, étouffer sa révolte par une résignation absurde. Mon cœur s’est serré.
Hélène se plaint de l’épaule. Cette douleur nouvelle allume aussitôt un éclair d’alerte dans les yeux de sa sœur. Ce regard si las déjà. Une métastase pleurale ? Laurence encaisse… Encore…
Claire part en début d’après-midi pour la Bretagne. Je ne m’en retournerai à Lyon qu’en fin de journée. Comme elle démarre, Olivier et moi remarquons que le coffre de sa voiture est mal fermé. Nous nous élançons pour la rattraper. Hélène sourit en nous voyant revenir. « Je n’avais jamais vu mon mari courir. », s’amuse-t-elle. Elle rajoute que Claire et moi n’avons pas changé. J’en suis touché. Alors qu’à l’encontre des apparences je serais sincère, je n’ose guère avancer que, selon moi, Olivier et elle restent également fidèles à eux-mêmes. Elle n’y verrait sans doute que provocation ou flatterie déplacée. Pour eux, l’avenir va prendre un brusque tournant. Grignotée par le mal, la vie d’Hélène va incessamment s’effacer.
Nous finissons l’après-midi avec les cousins de Laurence et d’Hélène et leur fils Edgar, mon adorable filleul.
Ce dernier repas entrera au registre des bons souvenirs. Comment mieux honorer ces derniers instants ? Je sais qu’Hélène aussi a apprécié ce moment. Son mari étonne : doux, présent sans en faire plus. Rien ne transparaît dans la sérénité qu’il affiche. Une leçon de vie nous a été donnée.
Patrick
Je regrette que, tous les deux, nous n’ayons pas pu vivre ainsi notre dernière rencontre. Te souviens-tu de ce jour ? Claire et moi étions passés te voir à l’hôpital alors que nous nous rendions au mariage de Laurence. Nos tenues annonçaient la joie de la fête à venir. Comme je venais te voir chaque fois que je le pouvais, probablement tu m’attendais.
Ta déchéance faisait peur. J’en aurais vomi. Pauvre corps décharné. Épuisé, sans flamme, rongé par l’angoisse du néant, de l’après, tu n’avais plus de force. Tu attendais, résigné, ne t’exprimant presque plus. Le spectacle que tu nous donnais parlait bien suffisamment.
Et nous, à peine tombés du nid, dans l’ivresse de notre jeunesse, étions plongés dans un profond malaise. Nous étions trop gamins pour admettre l’inacceptable. Le silence nous agressait. Pourtant, nous le laissions envahir la chambre. Impossible de parler avec détachement du monde extérieur, du soleil radieux, des couleurs rougeoyantes de l’automne, des exploits de nos enfants, de la vie… Je me sentais coupable de n’avoir plus rien à te dire. En fait nos silences dévoilaient nos pensées le rendant plus intolérable encore. Nous aurions dû tirer un trait sur la funeste fatalité, mais nos jeunes esprits écervelés étaient terrassés par le vilain tour que leur jouait le destin. Nous étions incapables de t’accompagner. Alors que la vie s’offrait à nous, ce mauvais scénario était comme un coup de patin à nos douces illusions. Je ne m’apitoyais pas sur moi, mais refusais ce gouffre d’injustice béant qui barrait ta route à peine entamée. J’étais trop enfant pour ne pas ruminer mon dégoût, cracher vainement ma révolte.
En nous voyant si beaux, tu as dit d’une voix monocorde : « Quand le chat n’est pas là, les souris dansent. » Tes lèvres bougeaient imperceptiblement, comme un ultime effort. Ta réflexion a claqué dans le silence déjà insoutenable. Notre malaise s’en est accru. Ta phrase exacerbait le fossé qui se creusait entre nous. Ta pitoyable métamorphose m’était odieuse, et toi, dans un vain sursaut, fouillais mon regard désemparé et parvenais à en lire le reflet. Ta tristesse augmentait. Nous devinions les pensées de l’autre. Personne ne trichait. C’était insupportable.
À notre grand soulagement, une infirmière est venue te chercher pour un examen sans doute superflu tant ce combat était depuis longtemps perdu. Nous t’avons pour une dernière fois embrassé et nous nous sommes enfuis. Dehors, notre honte ne parvenait pas à s’évaporer dans l’immensité de l’air du soir. Nous la traînions derrière nous tel un boulet. Et le soir même, nous nous sommes engouffrés frénétiquement dans la fête du mariage de Laurence comme certains boivent jusqu’à l’ivresse.
À toi que les hasards du destin ont rappelé à ma pensée juste avant ma dernière visite à Hélène, je dis merci. Tu n’es plus là, pourtant notre amitié perdure. Tu n’as pas changé à mes yeux. Tu restes un confident attentif.
Dans le train qui me ramène à la maison, il m’apparaît que je te dois cette conversation. Voilà longtemps que j’y songeais. Le moment est venu. Rentré à Lyon, je me campe donc devant l’ordinateur pour commencer cette bafouille. Pianotant ainsi, je me retrouve nez à nez avec le site de « Diagonale », le fameux magasin de Didier. Il me faut vérifier si cette petite étincelle qui m’a chauffé le cœur est une illusion. J’envoie aussitôt un courriel :
Didier,
Te souviens-tu seulement de nous, Claire et Antoine ? Nous nous étions connus via Patrick. Vous étiez à notre mariage en Bretagne. Est-ce toujours toi qui tiens la boutique ? Nous sommes passés dimanche devant. Nous avons sonné, mais c’était dimanche bien sûr ! Si c’est le cas, donne-nous le bonjour et, si cela te tente, la prochaine fois que nous montons à Paris, on vous fait signe.
La réponse arrive dès le lendemain :
Didier n’est hélas plus de ce monde depuis cinq ans, je crois. À cause d’une grave maladie. Nous avons repris le fonds de commerce depuis novembre 2005. Désolée de vous apprendre la mauvaise nouvelle, je pense qu’il aurait été content de vous voir.
Allons ! Je m’étais pris à rêver, mais ne me berçais guère d’illusions. Ces souvenirs brusquement resurgis, cet impossible espoir m’ont fait du bien. Ils ont chassé le moment de panique qui aurait pu me gagner à mesure que nous approchions d’Hélène. J’ai eu alors la conviction que ce repas serait agréable et serein. Rien de logique à cela. Pourtant c’est ainsi. Comme si, d’un coup, tu étais revenu vers moi. Tu étais à mes côtés pour revivre cet adieu que nous n’avons pas su vivre élégamment tous les deux il y a quatorze ans. Je t’en remercie.
Hélène
Les nouvelles d’Hélène sont mauvaises. Laurence dit que, depuis ce dimanche, elle est épuisée, dort à longueur de journée, ne mange plus et parle d’une voix qui sort d’outre-tombe. Mon amie pleure, rage contre ce sort injuste et refuse l’évidence. Laurence suggère à sa sœur d’alléger son traitement. Hélène refuse : « Cela signifierait que je suis en phase palliative », argumente-t-elle comme un naufragé qui s’accroche à un morceau d’épave.
L’argument heurte Laurence. Elle voudrait que tout soit clair, qu’il n’y ait aucun malentendu, aucun mensonge… Hélène joue à se voiler la face, semble s’illusionner. Inutile de se raconter des histoires : Une fille de son intelligence a tout compris depuis trop longtemps. Cette farce est bien assez sordide pour qu’on la laisse en interpréter le dernier acte à sa guise. Soyons le public qu’elle attend.
Elle veut réserver un hôtel pour la fin du mois dans le Sud. Laurence me demande : « Tu la laisserais partir ? » Bien sûr qu’il le faut. Les projets ne sont-ils pas le sel de l’existence ? Qu’importe qu’ils aboutissent ou non ! Pourquoi l’empêcher de se mêler au flot des vacanciers dans leur transhumance estivale ? Pourquoi n’offrirait-elle pas à ses enfants un dernier été ?
« Tu crois que s’il arrive quelque chose, ils sauront bien réagir ? ajoute Laurence. Je ne pourrai pas l’accompagner là-bas. » Nous y voilà. Laurence sait la partie perdue, mais elle ne supporte pas l’idée d’être privée de si précieuses minutes avec sa jumelle. Elle argue de la santé de sa sœur. Le docteur Laurence aurait-il oublié que la Côte d’Azur est tout sauf un désert médical ? Je mesure bien son désarroi. Je pressens le gouffre immense qui l’avalera quand le rideau tombera sur cette tragédie. Cela m’effraye. La perspective qu’elle se sentira désespérément seule dans un Paris plongé au cœur de l’été m’inquiète encore plus. Nous n’allons pas tarder à nous envoler vers Samarcande. Qui sera aux côtés de mon amie ?
L’existence reste impitoyable, mais ne va pas croire qu’elle se résume à cela. Tu t’interroges peut-être pour savoir pourquoi je décide de me confier à toi. Certes, la douleur de ton départ m’a longtemps hanté. Je ne l’ai pas gommée de mes pensées, mais, peu à peu, les moments heureux que nous avons vécus ont pris l’ascendant. Si j’ai songé longtemps que ta vie avait été un immense gâchis tant le mauvais sort l’avait écourtée, je la vois désormais comme le doux souvenir d’un temps heureux. Ce cheminement m’a pris du temps. Alors, je veux, en contant notre histoire, que tous mesurent combien elle fut belle malgré cette fin tragique. Il convient de ne pas la lire dans le sens que la logique nous dicte. J’espère Laurence qu’il en sera ainsi pour Hélène et toi…
La première rencontre
Qui aurait misé un centime à l’époque où le hasard nous vit échouer dans la même classe qu’un jour nous serions amis ? Pas moi en tous les cas !
Nous étions en Première. Tu t’asseyais toujours au premier rang. Classique presque BCBG1, comme l’on disait à l’époque. Je te revois comme si c’était hier : mocassins, chaussettes Burlington, pull ras du cou, blouson en daim. Frêle esquif dans un monde d’adolescents bruyants où chacun entendait prendre ses marques. Tu étais sage, discret, attentif. Un fayot quoi !
Je campais invariablement sur les chaises du fond de la classe, m’y balançant sans cesse. Je revêtais l’uniforme de rigueur en cette fin de ces années soixante-dix : blue-jean, sweat-shirt gris, Stan Smith, sans omettre le foulard palestinien autour du cou…
Tu étais entouré d’une sympathique bande de copains rencontrés durant les années du collège : Petit-Delu, Domerc… J’étais plutôt solitaire. En effet, quand j’avais redoublé ma troisième, mes amis s’étaient évaporés, envolés vers le lycée et m’avaient laissé seul au collège. Plus encore que de l’échec scolaire, j’avais souffert de ce fatal abandon. Vexé au-delà des apparences, mon désarroi s’était alors manifesté par un rejet des autres qui me punissait plus encore. J’avais sans doute alors snobé mes nouveaux camarades qui jusqu’alors n’étaient que mes benjamins. En juste retour des choses, ces derniers m’avaient bien rendu mon mépris. Je n’avais construit ainsi que des relations fugitives. Alors que tous se forgeaient des amitiés solides, je me contentais du copinage facile. Il ne me semble pas avoir souffert de cette situation que je devais considérer avec fatalité. J’allais bientôt tourner, grâce à toi, la page de cette traversée du désert.
L’école m’indifférait. Prenant l’ascendant sur le discours de mes professeurs, mes pensées flottaient souvent bien loin de leurs enseignements. Les griffonnages dans les marges de mes cahiers ne cessaient de me trahir. Un peloton de petits vélos me trottait dans la tête. Je rêvais d’ailleurs. Un planisphère décorait ma chambre. Je le parcourais inlassablement. J’en connaissais les îles lointaines. Une paire de copains partis autour du monde à la voile dans les années soixante-dix à bord de leur « Damien » faisaient figure d’idoles à mes yeux2.
L’été, je retrouvais les amis d’Erquy et nous tirions des bords inlassablement sur les dériveurs de nos parents à moins que nous ne fassions glisser nos planches à voile au gré de la houle. Nous étions infatigables. J’étais parcouru d’une ivresse indescriptible quand les embruns venaient me fouetter le visage dans ces longues glissades sur les vagues. Plus le temps était mauvais, plus nous étions heureux. Les coups de tabac nous excitaient. Seul le vent comptait pour nous. Rien ne nous arrêtait au plus grand désespoir de ma mère, régulièrement convoquée chez les CRS qui surveillaient la plage et blâmaient notre témérité.
Merveilleuses vacances ! Sitôt finies, j’aspirais aux suivantes.
J’abordais ainsi la Première, sans motivation. Vers Noël, les premiers émois amoureux tant désirés vinrent enfin tourmenter mon existence. Mon esprit déjà volage, enflammé par la passion, se détournait plus sûrement encore des cahiers et des cours. Tout à mes amours, le garçon insignifiant pour lequel je te tenais devenait plus transparent encore. Mesurais-tu cette ignorance qui frisait le mépris ? J’aurais sans hésiter saisi la première occasion pour te railler.
L’année filait et les beaux jours s’en revenaient. Tu finis par m’aborder. Je te revois fonceur maladroit, maigrelet, les mains jointes avec les deux index devant la bouche. Frêle, tu semblais pris de fièvre dans le malaise qui, irrémédiablement, te poussait à briser la glace entre nous. Tu me dis vouloir discuter. Je ne sais guère ce qui te poussa à le faire. Le défi de dompter l’arrogance trompeuse que j’affichais ? Une attirance sincère ? Jamais nous ne nous sommes confessés sur ce point. Toi, si réservé, m’accostas ainsi abruptement. Sous mes faux airs de relax, jamais je n’aurais osé en faire autant. De nous deux, j’étais en fait le plus timide.
Ta sincérité et ta fragilité étaient si nobles. Ta franchise m’a touché. Un sentiment indicible m’a envahi. S’il existait en amitié ce que le coup de foudre est à l’amour, il conviendrait d’employer ce terme pour traduire cette rencontre. Au diable ceux qui pourraient trouver là une ambiguïté qui jamais ne troubla notre amitié. Je m’y engouffrais avec d’autant d’avidité qu’elle mettait fin à un temps de disette. Je m’immergeais dans ces complicités dont l’adolescence a le secret. Je tournais une page. Notre amitié est née là. Le temps ne l’a jamais démentie. Je ne me doutais pas alors à quel point elle allait bousculer mon existence somme toute assez tranquille. Nous allions vivre les mois qui allaient suivre à une vitesse vertigineuse. Un feu d’artifice !
Ton appartement de Boulogne
Peu après que nous nous soyons liés, tu m’offris un soir de venir dîner chez toi à la bonne franquette. L’image de ton appartement de Boulogne reste gravée dans mon cœur. Les stores y étaient toujours baissés pour préserver des ravages de la lumière les œuvres d’art que collectionnait ton père.
Tes parents étaient absents. Ton frigo recelait les restes d’un somptueux saumon fumé qui figurait alors dans mon jeune esprit au registre des mets d’exception, de ceux que mes parents réservaient aux invités et que nous lorgnions mes sœurs et moi avec envie.
Surtout s’ouvrirent face à mes yeux ébahis les portes d’une véritable caverne d’Ali Baba. Quel fut mon émerveillement ! Tous les murs étaient couverts d’un joyeux amoncellement de tableaux. Si cet incroyable capharnaüm de toiles fut pour moi un véritable coup de cœur, sa profusion me choqua presque au début. Les œuvres tapissaient chaque mur, du sol au plafond. Pas un espace vierge. Tout était envahi. Une promiscuité transpirait de cet amas invraisemblable. Rien n’était mis en valeur. Une richesse suffocante ! Nous étions à l’antithèse de tout musée ordonné et aéré même pour les plus vétustes d’entre eux.
Ma mère m’avait forgé le goût pour l’art dès ma plus tendre enfance, m’expédiant quand elle ne m’y accompagnait pas dans les expositions parisiennes et m’encourageant toujours à explorer les musées de la capitale pour meubler des après-midis oisifs. Les tableaux que je découvris alors avec un bonheur croissant me fascinaient autant qu’ils m’intriguaient. Je trouvais là un mystère exaltant. Chez ton papa, je pris instantanément la mesure du trésor qui s’offrait à mes yeux. Je manifestai une telle stupéfaction qu’un instant tu as craint d’avoir commis un impair et que, face à tant de richesses, je ne prenne mes jambes à mon cou. Mais la disparité sociale m’indifférait. Ni cette opulence ni la découverte de ton monde bien discordant du mien ne m’affolèrent.
Vite rassuré par mon enthousiasme non feint, tu m’entraînas pour une visite guidée des œuvres qu’avait acquises ton papa. Tu connaissais leur histoire. Nous partagions nos goûts. De toile en toile, nous échangions tout en déviant à loisir sur une multitude de sujets. Quelle belle soirée ! Notre connivence naissante trouva là son ciment.
La boulimie du collectionneur était omniprésente. Bien vite je l’adoptai. Qu’ils aillent au diable ceux qui ne parvenaient pas à dénicher les trésors dans ce fatras ! Ici, il fallait aiguiser son regard, traquer les chefs-d’œuvre sur les murs et en percevoir les saveurs. Capter la perle rare requerrait un effort. Je ne me lassais pas de parcourir les pièces de cet antre. Hasard du destin ou affinité d’adolescent, j’affectionnais tout particulièrement le mouvement surréaliste. Ici, j’étais comblé.
Quelle chance incroyable j’ai eue de profiter à loisir de ces œuvres ! Elles sont ancrées à jamais dans ma mémoire : une femme nue sculptée par Marcel Jean s’arrachait à la glace de la banquise pour s’aventurer au gré des flots. Le dos de Kiki de Montparnasse captée par Man Ray s’offrait à notre regard tel un violon. Des livres sombraient sous une chape de Plexiglas fondue par Armand. Sur une photo, Antonin Artaud nous transperçait de son regard dément. J’y portais un œil particulier. « Le moine »3 faisait alors partie de mes lectures fétiches. Une fée longiligne s’attelait à sa machine à coudre… Tu ne manquais pas de me dire que cette toile d’Óscar Domínguez t’appartenait. Un placement qu’avait fait ton papa pour toi quand les nôtres nous ouvraient des livrets d’épargne Écureuil !
Ta chambre exiguë était décorée de masques africains dont certains auraient pu effrayer le petit garçon qu’ils fixaient inlassablement de leurs yeux noirs depuis son plus jeune âge.
Tu te souviens sûrement de ce petit tableau rectangulaire qui se cachait pudiquement à l’abri d’un voile. Pourtant tous étaient avides de savoir ce qui se cachait à l’abri de ce rideau. Je trouvais brillant le coup de génie de l’artiste pour attirer le regard sur son œuvre : une toile pornographique somme toute sans intérêt. Mais nul génie créateur à l’origine de ce travail surréaliste ! Suzanne, ta vieille nounou, avait installé ce tissu pour protéger tes yeux innocents de cette scène érotique ! Nous en rîmes souvent. Je n’y ai jamais pris garde depuis, mais j’espère qu’après le départ de Suzanne cette œuvre abrite toujours son mystère derrière ce voile. Il fait désormais partie de son histoire.
Henri
Le mariage de tes parents avait été un échec. Dans la discorde de leur brève union, ta maman, architecte, avait un jour toisé son époux avec mépris et raillé son manque de culture. Tu aimais à croire que, pour lui river le clou, ton père s’était alors lancé à corps perdu dans une collection d’œuvres surréalistes. Son aventure dans les salles de ventes et autres galeries avait débuté ainsi. Si la provocation de ta maman en fut le déclencheur, il y serait, de toute façon, venu tôt ou tard. Ton père a le gène de la collection ancré profondément en lui. S’y mêlent un désir de possession, un goût du jeu, mais aussi une vaste culture. Cette croisade dans l’univers de l’art ne s’est donc pas limitée à une simple passade. Elle est devenue son fil conducteur puis s’est muée en passion. Je rends hommage aux hommes et aux femmes qui, comme lui, engrangent des trésors que les musées ne pourraient s’offrir, accumulent les connaissances et servent le patrimoine culturel de la sorte.
Sa famille avait alors dû prendre cet engouement pour une lubie passagère. On pensa qu’il s’y brûlerait les ailes, perdrait un peu d’argent avant de réintégrer sagement le rang des spéculations plus classiques quoique tout aussi hasardeuses… Il n’en fut rien. Ton père se trompa peu dans ses achats. Sa collection grossit dans une cohérence et une harmonie que pourraient lui envier nombre de collectionneurs. Il ne se limitait pas à entasser des trésors, mais leur donnait une âme. Il tenait là son aventure. Les tiens ne purent que mesurer le succès de son entreprise. Pire pour les plus vénaux, ses tableaux ne cessaient de prendre de la valeur quand la Bourse chahutait leur propre patrimoine. Henri regardait, amusé, ceux qui avaient douté de lui. Les autres membres de la famille ne juraient que par la Bourse. Un tel succès les laissait perplexes. Ce monde de l’art où culture et spéculation sont indissociables leur paraissait trop éloigné de la logique financière qu’ils trouvaient aux actions.
Comme dans tous les univers où de grosses sommes d’argent sont en jeu, nombre de requins tournoyaient cherchant à abuser sans le moindre scrupule d’innocents collectionneurs fortunés. Mais si ton père cédait instinctivement à ses coups de cœur, il faisait preuve d’une connaissance infaillible du marché de l’art. Jamais l’ombre d’un doute ne planait sur ses décisions. Il ne discutait pas. Les marchands le connaissaient ainsi. À eux de lui proposer le prix juste ou de prendre le risque de le voir leur tourner le dos à jamais. C’est cette science que tes cousins lui jalousaient secrètement, celle du savoir et du flair.
Le week-end, j’étais souvent convié à déjeuner chez toi. Avant le repas, étendus dans les canapés moelleux du salon, nous refaisions le monde. Dans ces années porteuses d’espoir de l’Union de la Gauche, ma petite cervelle s’enflammait pour de grandes idées, refusant d’imaginer l’Homme cupide et me berçant d’idéaux utopiques. Fort de ma jeunesse, j’aimais croiser le fer, frotter mes idées avec celles des adultes. Ton père me questionnait puis, devant mes réponses, soupirait de tant de naïveté. Il jouait de mon enthousiasme sans chercher à me convaincre. Il s’amusait de ces joutes verbales stériles. Toi, tu observais. Prudent, tu ne te démarquais pas des dogmes paternels. Tu avais été éduqué avec le culte du patrimoine. Tu étais assuré d’y trouver ton confort futur. À quoi bon cracher sur cette vie facile qui te tendait les bras ?
Un jour, tu acquis un des costumes dont Mao avait vêtu son peuple entier au lendemain de la Révolution culturelle. Tu l’arboras sans complexe au grand déplaisir de ton père. Tu poussas même le vice à te ceindre du foulard palestinien : comble pour le Juif que tu étais ! C’était peut-être ta manière de participer au débat qui, à la veille de l’avènement de François Mitterrand, enflammait nos jeunes cervelles.
Si tu n’avais pas la flamme pour ces conversations où les copains de ton âge aimaient à s’engouffrer aveuglément, tu les suivais, amusé, un sourire ironique aux lèvres. Je ne sais s’il te paraissait sot de lutter contre l’évidence ou si les débats t’indifféraient. Tu avais peut-être d’autres préoccupations. Savais-tu dès ces instants qu’il te faudrait affronter ton père sur des sujets plus âpres encore et autrement délicats ?
Geneviève
Ta mère était partie un jour depuis fort longtemps. Tu avais quatre ans. Tu portais un regard sévère sur le couple qu’avaient formé tes parents : ni plus ni moins un arrangement pour rapprocher deux riches familles. Leur histoire était vouée à l’échec dès le départ. Tu n’avais aucun souvenir de cette époque, brisée dès ta plus tendre enfance.
Ta mère était partie sans se retourner en Angleterre d’abord puis en Amérique. Elle semblait ne s’inquiéter nullement de te revoir. Soucieux de limiter les conséquences de ces histoires d’adulte, ton grand-père paternel finançait les voyages pour que tu ailles lui rendre visite. Noble attitude. Tu lui dois d’avoir maintenu le fil tenu qui te reliait à ta maman. Elle le lui doit aussi. Pourtant, il semble que tu fus un temps perçu comme bien embarrassant aux yeux de ta mère. L’instinct maternel n’a pas bercé ton enfance.
Ton père, quant à lui, n’avait pas imaginé que la vie lui offrirait un tel scénario. Rien sans doute, ni dans son éducation ni dans sa culture, ne l’avait préparé au rôle de papa célibataire. Il se retrouva bien emberlificoté, seul avec son fils. Il fit les choses à sa façon en commençant par s’attacher les services d’une nounou, Suzanne, qui était toujours là quand nous nous connûmes. Sales gosses, nous étions peu charitables à l’égard de cette vieille femme.
Dans tes jeunes années, il est facile d’imaginer ton paternel, se morfondant dans d’interminables promenades du dimanche au jardin d’acclimatation où tu l’entraînais joyeusement de manège en manège. Corvée pour l’un, récréation pour l’autre. Il aimait nous narrer ces épisodes de sa vie, d’autant que nous riions tous de bon cœur tant il était facile de l’imaginer rongeant son frein, détestant ce parc où il ne venait que par devoir pour divertir le petit garçon que tu étais. Il aurait pourtant eu les moyens de se défiler… Mais non ! Il subissait courageusement ces sempiternels dimanches bénissant chaque lundi le retour de l’école. Il rencontrait parfois là Laurent Lindon4, subissant la même punition du destin. Ils sympathisèrent ainsi par solidarité.
Attentionné, ton père le devint certes par la force des choses, mais il prit ce rôle à cœur, à sa manière. Tu avais un papa en or qui jamais ne désarma là où tant d’autres auraient botté en touche. Pourtant tu ne l’as pas épargné. Tu étais doté d’un sacré petit carafon si j’en crois tes dires.
Tu n’étais encore qu’un tout petit garçon quand votre route a croisé celle de Geneviève : Personne incontournable, façonnée de gentillesse, de tendresse et de générosité. Tu aimais à raconter que c’était toi qui avais insisté pour qu’il la revoie, avant de donner ta bénédiction pour qu’il refasse sa vie avec elle. Il finit donc par l’épouser ! Qui de vous deux souhaitait le plus une présence féminine à la maison ? Était-ce toi, petit enfant délaissé par sa maman ou ton paternel désormais solitaire ? Vrai ou faux, tu demeurais convaincu d’avoir été l’artisan de cette union !
Sans jamais en revendiquer la place, elle fut ta véritable mère et t’entoura de toute son affection. Elle fait partie de ces femmes qui jamais ne changent, de ces gourmandes dont la vie ne cesse d’osciller entre le régime et le petit écart exceptionnel. Femme élégante, femme en sucre… Toujours de bonne humeur. Il m’est impossible de l’évoquer sans qu’un flux d’affection ne me submerge aussitôt. Elle nous choyait, sans jamais mettre d’entraves à nos libertés. Nous étions intouchables, « ses petits choux ». Seul le foutoir de collectionneur de ton père qui s’accumulait indéfiniment pouvait venir à bout de sa bonhomie.
Tu fus l’enfant qu’elle n’a jamais eu. Tu lui rendis bien l’amour qu’elle te donna. L’âge où nous nous sommes liés n’était pas propice aux concessions. Nos caractères entiers nous y encourageaient encore moins. Pourtant, Geneviève figurait sur un trône où aucune critique n’était de mise. Gare à celui qui se serait autorisé à le faire ! L’inverse était tout aussi vrai. Elle ne cessait de nous gâter, portait sur nous un regard d’une indulgence infinie, confiante, admirative… Elle nous inondait de sa tendresse.
Lors de ces déjeuners chez toi, la bonne humeur régnait. Geneviève, quand elle abandonnait un instant sa cuisine, venait s’asseoir à tes côtés sans même prendre la peine d’ôter son tablier. Vous vous loviez l’un contre l’autre et, par des gestes simples, manifestiez l’amour que vous éprouviez l’un pour l’autre. Vous étiez comme deux chatons. Tu étais à l’affût de ces contacts charnels et t’y délectais avec bonheur. Cela me surprit tout d’abord. Plus réservée, ma mère ne nous avait pas appris à exprimer ainsi notre affection. Ton père, invariablement affalé sur son canapé, regardait distraitement la télévision en tirant sur son cigare. S’en détachant par instant son regard parcourait ses œuvres qu’il affectionnait tant. Il semblait absent, mais, sous ses dehors nonchalants, il était à l’affût. Il ne manquait rien de ce qui se passait, toujours prêt à se glisser dans la conversation avec malice. Puis nous passions à table. Tout était bon et mitonné consciencieusement par Geneviève pour gâter ses petits chouchous. Plus nous nous régalions, plus elle était aux anges. Ces moments tenaient du bonheur. Il était loin ce temps où ton père maudissait l’interminable repos dominical et son parc d’acclimatation !
Après le repas, nous filions au gré des avenues dans Paris sur nos mobylettes. La tienne, repeinte par tes soins, était si vilaine qu’un voleur n’en aurait pas voulu : une customisation étonnante, complètement ratée, dont tu te moquais éperdument. Pire même, tu en étais assez fier. Elle était l’antithèse étonnante de ton look plutôt sage !
Mon appartement de Boulogne
Tu fus naturellement le confident de mes acrobaties sentimentales. Tu t’en accommodais bien.
Les filles avaient envahi ma petite vie. N’étions-nous pas les légitimes héritiers des batifolages volages dont nos grands frères de soixante-huit avaient érigé les bases comme pierre angulaire à la liberté de la jeunesse ? Dans une boulimie de jeune coq, à être trop gourmand, je finis rapidement par m’emmêler les pinceaux. Une légitime tempête de jalousie s’abattit donc sur moi. Il me fallut, tel le marin, mettre à la cape pour laissez-passer le grain. Je me retrouvais donc bredouille. Il n’est pas donné à tout le monde de savoir jouer les funambules de l’amour. Erreur de jeunesse bien savoureuse ! J’appris ainsi que cultiver plusieurs flirts n’était pas chose faite pour moi.