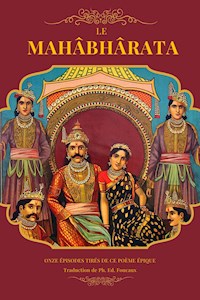
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alicia Editions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Le Mahâbhârata, livre sacré de l’Inde, grand poème sanskrit de la mythologie hindoue, relate la grande guerre entre les fils des deux frères Pândou et Dhritarâchtra, pour obtenir le pouvoir suprême dans l’Inde. L’histoire de cette rivalité dynastique entre les deux branches d’une famille royale est contenue dans plus de 106 000 vers ou çlôkas de 32 syllabes chacun répartis en 18 livres (parvas).
Ph. Ed. Foucaux nous livre, en français, onze épisodes tirés de cette oeuvre épique, avec une large introduction de plus d’une quinzaine de pages. Son texte est enrichi de près de 400 notes de bas de pages qui permettent une meilleure compréhension de ces fabuleuses histoires. Vous y découvrirez, en autres, la fameuse légende du Pigeon et du Faucon, la fable de l’arc magique d’Ardjouna (le troisième des cinq Pândavas) mais également la complainte de Gândhârî (l’épouse de Dhritarâchtra, mère de cent fils tombés lors de sanglants combats) et la malédiction de Krichna.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Le Mahâbhârata
onze épisodes tirés de ce poème épique
Ph. Ed. Foucaux
Alicia Editions
LE VÉNÉRABLE MAHÂBHÂRATA
COMPOSÉ
PAR LE VÉNÉRABLE MAHARCHI1 VÊDA-VYÂSA
1Les Maharchis sont des saints qui forment le troisième des sept ordres qui composent la réunion de tous les personnages connus sous le nom collectif de Richis.
Table des matières
INTRODUCTION
ADI PARVA
I. EXORDE
I
II
II. ADIVANÇAVATARANA PARVA
LIX
LX
LXI
LXII
LXIII
LXIV
VANA PARVA
I. KAIRATA PARVA
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
II. ILVALA ET VATAPI
XCV
XCVI
XCVII
XCVIII
III. PARACOURAMA
XCIX
IV. MORT DE VRITRA
C
CI
CII
V. LA LÉGENDE DU PIGEON ET DU FAUCON
Le Pigeon et le Faucon
STRI PARVA
I. DJALAPRADANIKA PARVA
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
II. STRIVILAPA PARVA
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
III. ÇRADDHA PARVA
XXVI
XXVII
MAHAPRASTHANIKA PARVA
I. LE GRAND VOYAGE
I
II
III
À LA MÉMOIRE D'EUGÈNE BURNOUF
HOMMAGE DE RECONNAISSANCE ET DE REGRET
Quand on demandait à l'illustre indianiste Eugène Burnouf quels étaient les livres sanscrits dont la traduction lui semblait le plus utile, c'était le Mahâbhârata qu'il désignait d'abord. Outre l'intérêt que le grand poème indien présente par lui-même, il le considérait comme un ouvrage qui convenait mieux que tout autre au goût et aux aptitudes de la philologie française.
Mais tant qu'il vécut, pas un de ceux qui suivaient ses leçons ne put entreprendre une tâche d'aussi longue haleine. Un seul de ses élèves et l'un des plus distingués, M. Théodore Pavie, a, du vivant de l'illustre professeur, publié un volume de fragments du Mahâbhârata, qu'il lui a dédié.
Nous aussi, fidèle aux enseignements du savant indianiste qui a laissé des travaux si beaux et si solides qu'il sera difficile de les égaler, nous voulons en publiant plusieurs épisodes du livre qu'il affectionnait, prouver que nous n'avons pas oublié ses conseils et ses leçons, et nous mettons ce modeste volume à l'abri du nom vénéré de celui qui voulut bien nous honorer de son amitié.
INTRODUCTION
I
C'est1 par l'extrait du Mahâbhârata nommé Bhagavadgîtâ, dialogue religieux et philosophique entre Krichna et Ardjouna (un dieu et un héros), que la littérature sanskrite s'est fait connaître pour la première fois en Europe. Ce beau poème, traduit en anglais par Wilkins, sur le texte original, parut à Londres en 1785. Une traduction française de ce livre, faite sur celle de Wilkins, par Parraud, fut publiée deux ans après à Paris. Le drame de Sakountalâ, traduit en anglais par Williams Jones, ne parut qu'en 1789.
Ces deux publications furent, à leur apparition, accueillies avec intérêt ; mais l'époque n'était pas favorable aux études littéraires. Les guerres qui se succédèrent jusqu'à la fin du premier empire, absorbèrent bientôt toute l'attention de l'Europe et mirent obstacle aux relations de la France et de l'Angleterre. Elles empêchèrent longtemps que la littérature indienne ne prît, comme elle l'a fait depuis, le rang qu'elle mérite d'occuper.
Cependant, dès la fin du dix-huitième siècle, l'éveil était donné ; l'Allemagne s'était aussitôt préparée à cette étude nouvelle, et en 1808, Frédéric Schlegel publiait un ouvrage sur la langue et la sagesse des Indiens, contenant des extraits du Râmâyana, du Mahâbhârata, et du code de Manou.
Le premier texte sanskrit imprimé en Europe est le recueil de fables nommé Hitôpadêsa, qui parut à Londres en 1810. Le second, imprimé aussi à Londres en 1819, est le célèbre épisode de Nala, édité par M. F. Bopp, et accompagné d'une traduction latine. Ce dernier ouvrage, de même que la Bhagavadgîtâ, dont nous avons parlé en commençant, est un extrait du Mahâbhârata qui, depuis, a été imprimé en entier à Calcutta, dans les années 1834-1839. C'est sur cette édition princeps, qu'on a traduit un assez grand nombre d'épisodes pris çà et là dans les dix-huit livres qui composent le poème, lequel contient environ deux cent mille vers.
Il n'est pas douteux que l'étendue de cette épopée gigantesque n'ait été le principal obstacle à ce qu'on la traduise d'un bout à l'autre. Pourtant ce poème, qui est à lui seul toute une bibliothèque, puisqu'on y trouve de l'histoire sous la forme de généalogie, des traités de théologie, de philosophie, de législation et de politique, mériterait bien d'être traduit, et il est à regretter que l'ouvrage, dont les extraits ont été les premiers à nous faire apprécier la poésie indienne, soit justement celui dont la traduction se fait le plus attendre2.
Habitués à regarder comme la plus juste mesure les proportions de l'Iliade et de l'Énéide, les lecteurs européens s'accoutument difficilement à l'idée d'un poème remplissant dix volumes. Il ne faudrait pas croire cependant que les Indiens manquent absolument de l'art de conduire une action héroïque à la manière des poèmes que nous sommes accoutumés à prendre pour modèles. Le Râmâyana, qui se rapproche de nos ouvrages classiques, et d'autres poèmes indiens, viennent à l'appui de ce que j'avance.
Il faut songer, d'ailleurs, aux lieux où le Mahâbhârata a été composé, et se transporter en idée dans un climat où la nature est douée d'une puissance excessive qui produit à profusion les fleurs et les fruits, et donne naissance à des animaux de toute espèce ; où les roseaux atteignent à la hauteur de grands arbres et forment de vraies forêts, sous les ombrages desquelles on rencontre ces éléphants que les poètes se plaisent à comparer à des collines.
Ce qui grossit le Mahâbhârata outre mesure, ce sont les épisodes et les légendes qu'on y a intercalés sans aucun souci des proportions. Dégagé de tout ce qui ne tient pas à l'action proprement dite, ce poème serait encore un long ouvrage, mais il s'accorderait, à peu de chose près, avec les exigences de la poétique de l'Occident, puisqu'il ne renfermerait que vingt-quatre mille distiques environ3.
A l'époque où l'on croit que le Mahâbhârata a été rédigé, sous la forme où il nous est parvenu, c'est-à-dire aux derniers siècles qui ont précédé notre ère, les brahmanes auront voulu rassembler sans distinction dans un seul ouvrage toutes les traditions qui les intéressaient, pour s'en servir au besoin. L'antagonisme qui déjà existait entre eux et les boudhistes n'est peut-être pas étranger à la manière dont le Mahâbhârata a été rédigé, par opposition au volumineux ouvrages que produisait incessamment la secte rivale.
On avait annoncé en Allemagne, il y a quelques années, une traduction complète du Mahâbhârata, par M. Goldstücker. Mais cet habile indianiste, occupé en ce moment à imprimer la troisième édition du dictionnaire sanscrit de Wilson, ne semble pas disposé, quant à présent, à poursuivre cette entreprise.
Quelques indianistes ont lu le poème entier, et entre autres le savant M. Lassen, qui a montré dans un excellent livre : « Indische Alterthumskunde, » et dans une série d'articles du journal : « Zeitschrift fur die Kunde des Morgelandes, » quel parti on pouvait tirer des renseignements de tout genre contenus dans le Mahâbhârata. Mais quelle que soit la sagacité d'un écrivain et la sûreté de sa critique, rien ne peut suppléer à la lecture des textes qui lui ont servi pour porter un jugement ou avancer un fait. Aussi quand on s'occupe si activement aujourd'hui de la traduction des Vêdas, pourquoi ne pas songer à celle de Mahâbhârata ? Ces deux livres, quoiqu'ils aient été composées à des époques bien éloignées et diffèrent considérablement par la forme, gagneraient beaucoup à être étudiés parallèlement.
II
Le Mahâbhârata se compose de dix-huit Parvas, chants ou livres, qui contiennent, dit-on, cent mille çlôkas ou distiques. L'édition imprimée à Calcutta contient cent sept mille, trois cents quatre-vingt-neuf çlôkas4, mais en y comprenant le supplément, nommé Harivança, composé de seize mille trois cents soixante-quatorze distiques, qui ne faisait certainement pas partie du Mahâbhârata original. La partie authentique du poème devait être primitivement beaucoup moins étendue, car d'après ce qui est dit dans l'exorde, le poème ne contenait que vingt-quatre mille distiques sans les épisodes. Quelques-uns de ces épisodes sont en effet des additions douteuses ; d'autres naissent naturellement du sujet, et plusieurs remontent certainement à une haute antiquité.
Le poème est attribué à Krichna-Dvâipâyana, le même qui arrangea les Vêdas, ce qui lui fit donner le surnom de Vyâsa ou compilateur.
Vyâsa était le père des deux princes Pândou et Dhritarâchtra, dont les enfants occupent le principal rôle dans le poème.
Vyâsa fit apprendre son ouvrage à son élève Vâiçampâyana, qui le récita pendant un grand sacrifice célébré par Djanamêdjaya, arrière-petit-fils d'Ardjouna, l'un des héros du poème.
Tel qu'il nous est parvenu, le Mahâbhârata a été, d'après la tradition, récité par Ougrasravas, fils de Lômaharchana, aux Richis ou sages rassemblés à l'occasion d'une solennité dans la forêt de Nâimicha .
Le sujet du Mahâbhârata est une guerre entre les fils des deux frères Pândou et Dhritarâchtra, pour obtenir le pouvoir suprême dans l'Inde.
Les fils de Pândou étaient au nombre de cinq : Youdhichthira, Bhîma et Ardjouna, de Prithâ, l'une de ses femmes, appelée aussi Kountî ; et Nakoula et Sahâdêva de Mâdrî, sa seconde femme.
La famille de Dhritarâchtra était beaucoup plus plus nombreuse.
Il avait eu de Gândhârî, fille du roi Soubala, cent fils et une fille, Douhsalâ, qui épousa Djayadratha, roi des Sâindhavas. Il avait aussi un fils né d'une servante.
Voici comment Gândhârî était devenue mère d'un si grand nombre d'enfants. Elle avait un jour reçu avec beaucoup d'égards le sage Vyâsa qui arrivait accablé de faim et de fatigue ; aussi lui avait-il promis en récompense un don à son choix.
Elle lui demanda cent fils pareils à son époux, et devint bientôt enceinte, mais elle resta ainsi deux ans sans mettre d'enfant au monde. Elle apprit alors que sa belle-sœur Kountî était devenue mère d'un fils beau comme le soleil. Elle s'irrita alors de ne pas être mère aussi. Folle de chagrin, elle s'ouvrit le sein, sans en rien dire à son époux. Il en sortit une masse de chair dure comme la pierre et le fer. Vyâsa l'ayant appris, arriva à la hâte, et Gândhârî lui dit : Au lieu de cent fils, c'est cette masse de chair que j'ai enfantée ! Vyâsa lui répondit : Ce que j'ai promis sera, car je n'ai jamais dit de chose vaine, même à un ennemi ! Il fit aussitôt creuser et remplir de beurre clarifié cent trous pareils à ceux où l'on met le feu sacré. Il mit dans chacun d'eux un morceau grand comme le doigt de la masse de chair qu'il avait divisée ; puis il s'en alla dans la montagne pour se livrer aux austérités, en recommandant de bien garder ces trous et de les ouvrir au temps convenable. C'est ainsi que naquirent Douryôdhana ses frères et sa sœur, car il s'était trouvé un cent-unième fragment. (Mahâbh. t. I, p. 165, si. 4,490 à 4,522.) L'aîné, Douryôdhana, était celui qui se montrait le plus hostile aux Pândavas ses cousins.
Quoique Pândou « le pâle, » comme son nom semble l'indiquer, fût l'aîné de Dhritarâchtra, il fut regardé comme incapable de succéder à son père à cause de sa pâleur5. Il fut obligé d'abandonner ses droits à son frère et se retira dans les montagnes de l'Himalaya où naquirent ses fils et où il mourut. Un débat eut lieu alors entre Kountî et Mâdrî, ses deux femmes, qui se disputèrent l'honneur de se brûler avec lui. Ce fut Mâdrî, celle qu'il avait épousée la seconde, qui monta sur le bûcher, en recommandant ses deux enfants à Kountî. (Mahâbh., t. I, p. 179, si. 4880 et suiv.) Après la mort de Pândou, ses fils, encore enfants furent conduits à Hastinâpoura par les ascètes compagnons de sa solitude, et présentés à Dhritarâchtra comme ses neveux. Quelques doutes s'élevèrent d'abord sur la légitimité de leur naissance ; et en effet, ils n'étaient les fils de Pândou que par adoption ; mais comme il les avait reconnus pour ses enfants, les jeunes princes furent reçus par Dhritarâchtra comme des neveux et élevés avec ses fils.
L'Adi parva « le premier livre » contient la généalogie des deux familles, et décrit les circonstances de la naissance et de l'éducation des princes.
On y voit naître l'inimitié qui bientôt divisera les deux familles. La malveillance des fils de Dhritarâchtra à l'égard de leurs cousins, devient de plus en plus grande, et va jusqu'à faire mettre secrètement le feu à la maison où ils demeurent avec leur mère Prithâ6. Avertis à temps, les Pândavas s'échappent par un passage souterrain en laissant croire qu'ils ont péri dans les flammes, et se retirent secrètement dans les forêts, après avoir pris les habits et les manières des brahmanes. C'est pendant cette période qu'ils entendent parler du Svayambara7 de Drâupadî, fille du roi Droupada, et qu'ils se rendent à la cérémonie pour chercher à obtenir la main de la jeune princesse. Ardjouna, le troisième des cinq frères, est choisi par Drâupadî, et à cette occasion, le bruit que les fils de Pândou existent encore, venant à se répandre, les ministres du roi Dhritarâchtra obtiennent de lui que ses neveux seront rappelés, et que la souveraineté sera partagée également entre eux et ses fils. Youdhichthira et ses frères eurent en partage une province sur les bords de la Djoumna, et pour capitale lndraprastha. Douryôdhana et ses frères régnèrent à Hastinâpoura, sur le Gange.
Mais de nouveaux sujets de haine et d'envie ne tardent pas à s'élever à cause des prétentions de Youdhichthira à célébrer le sacrifice du Râdjasoûya, pendant lequel les princes viennent offrir des présents en signe de soumission, à celui qui préside à la cérémonie. C'est ce qui forme la matière du deuxième livre nommé « Sabhâ parva, » qui se termine par les épisodes où l'on voit Youdhichthira, engagé dans une partie de jeu avec Douryôdhana, perdre son palais, sa fortune, son royaume, sa femme, ses frères et lui-même avec eux. Le vieux roi Dhritarâchtra leur fait rendre leur liberté et leurs biens, mais Youdhichthira ne tarda pas à se laisser entraîner de nouveau par la passion du jeu.
Il accepte pour condition que, si la chance lui est défavorable, ses frères et lui iront passer douze années dans les forêts, et qu'ils resteront une treizième année sans se faire reconnaître. Il perd, et s'en va avec Drâupadî son épouse, et avec ses frères vivre dans les forêts.
C'est à partir de cet événement que commence le troisième livre, le Vana parva, « livre de la forêt, » dans lequel se trouve le bel épisode de Nala et Damayantî8. Le Kâirata parva, « livre du montagnard, » qui se trouve dans ce volume, appartient à ce troisième livre.
A la fin de la douzième année qu'ils devaient passer dans la forêt, les Pândavas se mettent au service du roi Virâta, sous divers déguisements.
Leurs aventures, à partir de ce moment, sont racontées dans le Virâta parva, le quatrième livre. Ils se font estimer du roi qu'ils servent, et, à la fin de la treizième année, quand ils se font reconnaître de lui, il devient leur allié pour les aider à se venger et à réclamer leurs droits à la souveraineté.
Le cinquième livre, « Oudyôga parva, » décrit les préparatifs des deux partis pour la guerre, et fait l'énumération des princes qui se mettent de l'un ou de l'autre côté.
Parmi eux se trouve le roi de Dvârakâ, Krichna, qui est une incarnation de Vichnou. Krichna, allié aux deux familles par sa naissance, ne peut se décider à choisir entre les deux partis ; mais sachant d'avance ce qui doit arriver, il propose à Douryôdhana le choix entre son aide à lui, comme individu isolé, et la coopération d'une grande armée.
Douryôdhana préfère maladroitement la dernière, et Krichna qui, à lui seul, est plus qu'une armée, passe du côté des Pândavas, se charge de conduire le char de guerre d'Ardjouna, son ami et son favori, et devient le principal instrument du triomphe de ses alliés.
Les quatre livres qui suivent, sont consacrés à la description des batailles que se livrent les deux armées ennemies dans la plaine de Kouroukchêtra9.
Celles de Douryôdhana sont commandées par Bhîchma, son grand oncle, par Drôna son précepteur militaire, par Karna, roi d'Anga et son ami, et enfin par Çalya, roi de Madra, son allié (v. l'exorde). La description des opérations militaires de chacun de ces chefs forme un livre qui porte son nom. Dans le neuvième livre, le Çalya parva, Douryôdhana lui-même est tué par Bhîma, dans un combat singulier à la massue, arme dans l'emploi de laquelle ils excellaient tous les deux.
Quelques chefs qui survivaient du côté de Douryôdhana essayent alors de venger la mort de leurs amis, en attaquant pendant la nuit le camp des Pândavas. Cet épisode fait le sujet du dixième livre ou Sâuptika parva10.
Le onzième livre, Stri parva, qu'on trouvera tout entier dans ce volume, décrit les lamentations des femmes des deux partis, et le chagrin du vieux roi Dhritarâchtra. Youdhichthira lui-même y témoigne ses regrets de ce qui s'est passé.
Le douzième livre, Çânti parva, « le livre de la consolation, » donne de longs détails sur les devoirs des rois, l'efficacité du don, et les moyens d'obtenir la délivrance finale.
Le treizième livre, Anouçasana parva, est une longue série de discours sur les devoirs de la Société, en général. Ils sont adressés à Youdhichthira, par Bhîchma, quand il est près de mourir.
Dans ce livre, comme dans le précédent, les parties didactiques sont animées par des légendes ou des fables qui mettent les conseils en action.
Les derniers livres, quoique plus ou moins remplis d'épisodes, se rapportent davantage au récit principal. Ils sont aussi plus courts, et l'on sent que le dénouement approche.
Le quatorzième livre, Açvamêdhika parva « le sacrifice du cheval, » décrit les détails de cette cérémonie, célébrée par Youdhichthira comme preuve de sa suprématie.
Dans le quinzième livre, Açrama parva, « livre de l'ermitage, » le roi Dhritarâchtra accompagné de son épouse Gândhârî, et de ses ministres, se retire dans un ermitage où il meurt.
Le seizième livre, Mâusala parva, raconte la destruction de toute la race des Yâdavas, la mort de Krichna, qui appartenait à cette tribu, et la submersion par l'Océan de Dvârakâ, sa capitale.
Le dix-septième livre, Mahâprasthanika, « le grand voyage, » raconte l'abdication, par Youdhichthira, de la royauté qu'il a obtenue avec tant de peine, et son départ, en compagnie de ses frères et de Drâupadî, leur épouse commune11, pour le Mêrou, la montagne sacrée, en passant par les monts Himalayas.
Pendant qu'ils s'avancent, l'influence de leurs fautes passées leur devint fatale, et chacun d'eux, successivement, tombe sans vie sur le bord de la route. Il ne reste plus debout que Youdhichthira et un chien, qui avait suivi les voyageurs depuis la ville d'Hastinâpoura. Le dieu Indra vient alors au-devant du prince pour l'introduire dans le Svarga, l'Elysée dont il est le chef, mais Youdhichthira refuse d'y entrer, à moins qu'on n'y admette son chien. Après quelques difficultés, Indra consent à admettre le fidèle animal12.
Le dix-huitième et dernier livre, le Svargârôhana, « l’apothéose, » nous montre Youdhichthira entrant au ciel avec son corps. A son grand déplaisir, il y trouve Douryôdhana et les autres fils de Dhritarâchtra mais il n'y voit aucun de ses frères, pas plus que son épouse Drâupadî. Il demande alors ce qu'ils sont devenus et refuse de rester au ciel sans eux. Un messager des dieux vient alors pour lui montrer où sont ses parents et le conduit jusqu'à une espèce d'enfer, où il rencontre toutes sortes d'objets inspirant le dégoût et l'horreur. Son premier mouvement est de retourner en arrière, mais il est arrêté par les gémissements de voix bien connues qui le supplient de rester, car sa présence a déjà adouci les souffrances de ceux qui l'appellent. Il surmonte donc sa répugnance et se résigne à partager le sort de ses amis en enfer, plutôt que d'habiter le ciel avec ses ennemis. C'est l'épreuve suprême. Les dieux viennent et applaudissent à son vertueux désintéressement. Toutes les horreurs qu'il vient de voir sur sa route s'évanouissent ; ses parents et ses amis montent avec lui au ciel, où ils redeviennent les personnages célestes qu'ils avaient été dans l'origine et qu'ils avaient cessé d'être momentanément, afin de prendre en même temps que Krichna, une forme humaine sur la terre, pour travailler avec lui à délivrer le monde de ces êtres méchants qui, dans la personne de Douryôdhana, de ses frères et de ses alliés, opprimaient la vertu et propageaient l'impiété.
Le Harivansa est une espèce de supplément au Mahâbhârata. Il contient, outre la généalogie de Hari, ou Vichnou, incarné dans la personne de Krichna, des détails généalogiques, les récits des aventures et des exploits de Krichna, avec une foule de légendes faites pour recommander le culte de ce demi-dieu. Le caractère du Harivansa prouve qu'il est d'une date bien postérieure à la majeur partie du Mahâbhârata. Il a été traduit en français par A. Langlois, et publié par le « Oriental translation Comittee, » 2 vol. 4°, Paris et Londres, 1834.
III
Quand on étudie les religions de l'antiquité, l'un des résultats les plus intéressants de cette étude est celui qui nous fait suivre les transformations que subissent avec le temps, les objets du culte populaire. On voit une légende se développer ou s'amoindrir, selon qu'elle appartient à telle ou telle secte, et quelquefois même changer complètement de nature en passant d'un pays à un autre. L'intérêt augmente encore si l'on peut suivre sans interruption jusqu'à nos jours, des modifications de ce genre dans les croyances d'un peuple qui, comme celui de l'Hindoustan, malgré son contact journalier avec les musulmans, depuis le septième siècle, et avec les Européens depuis le seizième, est resté, pour le fond, à peu de chose près ce qu'il était au temps d'Alexandre.
C'est pour donner l'idée d'une étude de ce genre que nous avons traduit le récit de la mort de Vritra. On verra, en comparant l'hymne antique du Vêda à la légende beaucoup moins ancienne dont il contenait le germe, les changements que le temps a apportés au récit primitif.
Dans la table générale placée en tête du Mahâbhârata, et dans laquelle ce poème est appelé « un Vêda de Vyâsa, » concurremment avec le véritable Vêda, attribué aussi à Vyâsa, on trouve l'explication suivante du nom du Mahâbhârata :
« Seuls d'un côté les quatre Vêdas, et seul de l'autre, le Bhârata, ayant été mis dans une balance par les dieux assemblés, on reconnut alors que le dernier l'emportait sur les quatre Vêdas avec leurs mystères ; et, à partir de ce moment, il est, dans ce monde, appelé le Mahâbhârata (grand poids)13. »
Sans s'arrêter à cette étymologie, évidemment forgée à plaisir14, car la véritable doit être celle qui donne le sens de « grande histoire des descendants de Bhârata, » on ne peut s'empêcher de remarquer avec surprise que, dans l'idée de l'auteur du passage qu'on vient de lire, le Mahâbhârata semble mis clairement au-dessus des Vêdas. Mais quand il parle ainsi, quel est, au juste, le fond de sa pensée ? Veut-il dire que les mythes souvent obscurs des hymnes védiques ayant été expliqués et développés dans le Mahâbhârata, celui-ci leur est supérieur par cela même ? Si telle est sa pensée, l'esprit indien a fait bien du chemin pour arriver, en partant des Vêdas, jusqu'aux légendes du Mahâbhârata et des Pourânas, et à les préférer aux premiers.
Il ne faudrait pas, cependant, prendre les paroles du poète d'une manière absolue ; le passage suivant, emprunté à Mâdhava, auteur indien du quatorzième siècle, nous en donne probablement la véritable explication :
« L’Ecriture qui déclare que les personnes seulement qui ont reçu l'investiture du cordon sacré (c'est-à-dire celles qui appartiennent au trois premières castes) sont seules aptes à lire le Vêda, enseigne par cela même que l'étude de ces livres serait une cause d'infortune pour les femmes et les Soûdras (qui ne reçoivent pas l'investiture).
« Mais alors comment ces deux classes de personnes découvriront-elles les moyens d'arriver au bonheur futur ? Nous répondrons par les Pourânas et d'autres ouvrages du même genre. C'est pour cela qu'on a dit : Parce que le triple Vêda ne peut-être entendu par les femmes et les Soûdras ou les hommes déchus des hautes castes, le Mahâbhârata a été, par bonté, composé par le Mouni Vyâsa.15 »
Bien souvent ce qui n'était dans les hymnes védiques qu'une simple allégorie, est devenu une réalité dans le Mahâbhârata, où l'on voit des personnalités se substituer nettement aux êtres allégoriques, afin, sans doute, de se mettre mieux à la portée du vulgaire, auquel d'ailleurs la lecture des Vêdas est interdite, comme on vient de le voir.
« Dans les hymnes adressés à Indra » dit H. H. Wilson , « nous avons une explication détaillée du sens primitif de la légende du meurtre de Vritra par Indra, laquelle a été changée par les auteurs des Pourânas en un combat entre Indra et un Asoura (titan), quoiqu'elle ne soit, dans les Vêdas, qu'un récit purement allégorique de la production de la pluie. Vritra n'est rien de plus que l'accumulation de la vapeur condensée ou figurément enfermée ou arrêtée par un nuage. Indra, avec son tonnerre, c'est-à-dire, l'influence électrique de l'atmosphère, divise la masse condensée, et l'issue est donnée à la pluie qui alors descend sur la terre, arrose les champs et passe dans les rivières. Le langage des hymnes védiques n'est pas suffisamment clair et confond la métaphore avec la réalité, mais il n'approche jamais de cet inqualifiable débordement de personnifications qui, commençant vraisemblablement avec le Mahâbhârata, est devenu, pour les compilateurs des Pourânas, le motif d'amplifications extravagantes16. »
D'après le récit du combat de Vritra et d'Indra tel qu'il est dans l'hymne védique, le dieu ne perd pas complètement courage, et s'il est alarmé, cela ne va pas jusqu'à lui faire lâcher la foudre qu'il tient à la main. « Ni l'éclair, ni la foudre, ne purent arrêter Indra ; ni la pluie ni le tonnerre lancés par ce vil ennemi au moment du combat. Indra triompha des enchantements et pièges.— Pouvais-tu voir un autre que toi vainqueur de Vritra, ô Indra ! puisque, même après l'avoir abattu, la crainte entrait encore dans ton âme17 ? »
Dans la légende qui fait partie de ce volume, au contraire, le Dieu éperdu, laisse échapper le tonnerre qui, heureusement, s'en va de lui-même frapper Vritra, tandis que Indra, talonné par la peur, court précipitamment se jeter dans un étang, car il ne s'est pas même aperçu que la foudre s'est échappée de ses mains, et,, par conséquent, ignore la mort de Vritra.
Dans un second récit que fait le Mahâbhârata de la mort de Vitra, se trouve un passage qui, de même, n'est pas complètement d'accord avec le Rig-Vêda.
Remarquons, au sujet de cette répétition du même récit dans le poème, qu'il n'est pas rare de voir une légende reparaître deux fois dans le Mahâbhârata18, dans des parties éloignées il est vrai, mais toujours cependant racontée au principal héros du poème, à Youdhichthira. Pourquoi ces répétitions, qui ne diffèrent guère que par les détails ? sont-elles l'œuvre du même auteur ?
Avant qu'on ait traduit le poème entier, ce qui ne peut-être fait d'une manière définitive19 qu'à l'aide de commentaires que nous ne possédons pas, et après après avoir collationné autant de manuscrits qu'on pourra s'en procurer, il est difficile de répondre à cette question et à bien d'autres encore que soulève le contenu de l'épopée colossale des Indiens.
Voici le passage dont nous parlions tout à l'heure.
« Vritra, le grand magicien, doué d'une grande force, troubla l'esprit d'Indra en employant sans cesse la magie pour combattre. Le Dieu auquel on offre cent sacrifices eut peur de ce Vritra qu'il harcelait. Alors Vacichtba l'encouragea avec les paroles du Sâma-Vêda, en disant : Tu es le plus grand des dieux, ô Indra, destructeur des Dâityas et des Asouras ! En possession de la force des trois mondes, pourquoi es-tu inquiet ? Voici Brahma, Vichnou, et Civa, le maître du monde, et Sâma le dieu bienheureux, et tous les chefs des Richis. Ne te laisse pas aller au découragement comme un être vulgaire ; prends une détermination digne de toi pour combattre ; sois vainqueur des ennemis, ô maître des dieux ! Voici le Dieu aux trois yeux, le bienheureux (Civa) maître des mondes et adoré de tous les mondes qui te regarde. Mets de côté le trouble, Seigneur des dieux ! voici les Richis de Brahma, précédés de Vrihaspati ; ils t'adressent une louange divine pour que tu combattes ! — Ainsi encouragé par le magnanime Vacichtha, Indra retrouva une grande force, etc. » (Mahâbhâr., Edit. de Calcutta, t. III, p. 722, st. 10,118 et suiv.)
Le commentateur du Rig-Vêda veut faire entendre que la crainte éprouvée par Indra vient de l'incertitude où il était s'il détruirait ou non Vritra. Il y a aussi des parties du Vêda où il est dit qu'Indra, après la mort de Vritra, croyant avoir commis un crime, s'était enfui à une grande distance. C'est à peu près ce que l'on trouve dans la suite du récit dont nous venons de donner un fragment, et dans lequel Indra va s'adresser à Brahma, pour qu'il le délivre de l'idée du crime qui le poursuit.
On voit que déjà, dans les hymnes védiques, apparaît une tendance à établir une égalité relative entre les dieux et les hommes. Si, en effet, les derniers ont besoin du secours des dieux, ceux-ci ne peuvent subsister sans les sacrifices célébrés pour eux par les hommes. Puis, quand on voit les dieux recourir souvent aux solitaires livrés aux mortifications ou aux héros célèbres par leur valeur20, pour se débarrasser de leurs ennemis, et quand on sait qu'un ascète peut, par la force des austérités auxquelles il soumet son corps, faire déchoir un dieu tel qu'Indra et se mettre à sa place, on comprend que le brahmane, ce premier né de la création, n'hésite pas à se croire « un objet de vénération pour les dieux mêmes21. » Toute la légende de Vritra est remplie de cette idée que les mondes ne subsistent que par les austérités.
Le bouddhisme en critiquant les pratiques extérieures des ascètes22, et en indiquant comme les seuls moyens donnés à l'homme pour arriver à la délivrance finale, la méditation, la pureté des mœurs, les bonnes œuvres et la charité poussée jusqu'à l'abnégation, s'éloigne peut-être de la doctrine générale des livres brahmaniques, quoiqu'on puisse trouver dans ces derniers des passages où la même idée se présente23.
Mais quand le bouddhisme pose la naissance parmi les hommes comme condition nécessaire pour devenir un Bouddha accompli, auquel rien n'est supérieur, c'est une idée étrangère au brahmanisme, car pour que la délivrance finale des sectateurs de Brahma ait lieu, il n'est pas indispensable qu'ils soient nés parmi les hommes. Selon eux, les êtres qui sont au-dessus de l'humanité, c'est-à-dire les dieux de leur mythologie, peuvent très-bien, sans redescendre à la condition humaine, se livrer aux études sacrées qui les conduiront à être absorbés en Brahma24.
IV
Il y a trente ans environ que les études sur la religion bouddhique ont commencé à s'appuyer sur une base vraiment solide, par la découverte que M. Hodgson fit, en 1828, au Népal, d'un grand nombre d'ouvrages sanscrits, qui tous sont des originaux des livres sacrés du bouddhisme.
Cette découverte était d'autant plus précieuse, qu'il existe des traductions de la plupart de ces ouvrages, en chinois, en tibétain, en mongol, etc., parmi lesquelles il en est qui remontent aux premiers siècles de notre ère.
Avec un empressement et une libéralité qu'on ne saurait trop louer, M. Hodgson mit aussitôt tous ces livres sanscrits à la disposition des savants d'Europe. Mais, malgré les travaux d'un grand nombre d'orientalistes distingués, qui depuis ont jeté beaucoup de jour sur l'histoire et les dogmes du bouddhisme, il reste encore plusieurs points sur lesquels on n'est pas d'accord.
S'il n'est plus permis aujourd'hui de donner au Bouddha une origine africaine, comme le voulaient quelques savants du commencement de ce siècle, pas plus qu'on ne peut soutenir l'antériorité du bouddhisme sur le brahmanisme, il n'en est pas moins vrai que l'époque précise de la naissance du Bouddha est encore un sujet de controverse. Les Chinois et les Tibétains donnent treize dates pour cet événement, et le choix entre elles est assez difficile pour qu'on ait cru pouvoir, faute de preuves décisives, s'arrêter à la date adoptée par les Cingalais, c'est-à-dire à celle qui fait vivre le Bouddha environ cinq cents ans avant Jésus-Christ.
Mais si l'on ignore l'époque précise de la naissance de Sâkya-Mouni, on n'en connaît pas moins en détail toutes les particularités de sa vie et de son enseignement, grâce aux sources indiennes conservées dans les livres de Ceylan et du Népal, et qui sont reproduites dans les traductions chinoises, tibétaines et mongoles, avec une exactitude telle, qu'il ne peut s'élever aucun doute sur leur communauté d'origine.
Malgré cet accord parfait entre les traditions du Nord et celles du Midi, le point capital de la doctrine bouddhique, c'est-à-dire l'état de l'âme après la délivrance finale, comme devait l'entendre le Bouddha lui-même, est, en ce moment, regardé par les uns comme un anéantissement complet, et par d'autres comme un quiétisme qui n'en différerait guère, si l'on prenait ce mot d'une manière absolue, mais qui s'en éloignerait beaucoup, si, comme plusieurs textes semblent le prouver, il est possible de sortir de ce calme profond.
On a dit souvent, et l'on répète encore, que la différence de croyance, en ce qui regarde la délivrance finale, avait été la cause de l'antagonisme qui divisa les brahmanes et les bouddhistes. Cela est-il bien probable, dans un pays de tolérance religieuse où tant d'autres systèmes philosophiques se sont rencontrés sans se heurter violemment ? N'est-ce point plutôt l'influence que les bouddhistes avaient prise sur les peuples et les rois, de manière à ruiner complètement l'influence des brahmanes ? Si le Nirvâna du bouddhisme est l'anéantissement, diffère-t-il assez de celui du brahmanisme pour amener la persécution implacable qui fit chasser les bouddhistes de l'Inde ? On peut en douter en lisant ces paroles de l'illustre Wilson : « L’état absolu de l'âme ainsi délivrée n'est nulle part clairement défini ; elle perd toute individualité de l'esprit et du corps, soit que, avec le Vêdânta, nous la considérions comme devant être réunie à l'Être suprême ou absorbée en lui ; soit que, avec le Sângkhya, nous la regardions comme mêlée à l'élément spirituel de l'univers ; l'état individuel cesse d'exister dans les deux cas. L'annihilation donc, en ce qui regarde les individus, est aussi bien la destinée finale de l'âme que celle du corps, et ne pas être est le résultat mélancolique de la religion et de la philosophie des Hindous25. »
En présence des définitions assez vagues que donnent au sujet du Nirvâna les différentes écoles bouddhistes, on s'est peut-être trop pressé de trancher la question d'une manière ou d'une autre, car, en l'absence des livres primitifs, — ceux que nous possédons ne nous étant parvenus que remaniés par les conciles successifs qui eurent lieu quelques siècles après la mort du Bouddha,— il n'est pas facile de discerner la pure doctrine du maître. L'incertitude qui enveloppe une question de cette importance semble prouver que le Bouddha ne s'est jamais expliqué assez nettement pour prévenir après lui tout sujet de contestation.
Quoi qu'il en soit, la seule légende bouddhique qui se trouve dans ce volume ne touchant à cette question que d'une manière détournée, une plus longue discussion ne serait pas ici à sa place, et d'ailleurs elle ne pourrait être qu'incomplète, parce qu'il se passera probablement encore bien du temps avant qu'on ait lu tous les documents qui sont nécessaires pour traiter à fond ce sujet.
La légende du Pigeon et du Faucon est une des plus anciennes du brahmanisme, car le germe s'en trouve dans le Rig-Vêda26. Sous la forme qu'on va lire, elle fait partie du troisième livre du Mahâbhârata. Elle est répétée dans le treizième livre avec quelques variantes27.
Le roi Civi, qui en est le héros, devait être le père de la tribu dont il est fait mention par les historiens qui ont raconté les conquêtes d'Alexandre dans l'Inde. « Après avoir atteint le confluent de l'Acesines et de l'Hydaspe, Alexandre fit une marche rétrograde vers l'Indus, pour faire une incursion contre les Sibae, que les Grecs prirent pour des descendants d'Hercule, parce qu'ils étaient vêtus de peaux et armés de massues. La figure de cette arme était imprimée sur leur bétail. »
Ces peuples passaient pour descendre du roi Civi ; mais il est plus probable que leurs noms et leurs habitudes se rapportaient à la manière particulière dont ils honoraient le dieu Civa28.
Quoique la légende du récit brahmanique semble, au premier abord, pousser la charité jusqu'à ses dernières limites, on verra, en la comparant à celle des bouddhistes, que la doctrine de ces derniers va plus loin encore. Le brahmanisme, en effet, admet, et même, en certains cas, prescrit le meurtre des animaux29. Aussi, dans la légende des brahmanes, le roi Civi n'hésite pas à offrir au faucon la chair d'un autre animal en échange de celle du pigeon, et ce n'est qu'après y être forcé qu'il se résigne à donner la sienne. Dans le récit bouddhique, au contraire, quand la même idée se présente à l'esprit du roi, il la repousse aussitôt, parce que le bouddhisme, qui ne permet jamais de tuer un être vivant, va jusqu'à préconiser le suicide religieux qui fait sacrifier son corps pour un autre.
Rien de plus ordinaire, dans les livres bouddhiques, que les exemples de cette abnégation tout à fait contre nature. Le plus remarquable et le plus connu se trouve dans la légende où un jeune prince, nommé Mahâsattva, qui, dans une naissance future, sera le Bouddha, se livre à une tigresse affamée pour lui sauver la vie aux dépens de la sienne30.
Mais si le suicide, en vue d'une action méritoire, est donné pour modèle par Sâkya-Mouni, il le désapprouve quand il n'a pas d'autre cause que le dégoût de la vie. Un passage du livre de la discipline nous apprend, en effet, que plusieurs religieux, l'esprit troublé par des entretiens sur les misères de ce monde, ayant mis fin à leur existence par le fer ou le poison, Sâkya-Mouni défendit expressément, sous peine d'être complètement déchu, tout discours de ce genre capable de conduire les autres au désespoir31.
Nous avons cru intéresser les lecteurs en leur mettant sous les yeux les deux rédactions de la légende du Pigeon et du Faucon, lesquelles, bien qu'appartenant à des sectes rivales, diffèrent assez peu entre elles pour qu'il soit nécessaire d'y regarder de près, si l'on veut apercevoir la différence, au fond très-marquée, qui les distingue l'une de l'autre.
Le premier récit, extrait du Mahâbhârata, n'avait jamais été traduit. Le second est emprunté à la version tibétaine du recueil de légendes intitulée Dsang-loun, « Sage et fou. » L'original de ce livre, qui portait le titre de Dâmamoûkha, n’ a pas été retrouvé jusqu'à présent. Le texte tibétain de ce recueil, composé de cinquante et un chapitres, a été publié en entier, avec une traduction allemande, par I. J. Schmidt, sous le titre de « Der Weise und der Thor, » Saint-Pétersbourg, 1843, 2 vol. in-4°.
Paris, ce 15 juin 1862.
1Aucun des épisodes qui composent ce volume n'avait été traduit en français ; le premier, qui forme l'exorde, est le seul dont il existe une traduction anglaise attribuée à Wilkins, et insérée dans les « Annals of oriental littérature. » Londres, 1820.
M. O. Frank, a donné aussi le texte sanskrit de ce même morceau, accompagné d'une version latine, avec quelques extraits du Commentaire de Nilakantha, dans sa Chrntomalhia sanscrita.
Plusieurs personnes qui s'intéressent à la littérature sanskrite désiraient que le commencement du Mahâbhârata fût traduit, afin de remplir la lacune laissée par M. Th. Pavie, dans les « Fragments traduits du Mahâbhârata. » C'est ce que nous avons fait en traduisant l'exorde et l'Adivança. On aura maintenant, en réunissant notre volume à celui de M. Pavie, la traduction de deux mille distiques du premier livre.
2Voyez, dans le t. I, de l'excellent ouvrage de M. J. Muir, Original sanskrit texts on the origin and progress of the religion and institutions of lndia, de nombreux extraits du Mahâbhârata sur l'origine des castes, et les contestations qui s'élevèrent entre les brahmanes et les kchattriyas (militaires), dès les premiers temps de leur établissement dans l'Inde.
Les savantes notes du Râdjatarangint, « Histoire des rois du Kachmir, » trad. du sanscrit par M. Antoine Troyer, contiennent beaucoup de renseignements historiques empruntés au même poème.
Dans un vol. publié à Bruxelles en 1858, par M. F. Nève, « Portraits de femmes dans la poésie épique de l'Inde, » on trouve d'excellentes études morales et littéraires sur le Mahâbhârata.
L’illustre Wilson pense que le Mahâbhârata est la source primitive d'où provient la plus grande partie, si ce n.'est la totalité des Pourânas (Préf. du Vichnou pourâna, p. 58). C'est d'ailleurs, ce que dit le Mahâbhârata lui-même : « Il n'y a pas, dans le monde, un récit qui ne dépende de cette histoire, qui est la collection de toutes les traditions. Ce qu'on y trouve peut être ailleurs, mais ce qu'on n'y trouve pas n'est nulle part ailleurs. » (P. 73, 99 et 103 Je ce volume.)
3M. C. Schœbel a donné, dans les Annales de l’Université catholique, t. XVI, 1853, sous le titre de Légende des Pândavas, un travail qui résume le Mahâbhârata dégagé de tout les épisodes.
4C'est le nombre donné par Wilson, dans la préface des Selections from the Mahâbhârata, à laquelle j'emprunte la plus grande partie de cette courte analyse du poème. Mais ce compte ne doit être qu'approximatif, parce qu'il y a quelquefois des erreurs dans les chiffres qui indiquent le nombre des vers, dans l'édition de Calcutta. Voy. t. I, p. 562, où le premier çlôka est numéroté 9,900 au lieu de 8,900.
5Wilson croit que cette pâleur était causée par une espèce de lèpre, ce qui expliquerait jusqu'à un certain point l'exclusion du prince, car son frère était lui-même atteint d'une infirmité grave : Dhritarâchtra était aveugle, et Gândhârî, sa femme, pour partager eu quelque sorte, son infirmité, portait toujours un bandeau sur ses yeux.
6L'épisode dans lequel est raconté cet événement se trouve dans les fragments du Mahâbhârata, traduits par Théod. Pavie, p. 167.
7Cérémonie dans laquelle une princesse choisissait elle-même un époux parmi les prétendants à sa main.
Cet épisode se trouve aussi dans les Fragments traduits par Th. Pavie, p. 197.





























