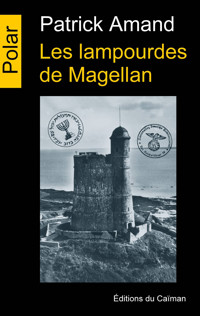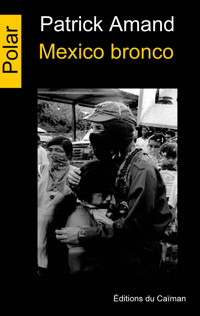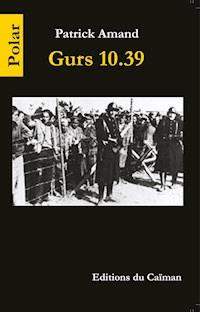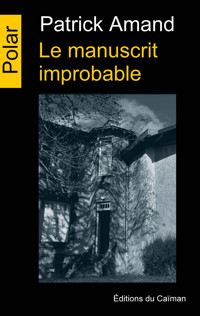
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Caiman
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
13 janvier 1937 : en pleine nuit, Louis Aragon débarque dans la demeure de son ami écrivain Jean-Richard Bloch à Poitiers, La Mérigote. De ce rendez-vous nocturne naîtra Ce soir un des plus grands quotidiens français. 80 ans plus tard, jour pour jour, le maire de Poitiers Charles Salviac annonce à la surprise générale la création d’une résidence d’écrivains dans ce lieu. Face à d’obscures motivations où seront mêlés bibliothécaires, chercheurs, étudiants, la demeure de l’écrivain poitevin dans laquelle se sont côtoyées les plus grandes plumes de l’entre deux guerre –Zweig, Malraux, Rolland, Aragon, Romains … – devient soudainement une maison où tourbillonnent le passé et des quêtes obsessionnelles. Le jeune journaliste Jean-Michel Hénère, fondateur de l’hebdomadaire C ton Poitiers se retrouve bien malgré lui embarqué dans une aventure romanesque, noire. Avec son lot de drames, il devra assembler un puzzle dont il découvrira les pièces au fur et à mesure de ses investigations et des morts qui jalonneront sa route sur le chemin de La Mérigote.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Passionné d’Histoire – particulièrement la Seconde Guerre mondiale –, de faits et d'événements peu connus dans des lieux qu’il apprécie, Patrick Amand aime les chassés-croisés historiques. Tout cela dans un esprit noir et avec un zeste d’humour… Il est également directeur de la collection Noires Nouvelle des Éditions du Caïman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
LE MANUSCRIT IMPROBABLE
Avertissement au lecteur de Poitiers et d’ailleurs
Même si cette histoire repose sur des faits réels, elle reste une œuvre de fiction avec une part de liberté dans l’interprétation et la mise en scène des événements rapportés. Il serait de même illusoire de vouloir faire concorder les personnages de fiction avec des personnes existant ou ayant existé, quels que soient leurs fonctions ou statuts.
La « marge de liberté » des artistes, si chère à Jean-Richard Bloch…
À Roland Sérazin, en toute amitié
« Un seul genre littéraire trouve aujourd’hui son public dans toutes les classes de la société indifféremment : le roman policier. Nouvelle preuve du désarroi que nous éprouvons tous.
Il y a un demi-siècle encore, le sentiment antisocial par excellence était l’amour, ce grand dérangeur des combinaisons financières et des mariages d’intérêt. L’enrichissement général de la bourgeoisie a privé de son ressort essentiel le conflit de l’amour et de l’argent. L’amant a cessé de jouer les premiers rôles en tant que héros secret de la société ; l’assassin l’a remplacé. La passion n’est plus l’acte antisocial en premier chef ; aujourd’hui, c’est le vol et, plus particulièrement, sa forme exaspérée, le meurtre crapuleux. Arsène Lupin prend la place de Ruy Blas.
Le roman policier est le poème épique du criminel de droit commun, de l’inadapté, de l’individualiste en rupture de ban. Toutefois ce genre n’a pas échappé à la loi d’optimisme fondamental qui commande la morale et le dynamisme capitalistes. Sur la route de l’assassin, s’est dressé l’autre enfant chéri de notre époque, le détective. Le roman policier ne peut éviter de traduire la lutte sociale, mais il le fait à sa façon, qui est la plus basse de toutes. Il réduit le conflit à un duel puéril entre deux individus, le délinquant et le policier.
(Au demeurant, je suis de mon siècle, un bon roman policier a toujours la vertu de m’attacher) ».
Jean-Richard BLOCH, Naissance d’une culture, 1936.
1
Poitiers, La Mérigote
13 janvier 1937
— Toc toc toc !
— …
— TOC TOC !
— Tu entends ?
— Oui, quelqu’un frappe à la porte.
— Toc toc ! BLAM !
— J’y vais.
Lui, qui venait juste de se coucher, passa rapidement un pantalon et dévala l’escalier. Elle, elle était tout de même inquiète. Qui pouvait tambouriner à sa porte à cette heure peu avant minuit ? Il était d’autant plus étonné qu’un voyageur égaré aurait dû franchir le portail, passer devant la maison des gardiens et surtout faire face au chien Bassanio, un berger noir ainsi nommé en hommage à Shakespeare et son livre Le Marchand de Venise. Étrangement, celui-ci était silencieux.
Jean-Richard Bloch ne fermait jamais la porte à clef : sa maison était réputée pour être une terre d’accueil, d’amis, de réfugiés, d’antifascistes de tous pays.
Située à la campagne, à quelques kilomètres du centre de Poitiers, la Mérigote, était un îlot de verdure, un écrin dont l’écrivain avait fait son port d’attache qui l’inspirait et lui procurait cette nécessaire solitude créatrice. Ses invités étaient toujours émerveillés par ce lieu dont Bloch n’hésitait jamais à vanter les charmes.
Mais il n’était pas certain que, ce soir-là, ce visiteur importun venait en pleine nuit pour admirer la beauté du lieu.
Jean-Richard ouvrit la porte qui donnait sur le parc et distingua une silhouette qui jouait avec Bassanio qui n’en demandait pas tant. Il ne reconnut en rien le visiteur qui s’amusait à faire dresser le chien sur ses pattes arrière, jusqu’à ce que celui-ci se retourne face à lui. Ce regard perçant il l’aurait reconnu entre mille, même dans la pénombre.
— Louis !
Aragon tiqua, n’aimant pas vraiment ce prénom, hérité de son père qui ne le reconnaîtra jamais et de son enfance mouvementée… Aragon lui suffisait, souvenir malgré tout de l’Aragon espagnole où son père Louis Andrieux fut diplomate. Face à un soleil couchant diffusant une lumière bleutée constellée de nuages orange, Aragon esquissa son plus beau sourire, charmeur, encore plus appuyé à l’endroit de celui qu’il considérait comme un des grands intellectuels de ce début du XXe siècle.
Jean-Richard Bloch était ce camarade, politiquement en transit – car proche du Parti communiste, mais pas adhérent contrairement à lui qui l’était depuis dix ans – auteur du magistral roman Et compagnie… salué par la critique en 1918, auteur de contes, de pièces de théâtre. Il était le fondateur du journal L’Effort en 1910, « revue de la civilisation littéraire », journal poitevin avant-gardiste qui a aussi bien publié les premiers travaux de Freud sur l’inconscient que traduit les poèmes de Walt Whitman… « O Captain ! My Captain ! Our fearful trip is done 1 ».
— Ô Jean-Richard, my captain ! Mon ami, mon camarade ! Notre voyage commence.
— Aragon ! Que fais-tu là, maintenant à Poitiers ?
— Nous allons créer un nouveau quotidien, un grand journal populaire.
— C’était donc ça les deux télégrammes si énigmatiques que tu m’as envoyés !
— Tous les deux, nous allons créer le plus grand quotidien français du soir.
— Oui, peut-être. Mais sûrement pas à cette heure-là. Que dirais-tu de profiter du lit de mon bureau pour quelques heures ? Je sentais que pour une fois, ce soir, mon état de santé me permettrait de dormir. J’aimerais bien vérifier cela.
— D’accord pour un peu de repos, mais avant cela, viens que je t’en dise rapidement quelques mots.
Les deux hommes entrèrent dans le bureau de Jean-Richard Bloch, ce bureau qu’il avait aménagé ici, face à la vallée du Clain, la rivière qui traverse Poitiers, dans cette extension de maison qu’il avait conçue en 1923, en cette Mérigote, son rocher.
Aragon débuta son plaidoyer pro domo. Il dura plus de cinq heures.
***
Marguerite, « Maguite », femme de Jean-Richard Bloch se leva pour préparer le petit-déjeuner des enfants et trouva son mari qui tournait en rond dans le salon. Autant pour se réchauffer, avec ce froid piquant de janvier, que par l’impatience de dire fermement à Aragon qu’il ne lui était pas possible de le suivre dans cette aventure.
— De toute façon, il va se lever tard après la nuit que vous venez de passer.
— Et moi ? Je ne dors pas !
— Tu es insomniaque.
— Oui, à cause de mes blessures de guerre…
— « O Captain ! My Captain ! rise up and hear the bells ; / Rise up – for you the flag is flung – for you the bugle trills.2 ».
Aragon déboula du bureau et entra comme une furie dans le salon, toujours avec ces strophes de Whitman à la bouche. Il avait l’air dans une forme athlétique ; politiquement athlétique. Maguite était impressionnée par la prestance de ce visiteur bien connu, qui plus est bel homme. Elle regrettait qu’Aragon soit venu sans Elsa qu’elle appréciait énormément depuis leur voyage au Congrès des écrivains soviétiques en 1934. Aragon sifflotait l’air d’une vieille chanson russe, souvenir de soirées avec Vladimir Maïakovski et Lili Brik, tout en beurrant une tartine qu’il couvrait copieusement de confiture de mirabelles de fabrication maison.
— Alors Jean ! Tu as bien réfléchi à ce que nous allons faire ensemble ?
Jean-Richard Bloch fixait son hôte, avec une pointe d’anxiété qui ne le quittait plus depuis la veille. Ils avaient beau être proches, l’arrivée d’Aragon en plein milieu de la nuit à la Mérigote – et il fallait être motivé pour venir de la gare de Poitiers jusqu’au bout de ce chemin caillouteux – l’avait perturbé.
Aragon recommençait son discours, tantôt en s’adressant à son ami, tantôt à Maguite.
— Nous allons…, enfin je dirais « il faut », créer un quotidien. L’Humanité a une très bonne diffusion et une très bonne audience. Mais il manque à notre pays un grand quotidien du soir. Il existe Paris-Soir, journal réactionnaire s’il en est. Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste en personne, m’a confié la tâche de concurrencer cette presse de droite. Il faut du répondant à ces idées ; cela passe par l’écrit. Le parti s’occupe de tout : financement et administration. J’ai carte blanche pour toucher un nouveau lectorat, différent de celui de l’Huma. Je suis prêt à me lancer dans l’aventure. Mais celle-ci ne se réalisera pas si tu n’en es pas. Je te connais Jean : il n’y a personne d’autre que toi pour organiser et fédérer autour de ce projet. Tu as une expérience journalistique sans équivalent : L’Effort, puis L’Effort libre. Et ce n’est pas un hasard si Romain Rolland avait pensé à toi pour être un des piliers de la revue Europe. Et c’est bien toi qui es à la manœuvre de Europe, qui n’aurait pas cette aura sans toi. Tu le sais, je le sais. Mon ami, mon camarade. Ce quotidien se fera avec toi, ou ne se fera pas. C’est exaltant : nous allons créer un journal populaire et très politique. Se former et s’informer. Notre combat pour l’Espagne Républicaine, cette Espagne que nous avons au cœur et qui saigne chaque jour, nous lui rendrons hommage dans ce quotidien, comme tu le fis à travers ton livre Espagne, Espagne !, ce terrible et poignant témoignage ramené du pays du Frente Popular avec Jean Cassou et Paul Nizan. Et puis notre Front Populaire a besoin de tous les soutiens.
Louis Aragon parlait très bien. Mieux que quiconque. Sa réputation de flatteur et charmeur n’était plus à faire. Jean-Richard Bloch l’écoutait car il ne pouvait faire autrement. Maguite avait quitté la pièce. À midi, la famille déjeuna au complet : les filles Marianne, Claude, France et le garçon, Michel. Sans oublier Bassanio qui prenait un malin plaisir à venir mordiller les chaussures d’Aragon lequel renvoyait gentiment le fidèle compagnon de la famille Bloch, tenant quand même à son apparence vestimentaire. Les chats « mérigotains », familiers de la demeure se promenaient quant à eux, tranquillement, entre les jambes des convives, comme à leur habitude. Après le repas, devant un bon café et une eau de vie locale, Aragon, qui rallumait la chaudière, supplia, tout en rondeur, son ami d’accepter cette collaboration.
— Tu le sais Louis, je ne suis plus au Parti communiste. J’y étais jusqu’en 1923. Trop de choses m’en ont rendu le séjour impossible. Je ne me vois pas aujourd’hui aller dans ce sens. Mes convictions politiques sont socialistes et communistes, et je n’ai pas besoin de parti pour réfléchir.
— C’est là qu’il faut que tu comprennes que ce quotidien sera populaire, grand public et touchera de nouveaux lecteurs. Et puis surtout, il faut que l’on révolutionne le genre. Je vois une grande part attribuée à la photo, c’est l’avenir. Il y a de jeunes et talentueux photographes qui couvrent la guerre d’Espagne que j’ai déjà contactés : Robert Capa, Gerda Taro et David Seymour sont d’accord pour collaborer avec nous. Cartier-Bresson également. Jean Renoir est aussi prêt à tenir une chronique cinématographique. Jean Cocteau m’a promis des textes. Robert Desnos parlera de l’actualité discographique, Yvette Guilbert de chansons. Elsa pourra tenir une chronique sur la mode. Tu vois, il faut que l’on trouve des personnes de cette trempe, qui n’ont pas forcément leur carte au parti – comme toi – mais qui sont sur une sensibilité politique proche de nous. Un journal de gauche sans scrupules, sans remords. Il sera donc dans les années à venir sans regrets.
— J’ai tellement de choses à faire, d’ouvrages à écrire. Je voudrais me lancer dans une suite de mes romans Sybilla… peut-être aussi Et compagnie. Et tu sais que ma santé est fragile. Je vis à crédit. C’est pour cela qu’avec Maguite nous essayons de ralentir ces allers-retours Poitiers/Paris afin de goûter à cette belle solitude mérigotine. Et cette solitude sur mon beau rocher poitevin, ce havre de paix, est ce qui m’est arrivé de mieux. Là je peux écrire, je peux donner libre cours à mon imagination, mes fantasmes littéraires. Et me reposer. Nous sommes loin de la ville, le lieu est magnifique, cette falaise calcaire en encorbellement me ravit tous les jours. Si j’accepte, je m’éloigne de mes romans. Si je te suis, j’abandonnerai ainsi la littérature.
— Je comprends mon ami. Mais notre combat commun te rattrape. Tu ne peux pas refuser.
En fin d’après-midi, Jean-Richard Bloch raccompagne Louis Aragon en gare de Poitiers. Sur le quai, il lui donne un accord temporaire.
— Je vais t’aider à lancer le journal. Mais je ne participe pas à la suite.
— Merci Jean, je savais que je pouvais compter sur toi. Rejoins-moi très vite à Paris. Tout démarre dans quelques semaines. Je me souviendrai de ce soir-là à La Mérigote.
— Comment s’appellera ce journal ?
— En souvenir de ce rendez-vous fondateur… Ce soir ?
***
Trois jours plus tard, le 16 janvier 1937, Jean-Richard Bloch rejoint Louis Aragon pour travailler au lancement de Ce Soir. Il se donne quarante-huit heures avec lui, et ensuite retour à la Mérigote.
Le 1er mars 1937, le premier numéro de Ce soir, Grand quotidien d’information indépendant paraît. Rédacteur en chef : Louis Aragon. Directeur : Jean-Richard Bloch. Il est aux côtés d’Aragon depuis deux mois et demi : il n’a pas quitté Paris depuis le 16 janvier. C’est lui qui dirige le journal. Aragon écrira sa première chronique politique en août 1937. Le journal tirera à 100 000 exemplaires pour en atteindre 260 000 en 1939. Durant cette période, Jean-Richard Bloch met entre parenthèses sa carrière d’auteur : « L’heure est aux correspondants de guerre, non aux écrivains. L’heure est aux combattants, non aux historiens. L’heure est aux actes, et non à la méditation sur les actes. ». Il ne publiera quasiment plus entre 1937 et 1941.
1 Ô Capitaine ! Mon Capitaine ! Notre effroyable voyage est terminé.
2 Ô Capitaine ! Mon Capitaine ! Lève-toi pour écouter les cloches / Lève-toi : pour toi le drapeau est hissé, pour toi le clairon trille.
2
Charles Salviac avait toujours pensé que le rasage était, sinon le premier geste le plus technique de la journée, du moins celui qui allait déterminer son déroulement. Ceci était d’autant plus vrai qu’il arborait une moustache taillée à la perfection, qui lui donnait un air de Clemenceau jeune. Il aurait préféré des bacchantes plus discrètes à la Stefan Zweig, mais sa calvitie grandissante l’obligeait à faire un travail sur sa moustache et sa barbe. Le rasage était donc un mélange de superstition et de pragmatisme. Il avait expérimenté cela et il savait que la mécanique du rasoir était tributaire de la main. Un écart, un faux mouvement et c’était l’incident. C’était comme en politique. La main devait guider l’objet. C’est pour cela qu’il s’arrangeait parfois : il lui arrivait d’enlever la lame de son rasoir, une lame qui avait deux jours, mais était bien domptée par sa main, pour la ranger soigneusement et la ressortir pour une journée qu’il voulait positive. C’était le cas de ce lundi 13 janvier 2017, où il allait faire une annonce tonitruante en cette date anniversaire. Pour la première fois, il n’avait mis personne dans le coup. Là, c’était son truc et il s’y engageait personnellement comme jamais il ne l’avait fait auparavant. Le jeu en valait la chandelle, il en était persuadé, mais il savait que les quolibets allaient fuser. Qu’importe ! Le temps du rasage était aussi celui du questionnement, du réglage, de la précision. Il mettait à profit ce moment où le miroir renvoyait son image pour voir si tout était OK. Tout devrait aller. Bien sûr il allait être emmerdé par tout un tas de broutilles, batailles politiques, problèmes techniques et financiers comme chaque jour pour tout maire d’une commune de cette taille. Le Directeur Général des Services s’en débrouillerait. La ville de Poitiers allait rentrer dans l’Histoire, une certaine Histoire, quatre-vingts ans après jour pour jour. C’était ce qui lui importait le plus.
***
La soirée inaugurale des Calliopades, la manifestation phare bi-annuelle de la médiathèque – une semaine non-stop destinée à mettre en avant de nouveaux poètes – battait son plein. Les premiers auteurs invités se mélangeaient et discutaient avec le public et les bibliothécaires.
Comme chaque année, sans surprise, la directrice de la médiathèque, Pierrette Champlain, fit un discours convenu, rappelant une nouvelle fois l’historique des Calliopades, avec une petite pointe d’humour, ce qui rendait acceptable cette ouverture plan-plan.
Le maire de Poitiers Charles Salviac, prononça également quelques mots, mais d’une facture très classique pour celui qui avait habitué son auditoire, convaincus ou adversaires politiques, à plus d’envolées lyriques. Ce qui provoqua ce commentaire d’un élu de sa majorité, narquois : « Tiens ! Le directeur de la communication doit avoir la grippe : les éléments de langage sont restés à la maison … ». Cela dit, c’était une manifestation littéraire qui roulait, il n’y avait pas à en faire des tonnes. Les propos du maire juste terminés, Pierrette Champlain invita le public à un verre de l’amitié. Les habitués des vernissages et autres pince-fesses publics n’en demandaient pas tant. Dans les starting-blocks, la ruée vers le buffet n’avait rien à envier à un ralliement d’un socialiste vers La République en Marche. C’est alors qu’on demanda le silence dans la salle. Charles Salviac avait fait deux pas en avant sur la scène et attrapa le micro à pleines mains, tel un vieux crooner sur le retour.
— Je vous remercie toutes et tous pour votre attention. J’ai souhaité faire de cette soirée un événement particulier. Il y a quatre-vingts ans jour pour jour, se passait quelque chose d’exceptionnel dans notre ville. Louis Aragon faisait le voyage Paris-Poitiers et demandait à Jean-Richard Bloch de codiriger un des plus grands quotidiens français, le journal Ce soir. Comme vous le savez, la demeure de Jean-Richard Bloch, La Mérigote, est aujourd’hui à l’abandon et sa disparition est inéluctable. C’est un crève-cœur pour moi. Je ne souhaite pas que cette maison chargée d’histoire devienne le manoir de Coecillan de Poitiers1. Je voulais juste vous annoncer ce soir que nous engageons les démarches nécessaires pour nous en porter acquéreurs et que La Mérigote sera rénovée et deviendra une résidence d’écrivains !
L’enthousiasme l’emporta sur la surprise dans la salle. Les hourras ! fusèrent parmi les invités les plus éclairés, pendant que les pique-assiettes s’empiffraient de toasts et de champagne dans l’indifférence générale.
— J’ajoute que ce projet aboutira d’ici un an et que pour le mener à bien, j’ai décidé de geler celui de la centrale photovoltaïque prévu au Nord de la ville.
C’est à ce moment qu’une toux monumentale recouvrit le brouhaha ambiant : à ces paroles, son premier adjoint, François Sapin, avala un toast d’œufs de lompe de travers et dut être évacué de la salle afin de reprendre pleine connaissance.
Charles Salviac était fier de son effet et poursuivait.
— Pour la renaissance de La Mérigote et la naissance de cette résidence d’écrivains, j’ai décidé de confier le conseil scientifique de cette mission à Claude Vival, Universitaire de renom à la Faculté de Sciences Humaines et spécialiste de Jean-Richard Bloch.
Tel un elfe sorti d’une forêt légendaire, costume ivoire et chemise noire du plus bel effet, Claude Vival apparaissait aux côtés du maire.
— Je lui ai demandé – et il a accepté avec enthousiasme – de superviser le projet global en lien avec les services municipaux mais aussi de mettre en place un projet scientifique et culturel en adéquation avec ce lieu.
Les vivats fusaient de plus belle ; la caution scientifique de l’universitaire ne faisait qu’en rajouter à l’enthousiasme suscité par l’annonce. L’euphorie générale permit de clore cet instant officiel et chacun allait de son commentaire tout en s’emparant d’un verre pour arroser l’événement. Seule Pierrette Champlain faisait grise mine et tentait d’apostropher Charles Salviac qui, voulant savourer le moment présent, renvoya d’un geste de la main la directrice de la médiathèque à ses chers problèmes existentiels. Champlain se rabattit alors sur Vival et le prit à part.
— Vous auriez pu m’en parler. Je suis encore la directrice de cet établissement et le fonds Bloch et La Mérigote ne font qu’un, projet ou pas projet.
— Huit !
— Quoi, « huit » ?
— C’est le nombre de lettres et mails que je vous ai envoyés au sujet de La Mérigote et son devenir en vous alertant sur l’état du bâtiment, justement car je l’estime lié au fonds Bloch. Je n’ai eu aucune réponse de votre part. Alors j’ai contacté et fait du lobbying – je l’admets – auprès du maire pour que l’annonce de ce soir ait lieu. Vous connaissez cette phrase de Mikhaïl Gorbatchev à l’adresse des dirigeants est-allemands quelques jours avant la chute du mur de Berlin ? « Qui fait les choses trop tard est puni par l’Histoire ».
La scène était intense ; les deux se toisaient, l’une était en jupe noire et chemisier blanc, l’autre en veste blanche et chemise noire. On aurait dit le combat du yin et du yang : le regard lancé par l’universitaire clôtura ainsi plus de trois ans d’échanges infructueux. Et Vival jubilait.