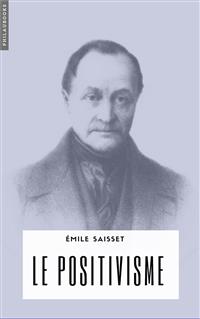
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
L’ambition de la philosophie positive est grande : elle n’aspire à rien moins qu’à organiser d’une manière complète et définitive le travail de l’esprit humain. Circonscrire le domaine de la pensée en ses limites naturelles, tracer les grandes routes où elle est appelée à se mouvoir et les méthodes générales qui doivent régler sa marche, fixer le but que sa nature lui impose d’atteindre et au-dessus duquel elle lui défend de s’aventurer, tel est le vaste dessein que la philosophie positive entreprend d’exécuter. Emile Saisset.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Le positivisme
Émile Saisset
philaubooks
Table des matières
Introduction
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Introduction
La réaction religieuse porte ses fruits ; elle ramène sur la scène philosophique le matérialisme vaincu ; elle suscite au scepticisme du xviiie siècle de nouveaux interprètes ; elle rend à l’athéisme décrié du Système de la Nature quelque attrait et quelque prestige.
Inévitable effet de la crise que nous traversons et où s’unissent en un déplorable assemblage le fanatisme de quelques-uns et l’hypocrisie ou la faiblesse de tant d’autres ! Faut-il être surpris que beaucoup de fortes âmes, profondément contristées ou violemment froissées par tout ce qui se fait et par tout ce qui se prépare, se précipitent aux dernières extrémités et opposent à l’insolence d’une réaction qui se croit sûre du triomphe la menace ou le défi d’une radicale négation ?
Nous comprenons, mais en même temps nous déplorons l’état de ces âmes. Elles oublient que si les religions positives ont trop souvent donné des chaînes à la pensée, et au despotisme des instruments, elles expriment à leur manière dans leur progressive évolution le plus légitime besoin et le droit le plus sacré de la raison humaine, le besoin et le droit de franchir les bornes du monde visible pour se recueillir au sein de l’Éternel, et pour entretenir dans ce divin commerce les sentiments qui donnent à la vie humaine sa valeur et sa dignité, l’amour du bien et du beau, l’amour de nos semblables, la foi dans l’invisible et dans l’idéal, et cette sainte espérance qui fait briller parmi les ténèbres du tombeau les lueurs vivifiantes d’un avenir immortel.
Proclamer chimériques ces hautes aspirations de la pensée, ces sublimes pressentiments du cœur, enfermer l’homme dans l’étroit horizon du monde visible, c’est bien mal connaître et les besoins les plus profonds de notre nature, et la puissance de la raison et le prix de l’humanité ; c’est en outre diminuer le rôle de la philosophie dans les destinées du monde, et porter atteinte aux droits de la pensée libre en trahissant ceux de la vérité. Comment accorder en effet une bien haute estime à cette raison qui n’a rien à nous apprendre de ce qu’il nous est si nécessaire de connaître ? Comment ne pas prendre en mépris une philosophie qui reste au-dessous de nos plus irrésistibles élans, et qui, loin de soutenir et d’étendre l’essor de notre âme, l’abaisse au contraire et l’appesantit ? Comment ne pas chercher hors de la raison une lumière pour éclairer nos ténèbres, un aliment pour rassasier nos immenses désirs ?
Tel est le danger que le matérialisme, à l’insu et contre l’intention de ses promoteurs, fait courir à la philosophie. La réaction qui entraîne aujourd’hui tant d’esprits n’est pas née d’hier ; elle a commencé, elle a été puissante du jour où la philosophie a cessé de cultiver les nobles instincts qui sommeillent dans les moments de crise, mais qui se réveillent bientôt, parce qu’ils ont au plus profond du cœur humain d’indestructibles racines. C’est ce qu’avaient pressenti, au XVIIIe siècle, ces grands esprits qui en ont été la force et l’honneur ; je parle de Montesquieu et de Voltaire, de Turgot et de Rousseau. En voyant se déchaîner sous leurs yeux le torrent des idées matérialistes, ils comprirent la nécessité de le contenir. Qui a rendu au sentiment religieux un plus sincère et plus libre hommage que l’auteur de l’Esprit des Lois ? Qui avec une ardeur plus intrépide que l’éloquent auteur d’Émile osa rompre en visière au scepticisme et au matérialisme triomphants ? Voltaire lui-même, celui de ces hommes d’élite qui a donné le plus de gages à la philosophie des sens, ne s’est-il pas toujours incliné devant l’idée sainte d’une intelligence infinie ? N’a-t-il pas compromis cette popularité qui lui était si chère pour accabler de son incomparable bon sens et de ses mortelles railleries l’athéisme de d’Holbach et de La Mettrie ? Mais une force invincible entraînait tout. Voltaire et Montesquieu passèrent bientôt pour des esprits timides, qui n’avaient secoué qu’à demi le joug des antiques préjugés, et l’on vint dire aux hommes que croire en Dieu et en l’âme immortelle, c’était une puérilité et une faiblesse.
Il faut dater de ce moment cette réaction énergique qui, d’abord contenue en de certaines limites, s’est peu à peu animée par ses progrès, et qui aujourd’hui se fait sentir à toute l’Europe, occupe les hommes d’État et alarme tous les esprits prévoyants. Pour nous, il nous semble qu’il y a un grand enseignement à tirer de ce spectacle, qui nous attriste sans nous ébranler c’est que le vrai rempart de la liberté de la pensée, ce n’est pas une philosophie étroite qui nie des besoins qu’elle ne peut satisfaire, des idées et des sentiments qu’elle est incapable d’expliquer ; c’est une philosophie plus pure et plus haute, ample comme l’esprit de l’homme, profonde comme son cœur, qui recueille toute idée vraie, alimente tout noble désir, explique toute croyance sainte, et ne laisse à ses adversaires que leurs violences et leurs folies.
Voilà la barrière qu’il faut opposer aux entreprises d’un parti que nos fautes seules pourraient rendre invincible. Une expérience récente doit ici nous servir de règle. À une époque dont le souvenir est sans doute importun à certaines consciences, on vit se déployer ces mêmes espérances et ces mêmes desseins qui renaissent aujourd’hui avec un redoublement d’ardeur. Pour les combattre, de fermes esprits élevèrent le drapeau d’une philosophie généreuse, qui puisait sa force dans sa pureté, et qui a dû son triomphe à sa haute modération. Ce glorieux drapeau, un instant abattu et humilié, les hommes de la génération nouvelle doivent le ressaisir et le défendre.





























