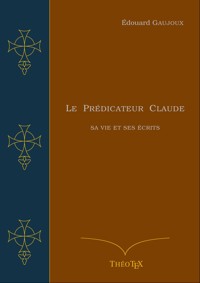
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Édouard Gaujoux (1852-1910) a été pasteur de l'Église réformée à Bergerac (Dordogne), puis à Quissac (Gard). Dans sa thèse il étudie un controversiste protestant célèbre au dix-septième siècle : Claude, dit Claude de Charenton. Les livres d'Histoire ne retiennent guère de lui que ses jouxtes oratoires avec Bossuet, dont impartialement, il était sorti vainqueur. L'envergure de ce ministre huguenot d'exception a cependant porté bien au-delà de ce détail ; ses écrits méritent d'être redécouverts aujourd'hui par les protestants évangéliques qui s'intéressent à leur héritage calviniste, et généralement par tous les chrétiens qui considèrent la Bible comme étant la parole de Dieu. Cette numérisation ThéoTeX reproduit le texte de 1877.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce fichier au format EPUB, ou livre numérique, est édité par BoD (Books on Demand) — ISBN : 9782322485444
Auteur Édouard Gaujoux. Les textes du domaine public contenus ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusivité.Les notes, préfaces, descriptions, traductions éventuellement rajoutées restent sous la responsabilité de ThéoTEX, et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation.ThéoTEX
site internet : theotex.orgcourriel : [email protected]Nous ne pensons pas qu'on nous appelle à justifier le choix de notre sujet. L'un des caractères les plus saillants de notre époque est, sans contredit, le développement qu'ont pris les études historiques dans toutes les branches des connaissances humaines. Or, parmi les différents genres d'histoire, il n'y en a peut-être pas de plus profitable que la biographie des grands hommes, car le savoir, le dévouement et l'abnégation ne seront jamais assez mis en lumière.
J. Claude occupa au milieu de ses coreligionnaires et dans son siècle une trop grande place pour qu'on nous reproche d'avoir consacré notre temps et nos forces à l'examen d'une question épuisée et d'un mince profit. Nous avons consciencieusement recherché tout ce qui pouvait contribuer à nous faire connaître cette personnalité distinguée à tant de titres. Nous croyons avoir examiné les principaux jugements portés sur lui, et nous aurons occasion de les citer ou de les indiquer. Mais c'est aux écrits mêmes du prédicateur et surtout du controversiste que nous nous sommes attaché. Le seul mérite dont nous osions nous prévaloir c'est que nous parlons de Claude d'après ses œuvres. Et si les citations paraissent trop nombreuses à quelques-uns, nous n'hésitons pas à dire qu'elles ont constitué une des plus grandes difficultés de notre tâche, et que notre devoir était de les donner.
Jean Claude naquit à La Sauvetat-du-Drop, dans l'Agenais, en 1618 ou 1619, et mourut, le 13 janvier 1687, à La Haye, dans l'exil décrété par Louis XIV lors de la Révocation de l'Édit de Nantes. Dès son enfance, il fut entouré d'exemples de vertu. Il fit ses premières études sous la direction de son père, pasteur instruit et dévoué, puis il se rendit à la Faculté de théologie de Montauban, où il obtint promptement l'affection de ses professeurs, MM. Garissoles et Charles. Avant d'être appelé dans l'Église de la Treyne, fief appartenant à la maison de Duras, il fut, en 1645, reçu ministre au Synode de la Haute-Guyenne et du Haut-Languedoc. A l'époque dont nous nous occupons, les Églises réformées de France formaient encore un tout compact et appuyé sur des bases solides. Quatre pouvoirs relevant les uns des autres dirigeaient l'Église. Sur le premier plan se trouvait le Consistoire, qui se réunissait toutes les semaines et veillait aux intérêts de la communauté. Les églises les plus voisines nommaient chacune deux députés et avaient à leur tête un Colloque qui se réunissait tous les trois mois. Au-dessus du Colloque se trouvait le Synode provincial, qui se réunissait tous les ans et où chaque Colloque était représenté par deux députés. Enfin, au sommet de l'édifice était le Synode national, qui jugeait en dernier ressort toutes les questions de foi et de discipline. Il était convoqué tous les trois ans, mais les circonstances politiques empêchèrent souvent sa réunion. En 1646, Claude fut choisi par l'Église de Sainte-Affrique, dans l'Aveyron. Celle-ci avait eu le bonheur d'être servie par des hommes d'un grand mérite, puisque M. Gâches, mort en 1668, pasteur à Charenton, et M. Martel, nommé en 1653 professeur de théologie à Montauban, y avaient exercé leur ministère.
Huit ans après, l'Église de Nîmes, guidée par la réputation de J. Claude, le demanda et l'obtint. L'Église de Nîmes n'avait pas cessé d'être une des plus importantes de France. Claude acceptait une lourde tâche, mais il joignait à beaucoup d'instruction une remarquable puissance de travail, et le 3 mai, le Synode d'Uzès, tout en lui laissant les fonctions de pasteur, le chargea d'enseigner la théologie dans l'Académie de Nîmes. Cette académie, fondée en 1561, dura jusqu'en 1666, malgré les difficultés que le pouvoir lui suscita de bonne heure (voir Bulletin du Protestantisme français, 1854, p. 543 et suivantes). « L'enseignement de Claude était si net, nous dit M. De La Devèzea, les matières qu'il expliquait paraissaient si bien méditées, et tournées si heureusement à l'usage de la chaire et à l'intelligence de l'Écriture-Sainte, qu'il attira un grand nombre de proposants. » Dans ce nombre, signalons, en passant, David Martin, bien connu par sa traduction de la Bible.
Le ministère de Claude était de ceux qui devaient éveiller promptement la défiance inquiète des catholiques fanatisés. Ils cherchaient donc avec impatience l'occasion de l'entraver, et cette occasion ne devait pas tarder à se présenter. Un nouveau projet de réunir les deux religions avait été mis en avant, sous l'influence de la Cour, par le prince de Conti, gouverneur du Languedoc. Claude, qu'on avait nommé modérateur du Synode provincial tenu à Nîmes au mois de mai 1661b, remarqua qu'un petit nombre de ses collègues inclinait à accepter une proposition si étrange ; il la combattit énergiquement dans l'Assemblée et conclut en disant qu'il était « impossible d'unir la lumière avec les ténèbres et Jésus-Christ avec Bélial ». Le commissaire Peyremales, qui assistait à l'assemblée par ordre du roi, suivant l'usage, protesta vainement contre ces paroles qu'il trouvait injurieuses pour la religion du roi, vainement il chercha à en empêcher l'insertion au procès-verbal, on ne partagea pas sa manière de voir, et la proposition du Modérateur fut votée à l'unanimité. Prévenu aussitôt, l'évêque de Nîmes, Cohon, signala au roi cette conduite, et Louis XIV, après avoir cassé la délibération du Synode, interdit à Claude l'exercice de son ministère à Nîmes et le chassa de la province (6 août 1661).
Claude se rendit sans retard à Paris pour réclamer contre cette condamnation et pour se justifier. Pendant son séjour à Paris, il entama sa fameuse polémique avec Nicole et Arnauld sur la question de l'Eucharistie, dont nous aurons à nous occuper avec soin dans le cours de cette étude. Cependant toutes ses démarches restaient sans résultat et, n'attendant rien désormais d'une cour où régnait l'intolérance, il partit pour Montauban où il prêcha le lendemain de son arrivée et fut aussitôt nommé pasteur.
D'après M. Michel Nicolas, il fut également professeur de théologie dans cette ville (voir Bulletin de l'Histoire du Protestantisme français, année 1858). Quatre ans après, on le frappa d'une nouvelle interdiction, par suite des plaintes formulées par l'évêque Berthier. Il courut encore à Paris pour réclamer contre cette nouvelle rigueur ; mais il ne réussit pas mieux que la première fois, et il allait se rendre aux vœux du Consistoire de Bordeaux lorsqu'il fut retenu par celui de Charenton (1666). L'Église de Charenton, aux portes de Paris, organisée depuis l'année 1606, était comme la métropole du protestantisme français et le principal théâtre de la controverse huguenote. Tout naturellement cette Église ne mettait à sa tête que des ministres distingués, et, si la religion dominante ne les avait comptés parmi ses adversaires, elle eût rendu à leur talent un hommage qu'elle leur a refusé. Claude ne tarda pas à occuper dans ce milieu le rang dont il était si digne, et il fut choisi comme le champion le plus capable de se mesurer avec Arnauld, Nicole et Bossuet. Il suivait, pas à pas, les plus minutieuses objections, il répondait, ligne pour ligne, aux plus longs ouvrages des adversaires de la Réforme. Il trouvait encore le temps d'entretenir une nombreuse correspondance pour ranimer les courages ou donner les consolations que la foi chrétienne sait inspirer. On n'a malheureusement pu recueillir qu'un volume de cette correspondance, mais nous y voyons une grande variété dans les sujets qu'il a abordés. La plupart des lettres qui nous ont été conservées sont de véritables traités d'apologétique ou de controverse ; d'autres nous donnent un éclaircissement détaillé sur tel ou tel passage obscur de la Bible.
Pendant dix-neuf ans, c'est-à-dire jusqu'à la révocation de l'Édit de Nantes, Claude resta l'infatigable défenseur des droits de ses coreligionnaires que le gouvernement foulait audacieusement aux pieds. A plusieurs reprises il protesta, au nom des opprimés, contre les violations chaque jour croissantes de l'Édit que l'on devait à Henri IV. Il protesta notamment contre un arrêt de 1675 qui excluait des synodes tous les ministres de fief, mesure qu'il regardait avec raison comme une des plus dangereuses atteintes que le clergé eût fait porter aux libertés des églises. Il protesta avec non moins d'énergie contre la Déclaration du 17 juin 1681, qui permettait aux enfants de se convertir à l'âge de sept ans, loi criminelle, contraire non seulement à l'Edit de Nantes, mais aux droits les plus sacrés de la nature. — Louis XIV ne tint nul compte de ces requêtes, et nous regrettons que toutes ne nous aient pas été conservées. Élie Benoit, dans son Histoire de l'Édit de Nantes (tome IV, p. 298), les cite avec éloge et nous en présente une analyse sommaire.
Bayle, généralement si peu prodigue d'admiration, a dit, en parlant de Claude : « Je ne sais si l'on vit jamais plus de délicatesse avec plus de force, plus d'abondance avec plus de choix, plus de pénétration avec plus de justesse, plus de vivacité d'esprit avec plus de solidité de jugement, un tour plus aisé avec une méthode plus exacte, plus d'élévation dans les pensées… etc.c »
Jamais ministre ne fut donc plus apte à diriger un consistoire et à présider un synode. Il fallait un talent spécial pour résumer les discussions, un calme et une prudence rares au milieu de circonstances si difficiles, et ces qualités, il les déploya, notamment en 1682, dans la fameuse séance du consistoire où l'intendant de l'Ile-de-France, accompagné de l'official, de plusieurs ecclésiastiques et de deux notaires apostoliques, vint, par ordre du roi, lire « l'Avertissement que l'Église gallicane assemblée à Paris adressait à tous ceux de la religion prétendue Réformée, pour les porter à se convertir et à se réconcilier avec Rome. »
Tour à tour bienveillant, menaçant et hautain, cet appel se terminait ainsi : « Si vous refusez de reconnaître votre égarement devant Dieu, vous devez vous attendre à des malheurs incomparablement plus épouvantables et plus funestes que tous ceux que vous ont attirés jusqu'ici votre révolte et votre schisme. » Un pareil langage suffirait, à notre sens, pour montrer que le clergé catholique du dix-septième siècle a été l'instigateur ardent et acharné du crime odieux de la Révocation. Claude, tout en reconnaissant que la haute position occupée dans le royaume par les prélats méritait le respect, fit entendre que la soumission a ses bornes, et que la conscience des Réformés n'était pas prête à faiblir devant des menaces brutales ou de fausses protestations d'intérêt. Peu après, il publia des Considérations sur l'avertissement du clergé ; il avait cru utile de garder l'anonyme, mais l'auteur s'y laissait deviner. Tout en ne s'écartant pas d'un profond respect pour les évêques, il sait y prendre un véritable air de grandeur bien légitime à l'égard de ceux qui prétendaient régenter les âmes, oubliant que la religion et la conscience ne relèvent que de Dieud





























