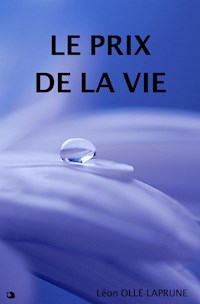
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alicia Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
♦ Cet ebook bénéficie d’une mise en page esthétique optimisée pour la lecture numérique. ♦
« Le plus grand laïc catholique français depuis Ozanam », voilà la présentation écrite par le philosophe anglais William P. Coyne à propos de Léon Ollé-Laprune.
Cet auteur fervent catholique a enseigné avec brio la philosophie à l‘Ecole Normale Supérieure en faisant preuve d’une grande tolérance pour ceux qui ne partageait pas ses croyances religieuses. Il fut notamment le maître de Jean Jaurès qui lui voua une grande admiration jusqu’à la fin de ses jours et celui de Maurice Blondel qui lui dédiera sa thèse.
En nous démontant à quelle point la vie est précieuse, il nous rappelle à l’ordre sur nos actions quotidiennes, pauvres insouciants que nous sommes tous de la fragilité de nos existences... Tout en nous invitant à réfléchir au sens de la vie, il nous explique pourquoi la vie vaut la peine d’être vécue.
Cette oeuvre reste d’une modernité déconcertante, une vraie philosophie de vie à adopter d’urgence !
Le texte comprend 185 notes dynamiques.
EXTRAIT : « La vie, cette chose qui est en moi, qui est mienne, et qui de tant de manières m’échappe, puisque je n’en ai pas le secret et que je n’en suis ni le principe ni le maître : quel objet incessant de mes pensées, de mes désirs, de mes soins ! Et, si je me mets à réfléchir, quelle énigme ! Je porte sur la vie les jugements les plus divers, les plus contradictoires : je la juge bonne, et je la déclare mauvaise ; je l’estime, et je la méprise ; je tiens à la conserver comme une chose précieuse et chère entre toutes, et je la prodigue comme une chose vile. Tantôt il n’y a rien de plus grand ni de meilleur, tantôt rien de plus pauvre, de plus mesquin, rien de pire. Je m’en lasse et m’en dégoûte, je m’y attache et m’y complais. Au fond, c’est bien le mot qui résume toutes mes aspirations, toutes mes ambitions, toutes mes espérances, toutes mes joies ; et si, par moments, il semble résumer toutes les peines, toutes les désespérances, toutes les déceptions, c’est que, dans cet espace de temps qui en est la mesure et que nous nommons lui-même la vie, des évènements fâcheux et des circonstances contraires en ont empêché le déploiement libre : elle n’a pu s’épanouir, elle n’a pu être elle-même ; et alors froissés, blessés, rabroués, si je puis dire, ce n’est pas de vivre que nous nous plaignons, c’est de ne pas vivre assez. Tant il est vrai que vivre est ce à quoi nous tenons par le fond de notre être ! »
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Le Prix de la Vie
Léon Ollé-Laprune
Alicia Editions
Table des matières
Avant-propos
PRÉFACE DE LA TROISIÈME ÉDITION
1. LA QUESTION DE LA VIE
2. LES DONNÉES ET LA MÉTHODE
3. LES OPINIONS CONTEMPORAINES
4. LE SÉRIEUX DE LA VIE
5. LES LOIS DE TOUTE VIE
6. L’ŒUVRE DE LA VIE
7. L’IDÉE DE L’HOMME
8. LA VERTU PRATIQUE DE L’IDÉE DE L’HOMME
9. LA SCIENCE ET LA VIE
10. L’OBLIGATION MORALE
11. LA CONSCIENCE MORALE ET LA SCIENCE POSITIVE
12. UN ESSAI DE FONDER UNE MORALE SANS OBLIGATION
13. LE MONDE MORAL
14. LES MISÈRES DE LA VIE
15. MYSTÈRES ET LUEURS
16. OPTIMISME ET PESSIMISME
17. LE BIEN ET LE BONHEUR
18. DIFFICULTÉS NOUVELLES
19. LE SENS DE LA VIE PRÉSENTE
20. LE PRIX DE LA PERSONNE MORALE
21. LE PRIX DE LA VIE PRÉSENTE
22. LA RENONCEMENT ET LA MORT
23. LA RAISON DE VIVRE
24. LA FAIBLESSE HUMAINE
25. L’AMOUR
26. LA RELIGION
27. LE CHRISTIANISME
28. LA FORME DE LA VIE
29. NOTRE TÂCHE D’AUJOURD’HUI ET DEMAIN
30. LA PHILOSOPHIE DE LA VIE
Notes
Avant-propos
Que penser et que faire de la vie ? J’ai posé cette double question il y a quelques années devant un auditoire de jeunes gens, et tout mon cours de 1887-1888 à l’École Normale a été un essai de réponse devant ces hommes de vingt ans ; avec eux, si je puis dire, j’ai cherché quel est le sens de la vie, si elle est bonne et à quoi elle est bonne, quel en doit être l’emploi. Je reprends ici, dans un livre, la même étude. Le titre que je donne à ce livre en résume l’idée maîtresse. Le Prix de la vie ! Je suis convaincu, et je voudrais convaincre les autres que la vie est singulièrement précieuse, si l’on sait voir ce pour quoi elle nous est donnée et ce que nous pouvons et devons en faire.
29 juin 1894.
PRÉFACE DE LA TROISIÈME ÉDITION
Quand, il y a deux ans bientôt, j’offrais au public ces études sur ce que je puis nommer la philosophie de la vie, ou encore, d’un beau mot emprunté à Aristote, la philosophie des choses humaines, je disais : « Je suis convaincu, et je voudrais convaincre les autres que la vie est singulièrement précieuse, si l’on sait voir ce pour quoi elle nous est donnée et ce que nous pouvons et devons en faire. »
C’est bien là l’idée maîtresse de ce livre, et c’est pour cela qu’il a pour titre le Prix de la vie. À cette déclaration je n’ai rien à ajouter, sinon, peut-être, que du double souci partout présent dans ces pages, celui de ne point mutiler l’homme et celui de prêcher le devoir d’agir, l’urgence, si je puis dire, est de plus en plus visible et va croissant.
Dans l’ordre intellectuel et philosophique, s’il est vrai que l’on constate une certaine aspiration à une synthèse de plus en plus compréhensive, une attention plus sérieuse donnée à des faits de différentes sortes longtemps négligés, un certain élargissement des cadres de la pensée et de la pensée elle-même, il est vrai aussi que la persistance trop générale de vieux préjugés entrave ce retour aux meilleures pratiques et ces heureuses nouveautés, et condamne les désirs, les efforts, les tentatives à demeurer trop souvent stériles ; qu’à l’égard des sciences il subsiste en bien des endroits une méconnaissance fâcheuse de leur véritable esprit, de leur juste portée et, par suite, un emploi peu judicieux de leur méthode et de leurs résultats ; et qu’enfin à l’égard de ce qui est chrétien la défiance est grande, très grande en beaucoup de régions du monde qui pense, ou qui croit penser, et en beaucoup d’autres, l’intolérance même est très aveugle, très haineuse, très active. Ainsi l’humanité se divise d’avec elle-même, et rejette ou néglige quelque chose d’elle-même et des ressources mises à sa disposition. D’autre part, « l’anarchie intellectuelle », que Jouffroy signalait déjà en 1834 1 comme une suite « de l’individualisme le plus exagéré et le plus complet », envahit toutes les parties de la pensée, elle a atteint la morale, elle est extrême ; des tendances diversement puissantes se disputent les esprits, aucune école ne prévaut, aucune influence même n’est décidément dominante, et dans l’universel désarroi il se trouve que c’est à l’énergie individuelle elle-même d’entreprendre la restauration de l’autorité de la vérité qui domine et rallie les intelligences : chacun doit s’appliquer plus que jamais, mieux que jamais, à consulter courageusement et fidèlement les principes et les faits pour se rendre plus que jamais, mieux que jamais, capable de voir clair, de juger et de conclure, précisément parce que ce n’est guère plus la mode ; c’est par cette application soutenue que les esprits peuvent se garantir des préjugés et des erreurs ; c’est grâce à cette application qu’ils peuvent reprendre de la consistance et trouver par quoi se rapprocher et se réunir.
Dans l’ordre social et politique, il en est de même : beaucoup de nobles et de généreuses aspirations, mais le vieil esprit de division, de rancune, de défiance et de haine toujours vivant ; un affreux égoïsme, en dépit de belles paroles et de beaux rêves, séparant les hommes et tout prêt à les armer les uns contre les autres ; et, devant les périls qui menacent la société, l’initiative individuelle, l’énergie individuelle plus que jamais nécessaire pour garantir les vrais intérêts sociaux et pour préparer de nouveaux groupements et par là ramener peu à peu la paix sociale et quelque consistance politique.
Tout ce que nous voyons nous commande donc, plus impérieusement et plus vivement que jamais, de ne rejeter, de ne négliger aucune des ressources qui sont à notre disposition, et de ne pas nous endormir dans l’attente chimérique et malsaine de je ne sais quels sauveurs qui, dans la sphère de la pensée et ailleurs, nous dispensant d’agir et de combattre, rétabliraient pour nous, sans nous, l’ordre troublé.
Les considérations sereines qui remplissent ce livre ont leurs conséquences dans le milieu où chacun de nous est placé. Pour philosopher, il faut regarder les choses dans la lumière des principes et s’élever au-dessus des menus détails comme au-dessus des petites passions : mais philosopher, ce n’est pas se retirer dans je ne sais quelle région abstraite et vide ; ce n’est pas devenir étranger à son pays, à son temps ; ce n’est pas se désintéresser des grands intérêts humains. Si ces pages ont contribué, pour leur petite part, et peuvent contribuer encore à rappeler la nécessité, l’urgence, le devoir d’aborder toutes les questions spéculatives et pratiques qui s’imposent à nous, avec toutes les forces de l’homme tout entier et avec la résolution de payer de notre personne, je me réjouis de les avoir écrites et je souhaite qu’elles se répandent. Plus que jamais il faut que notre devise soit : marcher toutes forces unies, viribus unitis, et agir, chacun de son mieux, en homme de tête, de cœur, de caractère, pro virili parte.
Dans toute recherche spéculative ayant quelque portée, dans toute tentative de réforme dépassant les détails qu’on pourrait appeler techniques, il faut déployer et employer toute la nature humaine, toutes ses capacités, tous ses trésors, tout ce qu’elle est, tout ce qu’elle a, tout ce qu’elle peut, je dirai aussi tout ce qu’elle souhaite et espère. Et si par delà « l’homme purement homme », comme disait Descartes, par delà l’homme avec le sentiment et la raison, avec les sciences, les arts, l’expérience des siècles, il y a encore ce que le même Descartes appelle « une merveille, à savoir l’Homme-Dieu », il faut déployer aussi et employer cette autre ressource, cette ressource divine apportée à l’humanité. En méconnût-on l’origine surhumaine, il faudrait du moins reconnaître l’importance de la conviction que cet ordre surnaturel existe et tenir compte des effets qu’une telle conviction a produits et continue de produire. C’est une façon de penser et de philosopher très mesquine et très étroite que de réduire l’homme aux sens, ou au sentiment, ou à la pure raison, que de tout ramener à l’industrie, ou à l’art, ou à la science, que de ne considérer dans l’histoire que les seules actions militaires, ou les seules combinaisons politiques, ou les seuls problèmes économiques, ou même les seuls conflits d’idées. C’est une autre mesquinerie et une autre étroitesse de supprimer la sphère religieuse et de traiter de l’homme et des choses humaines comme si le christianisme n’existait pas. Ritter a remarqué, dans son Histoire de la philosophie, que « nous portons en nous beaucoup de choses qui ne sont dues qu’au christianisme et qui, devenues en nous une seconde nature, ne nous semblent point être l’effet du christianisme, mais celui de la nature humaine universelle ». On a beau dire et l’on a beau faire, il y a du christianisme dans toutes les veines de l’homme moderne, aujourd’hui et en France particulièrement, et c’est pour cela que la plus grosse question qui s’agite autour de nous, et je pourrais dire en nous, est la question religieuse. L’objet de ce grand débat, c’est, au fond, de savoir si ce christianisme latent, persistant, est un venin qu’il faut expulser, ou un principe de vie qui peut tout ranimer et faire refleurir. C’est donc la plus vaine des choses que de vouloir qu’un homme qui pense fasse abstraction et de la question et de la solution. Demander à un philosophe attentif aux vérités morales de ne jamais regarder du côté du christianisme, c’est le condamner à une arbitraire et dangereuse relégation. Et, s’il a la conviction que le christianisme est vrai et fécond, demander à ce même philosophe de s’en taire sous prétexte de méthode, c’est le condamner à une coupable mutilation.
Est-ce à dire qu’il faille tout mêler ? Non pas, car tout mêler, c’est tout brouiller. Est-ce à dire qu’il faille à tout propos faire intervenir le christianisme et la théologie ? Non pas, car chaque science a son domaine propre, et doit s’y affermir suivant ses principes propres et sa méthode propre, et en poursuivre, en achever, si c’est possible, l’entière conquête ; mais l’homme, l’homme qui pense, s’il a une façon de penser large et haute, cet homme relie et domine ces domaines divers, et dans chacun il demeure ce qu’il est, entier, homme complet et, si c’est un chrétien, chrétien complet. J’ajouterai que chaque science même s’étiolerait, dépérirait, si aucune communication n’existait entre les diverses parties de la connaissance humaine et la philosophie plus sûrement que tout le reste, puisque la philosophie est essentiellement synthèse supérieure ou n’est rien qu’une sorte de redite en autre style des sciences particulières. En tout cas, se séparer d’une partie de soi-même pour penser, et séparer des choses unies dans la réelle complexité des faits, du passé historique et des questions actuelles, c’est un procédé dont l’habitude de compartiments convenus dans des programmes d’enseignement peut seule voiler le vice radical. D’une part, comme disait en 1857 Charles Secrétan2, « le philosophe devient chrétien sans abdiquer, lorsqu’au lieu de tergiverser, il a regardé le christianisme en face, comme un fait historique dont la philosophie de l’histoire est tenue de rendre compte, et qu’il s’est convaincu qu’une intervention directe de Dieu dans l’histoire est la seule raison suffisante de ce phénomène ». Et, d’autre part, une fois le christianisme admis, une « séparation absolue entre la philosophie et la religion » est, selon la remarque de M. Ernest Naville3, une « séparation factice, momentanée, et destinée à disparaître dans les âmes éclairées et sérieuses ». Je veux dire que devant les très hautes ou les fondamentales questions, le chrétien qui est philosophe ou le philosophe qui est chrétien ne saurait se résigner à se priver de sa foi, et que l’essayer serait folie. Sans doute il usera de la « nue raison », comme dit encore M. Naville, le plus possible ; il ira avec la raison seule le plus loin qu’il pourra, il ne négligera aucun des procédés, aucune des précautions que la raison recommande ; il sera, le plus et le mieux possible, raisonnable ; il emploiera, pour discuter avec ceux qui ne reconnaissent que la seule raison, les ressources de la raison seule ; mais quelle sagesse serait la sienne si, convaincu qu’il y a autre chose, il s’interdisait, par je ne sais quel scrupule, d’y faire allusion ? Nos prudences malavisées et nos étroites timidités ne rétréciront ni les questions ni les choses. Elles n’empêcheront pas que le Christ ne soit venu. Et si l’on se réjouit dans son for intérieur qu’il soit venu, comment se réduire à n’en pas tenir compte et à le traiter en public comme non avenu ? Comment parcourir les problèmes que soulève la pensée et ceux que présente l’ordre social et politique, sans qu’à la façon d’envisager ces problèmes et d’en tenter la solution il paraisse jamais que le Christ est dans le monde et qu’on y croit ?
Ainsi la philosophie conspire contre elle-même si elle ne se débarrasse du parti pris de mutiler l’homme, la vie, les choses, l’histoire. Comme il faut qu’elle tâche d’égaler ses vues à toute la réalité donnée, elle doit conseiller, elle doit prescrire, elle doit essayer elle-même d’user de tout l’homme et de toutes les ressources humaines et divines mises à la disposition de l’homme.
L’autre conviction qu’il importe de rappeler sans cesse, c’est que chacun doit agir.
Rien n’est plus insupportable que d’entendre de braves gens dire d’un air désolé : S’il se trouvait un homme. Vœu insensé, vœu lâche. Je n’ai pas la sottise de nier que les grands hommes soient bons à quelque chose, mais ils cessent de faire du bien quand leur action se substitue à toute autre. Henri IV, à la fin du seizième siècle, a eu un rôle admirablement salutaire : il a clos une période de troubles extrêmes, il a été vraiment un pacificateur ; par sa haute intelligence et sa puissante action, il a trouvé et il a fait triompher la solution du problème posé en France. Il n’a rien étouffé, il a discipliné, dirigé les forces vives de la nation, il ne les a pas supprimées4. En tout cas, invoquer un remède et un secours extraordinaire par lassitude de combattre soi-même, c’est se rendre incapable de profiter comme il faut de ce secours et de ce remède, s’ils viennent, c’est par avance les tourner en obstacles à la vraie amélioration intellectuelle, morale, sociale, politique. Nous parlons beaucoup de liberté, nous n’avons pas « les mœurs de la liberté5 ». Beaucoup d’honnêtes gens ne détestent pas qu’on les mène, parce que pour aller sans être mené il faut peiner. Un César à qui l’on peut dire avec admiration et reconnaissance,
Quum tôt sustineas et tanta negotia solus,
un homme fort sur qui repose tout le poids des affaires et qui assure notre repos, ne déplaît pas à certaines paresses, et s’il y avait dans l’ordre intellectuel aussi des Césars, il se trouverait des gens pour leur remettre l’empire de la pensée et le soin de le pacifier. Beaucoup d’hommes rêvent d’un dieu humain qui leur fasse des loisirs,
deus nobis hæc otia fecit.
Heureusement Dieu nous fait entendre, si je puis dire, de toutes les manières qu’en tout ordre de choses son dessein est autre, et que c’est à nous, à chacun de nous de prendre en main virilement la défense des intérêts les plus chers, de remédier aux maux dont l’humanité souffre, de préparer un meilleur avenir. L’histoire, elle aussi, paraît se démocratiser. Et il ne s’agit pas ici de nivellement, il s’agit d’effort personnel pour élever les esprits et les âmes ; il s’agit d’une plus large et comme d’une universelle diffusion de l’énergie intellectuelle et morale. Il faut que chacun soit de plus en plus, de mieux en mieux homme : Confortare et esto vir6. Le siècle finissant aura eu, grâce à Dieu, un grand Pape pour l’éclairer et le guider ; grâce à Dieu, je l’espère, il ne verra rien qui ressemble à un César. Et de plus en plus peut-être, nous paraîtrons réduits à l’impuissance de restaurer les indispensables bases de la société et de l’ordre ; cela servira, je pense, à nous convaincre que nous avons, avec l’aide de Dieu, à « faire nos affaires nous-mêmes7 ». Nous nous déciderons à des efforts intelligents et soutenus, et nous saurons nous unir entre nous ; nous serons convaincus qu’il faut que chacun fasse de son mieux son métier d’homme, et nous nous souviendrons que l’homme étant fait pour vivre en société, l’isolement ne vaut rien et ne peut rien. Chacun travaillera de son mieux à être sensé et bon, et les esprits droits et les âmes droites se rapprocheront malgré ce qui peut d’ailleurs les diviser : il se fera une ligue des honnêtes gens, une ligue du bien public, pour préparer de salutaires nouveautés. Est-ce un rêve ? Pourquoi serait-ce un rêve ? C’est conforme au sens de la vie, et, ce semble, au sens de l’histoire. C’est très certainement ce que la vie veut de chacun de nous, et c’est ce que les évènements nous demandent. Que faut-il de plus pour nous décider ?
23 avril 1896.
Chapitre 1
LA QUESTION DE LA VIE
La vie, cette chose qui est en moi, qui est mienne, et qui de tant de manières m’échappe, puisque je n’en ai pas le secret et que je n’en suis ni le principe ni le maître : quel objet incessant de mes pensées, de mes désirs, de mes soins ! Et, si je me mets à réfléchir, quelle énigme ! Je porte sur la vie les jugements les plus divers, les plus contradictoires : je la juge bonne, et je la déclare mauvaise ; je l’estime, et je la méprise ; je tiens à la conserver comme une chose précieuse et chère entre toutes, et je la prodigue comme une chose vile. Tantôt il n’y a rien de plus grand ni de meilleur, tantôt rien de plus pauvre, de plus mesquin, rien de pire. Je m’en lasse et m’en dégoûte, je m’y attache et m’y complais. Au fond, c’est bien le mot qui résume toutes mes aspirations, toutes mes ambitions, toutes mes espérances, toutes mes joies ; et si, par moments, il semble résumer toutes les peines, toutes les désespérances, toutes les déceptions, c’est que, dans cet espace de temps qui en est la mesure et que nous nommons lui-même la vie, des évènements fâcheux et des circonstances contraires en ont empêché le déploiement libre : elle n’a pu s’épanouir, elle n’a pu être elle-même ; et alors froissés, blessés, rabroués, si je puis dire, ce n’est pas de vivre que nous nous plaignons, c’est de ne pas vivre assez. Tant il est vrai que vivre est ce à quoi nous tenons par le fond de notre être ! Ne hasardons ici aucune formule philosophique, ce serait prématuré ; mais enfin, être et tendre à persévérer dans l’être, n’est-ce pas tout un ? et pour l’être vivant, quelle différence concevoir entre vivre et tenir à vivre ?
Je tiens donc à vivre, j’aime à vivre, je veux vivre, et cela de toutes les façons. Je n’ai pas besoin, en effet, de réfléchir beaucoup pour m’apercevoir que la vie en moi est multiple, que les opérations vitales sont diverses, et bientôt je remarque qu’entre ces formes variées de vie que je trouve en moi il y a une liaison et aussi un ordre. Les unes m’apparaissent comme la condition et la base de tout le reste ; les autres se montrent à moi comme plus belles et plus estimables que ce sans quoi, d’ailleurs, il semble qu’elles ne pourraient exister. À première vue la vie organique est le support de tout ; mais la vie intellectuelle, la vie morale ont une valeur plus grande que ce qui les rend possibles, et si haute en est la dignité que, pour l’amour d’elles, on peut, que dis-je ? l’on doit renoncer à la vie organique. Je veux vivre, et parfois pour vivre il faut mourir. Quelle étrange chose ! Et comme toutes ces formes de la vie, enchevêtrées les unes dans les autres, rendent difficile de juger de la vie ! Les formes nobles sont, en un sens très vrai, ce semble, dépendantes des formes inférieures. Ainsi le feuillage, la fleur et le fruit de l’arbre supposent les racines enfouies dans la terre. Et ces mêmes termes nobles apparaissent comme ayant une telle excellence qu’elles méritent que tout leur soit sacrifié : on dirait alors qu’elles subsistent par elles-mêmes : et pourtant, est-ce donc le moyen de conserver dans leur éclat le feuillage et la fleur, et de faire parvenir à sa maturité le fruit, que de couper l’arbre qui les porte ?
La vie est bien ce que nous connaissons le mieux, et c’est, en même temps, ce qui nous est le plus inconnu. Nous n’en avons aucune idée nette. Dès que nous y arrêtons notre pensée, nous voyons que, sur cet objet si familier et si intime, la confusion est extrême. Nous ne savons qu’en penser, pensant d’elle tant de choses différentes et contraires. Si nous nous demandons ce que nous en pouvons faire, l’embarras est le même. Nous en voyons tant d’emplois différents, tant d’usages opposés ! Et ainsi nous constatons que les premières réflexions sur la vie achèvent d’en brouiller le sens et nous exposent à l’impuissance d’en prendre la direction. Commençant à l’interroger, nous n’entendons plus du tout ce qu’elle est ni ce qu’elle vaut, ni ce qu’elle nous veut ; nous ne savons plus comment l’orienter. Elle est devant nous à l’état de question : nous voudrions découvrir le mot de l’énigme, et nous n’y réussissons pas. Elle est devant nous à l’état de chose pratique, d’affaire à conduire, de bataille à engager : il nous faut un mot d’ordre, et nous ne savons où le trouver.
Le mieux serait-il donc de se laisser vivre sans y penser jamais ? On aurait au moins pour aller et se mouvoir la nature, l’instinct, et aussi la coutume et la tradition. Si la réflexion empêche de vivre parce qu’elle embrouille les raisons de vivre et diminue les forces vives, il faut renoncer à réfléchir.
Non, il ne faut pas renoncer à réfléchir : il faut réfléchir davantage et mieux.
En toute matière, pour se faire des choses une idée nette et distincte, un effort est indispensable : effort d’attention, grâce auquel on écarte toutes les idées circonvoisines, accessoires, étrangères ; une fois qu’on a dégagé ainsi d’un entourage trop touffu quelque point simple, la lumière se fait : on saisit nettement telle chose, on en a une notion distincte et exacte. Puis, grâce à un nouvel effort, on ouvre cet objet : après l’avoir distingué de tout le reste, on y distingue ce qu’il contient en soi ; on y pénètre pour en visiter les replis, pour en scruter les détails, pour en apercevoir les appartenances, les suites, les dépendances, les replis obscurs ; on en obtient ainsi une connaissance de plus en plus complète, de plus en plus profonde. Voilà comment l’on procède en tout ordre de choses : il s’agit, non pas de découvrir ce que personne n’aurait jamais soupçonné, de révéler ce que personne n’aurait jamais dit, mais de mettre à nu ces idées essentielles qui se laissent saisir par tous dès qu’elles sont débarrassées du reste, ces points simples sur lesquels tout le monde est d’accord, puis, par un second travail de la pensée, d’en développer le contenu ; car si l’idée simple est claire, elle est riche aussi et féconde, et la déployer, la dérouler, faire voir les trésors qu’elle recèle,
... atria longt pateseunt,
c’est la tâche et c’est la récompense de la pensée philosophique, attentive, réfléchie, docile à la leçon que lui donnent les faits et aux éternelles exigences de la saine raison.
Je veux savoir que penser de la vie et qu’en faire. Je commence par me recueillir. Je m’efforce de faire cesser ce tumulte incessant des évènements, des choses et des hommes, autour de moi, des images, des mots et des arguments, au dedans de moi. Je veux user de mon esprit, voir par moi-même ce qu’il en est, prononcer avec connaissance de cause. Non que je prétende m’enfermer en moi-même pour tout tirer de moi. Je comprends trop l’absurdité et le danger qu’il y aurait pour moi à vouloir être ce que Leibniz appelle un solipse, à regarder comme non avenu ce que pensent les autres, à user de mon esprit comme si tout commençait à moi. Mais l’étude que j’entreprends demande que je me mette moi-même en face de mon objet et que je travaille à en juger à bon escient. Je m’engage donc dans cette étude avec une entière sincérité, résolu à tout faire pour bien voir, résolu aussi à ne jamais redouter la vérité connue : j’en veux embrasser par avance toutes les conséquences. Mon étude est toute spéculative ; mais sans doute, en cette matière, les conséquences pratiques ne seront jamais loin. Si telle vérité a dans la pratique telle suite contraire aux passions humaines, ce ne sera jamais pour moi une raison d’hésiter devant la vérité, de la nier, même de l’atténuer. Il n’y a de sincérité complète, de sincérité véritable qu’à ce prix. Je veux être sincère de cette manière-là. Et maintenant je commence.
Chapitre 2
LES DONNÉES ET LA MÉTHODE
Je commence : mais par où et avec quoi ? Où prendre mon point de départ ? et qu’ai-je à ma disposition en commençant ?
Il faut que ma première affirmation soit telle que pour être posée elle n’en suppose aucune autre. Cela est clair. Mais que puis-je affirmer qui ne suppose, pour être affirmé, aucune proposition antérieure ?
Des faits, et ma pensée avec certaines exigences (j’emploie à dessein ce mot pour ne rien préjuger).
C’est la situation du savant qui a recours à l’observation et à l’expérience, et qui se sert de sa raison.
Des faits incontestables, indéniables, positifs, constituent un terrain solide sur lequel on peut, tout d’abord, mettre le pied, et si nous invitons les autres à s’y placer avec nous, qui donc osera dire qu’il ne le veut pas, s’il a son bon sens et s’il est de bonne foi ? Voilà donc bien un commencement, un vrai et légitime commencement.
Quant aux exigences de la pensée, pour se convaincre qu’il y en a en effet, il suffit de se dire ceci : Puis-je penser n’importe comment ? Puis-je affirmer n’importe quoi ? Mais non, ce n’est pas possible. Je puis rêver à ma fantaisie, je puis divaguer, je puis faire le sot ou le fou, si bon me semble ; mais je n’appellerai pas cela penser. Du moment qu’il s’agit de penser tout de bon, il y a lieu d’affirmer ceci ou cela, et ce n’est pas de mon caprice que l’affirmation dépend ; elle est valable ou non, et cette valeur n’est pas en mon pouvoir : ce qui est en mon pouvoir, c’est de faire tout ce qu’il faut pour voir comme il faut, pour juger comme il faut. Il y a donc bien de certaines exigences de la pensée contre lesquelles rien ne saurait prévaloir. Je ne dis rien de plus. Je ne cherche aucune explication de cela, je ne tente aucune théorie. Ce serait prématuré. Mais je constate l’existence de ces exigences, et je dis : Voilà encore le commencement, le vrai et légitime commencement. Si je me mets en présence de faits certains et si j’use de ma raison, en tenant compte de ces exigences auxquelles je ne pourrais me soustraire sans divaguer, je trouverai des propositions que j’affirmerai d’emblée sans supposer aucune autre proposition antérieure ; et personne ne pourra les contester, à moins de manquer de sens ou de bonne foi.
Dans la question de la vie, le premier fait que je note, c’est que, en un sens, je puis faire de ma vie ce que je veux, et, en un autre sens, je ne puis pas faire de ma vie ce que je veux.
Je laisse de côté les difficultés auxquelles ces deux affirmations peuvent donner lieu, les mille questions qu’elles suscitent, les explications tentées, les théories édifiées. Prenons les faits eux-mêmes : ils sont incontestables.
C’est un fait que de ce que j’appelle la vie je puis, en un sens, faire ce que je veux. Et si d’ailleurs je ne pensais pas que je puis faire de ma vie ce que je veux, toute question relative à l’usage à faire de la vie serait superflue, oiseuse.
C’est un fait aussi, et non moins incontestable, que de ce que j’appelle la vie je ne puis pas faire ce que je veux. Il y a les mille empêchements que je rencontre à l’accomplissement de mes désirs et de mes projets. Il y a autre chose encore. En effet, si tous les usages de la vie se valent, si c’est chose entièrement indifférente que je choisisse celui-ci et que je rejette celui-là, si ceci n’est pas à rechercher et cela à éviter, s’il n’y a pas de raisons de préférer ceci à cela, à quoi bon poser la question de la vie ? C’est perdre le temps : il n’y a qu’à se taire.
Voilà donc deux faits, ou, si l’on aime mieux, un double fait impliqué dans le fait même de la question posée et partant hors de cause, et tel qu’il est naturel et légitime de l’affirmer dès le début. Partant encore, si je veux proposer aux autres mes idées ou examiner celles des autres, j’ai là en commençant un point pris pour accordé, donc quelque chose de commun entre les autres et moi, quelles que soient d’ailleurs nos divergences d’opinions, et, dès lors, la discussion sera possible : car, pour discuter, il faut qu’il y ait au moins une chose qu’avant toute discussion l’on entende de la même manière des deux côtés.
Je note, en même temps, que certaines propositions rencontreront, je le prévois, une résistance. D’où peut venir cette résistance ? D’un préjugé, dira-t-on. Sans doute, car ce ne peut être que quelque chose qui précède le jugement actuel.
Mais ce qui précède tel jugement actuel est préjugé au sens fâcheux du mot, si la source en est dans quelque habitude de l’esprit née sans réflexion, dans quelque influence inaperçue de la coutume, de l’exemple, dans quelque passion qui inspire insensiblement la pensée. Alors l’énoncé de certaines propositions provoque la résistance de l’homme esclave de la routine, de l’homme aveuglé, de l’homme passionné, parce que ces propositions contrarient ses vues accoutumées, ou ses préventions. Mais, s’il se trouvait que certaines propositions touchant la vie provoquassent la résistance de l’homme qui se sent et se sait homme, faudrait-il encore crier au préjugé ? Ne conviendrait-il pas plutôt de reconnaître là quelqu’une de ces exigences dont nous parlions plus haut, et contre lesquelles rien ne prévaut ?
Se sentir et se savoir homme, et non pas chose et animal, c’est un sentiment et c’est une notion où assurément il y a bien de l’acquis. Je le reconnais. Il ne serait pas malaisé de montrer ce qui y entre de résultats de l’éducation, de l’hérédité, de la culture reçue, de la civilisation. Mais, si je considère le fond, je le retrouve partout ; et là où il n’est pas, là du moins où il est par trop rudimentaire, je dis : Ce n’est pas vraiment l’homme. Et je parle, s’il s’agit d’un individu, d’exception, de monstruosité ; s’il s’agit d’une race, de dégénérescence, d’état embryonnaire : je ne veux plus voir là qu’un vestige effacé de l’humanité, ou qu’une ébauche informe. Et quiconque a son bon sens et est de bonne foi voit comme moi et parle comme moi.
Telles sont les ressources naturelles que j’ai tout d’abord à ma disposition pour juger de la vie et pour examiner et discuter toute proposition relative à la vie : un double fait indéniable, et une certaine notion de l’homme, qui me permet d’en appeler de l’homme à l’homme, je veux dire d’en appeler du penseur distrait ou ébloui à l’homme même.
Ainsi, que l’on me propose un épicurisme éhonté (j’emploie le mot épicurisme pour abréger, au sens vulgaire). Tout de suite, d’emblée, je dirai : Ce que vous me proposez, c’est une vie bestiale. Et je rejette la vie bestiale, βοσχημάτων βίον, comme disait Aristote, par la très simple raison que je ne suis pas une bête, mais un homme.
Si l’on répond : Mais cela me plaît ; je répliquerai : Mais cela ne doit pas vous plaire. Et, si l’on me presse, la réponse que je pourrai donner sera celle-ci : Cela ne doit pas vous plaire comme cela ne doit pas me plaire à moi non plus, parce que cela ne convient pas à l’homme. Non est hominis, non est humanum, non decet hominem. L’homme ainsi compris, l’homme dans cet état, ce n’est plus l’homme.
Est-ce parler au nom d’un préjugé que de parler ainsi ? Assurément non ; ou si l’on tient à nommer cela un préjugé, il faut dire que c’est un préjugé fondé sur la nature humaine, ayant dans la nature humaine sa racine, donc une exigence de la nature humaine, une exigence de la raison humaine en présence du fait de la vie.
Maintenant, muni et armé de la sorte, quel ordre vais-je me faire pour l’investigation que j’entreprends ? Quel sera mon premier objet d’étude ? Il me semble que ce doit être une première idée de la vie qui m’est suggérée par la question même. Je constatais tout à l’heure que, puisqu’il y a une question de la vie, dans un certain sens je fais de la vie ce que je veux, et dans un autre sens je n’en fais pas ce que je veux. C’est dire que, dans la vie, il y a bien des choses que je subis et bien des choses qui, dans une certaine mesure, dépendent de moi. Cela seul suffit à donner à la vie je ne sais quoi de grave. Je constatais aussi que certaines choses me paraissent convenir à l’homme et d’autres ne lui point convenir. L’idée de l’homme m’apparaît, dès mes premières réflexions, avec un certain caractère de grandeur, et voilà encore de quoi faire de la vie quelque chose de sérieux. Bien vite se présentent à moi les mots les plus nobles et les plus imposants : le devoir, la dignité humaine, la responsabilité. Mais je ne veux pas laisser mes pensées se précipiter. Je veux les conduire par ordre, pour voir plus clair et pour juger plus sûrement. De cette première vue sur la vie je ne veux retenir que ceci : la vie paraît quelque chose d’important, de grave, de sérieux. Est-ce vrai ? Tel est le point que je dois d’abord examiner. Cela me paraît d’une bonne méthode.
Cependant une réflexion s’offre à moi : c’est que si le sérieux de la vie est la première chose qui sollicite mon attention, ce n’est peut-être pas seulement parce que cette proposition naît pour ainsi dire de la question ; c’est aussi et surtout peut-être parce qu’elle répond à une des préoccupations les plus pressantes de ce temps. Je me suis recueilli en moi-même pour méditer, mais je ne veux pas pour cela demeurer étranger aux préoccupations contemporaines ; je l’ai déclaré dès le début. Or, une des opinions les plus en vue sur la vie, à l’heure qu’il est, c’est celle qui la répute vaine. Beaucoup d’hommes, aujourd’hui, ne voient dans la vie qu’une sorte de jeu ou un spectacle propre à intéresser les gens intelligents et cultivés, et à leur procurer d’esthétiques jouissances. Je le sais. J’entends ces discours, et si cette idée de la vie n’est pas toujours énoncée distinctement, elle se retrouve sans cesse inspirant d’une manière tacite les jugements, les sentiments, la conduite. C’est en partie pour cela, je n’en doute pas, que le sérieux de la vie m’apparaît comme le premier objet d’examen et d’étude que je doive choisir. Le dilettantisme étant pour ainsi dire dans l’atmosphère intellectuelle et morale, il faut avant tout que je sache à quoi m’en tenir sur cette conception de la vie.
Mais, si les opinions contemporaines me sont ainsi présentes, même quand je ne songe pas à les considérer expressément, n’est-ce pas le signe que je ferais bien de les considérer, en effet, dans leur ensemble avant d’entreprendre l’examen de l’une d’entre elles ? Elles constituent un grand fait que je ne puis négliger. Je suspends donc l’examen du dilettantisme, et je me livre à une sorte d’enquête pour savoir ce que mes contemporains pensent de la vie et ce qu’ils prescrivent ou conseillent d’en faire.
Chapitre 3
LES OPINIONS CONTEMPORAINES
Trois puissances attirent tous les regards à l’heure qu’il est. Elles se disputent l’empire des âmes : chacune d’elles prétend nous fournir l’explication de la vie et en déterminer la direction ; les trois ensemble forment un certain esprit d’où sort une conception assez nouvelle de la destinée humaine et de la conduite humaine. Ces trois puissances sont l’Art, la Science et la Critique. J’écris ici ces mots en lettres majuscules. Je suis un usage que je ne crois pas bon en général. Il me semble qu’ici c’est un moyen de marquer aux yeux pour ainsi dire que ces puissances exercent un grand empire sur les pensées et les actions des hommes.
Chacune d’elles implique une idée qui en est comme l’âme : cette idée, appliquée à la question de la vie, y devient principe d’explication et principe de direction.
Pour l’Art, au moins dans beaucoup d’esprits, l’idée maîtresse, ou principale, ou vitale, c’est l’idée d’une activité abondante, surabondante, qui se déploie librement, sans être assujettie à aucune nécessité, ni non plus à aucune obligation : activité qui se dépense comme en se jouant, sans autre raison que l’abondance même de la vie ; en sorte que, par cette liberté même et cette fécondité, elle a dans son jeu ce charme souverain de ce que nous nommons grâce et beauté et elle produit sans but précis des œuvres superflues, inutiles, dont la valeur esthétique est la seule raison d’être.
Dans la Science, l’idée maîtresse est bien différente : c’est celle d’un enchaînement régulier d’antécédents et de conséquents, auquel on donne le nom de déterminisme scientifique.
Dans la Critique, l’idée maîtresse est à la fois semblable et différente : c’est l’idée d’évolution, laquelle en effet semble impliquer le déterminisme, mais sans y être elle-même impliquée ; car l’évolution est un développement à partir d’un germe, développement soumis apparemment à la loi du déterminisme ; mais le déterminisme se conçoit en dehors de toute évolution proprement dite : une connexion ou suite régulièrement uniforme n’est pas nécessairement un développement à partir d’un germe.
Ces trois idées maîtresses produisent chacune une tendance à considérer la vie d’une façon particulière.
Ou la vie est elle-même une sorte de jeu ; ou elle est un système déterminé à la façon de tout ensemble de faits physiques ou chimiques ou physiologiques ; ou enfin elle est une évolution. L’expliquant par les principes mêmes de l’Art, ou de la Science, ou de la Critique, tantôt on n’y voit qu’un mouvement souple et varié, témoignage d’une activité très riche, très belle peut-être, mais sans but ; tantôt on la considère comme une partie d’un tout bien lié ; tantôt on y reconnaît un moment d’une vaste et longue évolution.
Puis, mêlant ces diverses idées, on est porté à comparer la vie à un organisme qui a ses lois et aussi ses fantaisies explicables au fond par ces lois mêmes. Alors on parle de la vie sans introduire dans le discours aucune notion morale. Le devoir, la responsabilité, la loi morale et la liberté morale, tout cela a eu son heure dans l’évolution humaine ; mais tout cela ne compte plus, tout cela est sans fondement, sans réalité. Pour l’organisme dont l’activité débordante se dépense en un jeu sans objet et par cela même charmant, pour l’organisme dont toutes les fonctions sont soumises à d’invariables lois, pour l’organisme enfin dont une évolution régulière explique la naissance, la croissance, le déclin et la mort, y a-t-il lieu de parler de liberté morale, de devoir, de responsabilité ?
Cependant il y a lieu de donner à la vie humaine une certaine direction : car il est manifeste qu’à certains égards on l’ordonne à son gré, soit qu’en ces desseins mêmes et en ces résolutions, on soit maître de soi ou mû par d’invisibles ressorts. On l’arrange donc ou avec des préoccupations esthétiques ; ou avec des préoccupations scientifiques ; ou avec des préoccupations critiques.
Dans le premier cas, on la considère moins de l’œil de l’artiste qui crée que de l’œil de l’amateur qui regarde : y voyant un jeu destiné à plaire, on tâche que le jeu soit aussi agréable, aussi intéressant que possible.
Dans le second cas, on tâche avant tout de la comprendre ; mais quand les choses sont comprises, c’est-à-dire ramenées à des lois qui les expliquent, elles sont sous la main du savant qui les comprend ; les lois claires sont aussi des lois fécondes ; de l’explication lumineuse sort une impulsion puissante. Savoir, c’est pouvoir. La science est conquérante. De là, dans l’ordre des choses humaines, une tendance née de la science, née du déterminisme scientifique, tendance à refaire le monde, dans la mesure où il dépend de nous, selon les formules de la science même. La conception toute scientifique de la vie donne lieu ainsi à des projets de réforme humanitaire. Le rêve parfois est le fruit de la science positive. C’est elle surtout peut-être qui aujourd’hui engendre les utopies.
Envisage-t-on la vie avec des préoccupations critiques ? On tâche de multiplier les occasions et les matières d’observation ; puis l’on remarque que c’est comme multiplier la vie même ; et pour cela on s’affranchit de tout ce qui resserre, limite, restreint l’activité. Le critique trouve que la joie de la vie, la raison de la vie, le but de la vie, c’est de tout voir, de tout pénétrer, de tout expliquer, de s’identifier avec tout, de vivre en tout et de tout, et, pour ainsi dire, de vivre soi-même toute vie.
Quel sera, dans chacune de ces régions, le mot d’ordre ? Dans la région de l’Art ou plutôt de l’esthétique, le mot d’ordre sera : Jouis du jeu auquel tu assistes, et joue toi-même si tu peux, et jouis de ton propre jeu. L’important, c’est de s’assurer une bonne place au spectacle de la vie.
Dans la seconde région, le mot d’ordre sera : Comprends le mécanisme des choses, et fais toi-même ton rôle de rouage. Le tout est de comprendre. En comprenant, on prend sa part de puissance dans l’univers, on coopère à la marche de la machine totale. On est broyé, l’heure venue, par la nécessité : comme elle nous fait tout ce que nous sommes, elle nous défait. Mais le voir, le savoir, le comprendre est précisément toute la raison de vivre pour l’homme qui pense.
Dans la troisième région, le mot d’ordre sera : Jouis de tout et comprends tout, et par là étends, affranchis, dilate, accrois ta puissance de vivre ; vis toutes sortes de vies ; à force de comprendre et de jouir en comprenant, tu te multiplieras comme à l’infini, tu seras pour ainsi dire toutes choses, dominant tout, n’étant retenu par rien, détaché de tout, trop clairvoyant pour être dupe de rien comme pour rien dédaigner, demandant à l’intelligence une source inépuisable d’illusions scéniques que l’intelligence même donne sans cesse le moyen de dissiper. Ainsi accomplis en toi-même l’universelle évolution, et, si par hasard tu allais être fasciné par le spectacle, vite romps le charme par un sourire, libère-toi par l’ironie.
Ces formules résument l’usage de la vie tel que le souhaitent aujourd’hui beaucoup de gens instruits et cultivés. Et avec cela il y a dans l’atmosphère intellectuelle des courants étranges et d’ailleurs contraires. Un vent de pessimisme envahit les âmes, les abat, les dessèche. En même temps je ne sais quels souffles viennent des régions supérieures et y emportent les âmes. On songe à ce qu’on appelle si volontiers « l’au-delà ». On déclare qu’on ne sait ce que c’est, qu’on n’en peut rien savoir. Mais quand la connaissance cesse, la croyance va encore, va toujours ; et si croire n’est plus guère possible, on peut du moins rêver, et le rêve a ses espérances. Découragements amers ou attendris, désespérances raisonnées ou poétiques, ou bien croyances vagues et presque sans objet, rêves vains mais sublimes, espoirs sans fondement aucun pour la raison mais agréables et stimulants, l’Art s’enchante de tout cela, la Science le suggère presque ou du moins le tolère, et la Critique y trouve un nouveau sujet d’étude qui la captive et la charme.
Voici maintenant une autre réponse à l’énigme de la vie, un autre but proposé à l’humaine activité. J’entends retentir un grand mot bien vibrant, et il fait fortune : la Pitié ! Au nom de la Pitié, on nous prêche l’action, l’espérance, le courage. On condamne le dilettantisme et ses langueurs, le savoir sans entrailles, les projets inefficaces d’universelle réforme, les vaines discussions et querelles d’école, les négations procédant de l’analyse à outrance. On regarde, on touche, on panse de ses mains, on console avec son cœur l’humanité souffrante. On ne se borne pas à promettre aux hommes, comme dans les philosophies nées des sciences, une amélioration lointaine, ou à la préparer lentement par des moyens scientifiques ; on y travaille tout de suite, et soi-même, et pour chacun, et l’on proclame que le beau de la vie, le tout de la vie, c’est de se dévouer pour les humbles, pour les petits, pour tous ceux qui souffrent ; c’est de s’user, de se dépenser, de mourir s’il le faut, pour procurer leur soulagement par les œuvres qu’inspire une cordiale et efficace pitié.
Et pourtant, presque partout, règne ce que je pourrais nommer une grande désillusion morale. Même avec des sentiments nobles et une doctrine généreuse, on craint le plus souvent de donner aux termes qui désignent les choses morales leur sens plein, qui est aussi leur sens usuel et consacré. Le langage semble se vider, et c’est avec un scepticisme secret ou avec une hésitation venant de je ne sais quel respect humain que beaucoup de gens, et même ou surtout des philosophes prononcent les mots de devoir et de responsabilité.
Jamais peut-être la question de la vie n’a été l’objet d’une plus générale attention ; jamais non plus les fondements de la morale n’ont été plus violemment secoués. Un regard jeté sur les catalogues de nos libraires suffirait pour en convaincre l’observateur le plus superficiel. La vie entre dans l’intitulé des livres les plus divers, et d’autres titres non moins significatifs déclarent, avec éclat, la crise de la morale. Kant, dont l’influence maîtresse dure encore, a enseigné la défiance à l’égard de toute réalité transcendante, et la confiance dans le seul absolu que sa critique de la connaissance épargnât, ou plutôt, peut-être, dans celui qu’elle avait pour but de mettre hors de pair, l’Impératif catégorique, le Devoir. Or, cette confiance s’ébranle, et cet absolu tend à disparaître à son tour : beaucoup d’esprits, que les choses de la morale préoccupent, n’y veulent plus rien que de relatif, des faits, là comme ailleurs, et non des principes, des mœurs, mais plus de morale, ainsi que le disait Schérer, dès 1861, dans un article célèbre1.





























