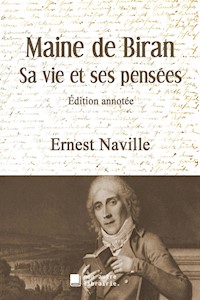2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Ernest Naville (1816-1909) a été professeur d'histoire de la philosophie à l'Académie de Genève. La postérité littéraire n'a guère retenu de lui que son édition des oeuvres de Maine de Biran, et sa biographie de ce philosophe. Mais Ernest Naville fut également un chrétien convaincu, et un pasteur ; c'est pourquoi ses autres écrits portent sur des questions philosophiques éclairées par la foi chrétienne. Le Problème du Mal réunit sous ce titre sept conférences données à Genève, puis à Lausanne, et adressées à un public d'hommes a priori non-chrétiens. Se limitant à la pensée philosophique seule, le conférencier montre qu'aucune solution satisfaisante ne peut être trouvée à la grave énigme de l'existence et de la prédominance du mal. Il montre ensuite en quoi la révélation biblique apporte un nouveau point de vue qui, semblable à la révolution copernicienne, va fournir à la pensée une explication simple et compréhensible du phénomène moral chez l'homme. Émaillés de nombreuses citations littéraires, ces discours se lisent avec aisance, curiosité, et réflexion. Cette numérisation ThéoTeX reproduit le texte de 1869.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ce fichier au format EPUB, ou livre numérique, est édité par BoD (Books on Demand) — ISBN : 9782322484041
Auteur Ernest Naville. Les textes du domaine public contenus ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusivité.Les notes, préfaces, descriptions, traductions éventuellement rajoutées restent sous la responsabilité de ThéoTEX, et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation.ThéoTEX
site internet : theotex.orgcourriel : [email protected]Les discours réunis dans ce volume ont été proposés au public de Genève, puis à celui de Lausanne, sous ce titre : le Problème du mal, étude philosophique.
Des auditoires très nombreux ayant répondu à cet appel, il a été nécessaire de laisser de côté les termes et les formules de l'école, pour présenter sous une forme littéraire, dans un style intelligible à tous, les résultats d'une recherche scientifique. Il n'était pas moins nécessaire, pour conserver à l'étude annoncée le caractère de la philosophie, d'aborder les côtés obscurs du problème, et de ne jamais substituer des formes oratoires à des arguments. Je me suis efforcé de répondre autant que possible à la double exigence née de la nature du sujet et de la composition de l'auditoire.
Une séance spéciale à la fin du cours a été consacrée à la libre discussion des doctrines exposées dans les séances précédentes. En revoyant les sténographies de mes discours, j'ai tenu compte sérieusement des objections qui m'ont été adressées, et dont je remercie les auteurs.
Ernest NAVILLE.
Messieurs,
Il n'est besoin ni de beaucoup d'art ni de beaucoup de paroles pour vous faire sentir l'importance du sujet dont l'étude nous rassemble en ce moment. Le problème du mal ! Qui ne se l'est pas souvent posé ? Les uns regardent au dehors, et, considérant la société humaine, ils se plaignent, au point de vue politique, de tant de tyrannies et de révolutions ; au point de vue économique, de tant de luxe d'un côté, et de tant de misère de l'autre. L'histoire des peuples n'est trop souvent qu'une trame de crimes et un tissu de malheurs. Aux bouleversements de la société s'ajoutent les troubles de la nature : l'ouragan qui engloutit les navires, le tremblement de terre qui détruit les villes, la disette qui affame les populations. Ainsi, lorsque nous jetons les yeux hors de nous, le problème du mal se pose dans l'histoire et dans la nature. Si nous regardons en nous-mêmes, nous rencontrons la douleur. Souffrir et (ce qui est plus dur encore pour bien des âmes) voir souffrir, n'est-ce pas notre destinée ? Enfin, à qui descendra dans sa conscience et se placera en face du devoir,
Une voix sera là pour crier à toute heure : Qu'as-tu fait de ta vie et de ta libertéa ?
et le problème du mal se posera dans les douleurs du repentir et dans les amertumes de l'impuissance. Ce n'est pas seulement la curiosité de l'intelligence qui soulève cette question. En présence du mal et des proportions du mal en nous et hors de nous, il peut arriver que la conscience hésite à croire au bien, que le cœur se décourage parce qu'il n'ose plus croire au bonheur, et que l'âme finisse par douter de Dieu. Aussi quel puissant écho a éveillé le poète qui s'est écrié :
Pourquoi donc, ô Maître suprême ! As-tu créé le mal si grand, Que la raison, la vertu même, S'épouvantent en le voyant ? Comment, sous la sainte lumière, Voit-on des actes si hideux Qu'ils font expirer la prière Sur les lèvres du malheureuxb ?
Est-il nécessaire de vous dire, — j'espère, Messieurs, que personne ici ne m'accuse d'assez de présomption pour que cela soit nécessaire, — est-il nécessaire de vous dire qu'en abordant le problème qui va nous occuper, je n'ai pas la prétention de lever tous les voiles, de dissiper tous les mystères, de répondre à toutes les questions ? Mais, voici ce que je désire, ce que j'espère. L'étude de ce triste sujet m'a été profitable. En fixant un long regard sur les régions ténébreuses du mal, j'ai vu toujours plus resplendir la lumière du bien. Cette expérience m'a donné le courage d'affronter les difficultés très grandes de l'exposition que nous commençons aujourd'hui. Vous associer à des pensées bienfaisantes, à des sentiments qui m'ont paru salutaires, tel est précisément le but que je poursuis. Je ne suis pas un artiste cherchant à vous captiver par la beauté de la parole, ni un docteur parlant avec autorité ; mais un simple compagnon de voyage qui, dans la vallée obscure que nous allons traverser ensemble, croit avoir fait quelques pas du côté de la lumière, et voudrait vous en montrer le chemin.
Nous essaierons aujourd'hui de définir l'idée du bien, puis d'en préciser la nature ; nous chercherons enfin quelle garantie nous pouvons avoir de la réalité de cette idée. Définition du bien ; — détermination du bien ; — garantie du bien : tel sera l'ordre de notre étude.
Si la lumière n'existait pas, nous n'aurions aucune idée des ténèbres. Nous ne pourrons comprendre clairement ce qu'est le mal, si nous n'avons pas une idée exacte du bien. Ce mot, qui joue un si grand rôle dans les discours des hommes, est employé dans des significations diverses. Ces significations, si je ne me trompe, peuvent toutes se ramener à trois.
Lorsque l'homme se dispose à agir, il entend comme une voix intérieure qui, lui parlant avec autorité, lui dit : fais ceci ! ne fais pas cela ! C'est la voix de la conscience. Ce qui constitue la conscience, dans le sens moral de ce mot, c'est le sentiment immédiat d'une obligation qui lie notre volonté à un acte qu'elle doit accomplir. L'obligation n'est pas le désir, car elle contredit souvent les plus ardents désirs de notre cœur ; l'obligation n'est pas une contrainte, car elle s'adresse à notre liberté ; nous pouvons la violer, nous la violons en effet ; l'obligation est un fait primitif, distinct de tout autre, qui constitue pour nous le devoir, c'est-à-dire un commandement que nous reconnaissons pour légitime. Nous sommes libres, mais nous ne sommes pas les maîtres de notre liberté. « Il ne faut pas que, semblables à des soldats volontaires, nous ayons l'orgueil de nous placer au-dessus de l'idée du devoir, et de prétendre agir de notre propre mouvement, sans avoir besoin pour cela d'aucun ordre… Devoir et obligation, voilà les seuls mots qui conviennent pour exprimer notre rapport à la loi morale. » Ainsi s'exprime le philosophe Kantc. Il dit : notre rapport à la loi, et il dit bien. La conscience, en effet, nous commande au nom d'une loi, d'une loi universelle qui, dans des circonstances identiques, prescrit à tous des devoirs absolument pareils. Il existe une loi qui propose le devoir à la volonté libre, et nous disons que la volonté est bonne quand le devoir est accompli.
Je sais qu'on a nié le devoir et la loi. On affirme, dans les livres de certains philosophes et dans les discours de certains hommes du monde, que ces mots : devoir, vertu, loi morale, sont des paroles trompeuses qui ne recouvrent jamais que la recherche de l'intérêt, ou les poursuites de la vanité. Nous n'entreprendrons point ici la discussion générale de cette doctrine ; bornons-nous à une simple remarque. L'idée du bien fait seule la dignité de la vie. Ceux qui nient la loi morale et le devoir n'ont pas d'autre alternative que de se contredire en étant meilleurs que leur doctrine (et ils le font souvent), ou de s'envelopper, comme en un linceul, dans le mépris des autres et d'eux-mêmes. Faire le bien c'est accomplir le devoir. Le bien, dans le premier sens de ce mot, est la loi de notre volonté.
Nous employons le mot dans un second sens lorsque nous parlons des biens de la vie : la santé, la fortune, le plaisir, la réputation, le pouvoir. Que demandons-nous à la fortune, au pouvoir, à la réputation ? Que demandons-nous, hélas ! aux satisfactions de l'envie, aux plaisirs de la vengeance ? Une même chose toujours. Dans les objets de toutes nos passions, tant mauvaises que bonnes, nous ne cherchons qu'une chose : la joie. Tout ce que nous désirons, nous le désirons comme un moyen de jouissance. Si l'avare sacrifie tous les plaisirs à la possession de son or, c'est parce que la possession de son or est pour lui un plaisir qui surpasse tous les autres, et par aucune autre raison. La joie est la nourriture de l'âme ; privée de cet aliment, l'âme languit ; et notre cœur est si ingénieux à la chercher qu'il réussit à la trouver jusque dans la souffrance, et que les poètes peuvent parler, sans être démentis, des douceurs de la mélancolie, et des charmes de la tristesse. Le désir du bonheur est en nous primitif et indestructible, aussi bien que le sentiment du devoir. Vous empêcheriez plutôt l'eau de suivre le cours de la rivière que l'homme de chercher le bonheur.
Ici encore nous rencontrons une philosophie qui se met en travers du chemin de la vérité, une fausse sagesse, dont il nous faut signaler l'erreur. La sagesse véritable nous enseigne qu'il est des bonheurs faux auxquels il faut renoncer pour trouver le bonheur vrai, parce que le bonheur vrai, celui pour lequel notre nature est faite, ne peut se rencontrer que dans une vie réglée selon le devoir. La sagesse vraie nous enseigne encore que l'âme appelée à sacrifier au devoir toutes les jouissances extérieures peut trouver dans le seul accomplissement du devoir une joie qui surpasse toute autre joie. L'expérience de la vie confirme ces enseignements de la sagesse, et, en rencontrant la satiété et le dégoût dans les plaisirs mauvais, l'homme est renvoyé, par la nature même des choses, aux plaisirs purs qui font partie de sa destination. Tel est le résultat commun de la réflexion des sages et de l'expérience de tout le monde. Mais on a affirmé autre chose ; on a affirmé qu'on peut arracher de notre âme le désir du bonheur et nous amener à un état de désintéressement absolu. C'est la pensée de quelques anciens, de certains mystiques de tous les temps, et de quelques moralistes modernes. Cette pensée est au fond de la fameuse doctrine du Bouddha, qui se propose d'obtenir de l'homme une renonciation générale à tout désir. Or, Messieurs, lisez avec une attention sévère les expositions de cette théorie, vous reconnaîtrez que ses défenseurs parlent invariablement ainsi : « Dans les voies que nous indiquons, vous trouverez le calme, vous trouverez la paix. » En d'autres termes, ils nous disent : Renoncez au bonheur et vous serez heureux ! Pour nous encourager au sacrifice de toute joie, c'est la joie même qu'ils nous proposent comme récompense. C'est ainsi que la nature triomphe dans la contradiction qu'elle inflige à ses contradicteurs. L'âme cherche la joie comme son bien, et dans le second sens du mot, le bien c'est la joie.
Il existe un troisième sens. Nous en faisons usage lorsque nous employons l'idée du bien là où il n'y a ni volonté, ni cœur, et où il ne peut y avoir par conséquent ni joie, ni devoir. Dans ce troisième sens, nous appelons bonne une chose qui répond à sa destination. Une lampe est bonne lorsqu'elle éclaire convenablement, parce qu'une lampe est faite pour éclairer. Un chemin étant un moyen de communication, nous affirmons qu'un chemin est bon lorsqu'il permet des communications promptes et faciles. En disant qu'une chose répond à sa destination, nous avons dans l'esprit un certain ordre qui fixe la destination des choses, et nous affirmons que cet ordre est réalisé. Dans le troisième sens, qui est le plus général de tous, le bien c'est l'ordre.
Il y a donc trois espèces de bien : le devoir qui est le bien de la conscience, la joie qui est le bien du cœur, l'ordre qui est le bien de la raison. Voilà trois sens du même mot ; mais pour ce mot unique, ne réussirons-nous pas à trouver un sens unique aussi ? L'emploi d'un terme commun révèle toujours une certaine communauté d'idées, car les langues, expression de la pensée humaine, ne sont pas faites au hasard. Voici la définition générale du bien que je vous propose : le bien est ce qui doit être ; le mal, par conséquent, est ce qui ne doit pas être. Pesez bien ces deux définitions, car elles renferment et résument tout mon enseignement. Au point de vue pratique, nous devons faire le bien et éviter le mal, vous le savez tous, et je n'ai rien d'autre à vous apprendre. Quant à la théorie, je n'aurai pas d'autre règle que celle-ci : repousser toutes les doctrines qui nieraient que le bien doive être, ou qui tendraient à établir que le mal doit être ; et nous arrêter à la doctrine qui laissera subsister nos deux définitions fondamentales. L'importance de ces définitions étant si grande dans l'étude que nous commençons, il est essentiel d'en bien établir le sens et la portée.
Pour prononcer sur ce qui doit être, il faut nécessairement, ainsi que nous venons de le remarquer, avoir dans l'esprit un plan qui marque l'ordre légitime, la destination des choses, et qui permette de prononcer que l'état des choses est ou n'est pas conforme à ce plan. Supposez un objet dont la destination vous soit entièrement inconnue ; vous ne pourrez pas le dire bon ou mauvais. Voici par exemple une machine ; est-elle bonne ? Vous ne pouvez répondre avant de savoir à quoi la machine est destinée. Est-ce une machine à coudre ? est-ce une machine à battre le blé ? Tant que vous ne le saurez pas, il vous sera impossible de prononcer qu'elle est bonne ou mauvaise, parce que, ignorant la destination de la chose, vous ne pourrez dire si la chose est conforme ou non à cette destination qui vous reste inconnue.
Si le bien est toujours ce qui doit être, dans le sens que nous venons d'indiquer, il semble que c'est le bien de la raison qui est pour nous la définition générale du bien. Oui, Messieurs, le bien étant toujours la réalisation d'un ordre, d'un plan, tout bien a le caractère du bien de la raison ; et nous pouvons reconnaître immédiatement que l'idée de répondre à sa destination renferme les deux autres sens du mot bien, si l'on admet que le devoir est la destination de la volonté et que la joie est la destination du cœur. Mais il est essentiel de remarquer que le doit être de la raison n'existerait pas dans notre pensée si nous ne puisions pas dans la conscience l'idée primitive, et unique dans son espèce, de l'obligation morale. Là où l'idée de l'obligation n'a pas de place, il n'y a pas de place non plus pour les idées du bien et du mal. Si nous supposons un être capable de penser et de sentir, mais sans conscience morale, nous pourrons comprendre qu'il ait les notions de l'agréable, de l'utile, du vrai, du beau, mais non pas l'idée du bien telle que nous la possédons ; car cette idée, telle que nous la possédons, procède de la conscience. Nous passons de la loi de notre volonté à la conception d'une loi générale des choses, de l'idée de ce que nous devons faire à l'idée de ce qui doit être fait. Le jugement bien, dans sa plus grande généralité, contient la pensée d'une obligation pour une volonté ; le jugement mal renferme toujours la pensée de la faute d'une volonté. L'idée du bien est donc conçue par la raison, mais sous condition que la conscience soit présente. Il existe un élément moral dans tout jugement relatif au bien.
Ce qui a souvent trompé les philosophes à cet égard, et leur a permis d'établir une séparation absolue entre le bien moral et un autre bien qu'ils nomment métaphysique, c'est qu'ils ont vu que nous appliquons l'idée du bien à des êtres dépourvus de volonté et qui ne sauraient par conséquent être le sujet d'une obligation. Mais ces êtres peuvent être pour des volontés l'objet d'une obligation. Une maison, par exemple, n'est obligée à rien, mais la qualification de mauvaise appliquée à une maison renferme au fond une plainte contre l'architecte qui devait la faire bonne. Dans le doit être de la raison, il y a toujours un élément de conscience, puisque sans la conscience le mot doit n'aurait pas de sens. L'idée du bien réalise ainsi l'union intime de la raison qui conçoit un plan, et de la conscience qui y attache l'idée de l'obligation. Lorsque la raison conçoit le bien, elle devient en quelque sorte l'organe de la conscience absolue, et prononce un doit être qui s'étend à tout l'univers.
On peut, je le pense, justifier ces affirmations par une revue détaillée de tous les cas où nous faisons usage de l'idée du bien. On peut établir que, toutes les fois que le terme n'est pas détourné de sa signification primitive et directe, l'emploi du mot bien suppose, avec l'idée d'un plan, celle d'une puissance qui doit le réaliser, et qui a tort si elle ne le réalise pas. Cette démonstration réclame des analyses qui seraient nécessairement longues et vous sembleraient probablement fort subtiles. Je me borne donc ici, en restant dans des termes généraux, à ramener au doit être de la conscience, la joie qui est le bien du cœur, et l'ordre qui est le bien de la raison. Commençons par la joie.
C'est, semble-t-il, un dur paradoxe que de chercher dans la joie une obligation morale, et de vouloir ramener à l'unité la conscience et le cœur. Depuis les déchirements du Cid de Corneille, partagé entre son honneur et sa maîtresse, jusqu'au cas d'un étudiant qui hésite le matin entre son professeur qui l'attend et les charmes de son lit qui le retiennent, notre vie entière n'est-elle pas la lutte de ces deux éléments dont j'affirme l'accord : la conscience et le cœur ? Assurément il y a des joies mauvaises ; assurément la loi du cœur n'est pas la loi de la volonté ; et si nous disons que la joie est obligatoire, ce ne sera pas toujours nous qui serons obligés, et nous ne serons jamais obligés à la recherche de toutes les joies. « Fais ce que dois, advienne que pourra, » c'est la seule formule de la conscience. Mais, de ce qu'il y a des plaisirs mauvais, et de ce que notre bonheur personnel n'est pas la loi de notre volonté, il ne résulte pas que la joie ne soit obligatoire en aucun sens, et pour aucune volonté. Nous voyons immédiatement que le bonheur de l'un peut être le devoir de l'autre. Le bonheur d'un père n'est-il pas le devoir de son fils, et le bonheur d'une femme n'est-il pas le devoir de son mari ? Prenons la question dans toute sa généralité. Me démentirez-vous si j'affirme que, lorsque la loi de la volonté est accomplie, la loi du cœur doit se réaliser, et que le bonheur doit suivre le devoir accompli, en sorte que la joie, sans être le but de notre volonté, doit être le résultat d'une volonté bonne ? Nous éprouvons, en quelque mesure, dans ce que nous appelons les satisfactions de la conscience, le fait de la joie qui accompagne la pratique du devoir. Mais je ne parle pas du fait, qui ne se réalise souvent que d'une manière incomplète, je parle du droit. Là où tout devoir serait réalisé, nous prononçons que le bonheur doit suivre, et ce lien du bonheur et du devoir est conçu par la raison comme un des éléments de l'ordre universel. Platon a dépeint un juste imaginaire, digne de tous les prix de la vertu et couvert de tout l'opprobre du viced. Placez-vous en présence de la figure de ce juste. Vous sera-t-il possible de ne pas comprendre aussitôt que le monde dans lequel ce juste souffre est un monde mauvais ? Lorsqu'un être souffre, il faut qu'il y ait une volonté dans le désordre ; il faut que sa souffrance soit le résultat de sa faute à lui, ou de celle des autres ; autrement nous dirions qu'il y a injustice, et que la nature des choses est mauvaise. Mais la nature des choses n'est qu'un mot qui exprime les faits et qui ne rend compte de rien. Aussi, en présence d'un monde dans lequel tout devoir serait accompli et où nous rencontrerions la douleur, l'homme, que froisserait l'injustice, se sentirait meilleur que le principe de l'univers ; il s'élèverait contre l'Auteur des choses, et « s'écrierait en gémissant : Tu m'as trompée ! » Un monde moralement dans l'ordre et livré à la douleur serait une objection contre la Providence. La joie doit donc suivre le devoir accompli ; elle fait partie de notre destination dans le plan de l'univers ; elle doit être, et rentre ainsi dans notre définition du bien.
Ramenons maintenant à ce même sens le bien de la raison. Démontrons que l'ordre conçu par la raison n'est le bien que parce que la conscience y attache le sentiment de l'obligation. Là où nous voyons l'ordre fait, nous approuvons les agents qui l'ont réalisé. Nous jugeons ainsi pour les œuvres humaines, et, en présence du spectacle de la nature, si les fonctions naturelles de notre âme ne sont pas paralysées, nous adorons l'architecte des mondes, et l'artiste suprême. Partout au contraire où nous rencontrons le désordre, nous recherchons instinctivement une volonté responsable. Dès que quelque chose ne va pas selon nos désirs, nous sommes enclins à nous plaindre de quelqu'un. Lorsque les eaux du Léman s'élèvent un peu trop sur les côtes vaudoises, nos confédérés s'en prennent aux autorités de Genève qui, disent-ils, ont obstrué le cours du Rhône à sa sortie du lac ; et lorsque le Rhône inonde les rues de Lyon, nos voisins de France accusent, et non pas sans fondement, l'imprudence des Valaisans, qui ont déboisé leurs montagnes. Partout où nous voyons le mal, nous avons besoin de blâmer une volonté, et cet instinct ne nous trompe pas. Ce qui nous trompe c'est que, dans le plus grand nombre de cas, nous nous plaignons des autres là où il ne faut nous plaindre que de nous-mêmes, soit de nos propres fautes, soit de la témérité présomptueuse de nos jugements, ce qui est encore une faute. S'il s'agit d'un désordre se manifestant dans un domaine où notre volonté ne peut rien, ni celle des autres non plus, qu'arrive-t-il ? Nous nous élevons contre la Providence, et c'est là ce qui m'a conduit à l'enseignement que nous inaugurons aujourd'hui. C'est pour répondre à une objection contre l'existence de Dieu que j'ai pris l'engagement de traiter le Problème du malf. Si le mal est une objection contre l'existence de Dieu, c'est parce que nous pensons que le bien doit être, et qu'il serait s'il existait une puissance capable de réaliser l'ordre que nous concevons comme légitime. L'objection ne peut pas s'entendre autrement. Disons toute la pensée de l'homme. Là où nous voyons le mal, en dehors de tout pouvoir humain, nous estimons que c'est Dieu qui manque à son devoir. Cette formule vous étonne et peut-être vous scandalise. Hâtons-nous de l'expliquer. Êtres tirés du néant, comme nous le sommes, nous n'avons aucun droit vis-à-vis du Tout-Puissant, et Dieu étant primitivement l'existence unique et absolue, il ne saurait y avoir de devoir pour lui, puisqu'il n'y a pas de devoir à l'égard du néant.
Si du Dieu qui nous fit, l'éternelle puissance Eût, à deux jours au plus, borné notre existence, Il nous aurait fait grâce ; il faudrait consumer Ces deux jours de la vie à lui plaire, à l'aimer.
Ce n'est pas un dévot qui a écrit ces vers, ils sont de Voltaireg. Mais, d'autre part, comme l'a justement observé Jean-Jacques Rousseauh, Dieu s'est lié lui-même, si de semblables expressions sont permises, par la manière dont il a constitué notre âme. Ce qu'il nous fait lui-même juger bien, c'est vis-à-vis de sa propre volonté, ou, comme on le dit, de sa propre gloire qu'il doit l'accomplir. N'est-ce pas dans ce sens que les Hébreux chantaient : « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloirei. » C'est ainsi que nous concevons pour l'Être absolu, non pas un devoir le soumettant à une règle étrangère, ce qui contredirait absolument sa nature, mais une obligation dont il est lui-même l'auteur.
Résumons, Messieurs, ces considérations. Il y a un bien pour la conscience, un bien pour le cœur, un bien pour la raison ; mais ces trois biens se ramènent à un. Le bien est ce qui doit être ; il renferme toujours une obligation pour nous, pour les autres, ou pour la volonté suprême, dans le sens que nous venons d'indiquer. Le bien n'est pas un être, une chose ; c'est un ordre déterminant les rapports entre les êtres, rapports qui doivent être réalisés par des volontés. Lorsque l'ordre est établi, lorsque la loi signifiée à la liberté est exécutée, le bonheur doit suivre. Le bien résume ainsi, et coordonne toutes les tendances de notre nature. Il est l'objet commun de la raison, de la conscience et du cœur ; de la raison comme ordre, de la conscience comme devoir, du cœur comme joie.
Vous pourrez maintenant entendre une des plus belles conceptions de la sagesse antique, la comparaison dans laquelle Platon nous présente le bien comme le soleil des espritsj. Vous connaissez le rôle du soleil dans la nature. Quand Melchthal, dans le Guillaume Tell de Schiller, apprend qu'un tyran féroce a crevé les yeux de son vieux père, il s'écrie :
O noble et doux présent, bienfait de la nature, Précieuse clarté ! l'heureuse créature Ne vit que par toi seule, et vers l'astre du jour La plante de nos champs se tourne avec amour. Tout te cherche, t'admire et le bénit au mondek.
Le soleil de la nature renferme indivisiblement dans son rayon la chaleur et la clarté, et c'est pourquoi la plante se tourne vers lui. Le bien, soleil des esprits, vraie lumière de la raison, renferme indivisiblement dans son rayon le devoir et le bonheur, et c'est pourquoi nos âmes se tournent vers lui. Oui, notre âme, toutes les fois qu'elle n'est pas déviée de sa direction naturelle, se tourne vers le bien et nous l'aimons. Ceci vous étonne sans doute. On ne s'en doute guère à nous voir agir, et nous ne pouvons guère nous en apercevoir en regardant notre propre cœur. Certes, nous n'aimons pas souvent le bien de cet amour efficace et viril qui produit les œuvres. Voici précisément quelle est notre situation. Nous craignons le bien sous la forme du devoir, parce qu'il nous commande et qu'il nous condamne ; mais en lui-même nous l'aimons, parce qu'il est la suprême beauté, et, toutes les fois que nous sommes hors de cause, cet amour naturel se fait sentir. Oh ! si l'on pouvait être bon sans effort et sans sacrifice, la vertu exciterait d'incroyables amours ! On le voit bien dans les circonstances où nous sommes personnellement désintéressés. Cicéron rapporte « qu'un jour un vieillard d'Athènes étant venu au spectacle, pas un de ses concitoyens, dans cette foule immense, ne se dérangea pour lui faire place ; mais comme il s'était approché des ambassadeurs de Lacédémone qui avaient leur banc particulier, ceux-ci se levèrent tous et le reçurent au milieu d'eux. L'assemblée entière éclata en applaudissements, ce qui fit dire à quelqu'un : Les Athéniens connaissent le bien, mais ils ne veulent pas le fairel. » Combien il y a de ces Athéniens-là ailleurs qu'à Athènes ! Voyez ce qui se passe sur nos théâtres. Mettez sur la scène une jeune fille aux prises avec les plus terribles tentations de la vie. La voilà soumise aux séductions de l'or, aux flatteries les plus ingénieuses, aux machinations les plus diaboliques ; elle voit d'un côté le vice et la fortune, d'un autre côté sa conscience et la misère. Faites qu'elle se maintienne droite et pure et que, traversant la corruption sans en être atteinte, elle reste avec la misère et sa conscience. Si le génie de l'art a touché votre front, vous réussirez à faire applaudir, à faire peut-être pleurer d'attendrissement, même des libertins endurcis.
Ceci nous explique un des secrets de la Providence dans le gouvernement du monde. Comment se fait-il que la loi morale se maintienne ? Il y a bien des siècles, le poète Sophocle faisait célébrer sur le théâtre d'Athènes cette loi sublime que l'oubli ne saurait jamais abolirm. Elle est toujours là, en effet, la loi ! Le temps a renversé bien des trônes et des républiques, bien des chartes et des constitutions, mais la loi morale est toujours debout. Cependant, quelle est la loi qui, plus qu'elle, a été violée, niée, attaquée ? Et pourtant elle est toujours là avec ses deux satellites : le remords qui punit le crime accompli, et ce vengeur du bien négligé qui frappe les vies perdues, l'ennui. Comment cela se fait-il ? Le voici : On cherche sans doute à établir de fausses maximes pour justifier une conduite mauvaise, et on ne réussit que trop à leur donner du crédit. Toutefois, on nie beaucoup moins la loi morale qu'on ne cherche à plaider pour soi des circonstances exceptionnelles qui permettent de la violer. On veut le bien et la loi, on les approuve, on les aime… chez les autres. Cet homme d'État, par exemple, qui médite de tromper ses confrères et de réaliser la maxime que la parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée, croyez-vous que, même en matière politique, il prétende établir comme une maxime universelle la légitimité du mensonge ? Attendez qu'un de ses employés lui fasse un rapport politique faux, et vous verrez comme il maintient dans sa rigueur la loi qui prescrit la vérité. Ce banquier qui s'enrichit par des manœuvres criminelles des dépouilles de ses clients, et qui prépare la ruine des autres et son propre déshonneur, croyez-vous qu'il érige le vol en loi morale universelle ? Attendez qu'un de ses commis dérobe quelques écus dans sa caisse, et vous verrez comme il se rappelle bien le chapitre du catéchisme qui prescrit le respect de la propriété. Son commis est un voleur ; mais pour lui-même, il y a un cas d'exception. C'est ainsi que nous cherchons des excuses pour nous dispenser de l'observation du devoir, plutôt que nous ne nions la valeur du devoir en général. Nous proclamons la loi, nous l'appliquons aux autres, nous la maintenons dans le monde, quitte à trouver pour nous des dispenses. Tous les sophismes dont nous nous servons alors sont autant d'hommages que le vice rend à la vertu. Nous sommes faits pour le bien, et lorsqu'il ne se trouve pas en conflit avec nos penchants mauvais, nous le voulons et nous l'aimons.
Le bien est un ordre qui doit être : telle est sa définition. Cette définition réunit la raison qui conçoit l'ordre, et la conscience qui le déclare obligatoire ; et comme le bien s'adresse à notre cœur par l'attrait qui lui est propre, toutes les puissances de notre âme, si elles ne sont pas déviées de leur direction légitime, sont tournées vers le bien. Il nous faut maintenant déterminer plus exactement sa nature, en demandant quel est cet ordre qui doit être.
Ce qui doit être, dans la société spirituelle, c'est l'accomplissement de la loi morale. Les diverses prescriptions de la loi pourraient-elles se ramener à une prescription unique qui les renfermerait toutes ? Je le pense, et je vous propose d'accepter l'idée que le devoir qui renferme tous les devoirs, est la consécration de chacun des membres de la société spirituelle au bien général de cette société, c'est-à-dire à son bonheur, en désignant par le mot bonheur, non des joies passagères qui peuvent se séparer du devoir et le contredire, mais un état heureux qui ne peut se rencontrer que dans l'ordre dont la loi morale est l'expression.
Tous les devoirs peuvent être ramenés à trois classes : les devoirs de la dignité, qui nous interdisent de nous ravaler au rang des brutes en mettant l'âme au service du corps, et de prostituer dans le mensonge la parole, organe de la pensée ; les devoirs de la justice, qui nous prescrivent de reconnaître dans nos semblables la dignité et les droits de notre propre nature, et de respecter la personne, la propriété et la réputation d'autrui ; les devoirs de la bienveillance, qui nous commandent de soulager nos semblables dans les nécessités de leur vie corporelle et spirituelle. Telle est la classification de nos devoirs qui m'a semblé la meilleure, après une assez longue étude de cette matièren. Or la formule que je vous propose contient ces trois classes de devoirs. En effet, pour que le bien de la société spirituelle soit réalisé, il faut que chacun de ses membres se constitue esprit en se dégageant d'une vie animale (dignité) ; il faut que le respect de chaque membre de la communauté en fasse une société vraiment spirituelle, c'est-à-dire libre (justice) ; il faut enfin que chaque volonté soit dirigée vers la réalisation du bien commun (bienveillance). Concevez une société d'esprits en croissance, en progrès continu de vie, et dans laquelle, sur la racine de la justice, fleurira de plus en plus la réciprocité de l'amour ; cette société ne sera-t-elle pas bonne ?
Quel nom trouverons-nous pour désigner cette consécration de chacun au bien commun, cette vertu suprême qui les renferme toutes ? Le fondateur du positivisme, Auguste Comte, s'est posé ce problème, et voici comment il l'a résolu. Il a donné à cette vertu maîtresse, dans laquelle la conscience éclairée par la réflexion reconnaît la formule générale du bien moral, le nom d'altruisme. Le progrès moral consiste, dans l'opinion du chef des positivistes, en ce que l'égoïsme cède de plus en plus la place à l'altruisme, c'est-à-dire à la préoccupation du bien d'autrui. Or, le mot charité qui, dans l'usage commun, a trop souvent perdu sa signification primitive, pour devenir le synonyme de l'aumône, désigne primitivement, non seulement dans la langue de l'Évangile, mais déjà dans celle de Cicérono, l'amour vrai, la consécration sincère de chacun au bien des autres. Ce mot a l'usage en sa faveur, et l'altruisme n'est pas un néologisme assez gracieux pour être séduisant. Restons dans l'ancien langage, et disons que la loi de charité est l'expression générale des rapports qui doivent relier les membres de la société spirituelle. S'il en est ainsi, le bien en ce qui concerne les relations des hommes entre eux, est la réalisation de la charité, ou la direction de la volonté de chacun vers le bonheur général.
Comment concevrons-nous maintenant le bien dans les rapports de la nature avec l'humanité ? Le corps doit être l'instrument de l'esprit ; la nature extérieure doit être la condition de la vie du corps, et elle doit donner l'éveil aux travaux de la pensée qui produisent la science, aux travaux de l'industrie qui établissent l'empire de l'homme sur la matière, à l'instinct de l'art qui, à partir des beautés sensibles, s'élance dans toutes les directions à la recherche de l'idéal. La nature soumise aux esprits, les esprits soumis à la loi de la charité, cela serait-il bien ? C'est à vous, Messieurs, que je le demande : Je ne viens pas ici vous enseigner des choses nouvelles, mais plutôt vous rappeler ce que vous savez tous, vous aider peut-être à souffler sur la poussière qui s'amasse au fond de nos âmes, afin que vous puissiez lire les caractères qui y sont écrits. Je vous demande : Voyez-vous, non pas dans votre pratique, mais dans votre conscience et votre raison, voyez-vous l'image du bien que je vous ai présentée ? Admettez-vous, comme une vérité qui vous paraît certaine et s'impose à votre pensée, que dans l'ordre, dans l'état légitime et bon de l'univers, les corps sont faits pour les esprits et les esprits pour la charité ? Serait-ce là une conception arbitraire, individuelle, nationale ? Est-ce moi, est-ce l'un de vous ? est-ce Paul, Jean, ou Alfred ? Est-ce un Français, un Russe, un Allemand, qui conçoit le bien tel que nous venons de le définir, ou est-ce l'homme tel qu'il existe dans chacun de nous, au-dessous de toutes les diversités individuelles ou nationales ? Ne sauriez-vous pas encore discerner la voix profonde de la nature humaine des bruits de la surface ? Cette voix est couverte trop souvent par le bruit des passions, par le tumulte des penchants en désordre ; mais elle finit par se faire entendre à l'âme sérieuse et calme. La destination de l'esprit est de dominer la nature. Vouloir le bien général est la loi suprême des esprits. Ne sentez-vous pas que ces pensées trouvent un écho au plus profond de la conscience ?
Nous nous heurtons ici à une doctrine vieille comme les lettres humaines, et qui essaie assez ridiculement de se rajeunir en se produisant sous le titre de science moderne. On nous dit qu'il n'y a pas de bien en soi, de bien réel et absolu ; qu'il existe des mœurs, et que ces mœurs varient ; mais qu'au-dessus de ces mœurs et de leur histoire, il n'y a pas de règle permanente du bien, pas de morale. On fait observer que bien des choses qui sont jugées mauvaises en Europe sont jugées bonnes en Asie. On remarque que chez les Peaux-Rouges, un jeune garçon obtient l'approbation de son père et le sourire de sa mère, en apportant la chevelure d'une tête qu'il a scalpée, action que des parents européens n'approuveraient pas. On conclut de tout un ensemble de faits de cet ordre que la conscience est une cire molle qui se prête indifféremment à toutes les formes. Ecoutons à ce sujet la pensée de Montaigne rédigée par Pascal : « On ne voit presque rien de juste ou d'injuste qui ne change de qualité en changeant de climat. Trois degrés d'élévation du pôle renversent toute la jurisprudence. Un méridien décide de la vérité… Plaisante justice qu'une rivière borne ! Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà… La plaisanterie est telle, le caprice des hommes s'est si bien diversifié qu'il n'y a pas une seule loi qui soit universelle. Le larcin, l'inceste, le meurtre des enfants et des pères, tout a eu sa place entre les actions vertueusesp. » En se fondant sur des considérations de cette nature on affirme que le bien n'est qu'une idée relative, variable, locale et temporaire, en sorte qu'il est impossible de le déterminer d'une manière générale. Ces affirmations sont graves et, si elles étaient admises, elles saperaient la base même de notre travail. Examinons-les brièvement, mais sérieusement, en nous rappelant que nous sommes ici, non pour un tournoi de paroles, mais pour une discussion de bonne foi.
La morale varie. Pour bien entendre la nature et la portée de ce fait incontestable, il est nécessaire de préciser plus que nous ne l'avons fait, le caractère des phénomènes moraux.
Ce que nous appelons précisément conscience, dans le sens moral de ce terme, c'est le sentiment de l'obligation qui nous commande certains actes, et nous en défend d'autres. Sans le sentiment spécial de l'obligation, il n'y aurait pour nous ni bien ni mal, ni estime ni mépris. Or, les idées du bien et du mal et les sentiments qui s'y associent forment un caractère essentiel de l'humanité ; l'individu qui en serait privé constituerait ce que les naturalistes appellent un monstre, et l'existence des monstres ne détruit pas l'existence de leur espèce. L'idée du bien existe partout où existe l'homme dans l'intégrité de sa nature ; à cet égard, il n'y a pas de variations. Mais quel est le bien, ou, en d'autres termes, que doit-on faire ? C'est ici qu'apparaît la diversité. Nous soignons nos vieux parents, et nous pensons bien agir. Certains sauvages les tuent pour leur épargner les souffrances de la vieillesse, et ils pensent bien agir. D'où vient la diversité de ces règles de conduite ? Elle vient de la différence des doctrines. Nous pensons que la vie de l'homme n'appartient pas à l'homme ; les sauvages qui tuent leurs vieux pères ont une autre idée à ce sujet. C'est la variété des doctrines relatives à la nature et à la destination des êtres qui fait varier la morale. La conscience n'est pas un pouvoir producteur des idées ; elle applique le sentiment de l'obligation à la réalisation de certains rapports ; elle s'attache à la vérité, mais elle ne la tire pas d'elle-même. La vérité est la nourriture de la conscience. Il n'y a pas une morale de la conscience et une morale de la raison. La raison seule n'a pas de morale, et la conscience seule ne renferme que le sentiment de l'obligation, dont l'objet ne saurait être déterminé sans la participation de la raison. C'est pourquoi la règle des mœurs tombe nécessairement sous l'influence des doctrines. Aussi (pour le dire en passant) la théorie contemporaine de la morale indépendante, qui prétend couper le lien qui rattache les mœurs aux croyances, exige de ses sectateurs l'ignorance ou l'oubli des résultats les plus certains de l'étude de l'homme.
Les idées morales varient donc. Il est facile de démontrer ce fait contre les théoriciens qui le nient. Mais voici trois réflexions qui vous empêcheront, je l'espère, de tirer de ce fait incontestable les conséquences qu'en déduit le scepticisme.
Première réflexion : Les variations de la morale, bien que réelles, n'ont pas l'étendue qu'un examen superficiel porte à leur attribuer. Il y a partout dans l'ordre moral deux courants très distincts. L'un est formé par les mœurs, les institutions et les maximes qui ont pour but de justifier les mœurs et les institutions. C'est la morale du monde, et celle-là varie prodigieusement, mais la cause de ses variations est facile à reconnaître. Naguère, par exemple, certains publicistes du sud de l'Amérique faisaient la théorie de l'esclavage. La pression exercée sur la conscience par les institutions et les intérêts était, dans ce cas, facile à reconnaître. On voit un fait analogue se produire journellement dans le travail des écrivains politiques qui semblent avoir une provision de morales à choisir pour expliquer et justifier les divers événements dont ils sont les narrateurs, et, pour leur part, les acteurs. Mais, à côté de ce courant ondoyant et divers, il en existe un autre. Il existe une morale que nous appellerons la morale de la conscience, sans oublier qu'elle suppose la participation de la raison et subit l'influence des doctrines. Cette seconde morale varie moins que la première, et en changeant elle se développe dans une direction uniforme. On se trompe en attribuant à la morale de la conscience des variations qui n'appartiennent qu'à la morale du monde. Les institutions et les mœurs ne donnent pas toujours une idée exacte des vraies pensées d'un peuple. Nos hospices d'enfants trouvés, par exemple, ne démontrent pas que les devoirs de la famille ne fassent pas partie de notre morale. Or, nous jugeons souvent les peuples peu civilisés, et qui n'ont pas de littérature, d'après leurs mœurs et leurs institutions ; et peut-être, chez ces peuples mêmes, la conscience trouve des représentants dont les protestations contre certaines coutumes immorales nous restent inconnues. Là où existe une tradition écrite, il est facile de constater que la morale de la conscience varie dans des limites moins étendues qu'on ne le croit à l'ordinaire. Les anciens livres de l'Inde, de la Perse, de la Chine, contiennent des rayons très purs de vérité, des conceptions très élevées du bien. Pour n'en citer qu'un seul exemple, l'ancien poème indien intitulé le Ramayana renferme, au milieu d'imaginations fantastiques, des traits d'une vertu faite pour nous servir d'exemple. L'héroïne du poème, Sita, est une femme d'une admirable pureté, et l'auteur adresse, plus d'une fois, aux personnages qu'il veut nous présenter comme dignes de louanges, l'éloge qu'ils trouvent leur plaisir dans le plaisir de toutes les créaturesq. Sous les variations considérables des mœurs, des institutions, et des maximes qui les justifient, on trouve donc dans l'humanité un fond d'idées morales qui expriment avec plus de fixité la conception du devoir. Les progrès de la réflexion dégagent et permettent de reconnaître, dans une lumière croissante, ces bases élémentaires de la moralité, et cette œuvre s'est accomplie partout où la civilisation a progressé. La morale chrétienne seule, selon ma conviction, a mis en vive lumière la loi fondamentale de l'ordre moral, et, en la dégageant des nuages, a permis à la conscience de se satisfaire pleinement ; mais on trouve chez les sages de la Grèce et de Rome, et chez les sages de l'Orient les rayons affaiblis et dispersés, mais réels, de la lumière qui nous éclaire aujourd'hui. La variation absolue de la morale est l'impression que laisse un examen superficiel des faits ; une étude plus sérieuse la détruit.
Deuxième réflexion : La conscience reconnaît la vérité lorsqu'elle lui est présentée, y adhère et, sauf des exceptions qui se rencontrent toujours dans l'ordre moral parce que l'ordre moral est le domaine de la liberté, elle ne s'en sépare plus. Lorsqu'un homme entraîné par ses passions s'éloigne du bien qu'il a connu, il arrive le plus souvent que sa conscience continue à lui rappeler les règles qu'il viole dans sa conduite. C'est une des causes du besoin d'étourdissement qui caractérise les vies coupables ; on se fuit soi-même avec tant de soin pour fuir la vue d'une lumière importune qui s'élève du fond de l'âme dès qu'elle est calme, et projette une trop vive clarté sur les ténèbres d'une existence en dehors la règle. L'histoire générale de la civilisation manifeste la même vérité avec éclat. Lorsqu'on affirme que chaque peuple a sa morale comme sa religion, et que nous n'avons aucun droit de supposer que c'est nous qui sommes dans la vérité, plutôt que les Hindous, les Chinois, ou les Groënlandais, on oublie que les civilisations diverses n'entrent point comme des facteurs égaux dans le développement de l'humanité. Que se passe-t-il quand deux civilisations se rencontrent, et finissent par se fondre dans une civilisation nouvelle ? Dans l'ordre des mœurs, c'est parfois le peuple le plus corrompu qui corrompt l'autre. Dans l'ordre des idées, c'est le peuple le plus éclairé qui amène l'autre à sa lumière. Sans compulser les annales de l'histoire, voyez seulement ce qui se passe sous nos yeux. La civilisation de l'Europe, ou, pour l'appeler du vrai nom qu'elle tire de ses origines, la civilisation chrétienne fait visiblement la conquête du monde. Son triomphe n'est qu'une affaire de temps ; personne n'en doute. Elle se propage, elle attaque, et n'a pas à se défendre. Nous nous efforçons de détruire les coutumes immorales et cruelles de l'Asie et de l'Afrique, mais l'Inde ne tente pas d'introduire chez nous la division des castes, ou les sacrifices humains, et les noirs habitants de l'équateur ne nous envoient pas des missionnaires pour ramener à la barbarie de leurs coutumes les populations de la France et de l'Angleterre. Les principes de la dignité, de la justice, de la bienveillance qui sont le fond de notre morale, sont les seuls dans lesquels la conscience reconnaisse sa véritable nature. On nous objecte en vain que c'est notre opinion, et que les opinions contraires ont précisément la même valeur pour ceux qui les adoptent. Nous mettons dans la discussion le poids d'un fait immense et incontestable. Nos principes s'étendent sur le globe entier ; les Asiatiques et les Africains peuvent le constater aussi bien que nous. L'avenir du monde appartient à nos idées morales ; nos sceptiques eux-mêmes n'en doutent pas. Voulez-vous vous en assurer ? Écoutez ce qu'ils disent, et lisez ce qu'ils écrivent, lorsque, ne pensant pas à soutenir leur doctrine, ils manifestent leur vraie pensée. L'histoire de l'humanité et l'observation de son état actuel ne permettent pas d'admettre que la conscience se prête également à toutes les doctrines relatives aux mœurs. La doctrine morale qui a la puissance de détruire les autres, et de s'emparer progressivement du genre humain, est visiblement la doctrine qui est faite pour l'homme, et à laquelle l'homme ne renonce pas une fois qu'il l'a acceptée. Le fait est là pour nous éclairer.