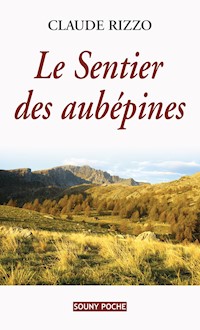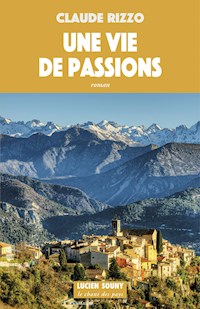Eveillée de sa sieste, Rosine Cini eut un regard vers la pendule. Elle fut surprise d’avoir pu dormir aussi longtemps par une chaleur pareille. Deux taches blanchâtres salissaient sa robe aux aisselles. La sueur coulait sur son visage,
empruntant le chemin des rides naissantes.
Ce n’est pas Dieu possible. On va mourir cette année.
La canicule sévissait depuis trois longues semaines, frappant des mêmes feux le littoral et le haut pays. Le ciel semblait avoir perdu ses repères. Plus de brise marine sur les plages du bas. Pas un seul orage pour les
habitants des villages perchés. Toutes les fins d’après-midi pourtant, comme un espoir annonçant la fin du martyre, l’horizon prenait cette teinte violette, prélude aux bourrasques d’été. Un spectacle son et lumière de grande qualité, le massif du Mercantour dans le rôle de cathédrale gothique. Des éclairs, un tonnerre de fin du monde, mais pas une seule goutte d’eau.
Rosine quitta le vieux fauteuil dont la plupart des ressorts avaient rendu l’âme. Elle s’approcha de la porte de la petite chambre, évitant de faire craquer les lames du plancher. Elle écouta. Aucun bruit dans la pièce.
Laissons-le dormir. Qu’il n’aille pas s’attraper une insolation en courant dehors à une heure pareille.
Elle revint s’asseoir, mit ses lunettes auxquelles il manquait une branche et ouvrit le Nice-Matin de la veille. Un journal que lui offrait M. Combes, son voisin le plus proche. Il le lisait le soir et le lui glissait le
lendemain dans sa boîte à lettres.
Elle parcourut les nouvelles locales durant quelques minutes, puis leva la tête.
Il dort aujourd’hui. C’est bien la première fois qu’il reste autant au lit depuis le début des vacances.
Elle reprit son journal, le reposa.
Je vais quand même aller voir.
Une angoisse, contre laquelle elle ne pouvait lutter, venait l’étreindre dès qu’elle ne l’entendait plus. La nuit, se levant dix fois, elle descendait l’escalier sans allumer. Assise sur la dernière marche, elle restait là, dans l’obscurité, pour le seul plaisir de l’écouter respirer.
La porte grinça plus que de coutume. Rosine Cini s’en voulut un instant, rien qu’un instant, le temps de se rendre compte que le lit était vide et la chambre déserte.
— Mais qu’est-ce que j’ai bien pu faire au Bon Dieu ? dit-elle en levant les bras au ciel. Et va savoir depuis combien de temps il
vagabonde au soleil ?
Elle connaissait le lieu de rendez-vous des gosses du village. Depuis des générations, ils se retrouvaient au même endroit dès que l’été montrait son nez.
Rosine prit une serviette de toilette dans son armoire et sortit. Au bout du
sentier des aubépines, quelques dizaines de mètres parcourus, elle suait comme un touriste du Nord grimpant le Boréon.
Un village désert, où même la veuve Audiberti avait quitté son poste d’observation.
Elle les aperçut du haut du petit pont de pierre. Une douzaine de gamins, en maillot de bain
ou en slip, barbotaient dans les trous d’eau d’une rivière au plus bas. Des bassins alimentés par de minuscules ravines ; une eau qui arrivait des sommets, de la fonte des neiges, glaciale malgré la fournaise.
Le chemin serpentait parmi les éboulis granitiques. Des rochers de plusieurs dizaines de tonnes, véritables pièges à chaleur, transformaient le sentier en four de boulanger.
Rosine Cini s’essuya le front tout en reprenant son souffle.
— Adrien, il y a ta mère qui est là, dit alors le fils Bellet, l’aîné de la bande et aussi le meneur.
Adrien leva un regard ennuyé.
— Qu’est-ce que tu veux, maman ?
— Vous l’entendez, fit-elle, prenant la compagnie à témoin. Il me demande ce que je veux. Je le crois dans son lit, à faire la sieste comme un bon chrétien. Et lui, pendant ce temps, il risque sa vie en nageant dans la rivière, alors qu’il ne sait même pas nager. Et après il me demande ce que je veux, comme si je le dérangeais dans ses activités.
Le cadet des Bellet, en tant que chef de clan, crut bon de prendre la défense d’Adrien.
— Il n’a pas voulu vous réveiller, Mme Cini. Et puis ici on ne risque rien. On n’a même pas de l’eau qui nous arrive jusqu’aux genoux.
— Toi, ne fais pas l’avocat. Pour se trouver de belles excuses, il n’a besoin de personne, crois-moi. Et n’oublie pas qu’un orage là-haut, ou même en Italie, et c’est le lendemain ou deux jours après que l’eau arrive ici. Et, du genou, elle vous monte alors à deux mètres de haut sans même vous laisser le temps d’une prière au doux Jésus.
José Camous, le dernier du boulanger, intervint à son tour :
— Mais on l’entend arriver de loin, madame. Elle fait un bruit, qu’on dirait un avion à réaction.
— Va demander au fils Silvestri, au cimetière, si on l’entend arriver comme ton avion. Et c’est ici, juste où vous êtes, qu’elle est arrivée, la calamité qui devait l’emporter.
Rosine était de mauvaise foi et le savait. Les enfants du village venaient patauger ici
depuis la nuit des temps. L’eau pouvait en effet dévaler tel un torrent entre ces gorges étroites. Cependant, dans un fracas évoquant un tremblement de terre, elle annonçait son arrivée, accordant ainsi aux gosses, aux pêcheurs et aux randonneurs, le temps de quitter la rive. Et chacun dans la vallée se demandait encore comment ce pauvre Silvestri avait bien pu se laisser
surprendre, alors qu’il était né sur cette commune.
Dominée par la peur, Rosine se moquait bien de se montrer injuste. Elle ne respirait
que lorsque cet enfant se trouvait à ses côtés, ou qu’elle le savait à l’école. Le reste du temps n’était qu’attente et inquiétude.
— Allez, arrive, commanda-t-elle sur un ton qu’elle voulut autoritaire.
Adrien eut un geste de mauvaise humeur.
— Pourquoi je ne peux jamais jouer avec les autres de mon âge ?
— Viens et ne discute pas.
Il sortit de l’eau.
— Regarde-moi ça, il tremble comme une brebis qui a les fièvres. Et tu as vu tes lèvres ? Violettes qu’on ne le croirait pas. Et tout cela par une chaleur de purgatoire.
Elle lui frictionna la poitrine et les épaules tout en parlant. Il reprenait des couleurs. Elle le serra contre elle,
lui passa la main dans les cheveux.
Mon Dieu, protégez cet enfant et donnez-moi la force de le conduire jusqu’à l’âge adulte. Un droit que j’ai payé dans le malheur et dans le sang.
Adrien recula, échappant à ses caresses. Elle eut un sourire. A la maison, assis sur ses genoux, il se
laissait câliner durant des heures. Mais là, devant ses copains…
— Allez, on rentre ? lui dit-elle.
— Encore un peu, maman. Il fait trop chaud à la maison.
Elle hocha la tête.
— Toi, un jour, tu me feras marcher sur les mains. Bon, encore un moment. Je ne
bouge pas d’ici et je te surveille. Et que les pieds dans l’eau. Il ne manquerait plus que ça, que tu me fasses une pneumonie. Oui, ça arrangerait bien nos affaires.
Rosine resta là durant deux bonnes heures, assise sur une pierre à l’ombre de la falaise, le regardant jouer. Elle aurait pu y passer l’après-midi sans faire rien d’autre. Mais Rosine Cini ne vivait pas de ses rentes.
***
Deux heures de travail dans le jardin et le poulailler par une chaleur qui cette
année-là s’accrochait aux jours comme aux nuits. Devait-elle arroser ? Rosine hésita un instant. De gros nuages, en armée menaçante, venaient d’apparaître au-dessus de la Cougourde.
Je le ferai en revenant du cimetière. On ne sait jamais. Elle finira bien par tomber, cette maudite pluie.
Elle sortit, traversa le chemin.
— Michel, sans vous déranger, vous pourriez jeter un œil sur Adrien. Je fais juste un tour au cimetière.
M. Combes, en short colonial, une casquette publicitaire sur le crâne, cueillait des haricots verts.
— Allez-y, Rosine, et prenez votre temps. Soyez sans crainte, je le surveille. Il
est où en ce moment, notre petit diable ?
— Comme d’habitude, dans sa cabane.
Les villageois montraient enfin leur nez. Une dizaine de personnes patientaient
en bavardant chez André et Muriel, le commerce à tout faire du bourg et des environs. Epicerie, bazar, mercerie, marchand de
journaux et grand spécialiste de la pêche et de la chasse, le magasin servait en outre de dépôt de pain au boulanger de Saint-Martin-Vésubie et assurait les services postaux. La place et ses deux châtaigniers centenaires appartenaient aux boulistes et à leurs spectateurs. Deux fois l’an, ces messieurs accordaient l’hospitalité au reste de la population. La fête patronale et le bal du 14 juillet représentaient en effet les deux événements inscrits au programme des réjouissances offertes par la commune. L’auberge du Boréon clôturait la liste des commerces du hameau. Hôtel, bar, restaurant à la fois, l’endroit était devenu le lieu de rendez-vous des habitants de la vallée. L’établissement, fréquenté par les randonneurs en toutes saisons, se voyait pris d’assaut par les Niçois et les touristes durant l’été. L’affaire des Goiran était sans doute l’une des plus prospères du canton.
— Je crois qu’on aura de l’orage avant peu.
Fifine, la veuve du Gaston Audiberti, harponnait tout paroissien passant à sa portée. Rosine leva la tête. Le ciel, au-dessus du Mercantour, avait pris une couleur de cendre.
— Tous les jours, c’est la même chanson. Tu en veux des éclairs et du tonnerre… Mais, pour l’eau, on dirait que le Bon Dieu a fermé son robinet.
Fifine secoua la tête.
— Aujourd’hui, c’est pour de bon. Mes rhumatismes ne m’ont jamais raconté d’histoires. Où tu vas ? Au cimetière ?
— Où veux-tu que j’aille, au bal du 14 juillet ?
Devant la tombe, Rosine fut reprise par les souvenirs et la mélancolie.
Deux hommes, aussi robustes l’un que l’autre. Et les deux couchés sous cette pierre. Si ce n’est pas une misère !
La photo de Robert s’évadait dans le souvenir, rongée par le soleil. Giovanni souriait encore à la vie qu’on lui avait arrachée en ce jour maudit. Un drame qui garderait à jamais son secret. Et la question qui la hantait lui revint à l’esprit. Les gendarmes avaient-ils cherché où il le fallait lors de l’enquête ? Elle était loin d’en être persuadée. Et toutes les histoires qu’on lui avait racontées à l’époque n’étaient pas parvenues à entamer sa conviction. La peau d’un pauvre berger piémontais ne valait certes pas celle d’un fils de famille.
Repose en paix, mon bon Giovanni. Un pauvre berger piémontais sans doute. Mais, par le cœur, tu valais bien cent fois toutes les familles les plus riches du canton.
Rosine parlait à ses morts. Les prières, à ses yeux, en leur donnant une place près des saints, les momifiaient et les éloignaient d’elle. Elle leur livrait sa vie quotidienne en feuilleton, les invitant à partager ses peines et ses joies, et ne leur cachant ni ses espoirs ni ses rêves. C’était à vrai dire ses confidents les plus assidus, les plus concernés aussi, et sans aucun doute les moins contrariants.
Tiens, je vais vous faire rire. Figurez-vous que cette nuit j’ai rêvé que nous étions ensemble, tous les trois. C’est peut-être bête comme rêve. Mais je me suis réveillée d’excellente humeur, comme si c’était un bon présage. Je pense d’ailleurs que vous seriez devenus de bons amis si vous vous étiez connus.
Cet après-midi, le petit a retiré un peu sa figure quand j’ai voulu l’embrasser devant ses copains. Je me suis dit que ce n’était peut-être qu’un peu de pudeur. Parce que maintenant ce monsieur se prend pour un grand du
haut de ses sept ans. Mais je ne pourrais pas vivre qu’un jour il ait honte de moi à cause de mon âge. Ça me mettrait un couteau dans le cœur. Et je crois qu’à ce moment je lui raconterais la vérité.
Elle hésita un instant.
Non, jamais je ne pourrai le faire souffrir, quoi qu’il fasse, même s’il me coupait en morceaux. Après tout ce que nous avons vécu, lui et moi.
Elle se rendit compte que ses propos, en revenant aux malédictions du passé, étaient de nature à troubler le dernier sommeil de ses deux époux. Elle changea de sujet.
Je me suis fait embaucher à l’auberge durant la saison. Les Goiran cherchaient quelqu’un de sérieux pour les aider trois heures tous les matins. Le temps de faire le ménage des chambres et de la salle de restaurant. M. Combes veillera sur Adrien durant ce temps.
Cette décision lui arrachait le cœur. Et cet emploi n’avait rien à voir dans l’affaire. Le travail représentait son lot quotidien depuis le certificat d’études. Et celui-ci en valait bien un autre. Mais confier Adrien, même à M. Combes, à qui elle accordait pourtant toute sa confiance, éveillait chez elle des peurs irraisonnées.
Ce n’est qu’un homme après tout. Et un accident est si vite arrivé de nos jours. Mais comme je n’ai pas le choix… Le petit n’a plus rien à se mettre. On dirait un miséreux de l’orphelinat avec ses shorts trop courts et ses tricots qui laissent voir le
nombril. Et je ne parle même pas de la rentrée des classes. Vous savez aussi bien que moi ce que ça coûte.
Deux petites pensions, une aumône versée par les Allocations familiales, Rosine se prêtait à tout. Et le ménage chez les autres ne lui posait aucun problème dès qu’il s’agissait de gagner quelque argent. Elle portait les mêmes vêtements depuis sept ans et ne demandait rien pour elle-même. Nourrir cet enfant, l’habiller comme tous les gosses de son âge, lui offrir un modeste cadeau pour son anniversaire et pour Noël, une gâterie de temps à autre : c’était là sa seule volonté. Une ambition pour laquelle elle était prête à donner sa santé et le peu de jeunesse qui lui restait.
Elle crut bon malgré tout de se justifier d’avoir à confier Adrien à son voisin. Un enfant qu’aucun de ses deux époux n’avait connu, et qui leur était étranger par le sang.
Vous le comprenez, je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. Les emplois
ne courent pas les rues au village en ce moment, croyez-moi. J’en connais au moins dix qui l’auraient pris sans hésiter.
Elle s’adressa ensuite à Robert :
Et il a fallu qu’Anselme intervienne pour qu’on me le donne. Ah, celui-là, tu peux dire que c’était vraiment ton ami. Et quand tu penses qu’au village certains le critiquent comme maire.
Le ciel se fit soudain plus menaçant. Le tonnerre n’en finissait plus d’annoncer le sérieux de l’affaire. Rosine se rendit compte qu’il ne s’agissait plus là d’une fausse alerte.
Le temps pour elle de retrouver la maison, de déloger Adrien de sa cabane, et le déluge proclama le déclin de la canicule et la fin de la sécheresse.
***
L’orage s’éloigne au grand galop. Encre de Chine sur les sommets italiens, le ciel revêt son plus beau printemps du côté de la Méditerranée. Une dernière bourrasque accompagne un grondement sans vigueur. Le tonnerre n’y croit plus. Féroce voilà une heure, il grogne à présent comme un chien déjà soumis.
Rosine respire à pleins poumons les parfums des prairies brûlées et des sous-bois avides que l’orage a libérés.
Quinze jours de farniente sous cette chaleur. A présent, c’est le moment de donner un grand coup de collier, ma grande. La semaine
prochaine, avec l’hôtel…
Le bois de l’hiver à fendre et à rentrer. Des haricots verts à mettre en pots. Les pommes de terre qui s’annoncent. Et les confitures qui n’attendent pas. Avec cette bonne pluie, elle pouvait en outre espérer quelques champignons dans les jours à venir.
Après le repas, Adrien couché, elle nettoya le clapier, rentra sa chèvre, ses trois brebis et leurs agneaux.
La coupe du bois l’avait épuisée. Rosine méritait bien quelques instants de bavardage en compagnie de M. Combes.
M. et Mme Combes avaient acheté leur maison voilà dix ans, devenant ainsi ses plus proches voisins. Une masure menaçant ruine, qu’ils avaient rénovée de leurs mains.
L’épisode avait eu lieu trois ans après la mort de Robert. Rosine venait d’épouser Giovanni et le ciel semblait bien décidé à lui accorder sa part de bonheur.
Elle n’oubliera jamais leur arrivée, en cette veille de Noël. Le ciel ne s’était pas mis en quatre pour accueillir leur étrange convoi. Mme Combes conduisait une voiture tractant une caravane. Son époux la suivait au volant d’une camionnette délabrée où il transportait son matériel et ses outils.
Le lendemain, Giovanni Cini observait ses voisins par la fenêtre.
— On ne va pas laisser ces poverini seuls dans leur camping un jour de Noël. Ils n’ont même pas d’électricité. Et je suis sûr que l’eau a dû geler dans leur citerne.
Rosine reconnaissait bien là son époux, toujours prêt à s’ouvrir aux autres.
— Allez, va les inviter à passer la journée avec nous, tu en meurs d’envie.
Giovanni se tourna alors vers Antonia. La fillette, assise à la grande table de ferme, avait sorti ses crayons de couleur.
— Toi aussi, tu veux qu’on les invite ?
— Oui ! Et je leur dessinerai une maison toute neuve. Ça sera leur cadeau de Noël.
Une amitié venait d’éclore, de celles qui se laissent aller sans calculs.
On tira un câble électrique. On prêta aux nouveaux arrivants tout ce qui leur manquait. Rosine les approvisionnait
en légumes du jardin, en fromages de ses brebis, en confitures et en miel de sa
ruche. Rentrant de transhumance, Giovanni passait des journées à les aider sans marchander ses efforts.
Une époque où les Combes avaient beaucoup reçu. Ils allaient prouver, dans les vicissitudes imposées par le destin, qu’ils savaient aussi donner.
Voilà trois ans, Michel Combes se retirait au village pour y vivre toute l’année. Son épouse reposait à présent dans le cimetière familial, dans ce bourg tranquille du vignoble beaujolais que Rosine avait eu
le plaisir de connaître lors de vacances inattendues.
Pourquoi ne pas joindre leur solitude, et alléger ainsi le fardeau que portait Rosine ? A pas comptés, à mots feutrés, Michel proposait de lui offrir son aide et de veiller sur son sommeil.
Elle le remerciait du fond du cœur de revenir sur le sujet sans jamais se lasser. Sans lui, enfermée dans son combat contre l’indigence, elle en aurait oublié qu’elle était une femme. Une femme de moins de cinquante ans, aux passions intactes, bien
décidée à clore son existence sur un enfant que la providence lui avait confié, et qu’elle avait élevé jusque-là sans l’aide de quiconque.
— Rosine, vous en faites trop, ma chère, lui reprocha Combes ce soir-là, reprenant ainsi par un détour son sujet favori.
— Dites-moi, Michel, vous n’êtes pas superstitieux ? lui demanda-t-elle en retour.
— Pourquoi cette question, Rosine ?
La pénombre se prêtait sans doute aux confidences inédites.
— Tout simplement pour vous apprendre que je porte malheur aux hommes. J’en ai déjà tué trois, Michel. Et je pense que cela suffit.
— Trois ! Comment trois ? s’étonna-t-il.
— Je ne me suis pas trompée. J’ai bien dit trois. Et figurez-vous que je n’ai même pas laissé au premier le temps de me conduire à l’hôtel de ville.
Combes l’observait d’un œil incrédule.
— Vous voulez connaître l’histoire ? questionna-t-elle en souriant. Pour vous, je vais oublier que j’ai juré de ne jamais la raconter.
Il eut un geste de la main.
— N’ayez aucune crainte, Michel. Elle ne fera plus de tort à personne. Tous les personnages concernés séjournent à présent au paradis. Et cela ne fera qu’un secret de plus que nous aurons à partager. Et je sais que vous le garderez pour vous, comme les autres.
Le premier homme qui marqua l’existence de Rosine s’appelait Antoine Rossi. Etait-il beau, intelligent, spirituel ? Elle ne pouvait le dire, dans sa crainte d’employer des mots excessifs. A cette époque, éblouie par la passion, elle voyait le monde tel un jardin enchanté.
Un fils de bonne famille, sans aucun doute. Les Rossi figuraient parmi les
ultimes spécimens d’une espèce en voie de disparition. Horticulteurs, producteurs de l’authentique œillet de Nice, ils devaient résister à la concurrence hollandaise, et surtout aux sirènes des promoteurs. Ils possédaient en effet quelques hectares sur les Hauts de Rimiez, l’un des derniers espaces disponibles que comptait la ville de Nice. Les Rossi étaient assis sur un véritable trésor. Ces derniers n’avaient toutefois aucune intention d’ouvrir le coffre. Ils continueraient à vivre de leurs fleurs avant de transmettre à leur fils unique les terres héritées de leurs ancêtres.
Antoine Rossi appartenait à un club de randonnées en montagne. Il avait désormais une raison de plus de fréquenter le Mercantour.
Ils se connurent en hiver. Une saison favorable pour résister aux sirènes de dame tentation dans ces vallées ombreuses où souffle la bise qui transforme les torrents en sculptures modernes. Mais le
printemps succède à l’hiver. Avec l’agonie des frimas, la montagne se prend alors à jouer au jardin d’agrément. Et déjà les forteresses montrent quelques faiblesses dans des baisers au goût de sève. Voici l’été et son ivresse de parfums. L’amour triomphe jusqu’aux plus hautes cimes. Rosine, portée par sa morale et la crainte de Dieu, résiste toujours.
Ah, les fêtes patronales ! Elles ont été inventées afin d’enrichir les livres de contes, ceux qui racontent la même histoire et n’ont jamais fini de la raconter.
Quelques semaines plus tard, Rosine sut qu’elle était enceinte. Cette nouvelle n’éveilla chez elle aucune angoisse. La date des épousailles était déjà arrêtée. M. le maire les attendait dès la fin du service militaire d’Antoine. Et sans doute n’étaient-ils pas les premiers à avoir consommé leur lune de miel avant la pièce montée de la fête. Désormais, le jeune homme avait le choix : convoler en tenue de chasseur alpin ou se retrouver avec son héritier sur la photo de mariage.
Rosine reçut sa réponse par retour de courrier. Antoine ne semblait pas avoir été touché par les fées de la littérature. Il savait par contre ce qu’il voulait.
Rosine, mon amour, j’ai bien reçu ta lettre qui m’annonce la nouvelle que tu m’écris. Je l’ai racontée à tous les copains de ma section, vu qu’elle m’a fait un grand plaisir malgré les problèmes qui vont se poser à cause de l’Armée.
J’ai déjà téléphoné à mes parents. Ma mère, elle voulait tout savoir, même la couleur de tes yeux. J’y ai rien dit, sauf ton prénom. C’est une surprise pour ma première permission.
Mon père, il est marrant. Quand je lui ai appris qu’il y avait le feu, il m’a demandé si j’étais sûr que c’était moi qui l’avais allumé. J’ai répondu que la cheminée était toute neuve quand j’y ai mis mon allumette. Ça l’a fait rire.
Bon, voilà ce que nous allons faire : dans trois semaines, à la fin de mes classes, j’aurai une perm de soixante-douze heures. Un coup de moto depuis Barcelonnette, j’arrive chez toi le vendredi vers midi. Tu prends le car de l’après-midi pour Nice. Pas de moto pour toi, à cause du bébé, pour sa santé. Je te présente à mes parents. Le dimanche, on monte au village tous ensemble. Toi, dans la
voiture de mon père. Les familles font connaissance. On fixe la date du mariage. Et le tour est
joué.
Ecris-moi pour me dire si cela te convient. Ecris-moi aussi pour me dire d’autres choses.
Je t’embrasse, ainsi que le bébé.
Ton Antoine qui t’aime comme un fou.
Rosine arrêta son récit, perdue dans ses souvenirs.
— Ensuite ? ne put s’empêcher de demander M. Combes.
— Départementale 2 205. Les gorges de Valabres. Juste après le pont Saint-Honorat. C’est là que la moto a dérapé. Mort sur le coup. Je l’ai appris par les journaux le lendemain.
— Donc, si je vous suis, votre fille, Antonia… Ah, je comprends à présent : Antoine, Antonia…
— Eh oui, je lui devais bien ça. Antonia est en effet la fille d’Antoine.
— Et non pas de Robert, votre premier mari, dont elle porte pourtant le nom. Il l’a donc reconnue, c’est évident !
Rosine eut un sourire.
— Ah, ce brave Robert. Mon amoureux depuis la communale. Toujours là, avec ses grands yeux pleins de tendresse. Et il se trouvait encore là quand le malheur m’a montré son vilain nez pour la première fois. Je lui ai tout raconté pour me libérer du poids qui m’écrasait. J’avais alors dix-huit ans, je venais de perdre le jeune homme que j’aimais et j’allais mettre au monde un bâtard.
Robert la voulait toujours, même enceinte d’un autre. Il exigeait par contre que personne ne connaisse jamais la vérité, et surtout pas le petit à venir.
— C’était la moindre des choses. Et vous avez tenu votre promesse ? demanda Combes.
— Jusqu’à ce soir.
— Même Giovanni… ?
— Même Giovanni l’ignorait. Et je n’ai jamais regretté de ne lui avoir rien dit. Il n’aurait pas été plus heureux en connaissant l’histoire.
— Et Robert, comment s’est-il comporté avec Antonia ?
— Je suis sûre qu’il avait fini par oublier qu’il n’était pas son père. Et Giovanni, à son tour, l’a aussi considérée comme sa propre fille. Si vous pensez que la folie d’Antonia vient d’une jeunesse perturbée, vous vous trompez. Rien n’explique ce que ma fille a fait par la suite. Pour moi, cela restera toujours un
mystère.
— Et les parents d’Antoine ne se sont jamais manifestés ? Ils savaient pourtant que vous étiez enceinte.
— Ah, les Rossi ! Je n’en ai jamais entendu parler, Dieu soit loué. Il ne manquait plus qu’eux dans le décor.
M. Combes hésita. La question qui lui brûlait les lèvres appartenait à un sujet qu’il évitait, de crainte d’éveiller une blessure jamais refermée.
— Antonia, des nouvelles ? demanda-t-il malgré tout.
— Pas la moindre en sept ans, depuis cette fameuse nuit. Vous vous souvenez de la
dernière phrase de sa lettre : « Tu ne me reverras jamais plus. » Je crains hélas que sa menace ne soit pas que des mots.
Michel Combes hocha la tête. Sa pauvre épouse et lui avaient joué leur rôle dans cet épisode tragique. Il en connaissait tous les détails. Les causes du ressentiment d’Antonia pour sa mère demeuraient un mystère. Témoin de leur vie depuis des années, il pouvait affirmer que Rosine ne méritait pas le sort que sa fille lui avait réservé.
— Et de ces trois hommes… ?
Michel arrêta sa phrase. Sans doute allait-il un peu trop loin.
— Vous voulez savoir celui qui m’a le plus marquée. Je vous répondrai sans hésiter : le quatrième. Celui qui est entré dans ma vie sans frapper voilà sept ans, et qui m’a donné une raison d’exister alors que j’étais condamnée à la solitude. Je vais vous faire une dernière confidence, Michel. Je pense avoir été une mère à qui l’on ne peut rien reprocher. Eh bien, je dois vous avouer que même ma propre fille ne m’a pas donné autant de joie que ce petit.
***
La bise se précipitait dans les ruelles étroites du village. Les hommes tenaient leur chapeau d’une main et serraient le col de leur canadienne ou de leur manteau de l’autre. Leurs épouses, endimanchées, en talons des grandes occasions, s’accrochaient à leurs bras dans la crainte de déraper sur les pavés verglacés.
La cloche de l’église se mit à sonner. Lugubre, assorti aux cieux, le glas annonçait l’arrivée du corbillard.
Rosine ouvrait le convoi, soutenue par sa belle-sœur. Anselme Orengo, ami d’enfance du défunt, mieux qu’un frère au regard de l’affection qui liait les deux hommes, tenait l’orpheline par la main. Il avait oublié son écharpe de maire. Il n’était pas là en représentant officiel de la commune.
Le village enterrait ce jour-là Robert Michelis, mort dans la force de l’âge, emporté par la sale maladie en moins de trois mois.
La mort d’Antoine avait ouvert une plaie jamais cicatrisée. Celle de Robert signifiait la perte d’un compagnon fiable et estimé. Et le deuil de Rosine eût mérité toute sa mélancolie si elle n’avait eu une enfant à nourrir. Commença alors le combat contre le dénuement. Une vallée isolée, loin des stations de ski, où les femmes ne peuvent espérer que des emplois à la petite semaine. Un combat sans vainqueur ni vaincu. Dix ans plus tard, malgré son courage et ses efforts, Mme veuve Cini en était encore à compter les derniers centimes bien avant l’arrivée de ses maigres pensions.
Rosine travaillait depuis l’âge de quinze ans. Elle avait quitté l’école après le certificat d’études afin d’aider son père et son aîné dans l’entreprise familiale, une petite ébénisterie spécialisée dans le meuble de montagne.
On l’attendait au bureau, dans les comptes et les papiers. Rosine trouva sa place
dans l’atelier, parmi la dizaine de menuisiers qu’elle aida de son mieux durant les cinq ans qui la conduisirent à son mariage.
Quelques mois après qu’elle eut épousé Robert, son frère était monté la voir au village. Cette visite la surprit et l’effraya à la fois. Alain n’avait jamais fait preuve d’un grand attachement à la famille. Sorti de son travail, il ne connaissait que la pêche et la chasse. Savait-il même qu’il venait d’avoir une nièce ?
— Si tu te déranges, c’est qu’il est arrivé quelque chose, dit une Rosine s’attendant au pire.
— Non, rien de nouveau. C’est seulement la santé de papa qui s’aggrave.
— Je le sais. Je l’ai vu la semaine dernière.
— Il perd de plus en plus la tête. C’est une maladie terrible, contre laquelle on ne peut rien. Et, vois-tu, il faut
malgré tout penser à l’entreprise et à ses problèmes. On en a parlé avec maman. Elle est de mon avis. Il ne peut plus conserver son poste de gérant.
Rosine hocha la tête.
— Pauvre papa ! soupira-t-elle devant l’obligation de voir le nom de celui-ci disparaître d’une affaire qu’il avait créée et fait prospérer. Alors, que faut-il faire ?
— Procéder à la nomination d’un autre gérant ; c’est tout !
— Eh bien, fais-le ! Ce sera toi le nouveau gérant. Qui veux-tu que ce soit d’autre ?
— Il faut que tu signes des papiers, en tant que propriétaire de vingt-cinq pour cent des parts.
Elle eut un geste de la main.
— Fais-les préparer. Laisse-les à la maison. Je passerai voir les parents dans quelques jours. Je les signerai en
même temps.
Rosine tint sa promesse dès qu’elle le put.
— Ça me paraît bien compliqué tout ça, dit-elle en lisant les pièces qu’Alain avait établies avec l’aide de l’un de ses amis, conseiller juridique.
— J’espère que tu ne doutes pas de ton frère ? la reprit sa mère.
— J’aimerais bien comprendre, c’est tout ! Tu les as lues, toi ?
— Oui, et je n’ai rien trouvé à redire.
— Tu peux m’assurer qu’Alain est loyal dans cette affaire ?
— Je peux te l’assurer, et même te le jurer.
Elle signa sans plus hésiter. Trois mois plus tard, tout était vendu : entreprise, maison familiale et champs attenants. Rosine ne vit pas un sou de
la transaction.
Humiliée, blessée au plus profond, Rosine ne pouvait oublier cette triste affaire. Robert
haussait les épaules en l’écoutant.
— Tu en avais peut-être besoin de cet argent ? lui demanda-t-il, alors que le sujet revenait.
— Ce n’est pas l’argent. Tu ne peux pas comprendre ce que l’on éprouve en se faisant voler par son propre frère, avec sa mère comme complice.
— Allez, oublie cette vilaine histoire. Et dis-toi qu’il ne te manque rien dans la vie. Tu as une maison solide, que nous allons
agrandir avant l’arrivée du reste de la nichée. Et j’ai du travail à ne plus savoir où donner de la tête.
Robert était plombier. Une profession où les moins sérieux des artisans ignorent le chômage. Robert bénéficiait de la meilleure réputation et ne connaissait qu’une seule hantise : servir à temps ses meilleurs clients.
— Tiens, je suis allé voir Anselme à propos de l’extension de la maison, ajouta-t-il. Je lui ai confié les plans que j’ai fait établir. En tant que maire d’une petite commune, il n’a pas le pouvoir de décision. Mais il m’a promis de présenter lui-même mon dossier à la DDE où il a pas mal d’amis.
Les plans jaunissaient à présent dans le buffet. La nichée de Robert devait se limiter à Antonia, un coucou qu’il avait adopté et aimé de toute sa tendresse.
Un jardin derrière la maison, plus une vingtaine d’ares de prairie montant en pente douce vers la forêt communale : le territoire que Rosine s’attribua après son accouchement. Elle n’était pas femme à tricoter devant la télé une fois le ménage à son terme, quand le repas était prêt et que la petite dormait.
Robert descendait à Nice pour les besoins de son entreprise. Elle lui passait commande :
— Tu me prendras des entretoises métalliques, de gros clous à tête d’acier et deux rouleaux de grillage très fin. En remontant, tu t’arrêteras à la scierie. Je leur ai téléphoné. Tout est prêt à mon nom.
Robert souriait, fier de l’adresse de son épouse.
— C’est l’extension de la maison que tu vas commencer, ou quoi ?
— Je ne touche que du bois. Il paraît que ça porte bonheur. Je veux construire un abri où ranger les outils de jardin, un poulailler, un clapier, et par la suite deux ou
trois ruches et une petite bergerie pour une chèvre et quelques brebis.
— En voilà un programme. Si je comprends bien, ce n’est pas demain que je reverrai ma scie sauteuse, mon établi et mes outils.
— Je crois que tu peux même leur dire adieu.
— Oui, je le crains.
Un passe-temps qui devait assurer une partie de leur subsistance avec la mort de
Robert. Une pension de veuve d’artisan : juste de quoi ne pas mourir de faim. Rosine accepta dès lors toutes les tâches qui se présentaient. Travaux de quelques jours, mais aussi ménages dans les chalets des environs, appartenant à de riches familles niçoises.
Sa route croisa ainsi celle des Gubernatis. Ces derniers, mis en confiance par
son sérieux et sa droiture, lui confièrent une clé en la chargeant de veiller sur leur bien.
Antonia avait sept ans lorsqu’elle rencontra Lucas Gubernatis pour la première fois. Lui entrait dans sa neuvième année. Ils ne devaient plus se quitter de toutes leurs vacances et s’écrivaient chaque semaine dès que l’école les séparait.
Un amour aux racines solides, fait pour donner le plus bel arbre. Mais seuls les
contes de fées offrent des fins heureuses aux histoires entre les fils de famille et les
filles de leurs femmes de ménage.
***
La neige est tombée en bourrasques toute la journée. Le froid du crépuscule a figé le ciel pour un autre décor. Une nuit glaciale s’annonce. La ligne de crêtes aux contours argentés disparaît, tels de grands paquebots dans les brumes du large. L’obscurité s’attaque ensuite aux mélèzes qui résistent et dressent leur silhouette parsemée de cristaux, avant de disparaître à leur tour.
Rosine se lève et met une bûche dans la cheminée. Elle reste un instant devant le feu, respirant la bonne odeur de bois brûlé. Les longues soirées d’hiver, qui n’en finissent plus de distiller leur mélancolie, conviennent à cette douce somnolence où baigne son âme depuis la mort de Robert.
Antonia, de l’autre côté de la table, s’applique en faisant ses devoirs. Rosine l’observe durant quelques instants.
Fallait-il qu’elle ressemble autant à ma mère et à mon frère ?
Un visage rond, mais assez bien dessiné, des yeux d’un marron indécis et une chevelure indomptable ; rien dans les traits, dans le geste et les comportements, ne lui rappelle
Antoine.
Rosine est prise de remords.
Ce n’est quand même pas sa faute si elle a hérité de la tête de sa grand-mère et de son oncle. Et puis, elle est tellement gentille. Une gosse adorable,
qui n’exige et ne demande jamais rien.
— Viens, lui dit-elle en arrêtant la machine à coudre, c’est pour un essayage.
Rosine lui passe son mètre ruban autour de la taille et de la poitrine. Elle l’assied sur ses genoux, l’embrasse sur la nuque et la serre contre elle.
Il faudra que je me montre bien plus affectueuse avec elle à présent.
— Comment va ton ami Lucas ? Qu’est-ce qu’il te raconte dans sa dernière lettre ? lui demande-t-elle.
— Il se prend pour un grand maintenant qu’il va au lycée. Il m’a dit qu’aux vacances de Pâques on ne pourra plus jouer aux jeux qu’on jouait avant. Il veut m’en apprendre d’autres, des intelligents qu’il m’a dit.
Rosine sourit en hochant la tête.
— Tu verras, les garçons sont comme ça, ils veulent toujours nous diriger. Celui-là, en plus, c’est un Gubernatis. Et les Gubernatis sont venus au monde pour commander les
autres. Ça va, tes devoirs ?
— J’ai déjà fini le calcul et la géographie. J’ai plus que la récitation à réviser.
— Allez, va travailler. J’espère que ce mois-ci tu auras encore ton tableau d’honneur.
Rosine remet la machine en route. Quelques mètres de velours achetés sur le marché, dans lesquels elle espère pouvoir tirer une robe pour Antonia et une jupe pour elle.
Elle s’était mise à la couture par obligation bien plus que par passion. Hélène, son amie d’enfance, avait guidé ses premiers pas. Un apprentissage dans la douleur, où elle faillit bien souvent capituler.
— J’ai des doigts de travailleur, pas de couturière, disait-elle. Et je préfère, et de loin, les planches, le rabot et les clous au tissu.
En s’aidant des patrons dégotés dans les magazines, elle pouvait à présent tailler une robe et la terminer. Hélène lui prêtait sa Singer électrique chaque fois qu’elle en avait besoin.
— Maman, quelqu’un arrive, dit Antonia en se levant.
— C’est ton parrain. Je reconnais le moteur de sa camionnette.
Anselme Orengo ne laissait jamais passer une semaine sans monter les voir. Dans
le désert où ronronnait son existence, Rosine savait qu’elle pouvait compter sur lui.
Anselme baissa la tête pour entrer. Un géant aux épaules de lutteur, à la tignasse rousse ; une force de la nature cachant une âme en source fraîche.
Il posa son panier, embrassa Rosine. Puis, prenant Antonia dans ses bras, il la
souleva telle une poupée de chiffon.
Rosine sortit deux verres et la bouteille de grappa.
— Qu’est-ce que tu as encore apporté ? demanda-t-elle en jetant un coup d’œil au panier.
— Oh, trois fois rien. Une pièce de chamois de notre dernière sortie et un livre pour ma princesse, de sa collection préférée. Je crois qu’Henriette a ajouté quelques pots de confiture.
Il s’assit à la table, sa filleule sur les genoux.
— Je suis venu te dire que samedi nous prenons la petite. Nous descendons à Nice voir mes parents, et nous remonterons dimanche soir. J’en profiterai pour conduire les gosses au cinéma.
— C’est gentil, Anselme.
Il eut un geste de la main.
— Ce n’est pas grand-chose.
Il prit son verre, but une gorgée et le reposa.
— Comment ça va, Rosine ? demanda-t-il sur un ton qui n’était pas celui des conventions.
— Ça va, Anselme. Ça va aussi bien que possible.
— Rosine, tu n’as pas trente ans. Tu ne peux pas continuer à vivre seule avec la petite. Et pourtant, tu sais que ça m’arrachera le cœur le jour où il faudra te remarier.
Trois ans de veuvage sans la moindre aventure, malgré ces messieurs, amis de Robert et pères de famille pour la plupart, qui l’auraient volontiers couchée sur la mousse des bois.
— Il viendra peut-être un jour, celui qui sera digne de remplacer Robert. Mais, pour l’instant, je ne l’ai pas encore rencontré. Il faut dire qu’après lui n’importe quelle femme se montrerait difficile.
En plaçant ainsi très haut le souvenir de son ami d’enfance, elle voulait offrir à Anselme un instant de plaisir. Ce dernier hocha la tête dans un grand sourire.
— Et la mairie ? lui demanda-t-elle.
— Rien de neuf ni de bien excitant. En fait, ce n’est pas drôle tous les jours d’être maire d’une petite commune. Il ne s’agit pas là d’une vocation, mais d’un véritable sacerdoce où il n’y que de mauvais coups à ramasser. Vois-tu, les gens à qui tu ne peux pas rendre service deviennent tes ennemis. Et il ne faut surtout
pas compter sur la gratitude de ceux que tu as aidés. Enfin, c’est comme ça depuis toujours, et ça ne changera pas.
Rosine mit à profit son week-end de solitude pour repeindre la cuisine. Un travail qui
attendait la bonne occasion depuis des mois.
Le samedi en fin d’après-midi, porte et fenêtres ouvertes, elle finissait son second mur. A quatre pattes, un pinceau à rechampir en main, elle s’appliquait à ne pas déborder sur la plinthe. Elle sursauta soudain. Une ombre venait de lui cacher un
soleil hésitant.
— Qui est là ? dit-elle en se retournant.
Un homme se trouvait sur le pas de la porte. Vêtu d’un long manteau, coiffé d’un chapeau de feutre, un mouchoir noué autour du cou, il tenait un bâton noueux dans la main. Son chien, un Border Collie, s’était assis à ses pieds. Un berger qui ne dissimulait pas sa profession. Il aurait pu figurer
sur un guide touristique flattant les charmes du Mercantour.
Rosine se redressa, l’observa durant un instant. Un visage brûlé par le soleil, parcouru de fines rides ; un regard marron foncé qui ne connaissait aucun repos. Elle perçut que cet homme ne lui voulait aucun mal.
— Vous êtes bien la veuve Michelis ? questionna-t-il avec un léger accent italien qui finissait ses phrases.
— Qui vous l’a dit ? fit-elle en retour.
Il haussa les épaules.
— Qu’est-ce ça peut faire ? L’important, c’est de savoir pourquoi je suis là.
Elle posa le pinceau, s’essuya les mains dans son chiffon.
— Alors, pourquoi vous êtes là, puisque vous désirez que je vous le demande ?
— Je suis berger, répondit-il, laissant croire que son métier expliquait sa visite.
Elle eut un sourire.
— Je l’aurais deviné.
— Je suis italien. Je viens du Piémont, d’un petit village pas très loin de la frontière.
— Ça aussi, je l’avais compris. Alors, qu’est-ce qui vous amène, puisque vous n’êtes pas ici par hasard ?
— Je travaille maintenant en France. Je me suis fait engager chez un éleveur de la Gordolasque. Un emploi pour longtemps, et je cherche une femme.
Vous êtes veuve, et moi je ne suis plus très jeune. Je cherche une femme pour lui parler sérieusement, pas pour l’amusement.
Rosine se mit à rire sans retenue.
— Voilà une demande en mariage qui ne manque pas d’originalité.
Vêtue d’une vieille combinaison de Robert dont elle avait remonté les manches et retroussé les bas de pantalon, coiffée d’une casquette publicitaire, le visage et les mains éclaboussés de peinture, elle ne s’était pas préparée à l’événement.
— Vous auriez dû me prévenir, ajouta-t-elle en riant toujours. J’aurais évité de me déguiser en clown pour recevoir votre proposition.