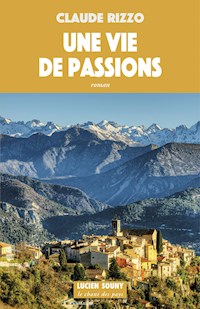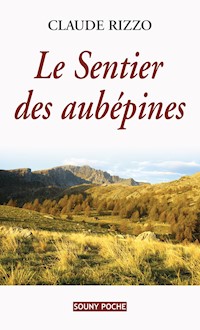Robert Frémont entra dans l’atelier, oubliant de refermer la porte derrière lui. Les deux femmes, qu’il n’avait pas saluées, échangèrent un regard, persuadées qu’un nouvel affrontement s’annonçait. Un désaccord dont elles avaient tout à craindre. Elles étaient, l’une et l’autre, parvenues à un âge où la perte d’un travail représente une malédiction sans espoir. Et le conflit, qui déroulait ses chapitres sous leurs yeux, mettait en péril l’entreprise et menaçait ses trois salariés.
Lucien Frémont eut un soupir en voyant son aîné pénétrer dans le bureau vitré.
— Rien ne t’empêche de dire bonjour, fit-il en reposant le stylo sur la facture qu’il établissait.
— Tu as pris le temps d’examiner notre affaire, de façon objective, sans te laisser gagner une nouvelle fois par les images du passé ; un attachement à des valeurs puériles et rétrogrades ? demanda Robert en ignorant la remarque de son père.
Lucien secoua la tête dans un sourire sans joie. À quelle affaire son fils faisait-il allusion ? Il ne connaissait qu’une seule affaire qui méritait son attention : celle qui leur permettait de vivre ; cette entreprise artisanale que son grand-père avait créée, pour laquelle il œuvrait depuis le jour où il en avait hérité, et qui resterait sa propriété jusqu’à son dernier souffle.
— Et toi, quand vas-tu oublier ce projet farfelu et te remettre au travail ? ajouta-t-il. Ta place est ici, et nulle part ailleurs, tu le sais bien !
Robert s’assit en face de son père, bien décidé en cet instant à reprendre ses arguments sans se laisser déborder par ses ressentiments, à lui faire entendre raison en lui démontrant que l’avenir appartient aux êtres qui regardent devant eux, et non pas à ceux qui s’accrochent au passé et refusent la marche du temps.
— Réfléchissons ensemble, sans a priori ni arrière-pensée et observons la proposition qui nous est faite en listant les avantages que
nous pourrions tirer de cette alliance et les désagréments qu’elle pourrait nous valoir.
— Tu n’as rien compris à l’histoire, Robert, mais je ne t’en veux pas ! J’imagine sans peine les pressions que tu dois subir de la part de ton épouse et de son père, réunis pour la circonstance afin de te conduire à trahir les tiens.
— Laissons Amandine en dehors du propos ! Elle ignore tout des affaires de son père et ne sait même pas que nous avons ouvert des négociations en vue du rapprochement de nos deux entreprises.
Lucien n’en croyait rien. Sa belle-fille, qu’il savait adroite et fine mouche, avait sans doute manipulé ce gros bêta sans même qu’il s’en rendît compte.
— Des négociations ? De quelles négociations parles-tu ? Je dirais pour ma part qu’il s’agit là d’une tentative de spoliation. Un complot imaginé par ton beau-père, auquel tu te prêtes comme un naïf patenté, sans même te rendre compte que tu travailles contre tes intérêts.
Robert ne partageait pas cet avis. Il était persuadé que les deux parties tireraient bénéfice de ce rapprochement dont il évoqua de nouveau les modalités. Jules Galéa, son beau-père, leur proposait de regrouper les deux entreprises en une même société. L’occasion de rappeler que celle de sa belle-famille comptait une soixantaine d’employés, alors que cinq personnes, eux compris, travaillaient ici.
— Réfléchis un peu, reprit-il. Regarde notre chiffre d’affaires et imagine le leur. Un euro chez nous, cent chez eux. Et pourtant,
Jules serait disposé à nous accorder quinze pour cent du capital de la nouvelle entité.
Lucien leva les bras au ciel. Son fils était encore plus crédule qu’il ne le craignait. Comment pouvait-il imaginer que Galéa leur consentirait un cadeau ? Avait-il oublié ce qui se racontait dans leur milieu sur le compte de ce cher monsieur ?
— Tu veux que je te répète ce que l’on dit de lui ? demanda-t-il.
— Inutile ! J’ai appris depuis bien longtemps que la réussite d’un homme le rend suspect et l’expose à toutes les médisances. Et je te signale en outre que « ce cher monsieur » est le père de mon épouse, puisque tu sembles l’oublier.
— Tu as raison, rien ne vaut l’esprit de famille, ironisa Lucien. C’est donc au nom de ce beau principe que nous allons offrir à ton beau-père notre savoir-faire et nos secrets de fabrication. Tu n’ignores pas que celui-ci ne produit que de la saloperie industrielle dans son
usine et qu’il est bien incapable de mettre au point une gamme de qualité. Et nous lui servirions tout ce qui lui manque contre quelques actions qui ne
nous accorderaient aucun pouvoir, sauf celui d’obéir et de nous taire. Et un jour, quand il nous aura vidés de notre substance, il nous mettra…
Il arrêta sa phrase, reprit d’une autre voix :
— Il me jettera à la poubelle. Quant à toi, en tant que beau-fils, tu auras sans doute droit à un emploi dans sa fabrique de chiures de mouche. Et comme Jules est loin d’être bête, et qu’il sait à qui il a affaire, il t’enfermera au labo, avec mission de continuer à améliorer sa production. Et c’est ainsi que le travail de trois générations passera entre ses mains.
Robert prit le parti de rire devant tant de mauvaise foi. La gamme de son beau-père n’était pas aussi médiocre que le laissaient supposer les propos qu’il venait d’entendre. Et personne n’ignorait ici le montant des bénéfices que ce dernier tirait de ses « chiures de mouche. »
Robert reconnaissait à son père, malgré les sarcasmes, d’avoir développé l’idée même de la collaboration qui les attendait. Un mariage heureux, réunissant un savoir-faire artisanal et des moyens importants. Une nouvelle
collection serait alors mise sur le marché. Elle associerait ainsi les deux noms, celui des Galéa et celui des Frémont. Un bien commun, comme preuve que chacun trouverait sa place dans une
aventure qui éveillait chez lui bien plus que de l’enthousiasme.
— Je me moque de ses bénéfices et j’aurais honte de voir mon nom figurer près du sien. Et qu’avons-nous besoin de ces gens, grand Dieu ! Notre petite boutique nous permet de payer nos salariés et nos fournisseurs et de vivre sans nous soucier du lendemain. En outre, nos
clients nous accordent leur fidélité et leur nombre ne cesse de progresser. Que demander de plus ?
Un point de vue égoïste, démontrant que Lucien oubliait que l’un de ses fils travaillait à ses côtés. Des réticences qui appartenaient bien à un homme en fin de carrière, indifférent au sort de celui appelé à lui succéder. Un être qui désormais ne caressait plus que quelques désirs : vivre de ses acquis en évitant de bouger un petit doigt, attendre la retraite en admettant la modestie
que leur valait un atelier qui avait pris un grand coup de vieux.
Robert, cependant, n’avait que trente-trois ans et nourrissait d’autres ambitions. Il le dit haut et fort, voulant ainsi prouver qu’il n’était plus un gamin obéissant et soumis.
— « Ambition ! » Le mot est lâché, se moqua le père. Je l’attendais. Il est enfin arrivé.
— Si le mot ne te convient pas, je le dirai autrement. Tu as ton destin et j’ai le mien. Et force est de constater aujourd’hui que nos chemins divergent. Et Dieu m’est témoin que j’aurai été au bout de mes arguments pour éviter la mésaventure qui nous pend au nez.
Robert s’était levé. La déception née de son échec se lisait sur son visage. L’histoire était écrite. Cette décision constituait un arrache-cœur à ses yeux. Elle lui était imposée par la déraison d’un vieil entêté.
— Et que va-t-il arriver ? demanda Lucien qui, toujours assis, observait son aîné d’un œil ironique, persuadé en cet instant que cette histoire ne représentait qu’une tempête dans un verre d’eau, et que celle-ci finirait bien par s’éloigner.
Un optimisme auquel Robert mit fin en annonçant qu’il abandonnait son père à son sort et qu’il quittait cet atelier dans l’intention de rejoindre celui des Galéa.
— Tu veux dire que tu laisses derrière toi cette affaire qui te reviendra un jour pour un poste de larbin chez ton
beau-père ? interrogea Lucien en se levant à son tour.
— Contraint et forcé par ton obstination ! Et mon cher beau-père héritera ainsi de notre savoir-faire et de nos petits secrets sans même avoir à nous concéder les actions de cette société que nous voulions créer.
Lucien s’était approché de son aîné, venant sous son nez et le défiant du regard.
— Aucun homme digne de ce nom ne commettrait pareil sacrilège ! Une insulte à la mémoire de ton grand-père et à celle de ta pauvre mère !
— Une situation dont tu es le seul responsable.
— Tu n’es vraiment qu’un pauvre imbécile !
— Et toi, un vieux tromblon rongé par la rouille !
La gifle laissa sur la joue de Robert la marque de la chevalière que Lucien portait à son doigt. C’était là la première fois que ce dernier levait la main sur l’un de ses fils.
Surpris par ce geste auquel il s’attendait si peu, Robert hésita un instant. Puis, sans un mot, il sortit du bureau et quitta l’atelier.
La porte s’ouvrit de nouveau quelques secondes plus tard. Ernest, le troisième salarié de la maison, parti de grand matin, revenait après être allé livrer quelques clients.
— Bonjour, mes belles, dit-il en entrant, s’adressant aux deux femmes qui l’une et l’autre étaient en âge d’être sa mère.
Le jeune homme, un grand gaillard avenant et bien bâti, apportait une touche de bonne humeur en ces lieux où le sérieux ouvrait sur la mélancolie.
Posant l’index sur les lèvres, Arlette, la plus ancienne des employées, l’invita au silence. L’heure se prêtait peu aux plaisanteries et aux rires.
— Vous en faites des têtes, mes chéries. On croirait que vous vous préparez à vous rendre à un enterrement. Allez, racontez-moi ce qui justifie ces mines de jour de
Toussaint ? demanda Ernest sans baisser de ton.
Un enterrement sans doute, celui de leur entreprise, condamnée à terme par des péripéties dont les deux femmes avaient été témoins. Des événements qu’elles rapportèrent au jeune homme en parlant à mi-voix.
Chacun savait ici que Lucien Frémont avait perdu pied avec l’âge et les atteintes que lui valait son diabète. Les dernières nouveautés, celles qui avaient enrichi leur gamme, les plus recherchées par la clientèle, étaient à mettre sur le compte de Robert sur lequel reposait désormais l’avenir de leur petite entreprise.
Lucien passait à présent une grande partie de ses journées dans le bureau vitré, attaché aux problèmes administratifs. Il en sortait quand l’urgence le lui commandait, travaillant alors à leurs côtés durant quelques heures, avant que la fatigue le contraigne à s’asseoir de nouveau.
Deux hypothèses, aussi fâcheuses l’une que l’autre, se présentaient à eux, en déduisit Ernest après avoir écouté ses collègues. L’entêtement du père conduisait l’affaire à péricliter et à disparaître, sans tarder. L’idée du fils les livrait sans recours à la volonté de ce foutu Galéa. Et, sans être devin, chacun pouvait annoncer que ce dernier aurait vite fait de liquider
un atelier aux méthodes ancestrales. Un atelier qui ne répondait plus aux normes de la profession et dégageait une forte odeur de naphtaline.
— D’une façon ou d’un autre, nous nous retrouverons à la rue, en conclut Marguerite, la seconde employée.
— Et qui voudrait de nous, de vieux torchons à quelques années de la retraite ? demanda Arlette, sans illusion sur leur sort.
— Pas de panique, mesdames ! N’oubliez pas que l’expérience a encore son prix. Et j’en connais quelques-uns, parmi nos concurrents, qui seraient ravis de vous
ouvrir leur porte.
Un propos guidé par la tendresse que le jeune homme portait à ses deux collègues. Un propos auquel ici personne ne voulut croire. Un pessimisme que
partageait Lucien Frémont. Les coudes posés sur son bureau, la tête entre les mains, celui-ci voyait défiler les images de la décrépitude qui l’attendait. Lucide, il n’ignorait pas que l’âge avait éteint chez lui cette flamme qui, durant des décennies, lui avait offert inspiration et fécondité. Des aptitudes qui avaient fait de lui l’un des maîtres de la profession. Le vieil arbre se desséchait. Une jeune pousse, née de ses œuvres, avait hérité de son génie. Et Lucien avait admis ce transfert, comme obéissant aux lois de Mère Nature. Il était écrit que son fils aîné prendrait la relève et préserverait ainsi la réputation de leur famille. Il aurait pu jurer, ce matin encore, que l’histoire lui réservait une fin heureuse, dans la certitude que cette affaire lui survivrait.
— Quelle faute ai-je commise, méritant un tel châtiment ? se demanda-t-il en chuchotant.
Il estimait n’avoir jamais failli à ses devoirs. Il considérait que peu de pères s’étaient montrés aussi attentifs, aussi indulgents à l’égard de leurs enfants. Il savait également que ses trois employés n’avaient jamais eu à se plaindre de leur sort. Il pouvait jurer en outre que sa vie de commerçant avait toujours été guidée par la morale la plus stricte. Ses clients, ses fournisseurs, son banquier en
portaient témoignage par la confiance qu’ils lui accordaient.
11 mois plus tôt
Une cinquantaine de personnes attendaient sur le parvis de l’église du Port. Robes longues, smokings et nœuds papillon, costumes de bonne coupe, tailleurs de marque habillaient la
plupart d’entre eux.
Le ciel s’était montré clément à leur endroit. Une pluie rageuse avait arrosé la ville tout au long de la matinée. Midi avait sonné la fin de son règne. Un mistral léger s’était levé, contraignant l’armée de nuages à prendre la haute mer, accordant ainsi aux invités de la noce un après-midi de printemps en ce début de mois de février.
La promise se faisait attendre. Plus d’une demi-heure de retard, elle bousculait le programme de ce pauvre curé. Celui-ci devait en effet assumer trois mariages avant la messe dominicale qui,
en cette paroisse, se tenait le samedi à dix-neuf heures !
Une Jeep qui ne datait pas d’hier, où se devinait encore l’étoile de l’armée américaine, vint se garer au plus près du parvis en occupant la moitié du trottoir. Un jeune homme en descendit. Vêtu d’un pantalon de velours à grosses côtes, d’un anorak lustré par le temps, il était chaussé d’une paire de rangers qui eux aussi avaient connu des jours meilleurs.
La jeune femme qui l’accompagnait mérita toutes les attentions dès que l’on comprit que le couple appartenait à la noce. Les regards des hommes racontaient qu’il n’est pas donné tous les jours de voir réunis tant de charme et de distinction en une même personne. Ceux des femmes, envieux, désapprobateurs, s’attachaient plutôt à des vêtements ridicules, un déguisement de carnaval à leur goût, indécent en la circonstance. La nouvelle arrivante portait en effet la tenue
traditionnelle vietnamienne : une tunique en soie sauvage, fendue sur le côté et rehaussée d’un col officier. Un pantalon, serré à la taille, s’élargissait ensuite, tombant sur une paire de sandales rouge écarlate. Ne manquait que le chapeau conique pour clôturer le tableau. La jeune femme lui avait préféré un bandeau piqué de fleurs des champs.
Lucien Frémont eut un hochement de tête en voyant son second fils arriver en pareil équipage.
— Tu aurais pu t’habiller correctement. Le mariage de ton frère invitait à un peu plus de décence, lui reprocha-t-il, évitant de donner son avis sur l’accoutrement de celle qui l’accompagnait.
Alain lui répondit dans un sourire. Son père devait apprendre qu’il avait choisi le meilleur de sa garde-robe pour l’occasion. Celle-ci ne comptait, outre la tenue du jour, que des combinaisons,
des bleus de travail et des brodequins en moins bon état que les galoches qu’il portait aux pieds. Lucien lui rappela qu’une armoire l’attendait dans sa chambre, à la maison. Il aurait pu y trouver une veste, une chemise, une cravate : tout ce qui sied à un citoyen convenable, soucieux de sa dignité et respectant les conventions qui régissent la vie en société.
— Tu peux tout donner aux pauvres de la paroisse, pa ! Ces fringues appartiennent à une époque révolue de mon existence, à laquelle j’ai tourné le dos sans aucune intention d’y revenir.
La jeune femme se tenait à l’écart. Alain l’invita à s’approcher.
— Je te présente Lilly-Fleur, ma compagne, pour employer un mot de la bonne société.
Lucien la salua d’un geste de la tête. La bien nommée Lilly-Fleur lui rendit son salut en une sorte de révérence avant de s’éloigner de nouveau, laissant ainsi les deux hommes deviser à leur guise.
— Alors, comment la trouves-tu ?
— C’est une très belle femme, je l’admets ! Mais le problème n’est pas là.
— Ah ! Il y a donc un problème ! Et il est où, ce problème ?
Lucien reprit un credo auquel son cadet avait droit à chacune de leur rencontre. Un père désespéré, qui ne pouvait admettre que l’un de ses deux fils avait pu tourner le dos au monde civilisé, se laissant ainsi gagner par une forme de vie qui rejetait toutes les valeurs
qui appartenaient à sa famille, à son milieu et reniait ainsi l’éducation qu’il avait reçue.
— Que de grands mots, s’amusa Alain. Une question, pa, si tu le permets ? Comment imagines-tu cette forme de vie dont tu fais toute une histoire ?
Lucien y voyait une bande d’hurluberlus dépendant d’une nébuleuse qui avait fait sienne des formules vides de sens desquelles ils tiraient
un enseignement, apologie du libertinage et de la perversité. Une doctrine fumeuse, qui prétendait renier les réalités de ce monde et les principes moraux du plus grand nombre, et ne représentait en fait qu’un paravent derrière lequel une cohorte de déserteurs cachaient leur lâcheté, leur paresse et leurs vices. « Peace and love », « beatniks », « babas cool » : ces niaiseries le porteraient à rire si elles n’appartenaient pas à l’existence de l’un de ses deux enfants. Et sans doute, respectant leurs dogmes, ces drôles changeaient-ils de couches au gré des vents, élevant ensuite en troupeau les enfants nés de leurs œuvres blasphématoires. Il les voyait aussi consommer des produits interdits qui les
conduisaient à se traîner tels des zombies tout au long de leurs journées. Il imaginait que cette drogue, dont ils étaient captifs, devait contraindre les hommes à mendier dans les rues des villages, tandis que les femmes ne refusaient pas d’offrir à l’occasion quelques douceurs aux hommes du Haut-pays contre le prix d’un gramme ou deux de leur poison. Sans être devin, il pouvait aussi affirmer qu’aucun d’entre eux ne fêterait ses cinquante ans. Drogue, maladies dues à leurs mœurs dissolues les condamnaient en effet à disparaître à un âge où il paraît indécent de mourir.
Alain se prit à rire sans retenue. Son père venait, en quelques phrases, de dresser la liste des clichés qui s’attachaient à ces communautés qui avaient choisi d’autres chemins que ceux suivis par le plus grand nombre. Il devait reconnaître malgré tout que quelques vérités apparaissaient sous ce rassemblement d’images d’Épinal. Il acceptait, en s’en flattant d’ailleurs, le titre de déserteur. Il pouvait même y ajouter ceux de réactionnaire et de révolté. Une révolte contre une société sans âme, si peu fraternelle, qui ignorait la compassion, abandonnant sur le bord de
la route tous ceux qui n’avançaient pas au pas cadencé. Une société de consommateurs, où l’homme n’était plus reconnu que par sa spontanéité à dégainer sa carte bleue ou son carnet de chèques.
Lucien se mit à rire à son tour. Les lieux communs de monsieur l’anticonformiste ne paraissaient pas plus originaux que les siens.
— Admettons ! Laisse-moi à présent t’éclairer sur quelques points qui te conduiront à penser que tu n’assisteras pas à mon enterrement dans les années qui viennent. Apprends tout d’abord que chez nous chaque couple dort dans son lit, et ceci bien que nous ne
fassions pas de la fidélité une affaire d’État. Sentiment petit-bourgeois, je l’avoue, je n’accepterais en aucun cas de partager Lilly-Fleur avec quiconque, mon frère y compris. Et je pense que ma présence suffit à ses nuits. Et sais-tu ce qui occupe nos journées ? Je n’emploierai qu’un seul mot pour définir le quotidien que nous connaissons là-haut. Un mot qui nous conduit à des lieues du roman noir que tu t’es écrit à notre sujet. Le travail, pa ! Eh oui, c’est ainsi ! Figure-toi que nous travaillons du lever au coucher du soleil, en ignorant le
jour du Seigneur et ceux réservés à ses saints.
— Et ce travail, en quoi consiste-t-il ? questionna Lucien sans cacher son scepticisme.
Quinze chèvres, des brebis et un bouc, deux vaches laitières, un poulailler, un potager, quelques arbres fruitiers, une dizaine de
ruches, mais aussi les foins à couper et à rentrer, les fromages à confectionner et à vendre sur les marchés des villages environnants, la remise en état de leur masure et de nouvelles constructions : son père pouvait admettre que l’ouvrage ne leur accordait pas le loisir de rêvasser en exposant leur nombril au soleil.
Une seule occupation manquait à l’appel sur la liste des tâches qui tenaient les membres de la compagnie tout au long de leurs journées. Celle-ci les conduisait à prendre soin d’une petite serre mise à l’abri des regards indiscrets. Il y poussait quelques plans fournissant une herbe
réservée aux ayants droit. Une consommation modérée, juste quelques bouffées destinées à effacer les fatigues du jour.
— Et les gens de là-haut vous achètent vos fromages ? demanda le père sans trop y croire.
— Jusqu’au dernier ! Et nombre de villageois viennent à présent s’approvisionner chez nous.
Des bienfaits que la communauté devait à Lilly-Fleur et à ses talents. Fille de restaurateur, celle-ci avait hérité de ses parents le goût des métiers de bouche. Une vocation qui l’avait amenée à prendre place au sein de brigades de quelques cuisines de restaurants étoilés, de ceux où l’on ne sert pas le plat du jour. Une situation à laquelle elle avait tourné le dos, à l’exemple de chacun d’entre eux, afin d’échapper aux contraintes et de connaître l’ivresse de la liberté. Une habileté, une compétence, qu’elle mettait à présent au service du groupe et de ses clients.
— Tu es invité à venir t’asseoir à notre table au jour de ton choix, ajouta Alain. Tu te rendras alors compte par
toi-même que ton cadet ne vit pas dans un lieu de perdition. Et tu finiras peut-être de te raconter de mauvaises histoires à mon sujet.
Lucien lui répondit en promettant qu’il ferait un jour le voyage. Un engagement qu’il oublierait sans tarder.
— Je me demande si la promise n’a pas changé d’avis, ironisa Alain en surprenant son père qui consultait de nouveau sa montre.
— Je reconnais bien là les Galéa ! Se faire attendre, laisser les autres poiroter doivent leur valoir des
sentiments qui chatouillent leur orgueil.
— Tu ne sembles pas porter une affection démesurée aux parents de ta future belle-fille ; je me trompe ?
Lucien écarta la question d’un geste de la main. Le bonheur de Robert, auprès de celle qu’il avait choisie, apparaissait comme la seule préoccupation qui le tenait. Il était prêt, à ce titre, à sourire à Jules Galéa autant qui le faudrait.
— Des arrivistes malgré tout, ne put-il s’empêcher d’ajouter. Tu t’en rendras compte ce soir ! Le Plazza ! Deux cents invités ! De la poudre aux yeux ! Enfin, c’est Jules qui l’a voulu ainsi et c’est lui qui réglera le plus gros de l’addition !
Alain apprit à son père qu’il n’avait aucune intention de grossir le nombre de convives participant à la fête. Il abandonnait, sans aucun regret, champagne et petits fours au reste de la
compagnie.
— La cérémonie à son terme, j’irai rendre visite à Mam et je lui présenterai Lilly-Fleur par la même occasion, ajouta-t-il. Je reprendrai ensuite la route de la montagne, épuisé par ces quelques heures passées en ville. À propos de Mam, comment va-t-elle ?
Le père haussa les épaules dans un geste laissant voir son peu d’optimisme. Alain ne devait pas ignorer que Carmen, que ce dernier appelait Mam
depuis toujours, s’était alitée sans peu d’espoir de revoir un jour le soleil. Une opération, des soins intensifs, des séjours à l’hôpital, la médecine était allée au bout de sa science. Carmen ondoyait désormais entre les souffrances de cette terre et le monde éthéré que lui accordaient les narcotiques qui lui étaient administrés sans parcimonie.
Une vérité dont Alain avait connaissance. Il ne manquait jamais, descendant au village, de
téléphoner à la maison. Mathilde répondait le plus souvent. Elle lui donnait des nouvelles et lui passait Mam quand
celle-ci était en mesure d’échanger quelques phrases.
Les deux hommes eurent la même pensée en cet instant. Un sort cruel leur imposerait d’être réunis de nouveau. Une autre église, celle de leur quartier, les attendait déjà.
— J’imagine que tu n’assisteras pas non plus à la séance de félicitations.
— Tu l’as deviné, pa !
— Tu devrais donc aller saluer Robert, le temps que celle qui n’en finit plus de se faire attendre daigne enfin montrer le bout de son nez.
Robert, de l’autre côté du parvis, subissait les assauts de deux moulins à paroles, amies des Galéa, qui dressaient la longue liste des vertus de la future Mme Frémont. Alain ne pouvait pas mieux tomber.
De toutes les personnes étrangères aux Frémont, qui les virent s’embrasser, aucune ne put imaginer qu’il s’agissait là de deux frères. Seul Robert avait hérité des traits de son père. Un visage bien dessiné, mince jusqu’à l’excès, les mêmes yeux d’un bleu délavé, il laissait voir un front dégarni qui le destinait à son tour à une calvitie précoce. Alain, quant à lui, ne semblait rien devoir à ses parents. Un rejeton aux épaules de bûcheron, une tignasse à la diable qui lui donnait l’air de sortir du lit à tout instant de la journée, aussi brun qu’un Calabrais, il portait sans doute en lui quelques survivances de ses ancêtres maternels, arrivés voilà plus de deux siècles dans le comté de Nice.
— Alors, on a tiré le gros lot, mon grand, si j’ai bien compris ?
Robert répondit en haussant les épaules. Il épousait la femme qu’il aimait. Tout le reste paraissait secondaire à ses yeux.
— Je te l’accorde, c’est là l’essentiel ! Mais admets quand même que lorsque ce reste représente un beau pactole, la noce n’en est que plus belle. Et te voilà désormais le cul entre deux chaises, si j’ai bien compris ! L’usine de ta belle-famille, l’atelier de pa. Alors, où vas-tu caser tes fesses à présent ?
La question ne se posait pas. La place de Robert se trouvait dans l’atelier familial et nulle part ailleurs.
— Tu sais ce que dit papa à ce sujet, ajouta Robert. Il répète à qui veut l’entendre que les Galéa et nous utilisons les mêmes matières premières sans appartenir toutefois à la même profession. Un avis que je partage sans réserve. Et mon métier, celui que j’aime et qui m’offre tant de plaisir, je le pratique chez nous, dans notre modeste boutique.
— Bravo ! Rien ne vaut l’attachement aux valeurs familiales.
— Une morale dont tu es un exemple vivant, n’est-ce pas ?
Alain répondit en souriant. Personne n’ignorait chez les Frémont qu’un vilain petit canard avait dénaturé une couvée inaugurée par un cygne admirable. Un emploi de trublion que l’on avait attribué à ce cadet venu d’on ne sait où. Alain partageait cet avis, tant le rôle lui convenait.
— Revenons au sujet du jour, mon grand ! Alors, comment as-tu rencontré ton sac de pépites ?
— Mon sac de pépites a un nom ! Elle s’appelle Amandine, si tu ne le savais pas !
Robert raconta qu’il s’était rendu à Paris, à l’occasion d’un salon professionnel. Il en était revenu, sa serviette remplie de documents proposant du matériel récent. Des équipements de nature à moderniser leurs moyens de production et à améliorer ainsi leur rentabilité. Leur père, un mur de granit quand il le décidait, ne voulut rien entendre. Leur outillage, datant du temps de son propre père, leur assurait une qualité qu’aucun équipement moderne n’était en mesure d’égaler. Un avis définitif contre lequel Robert s’était épuisé en pure perte.
— Et faute de matériel, tu nous as rapporté une Amandine, ironisa son cadet.
— Eh oui ! Nés dans la même ville, il a fallu que nous nous rencontrions à Paris où elle accompagnait son père. Nous avons sympathisé et…
Alain connaissait le début de l’histoire. La chute de celle-ci allait s’écrire dans une petite heure. Il devait par contre ignorer à jamais les péripéties suivantes, celles qui avaient conduit parents et amis devant cette église où ils avaient attendu plus que de raison. Un concert de Klaxon annonça en effet l’arrivée de la future Mme Frémont. Une américaine décapotable rose bonbon suivie par deux berlines qui ne devaient pas coûter quatre sous vinrent se ranger sur le parvis.
— Je crois que l’on te demande, mon cher Robert. Et n’oublie pas qu’en sortant de cette église tu seras privé à jamais du pouvoir de dire « Je veux ! » Il faudra changer de disque, mon grand, et t’habituer à dire « Si tu veux bien, ma chérie ! »
***
Une route étroite, ponctuée de lacets, grimpait au plus haut de la colline de Bellet. Une départementale bordée de maisons de pays et de villas plus récentes, la plupart bâties sur plusieurs niveaux, épousant ainsi la configuration de terrains qui, en terrasses étroites descendant vers la vallée, n’avaient accordé d’autres choix aux habitants des lieux.
La plus belle vue sur la baie des Anges, du cap Ferrat au cap d’Antibes, se méritait par une ascension d’une vingtaine de minutes sur cette voie où deux véhicules avaient bien du mal à se croiser.
Alain rangea sa Jeep le long du garage que les Frémont ne fermaient jamais à clé. Il ouvrit la porte. Pas un seul outil n’avait bougé depuis son départ. Son royaume, là où il avait passé des heures et des heures durant sa jeunesse, réparant sa mobylette et celles de ses amis. Le bricoleur de la maison qui, en
outre, à quatorze ans, entretenait la voiture de son père et bâtissait une remise au fond du jardin. Lilly-Fleur eut un sourire en l’écoutant. Elle venait d’avoir confirmation que le citoyen qui partageait sa couche n’avait jamais perdu son temps à la lecture des philosophes. Alain admit qu’il avait abandonné ces derniers à leur triste sort, où ils avaient rejoint leurs confrères, ceux qui avaient été édités dans les collections vertes, rouges et or et compagnie. Une carence qui ne l’avait pas empêché de décrocher deux diplômes de qualité : le certificat d’études et un CAP de menuisier-ébéniste. Il avait choisi cette matière après bien des réflexions. Il aurait pu, avec autant d’aisance, lui préférer la maçonnerie, la plomberie, l’électricité. Lilly-Fleur en convint sans hésitation. Le Ciel avait offert à M. Alain Frémont des mains en or et des doigts de fée. Un présent dont il faisait bon usage tout au long de ses journées et durant une partie de ses nuits. Elle pouvait en témoigner, en tant que victime de ses agissements douteux.
L’entrée dans le monde des adultes apporta une nouvelle preuve qu’Alain appartenait à ces arbres qui dénaturent un verger en poussant en branches tordues. Indiscipliné, fantasque, imperméable à toute discipline, il devait vagabonder d’une entreprise à l’autre, mis à la porte ou quittant son emploi sur un coup de tête. Jusqu’à ce jour…
Ce dimanche-là, comme ceux qui l’avaient précédé, le cadet des Frémont abandonna Nice aux premières lueurs du jour sur sa moto tous terrains. Elle lui permettait d’emprunter les sentiers escarpés, de s’attaquer aux grimpettes les plus raides et de franchir les passages étroits, des paysages lui procurant bien des frissons. Après deux heures passées à effrayer les mouflons, à paniquer des hardes de sangliers, il découvrit cette masure par le plus grand hasard. Une ruine à vrai dire, en face de laquelle étaient dressées trois tentes de camping, chacune servant d’abri provisoire à l’un des couples qui l’avaient accueilli et invité à partager leur repas. Le soir, quittant le Mercantour, il sut que la Providence
lui avait indiqué son chemin. Deux mois plus tard, Lilly-Fleur était arrivée, retrouvant ainsi l’une de ses meilleures amies. Elle aussi avait tourné le dos à son passé, choisissant la liberté dans une existence qui chassait le superflu pour ne laisser place qu’à l’essentiel.
— Il me semblait bien avoir entendu des voix. Par tous les saints du paradis, mais
c’est notre gamin qui vient nous rendre visite !
Elle était arrivée par la porte ouvrant sur la cuisine et les avait surpris dans les bras l’un de l’autre.
— Lilly-Fleur, je te présente Mathilde, l’une des femmes de ma vie, fit Alain après avoir embrassé cette dernière qui avait pris quelques kilos et semblait avoir perdu toute coquetterie. Sa
robe de chambre aux couleurs effacées, les vieilles charentaises qu’elle portait aux pieds démontraient un laisser-aller qui éveilla chez Alain une sorte de morosité lui rappelant la fuite de sa jeunesse mais aussi un sentiment de tristesse
devant l’état de décrépitude de cette femme qui l’avait vu grandir.
Lilly-Fleur l’embrassa à son tour.
— Mon Dieu que vous êtes belle, mademoiselle. Vous êtes la fiancée de notre petit ? demanda Mathilde avec cet accent toulousain dont elle ne s’était jamais défaite. Mais vous n’êtes pas à la noce de Robert ? ajouta-t-elle sans attendre de réponse. Venez, ne restons pas là, nous serions bien mieux à l’intérieur pour bavarder. Le temps que je vous prépare un café, ou un thé si vous préférez ? Alain vous a sans doute déjà raconté que je partage la vie des Frémont depuis bientôt trente ans.
— En effet, il m’a tout dit à votre sujet. Et je vous connaissais avant même de vous rencontrer.
Une affirmation que Mathilde ne voulut pas entendre. Son histoire méritait à l’évidence une seconde diffusion. Elle s’y employa dans ce garage, oubliant le café ou le thé par la même occasion.
Plus d’un quart de siècle durant lequel la vie et la mort s’étaient rendu coup pour coup. Deux garçons étaient nés dans cette maison. L’aîné entrait dans sa troisième année, le second n’avait que six mois quand leur mère quitta ce monde. Mathilde n’avait pas perdu le souvenir de son arrivée ici, où l’attendaient un veuf désemparé et deux poussins à l’abandon. Une époque où elle prenait son service le matin et repartait au retour de M. Frémont. Une période durant laquelle elle avait dirigé cette villa à sa guise, sans que jamais l’on n’eût à se plaindre de ses services. Et puis, deux ans plus tard, Carmen était apparue dans le décor.
L’occasion aux yeux d’Alain d’interrompre Mathilde, dont il connaissait la faculté de s’écouter parler durant des heures.
— Nous pourrions peut-être aller la voir. Lilly-Fleur aimerait bien la connaître.
— Elle dort pour l’instant. Je lui ai donné son cachet en début d’après-midi. Et celui-ci va la tenir durant encore un petit moment. Qu’est-ce que je disais ? Ah oui, je parlais de l’arrivée de Carmen. J’étais certaine alors que cet événement me condamnait à quitter les lieux. M. Frémont ne l’entendait pas de cette oreille. J’étais ici et j’y resterai.
Elle ajouta, s’adressant à Lilly-Fleur :
— Mais vous savez comment nous sommes, nous, les femmes. Nous n’aimons pas partager ce qui nous est acquis. J’étais la patronne dans cette maison, et voilà qu’une autre se préparait à me donner des ordres. Eh bien, je me trompais, ma belle ! Je craignais l’arrivée d’une concurrente. Le Ciel m’a envoyé une sœur. Et puis mon pauvre mari, que Dieu ait son âme, s’est endormi un soir en oubliant de se réveiller au matin. Carmen m’a alors proposé de venir m’installer ici. Et j’y suis depuis ce jour. Et vous n’ignorez sans doute pas que cette pauvre Carmen a vécu elle aussi une drôle d’histoire.
Alain rappela à Mathilde qu’elle leur avait suggéré de quitter le garage pour s’installer à l’intérieur. Il fit l’économie de quelques phrases en s’abstenant de lui apprendre que Lilly-Fleur connaissait aussi l’histoire de Mam. Mathilde avait décidé de la raconter. Et rien ni personne ne pourraient l’en empêcher.
— C’est vrai ! Où avais-je la tête ? Venez, les enfants, vous serez bien mieux au salon. Et nous entendrons ainsi
Carmen, qui ne devrait pas tarder à s’éveiller.
Ils s’étaient assis devant une tasse de thé. Mathilde observa de nouveau Lilly-Fleur qui, en pleine lumière, lui parut plus ravissante encore. Comment se pouvait-il qu’une aussi belle femme ait pu choisir comme fiancé leur garnement, qui lui n’était ni séduisant ni très intelligent ? s’étonna-t-elle. Alain remercia pour tant de compliments tandis que Lilly-Fleur
reconnaissait le bien-fondé de ces remarques. Elle-même se posait d’ailleurs la question, sans jamais obtenir de réponses expliquant cette curiosité.
— Peut-être m’amuse-t-il ? reprit-elle. Et vous admettrez que les hommes qui savent nous faire sourire ne
courent pas les rues. J’ajouterais que le bougre ne s’exprime pas trop mal au regard de son peu de culture. Un beau parleur, prêt à vous saouler de mots pour parvenir à ses fins et vous rouler ainsi dans la farine. Vous en convenez, madame ?
Mathilde partageait cet avis sans réticence. Elle se souvenait encore des méthodes utilisées par les deux frères à l’âge des caprices. Robert exigeait, tapait du pied, larmoyait. Alain, lui, ne
pleurait jamais. Il préférait parlementer, argumenter, cajoler. Un véritable pot de glu dont les deux femmes ne pouvaient plus se défaire. Elles en riaient encore avec Carmen.
— Quand le destin ne t’a pas donné le plumage, il faut avoir le ramage, fit Alain dans un sourire.
— Une belle réflexion ! s’étonna Lilly-Fleur.
Alain crut bon de la rassurer en lui apprenant qu’elle n’était pas de lui. Il la devait à l’un de ses amis. Et ce dernier avait ensuite investi dix bonnes minutes en
parlotte avant qu’il en comprenne le sens.
Mathilde se souvint alors qu’elle leur avait promis l’histoire de Carmen. Lilly-Fleur et Alain échangèrent un regard amusé. Le pot de glu avait changé de main dans cette maison.
Il fallut admettre que la Providence n’avait pas épargné Carmen Muscat avant sa rencontre avec Lucien Frémont. Des mésaventures, dignes de figurer dans un roman-photo, l’avaient conduite à affronter une situation des plus inédites.
L’époux de Carmen appartenait à la marine marchande depuis plus de dix ans à l’époque où ce drôle de drame s’était produit. Ingénieur-mécanicien sur un porte-conteneurs, celui-ci partait pour de longues traversées qui le conduisaient en Asie ou en Amérique du Sud.
Au terme de deux semaines de détente, Muscat avait rejoint le port du Havre pour un périple en direction du golfe du Bengale. Le navire, au bout de son voyage, sa
cargaison à quai, était reparti sans lui. L’ingénieur-mécanicien ne s’était pas présenté à l’appel. L’enquête, diligentée par la compagnie, soutenue par l’ambassade de France, après deux ans de recherches, aboutit à une conclusion sans appel : Muscat avait disparu de son plein gré. Tout laissait supposer que celui-ci avait ajouté son nom à la liste des marins qui, oubliant leur passé, s’étaient bâti de nouvelles existences auprès de sirènes locales.
Carmen, contrainte de travailler, avait alors trouvé un emploi chez l’un des clients des Frémont. Ce fut ainsi que Lucien la rencontra. Carmen portait toujours le nom de
son époux, refusant de demander le divorce au nom de ses convictions religieuses.
Entre deux péchés, elle avait choisi le concubinage, la faute la plus acceptable à ses yeux. Et la joie revint dans cette maison. Lucien retrouva son sourire et
deux femmes prenaient soin à présent de ses enfants.
— Elle s’est réveillée et m’appelle, ajouta Mathilde, surprenant Lilly-Fleur et Alain qui eux n’avaient rien entendu.
Ils voulurent se lever à leur tour. Elle les pria de n’en rien faire et d’attendre qu’elle vînt les chercher. Cette pauvre Carmen connaissait en effet des incontinences avec
sa maladie. Le temps pour elle de la changer si besoin était et de la rendre ainsi présentable.
Alain s’était préparé au pire en retrouvant Mam qu’il n’avait pas vue depuis deux ans. Le spectacle qu’il découvrit fit vaciller sa volonté de ne rien céder à la consternation. Il eut pourtant bien du mal à contenir les sanglots qui l’étouffaient et à chasser le trouble qui nouait son estomac. Prenant sur lui, respirant à pleins poumons, il parvint à se dominer, affichant un maigre sourire qui cachait mal sa douleur.
— Approchez-vous, les invita Carmen d’une voix qui les surprit par sa fermeté. C’est gentil d’avoir quitté la noce pour venir me présenter ta promise, ajouta-t-elle en s’adressant à Alain. Robert m’a lui aussi rendu visite avec sa fiancée. Et aujourd’hui, je n’ai pensé qu’à eux et j’ai longtemps prié pour leur bonheur. Mais hélas…
— La demoiselle s’appelle Lilly-Fleur, fit Mathilde en lui coupant la parole dans son désir de chasser la mélancolie qui pointait son nez. Regarde cette jolie jeune fille qu’Alain nous amène et regarde aussi sa tenue. Je suis sûre que la demoiselle a du sang qui nous vient d’ailleurs.
Lilly-Fleur comprit qu’il lui fallait soutenir Mathilde dans son désir d’alléger le propos, de le conduire vers des futilités souriantes. Elle confirma ainsi qu’elle était née d’un mélange de sang où deux continents avaient mis leurs graines. On y retrouvait une grand-mère annamite, une autre tonkinoise et deux anciens coloniaux qui avaient rapporté ces poupées exotiques dans leurs bagages.
Alain ne s’était pas montré bavard jusque-là. Il entra à son tour dans le jeu des deux femmes.
— Et vous devez savoir que Lilly-Fleur est aussi une excellente cuisinière. Ses parents tenaient un restaurant où elle a tout appris du métier. Elle a aussi travaillé aux côtés de grands chefs étoilés qui tous ont apprécié ses qualités professionnelles. Et ce n’est pas nous, là-haut, qui nous en plaindrons. Lilly-Fleur nous régale en effet de spécialités de son invention, où se mêlent les goûts des deux pays qui appartiennent à son héritage.
Carmen avait fermé les yeux et son visage, privé de chair et de couleurs, laissait voir le retour de la souffrance. Mathilde s’était levée. Elle revint avec un verre d’eau et un nouveau cachet.
— Je crois qu’il est temps pour vous de partir, les enfants. Lilly-Fleur et Alain veulent te
dire au revoir, ajouta-t-elle en haussant la voix. Il est l’heure pour eux de rejoindre la noce.
Carmen ouvrit les yeux. Alain se pencha sur elle pour l’embrasser. Elle lui prit la main qu’elle serra dans la sienne.
— Prends bien soin de toi, mon petit ! Et tu diras à Robert et sa petite femme que je suis avec eux par le cœur et par l’esprit, chuchota-t-elle.
— Et promets-leur qu’à leur prochaine visite ils te trouveront sur pied.
— À la volonté de Dieu, Mathilde !
Cette dernière les raccompagna jusqu’au portail, leur souhaitant de passer une bonne soirée malgré tout. Alain s’abstint de lui apprendre qu’ils finiraient leur journée dans le calme et la sérénité de leurs montagnes.
Ils quittèrent Nice par la vallée du Paillon et se dirigeaient vers Sospel. Ils gardaient le silence, l’un et l’autre perdus dans des réflexions qui les conduisaient vers des rivages bien différents. Alain était tout à ses remords. Deux années passées là-haut durant lesquelles il n’avait jamais pris le temps de rendre visite aux siens. Et Carmen se préparait à les abandonner, sans avoir entendu de sa bouche les mots qu’elle méritait, ceux qui lui venaient à présent à l’esprit, qui parlaient d’amour, de tendresse et de reconnaissance.
Lilly-Fleur avait posé la main sur l’épaule d’Alain. Elle était à ses côtés dans l’épreuve qu’il traversait. Parjure en cet instant, elle admettait avoir quitté la chambre de la malade sans aucun regret. La Providence lui avait en effet
fait don d’une faculté qui s’était révélée bien utile dans l’univers de la gastronomie auquel elle avait appartenu durant des années. Une qualité qui pouvait aussi la mettre mal à l’aise en quelques circonstances. Lilly-Fleur était bien plus perméable aux odeurs que la plupart des mortels. Et celles de cette chambre, où se mêlaient des relents d’urine, de cire rance et de parfum de grande surface, l’avaient indisposée et lui retournait encore l’estomac. Un regret la tenait en outre. Une frustration qu’elle n’aurait jamais osé avouer, comme appartenant à l’une de ces futilités que la communauté, à laquelle elle adhérait sans réticence, avait chassées de son quotidien. Lilly-Fleur aurait bien assisté au banquet qui suivait la cérémonie. Le temps pour elle de juger de la qualité d’un buffet proposé par l’un des établissements figurant parmi les grandes adresses de la Côte d’Azur. Une bouffée de nostalgie, laissant apparaître la contradiction d’une femme qui aimait à la fois son présent tout en regrettant son passé.