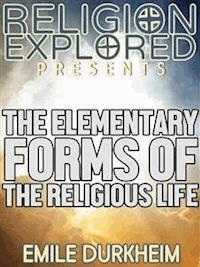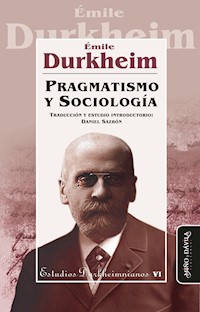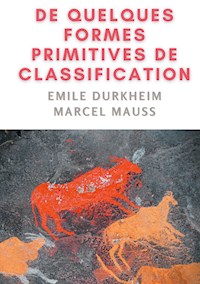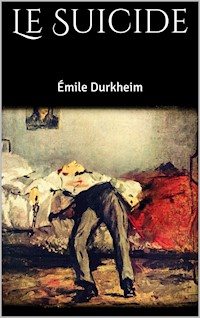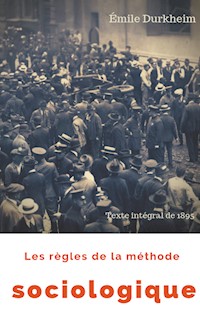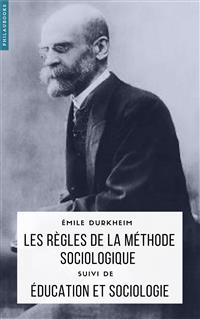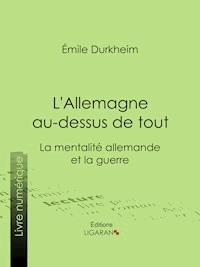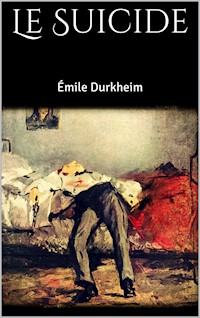
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Skyline
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
Depuis quelque temps, la sociologie est à la mode. Le mot, peu connu et presque décrié il y a une dizaine d'années, est aujourd'hui d'un usage courant. Les vocations se multiplient et il y a dans le public comme un préjugé favorable à la nouvelle science. On en attend beaucoup. Il faut pourtant bien avouer que les résultats obtenus ne sont pas tout à fait en rapport avec le nombre des travaux publiés ni avec l'intérêt qu'on met à les suivre. Les progrès d'une science se reconnaissent à ce signe que les questions dont elle traite ne restent pas stationnaires. On dit qu'elle avance quand des lois sont découvertes qui, jusque-là, étaient ignorées, ou, tout au moins, quand des faits nouveaux, sans imposer encore une solution qui puisse être regardée comme définitive, viennent modifier la manière dont se posaient les problèmes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Émile Durkheim
Le Suicide
table des matières
PRÉFACE
INTRODUCTION
LIVRE PREMIER
CHAPITRE I
CHAPITRE II
CHAPITRE III
CHAPITRE IV
LIVRE II
CHAPITRE PREMIER
CHAPITRE II
CHAPITRE III
CHAPITRE IV
CHAPITRE V
CHAPITRE VI
LIVRE III
CHAPITRE I
CHAPITRE II
CHAPITRE III
PRÉFACE
INTRODUCTION
I.
Comme le mot de suicide revient sans cesse dans le cours de la conversation, on pourrait croire que le sens en est connu de tout le monde et qu'il est superflu de le définir. Mais, en réalité, les mots de la langue usuelle, comme les concepts qu'ils expriment, sont toujours ambigus et le savant qui les emploierait tels qu'il les reçoit de l'usage et sans leur faire subir d'autre élaboration s'exposerait aux plus graves confusions. Non seulement la compréhension en est si peu circonscrite qu'elle varie d'un cas à l'autre suivant les besoins du discours, mais encore, comme la classification dont ils sont le produit ne procède pas d'une analyse méthodique, mais ne fait que traduire les impressions confuses de la foule, il arrive sans cesse que des catégories de faits très disparates sont réunies indistinctement sous une même rubrique, ou que des réalités de même nature sont appelées de noms différents. Si donc on se laisse guider par l'acception reçue, on risque de distinguer ce qui doit être confondu ou de confondre ce qui doit être distingué, de méconnaître ainsi la véritable parenté des choses et, par suite, de se méprendre sur leur nature. On n'explique qu'en comparant. Une investigation scientifique ne peut donc arriver à sa fin que si elle porte sur des faits comparables et elle a d'autant plus de chances de réussir qu'elle est plus assurée d'avoir réuni tous ceux qui peuvent être utilement comparés. Mais ces affinités naturelles des êtres ne sauraient être atteintes avec quelque sûreté par un examen superficiel comme celui d'où est résultée la terminologie vulgaire; par conséquent, le savant ne peut prendre pour objets de ses recherches les groupes de faits tout constitués auxquels correspondent les mots de la langue courante. Mais il est obligé de constituer lui-même les groupes qu'il veut étudier, afin de leur donner l'homogénéité et la spécificité qui leur sont nécessaires pour pouvoir être traités scientifiquement. C'est ainsi que le botaniste, quand il parle de fleurs ou de fruits, le zoologiste, quand il parle de poissons ou d'insectes, prennent ces différents termes dans des sens qu'ils ont dû préalablement fixer.
Notre première tâche doit donc être de déterminer l'ordre de faits que nous nous proposons d'étudier sous le nom de suicides. Pour cela, nous allons chercher si, parmi les différentes sortes de morts, il en est qui ont en commun des caractères assez objectifs pour pouvoir être reconnus de tout observateur de bonne foi, assez spéciaux pour ne pas se rencontrer ailleurs, mais, en même temps, assez voisins de ceux que l'on met généralement sous le nom de suicides pour que nous puissions, sans faire violence à l'usage, conserver cette même expression. S'il s'en rencontre, nous réunirons sous cette dénomination tous les faits, sans exception, qui présenteront ces caractères distinctifs, et cela sans nous inquiéter si la classe ainsi formée ne comprend pas tous les cas qu'on appelle d'ordinaire ainsi ou, au contraire, en comprend qu'on est habitué à appeler autrement. Car ce qui importe, ce n'est pas d'exprimer avec un peu de précision la notion que la moyenne des intelligences s'est faite du suicide, mais c'est de constituer une catégorie d'objets qui, tout en pouvant être, sans inconvénient, étiquettée sous cette rubrique, soit fondée objectivement, c'est-à-dire corresponde à une nature déterminée de choses.
Or, parmi les diverses espèces de morts, il en est qui présentent ce trait particulier qu'elles sont le fait de la victime elle-même, qu'elles résultent d'un acte dont le patient est l'auteur; et, d'autre part, il est certain que ce même caractère se retrouve à la base même de l'idée qu'on se fait communément du suicide. Peu importe, d'ailleurs, la nature intrinsèque des actes qui produisent ce résultat. Quoique, en général, on se représente le suicide comme une action positive et violente qui implique un certain déploiement de force musculaire, il peut se faire qu'une attitude purement négative ou une simple abstention aient la même conséquence. On se tue tout aussi bien en refusant de se nourrir qu'en se détruisant par le fer ou le feu. Il n'est même pas nécessaire que l'acte émané du patient ait été l'antécédent immédiat de la mort pour qu'elle en puisse être regardée comme l'effet; le rapport de causalité peut être indirect, le phénomène ne change pas, pour cela, de nature. L'iconoclaste qui, pour conquérir les palmes du martyre, commet un crime de lèse-majesté qu'il sait être capital, et qui meurt de la main du bourreau, est tout aussi bien l'auteur de sa propre fin que s'il s'était porté lui-même le coup mortel; du moins, il n'y a pas lieu de classer dans des genres différents ces deux variétés de morts volontaires, puisqu'il n'y a de différences entre elles que dans les détails matériels de l'exécution. Nous arrivons donc à cette première formule: On appelle suicide toute mort qui résulte médiatement ou immédiatement d'un acte positif ou négatif, accompli par la victime elle-même.
Mais cette définition est incomplète; elle ne distingue pas entre deux sortes de morts très différentes. On ne saurait ranger dans la même classe et traiter de la même manière la mort de l'halluciné qui se précipite d'une fenêtre élevée parce qu'il la croit de plain-pied avec le sol, et celle de l'homme, sain d'esprit, qui se frappe en sachant ce qu'il fait. Même, en un sens, il y a bien peu de dénouements mortels qui ne soient la conséquence ou prochaine ou lointaine de quelque démarche du patient. Les causes de mort sont situées hors de nous beaucoup plus qu'en nous et elles ne nous atteignent que si nous nous aventurons dans leur sphère d'action.
Dirons-nous qu'il n'y a suicide que si l'acte d'où la mort résulte a été accompli par la victime en vue de ce résultat? Que celui-là seul se tue véritablement qui a voulu se tuer et que le suicide est un homicide intentionnel de soi-même? Mais d'abord, ce serait définir le suicide par un caractère qui, quels qu'en puissent être l'intérêt et l'importance, aurait, tout au moins, le tort de n'être pas facilement reconnaissable parce qu'il n'est pas facile à observer. Comment savoir quel mobile a déterminé l'agent et si, quand il a pris sa résolution, c'est la mort même qu'il voulait ou s'il avait quelque autre but? L'intention est chose trop intime pour pouvoir être atteinte du dehors autrement que par de grossières approximations. Elle se dérobe même à l'observation intérieure. Que de fois nous nous méprenons sur les raisons véritables qui nous font agir! Sans cesse, nous expliquons par des passions généreuses ou des considérations élevées des démarches que nous ont inspirées de petits sentiments ou une aveugle routine.
D'ailleurs, d'une manière générale, un acte ne peut être défini par la fin que poursuit l'agent, car un même système de mouvements, sans changer de nature, peut-être ajusté à trop de fins différentes. Et en effet, s'il n'y avait suicide que là où il y a intention de se tuer, il faudrait refuser cette dénomination à des faits qui, malgré des dissemblances apparentes, sont, au fond, identiques à ceux que tout le monde appelle ainsi, et qu'on ne peut appeler autrement à moins de laisser le terme sans emploi. Le soldat qui court au devant d'une mort certaine pour sauver son régiment ne veut pas mourir, et pourtant n'est-il pas l'auteur de sa propre mort au même titre que l'industriel ou le commerçant qui se tuent pour échapper aux hontes de la faillite? On en peut dire autant du martyr qui meurt pour sa foi, de la mère qui se sacrifie pour son enfant, etc. Que la mort soit simplement acceptée comme une condition regrettable, mais inévitable, du but où l'on tend, ou bien qu'elle soit expressément voulue et recherchée pour elle-même, le sujet, dans un cas comme dans l'autre, renonce à l'existence, et les différentes manières d'y renoncer ne peuvent être que des variétés d'une même classe. Il y a entre elles trop de ressemblances fondamentales pour qu'on ne les réunisse pas sous la même expression générique, sauf à distinguer ensuite des espèces dans le genre ainsi constitué. Sans doute, vulgairement, le suicide est, avant tout, l'acte de désespoir d'un homme qui ne tient plus à vivre. Mais, en réalité, parce qu'on est encore attaché à la vie au moment où on la quitte, on ne laisse pas d'en faire l'abandon; et, entre tous les actes par lesquels un être vivant abandonne ainsi celui de tous ses biens qui passe pour le plus précieux, il y a des traits communs qui sont évidemment essentiels. Au contraire, la diversité des mobiles qui peuvent avoir dicté ces résolutions ne saurait donner naissance qu'à des différences secondaires. Quand donc le dévouement va jusqu'au sacrifice certain de la vie, c'est scientifiquement un suicide; nous verrons plus tard de quelle sorte.
Ce qui est commun à toutes les formes possibles de ce renoncement suprême, c'est que l'acte qui le consacre est accompli en connaissance de cause; c'est que la victime, au moment d'agir, sait ce qui doit résulter de sa conduite, quelque raison d'ailleurs qui l'ait amenée à se conduire ainsi. Tous les faits de mort qui présentent cette particularité caractéristique se distinguent nettement de tous les autres où le patient ou bien n'est pas l'agent de son propre décès, ou bien n'en est que l'agent inconscient. Ils s'en distinguent par un caractère facile à reconnaître, car ce n'est pas un problème insoluble que de savoir si l'individu connaissait ou non par avance les suites naturelles de son action. Ils forment donc un groupe défini, homogène, discernable de tout autre et qui, par conséquent, doit être désigné par un mot spécial. Celui de suicide lui convient et il n'y a pas lieu d'en créer un autre; car la très grande généralité des faits qu'on appelle quotidiennement ainsi en fait partie. Nous disons donc définitivement: On appelle suicide tout cas de mort qui résulte directement ou indirectement d'un acte positif ou négatif, accompli par la victime elle-même et qu'elle savait devoir produire ce résultat. La tentative, c'est l'acte ainsi défini, mais arrêté avant que la mort en soit résultée.
Cette définition suffit à exclure de notre recherche tout ce qui concerne les suicides d'animaux. En effet, ce que nous savons de l'intelligence animale ne nous permet pas d'attribuer aux bêtes une représentation anticipée de leur mort, ni surtout des moyens capables de la produire. On en voit, il est vrai, qui refusent de pénétrer dans un local où d'autres ont été tuées; on dirait qu'elles pressentent leur sort. Mais, en réalité, l'odeur du sang suffit à déterminer ce mouvement instinctif de recul. Tous les cas un peu authentiques que l'on cite et où l'on veut voir des suicides proprement dits peuvent s'expliquer tout autrement. Si le scorpion irrité se perce lui-même de son dard (ce qui, d'ailleurs, n'est pas certain), c'est probablement en vertu d'une réaction automatique et irréfléchie. L'énergie motrice, soulevée par son état d'irritation, se décharge au hasard, comme elle peut; il se trouve que l'animal en est la victime, sans qu'on puisse dire qu'il se soit représenté par avance la conséquence de son mouvement. Inversement, s'il est des chiens qui refusent de se nourrir quand ils ont perdu leur maître, c'est que la tristesse, dans laquelle ils étaient plongés, a supprimé mécaniquement l'appétit; la mort en est résultée, mais sans qu'elle ait été prévue. Ni le jeûne dans ce cas, ni la blessure dans l'autre n'ont été employés comme des moyens dont l'effet était connu. Les caractères distinctifs du suicide, tels que nous l'avons défini, font donc défaut. C'est pourquoi, dans ce qui suivra, nous n'aurons à nous occuper que du suicide humain[3].
Mais cette définition n'a pas seulement l'avantage de prévenir les rapprochements trompeurs ou les exclusions arbitraires; elle nous donne dès maintenant une idée de la place que les suicides occupent dans l'ensemble de la vie morale. Elle nous montre, en effet, qu'ils ne constituent pas, comme on pourrait le croire, un groupe tout à fait à part, une classe isolée de phénomènes monstrueux, sans rapport avec les autres modes de la conduite, mais, au contraire, qu'ils s'y relient par une série continue d'intermédiaires. Ils ne sont que la forme exagérée de pratiques usuelles. En effet, il y a, disons-nous, suicide quand la victime, au moment où elle commet l'acte qui doit mettre fin à ses jours, sait de toute certitude ce qui doit normalement en résulter. Mais cette certitude peut être plus ou moins forte. Nuancez-la de quelques doutes, et vous aurez un fait nouveau, qui n'est plus le suicide, mais qui en est proche parent puisqu'il n'existe entre eux que des différences de degrés. Un homme qui s'expose sciemment pour autrui, mais sans qu'un dénouement mortel soit certain, n'est pas, sans doute, un suicidé, même s'il arrive qu'il succombe, non puis que l'imprudent qui joue de parti pris avec la mort tout en cherchant à l'éviter, ou que l'apathique qui, ne tenant vivement à rien, ne se donne pas la peine de soigner sa santé et la compromet par sa négligence. Et pourtant, ces différentes manières d'agir ne se distinguent pas radicalement des suicides proprement dits. Elles procèdent d'états d'esprit analogues, puisqu'elles entraînent également des risques mortels qui ne sont pas ignorés de l'agent, et que la perspective de ces risques ne l'arrête pas; toute la différence, c'est que les chances de mort sont moindres. Aussi n'est-ce pas sans quelque fondement qu'on dit couramment du savant qui s'est épuisé en veilles, qu'il s'est tué lui-même. Tous ces faits constituent donc des sortes de suicides embryonnaires, et, s'il n'est pas d'une bonne méthode de les confondre avec le suicide complet et développé, il ne faut pas davantage perdre de vue les rapports de parenté qu'ils soutiennent avec ce dernier. Car il apparaît sous un tout autre aspect, une fois qu'on a reconnu qu'il se rattache sans solution de continuité aux actes de courage et de dévouement, d'une part, et, de l'autre, aux actes d'imprudence et de simple négligence. On verra mieux dans la suite ce que ces rapprochements ont d'instructif.
II.
Mais le fait ainsi défini intéresse-t-il le sociologue? Puisque le suicide est un acte de l'individu qui n'affecte que l'individu, il semble qu'il doive exclusivement dépendre de facteurs individuels et qu'il ressortisse, par conséquent, à la seule psychologie. En fait, n'est-ce pas par le tempérament du suicidé, par son caractère, par ses antécédents, par les événements de son histoire privée que l'on explique d'ordinaire sa résolution?
Nous n'avons pas à rechercher pour l'instant dans quelle mesure et sous quelles conditions il est légitime d'étudier ainsi les suicides, mais ce qui est certain, c'est qu'ils peuvent être envisagés sous un tout autre aspect. En effet, si, au lieu de n'y voir que des événements particuliers, isolés les uns des autres et qui demandent à être examinés chacun à part, on considère l'ensemble des suicides commis dans une société donnée pendant une unité de temps donnée, on constate que le total ainsi obtenu n'est pas une simple somme d'unités indépendantes, un tout de collection, mais qu'il constitue par lui-même un fait nouveau et sui generis, qui a son unité et son individualité, sa nature propre par conséquent, et que, de plus, cette nature est éminemment sociale. En effet, pour une même société, tant que l'observation ne porte pas sur une période trop étendue, ce chiffre est à peu près invariable, comme le prouve le tableau I (V. ci-dessous). C'est que, d'une année à la suivante, les circonstances au milieu desquelles se développe la vie des peuples restent sensiblement les mêmes. Il se produit bien parfois des variations plus importantes; mais elles sont tout à fait l'exception. On peut voir, d'ailleurs, qu'elles sont toujours contemporaines de quelque crise qui affecte passagèrement l'état social[4].
/* TABLEAU I
Constance du suicide dans les principaux pays d'Europe (Chiffres absolus).
+————+————-+————-+————+———-+—————+—————-+ | | | | | | | | | ANNÉES.| FRANCE. | PRUSSE. | ANGLE- | SAXE. | BAVIÈRE. | DANEMARK. | | | | | TERRE | | | | +————+————-+————-+————+———-+—————+—————-+ | | | | | | | | | 1841 | 2.814 | 1.630 | | 290 | | 337 | | 1842 | 2.866 | 1.598 | | 318 | | 317 | | 1843 | 3.020 | 1.720 | | 420 | | 301 | | 1844 | 2.973 | 1.575 | | 335 | 244 | 285 | | 1845 | 3.082 | 1.700 | | 338 | 250 | 290 | | 1846 | 3.102 | 1.707 | | 373 | 220 | 376 | | 1847 | (3.647) | (1.852) | | 377 | 217 | 345 | | 1848 | (3.301) | (1.649) | | 398 | 215 | (305) | | 1849 | 3.583 | (1.527) | | (328) | (189) | 337 | | 1850 | 3.596 | 1.736 | | 390 | 250 | 340 | | 1851 | 3.598 | 1.809 | | 402 | 260 | 401 | | 1852 | 3.676 | 2.073 | | 530 | 226 | 426 | | 1853 | 3.415 | 1.942 | | 431 | 263 | 419 | | 1854 | 3.700 | 2.198 | | 547 | 318 | 363 | | 1855 | 3.810 | 2.351 | | 568 | 307 | 399 | | 1856 | 4.189 | 2.377 | | 550 | 318 | 426 | | 1857 | 3.967 | 2.038 | 1.349 | 485 | 286 | 427 | | 1858 | 3.903 | 2.126 | 1.275 | 491 | 329 | 457 | | 1859 | 3.899 | 2.146 | 1.248 | 507 | 387 | 451 | | 1860 | 4.050 | 2.105 | 1.365 | 548 | 339 | 468 | | 1861 | 4.454 | 2.185 | 1.347 | (643) | | | | 1862 | 4.770 | 2.112 | 1.317 | 557 | | | | 1863 | 4.613 | 2.374 | 1.315 | 643 | | | | 1864 | 4.521 | 2.203 | 1.340 | (545) | | 411 | | 1865 | 4.946 | 2.361 | 1.392 | 619 | | 451 | | 1866 | 5.119 | 2.485 | 1.329 | 704 | 410 | 443 | | 1867 | 5.011 | 3.625 | 1.316 | 752 | 471 | 469 | | 1868 | (5.547) | 3.658 | 1.508 | 800 | 453 | 498 | | 1869 | 5.114 | 3.544 | 1.588 | 710 | 425 | 462 | | 1870 | | 3.270 | 1.554 | | | 486 | | 1871 | | 3.135 | 1.495 | | | | | 1872 | | 3.467 | 1.514 | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————+ */
C'est ainsi qu'en 1848 une baisse brusque a eu lieu dans tous les États européens.
Si l'on considère un plus long intervalle de temps, on constate des changements plus graves. Mais alors ils deviennent chroniques; ils témoignent donc simplement que les caractères constitutionnels de la société ont subi, au même moment, de profondes modifications. Il est intéressant de remarquer qu'ils ne se produisent pas avec l'extrême lenteur que leur ont attribuée un assez grand nombre d'observateurs; mais ils sont à la fois brusques et progressifs. Tout à coup, après une série d'années où les chiffres ont oscillé entre des limites très rapprochées, une hausse se manifeste qui, après des hésitations en sens contraires, s'affirme, s'accentue et enfin se fixe. C'est que toute rupture de l'équilibre social, si elle éclate soudainement, met toujours du temps à produire toutes ses conséquences. L'évolution du suicide est ainsi composée d'ondes de mouvement, distinctes et successives, qui ont lieu par poussées, se développent pendant un temps, puis s'arrêtent pour recommencer ensuite. On peut voir sur le tableau précédent qu'une de ces ondes s'est formée presque dans toute l'Europe au lendemain des événements de 1848, c'est-à-dire vers les années 1850-1853 selon les pays; une autre a commencé en Allemagne après la guerre de 1866, en France un peu plus tôt, vers 1860, à l'époque qui marque l'apogée du gouvernement impérial, en Angleterre vers 1868, c'est-à-dire après la révolution commerciale que déterminèrent alors les traités de commerce. Peut-être est-ce à la même cause qu'est due la nouvelle recrudescence que l'on constate chez nous vers 1865. Enfin, après la guerre de 1870 un nouveau mouvement en avant a commencé qui dure encore et qui est à peu près général en Europe[5].
Chaque société a donc, à chaque moment de son histoire, une aptitude définie pour le suicide. On mesure l'intensité relative de cette aptitude en prenant le rapport entre le chiffre global des morts volontaires et la population de tout âge et de tout sexe. Nous appellerons cette donnée numérique taux de la mortalité-suicide propre à la société considérée. On le calcule généralement par rapport à un million ou à cent mille habitants.
Non seulement ce taux est constant pendant de longues périodes de temps, mais l'invariabilité en est même plus grande que celle des principaux phénomènes démographiques. La mortalité générale, notamment, varie beaucoup plus souvent d'une année à l'autre et les variations par lesquelles elle passe sont beaucoup plus importantes. Pour s'en assurer, il suffit de comparer, pendant plusieurs périodes, la manière dont évoluent l'un et l'autre phénomène. C'est ce que nous avons fait au tableau II (V. ci-dessous). Pour faciliter le rapprochement, nous avons, tant pour les décès que pour les suicides, exprimé le taux de chaque année en fonction du taux moyen de la période, ramené à 100. Les écarts d'une année à l'autre ou par rapport au taux moyen sont ainsi rendus comparables dans les deux colonnes. Or, il résulte de cette comparaison qu'à chaque période l'ampleur des variations est beaucoup plus considérable du côté de la mortalité générale que du côté des suicides; elle est, en moyenne, deux fois plus grande. Seul, l'écart minimum entre deux années consécutives est sensiblement de même importance de part et d'autre pendant les deux dernières périodes. Seulement, ce minimum est une exception dans la colonne des décès, alors qu'au contraire les variations annuelles des suicides ne s'en écartent qu'exceptionnellement. On s'en aperçoit en comparant les écarts moyens[6].
Tableau II
Variations comparées du taux de la mortalité-suicide et du taux de la mortalité générale.
/* +——————————————————————————————————+ | A.—Chiffres absolus. | +——————————————————————————————————+ |PÉRIODE|SUICIDES|DÉCÈS|PÉRIODE|SUICIDES|DÉCÈS|PÉRIODE|SUICIDES|DÉCÈS| |1841-46|par |par |1849-55|par |par |1856-60|par |par | | |100.000 |1.000| |100.000 |1.000| |100.000 |1.000| | |hab. |hab. | |hab. |hab. | |hab. |hab. | +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | 1841 | 8,2 | 23,2| 1849 | 10,0 | 27,3| 1856 | 11,6 | 23,1| +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | 1842 | 8,3 | 24,0| 1850 | 10,1 | 21,4| 1857 | 10,9 | 23,7| +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | 1843 | 8,7 | 23,1| 1851 | 10,0 | 22,3| 1858 | 10,7 | 24,1| +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | 1844 | 8,5 | 22,1| 1852 | 10,5 | 22,5| 1859 | 11,1 | 26,8| +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | 1845 | 8,8 | 21,2| 1853 | 9,4 | 22,0| 1860 | 11,9 | 21,4| +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | 1846 | 8,7 | 23,2| 1854 | 10,2 | 27,4| | | | +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | | | | 1855 | 10,5 | 25,9| | | | +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | Moy. | 8,5 | 22,8| Moy. | 10,1 | 24,1| Moy. | 11,2 | 23,8| +——————————————————————————————————+ | B.—Taux de chaque année exprimé en fonction de la moyenne | | ramenée à 100. | +——————————————————————————————————+ | 1841 | 96 |101,7| 1849 | 98,9 |113,2| 1856 | 103,5 | 97 | +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | 1842 | 97 |105,2| 1850 | 100 | 88,7| 1857 | 97,3 | 99,3| +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | 1843 | 102 |101,3| 1851 | 98,9 | 92,5| 1858 | 95,5 |101,2| +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | 1844 | 100 | 96,9| 1852 | 103,8 | 93,3| 1859 | 99,1 |112,6| +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | 1845 | 103,5 | 92,9| 1853 | 93 | 91,2| 1860 | 106,0 | 89,9| +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | 1846 | 102,3 |101,7| 1854 | 100,9 |113,6| | | | +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | | | | 1855 | 103 |107,4| | | | +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | Moy. | 100 |100 | Moy. | 100 | 100| Moy. | 100 |100 | +——————————————————————————————————+ | C.—Grandeur de l'écart. | +——————————————————————————————————+ | | ENTRE DEUX ANNÉES |AU-DESSUS et au-dessous | | | consécutives. | de la moyenne. | +——————————————————————————————————+ | |Ecart |Ecart |Ecart | Maximum | Maximum | | |maximum|minimum|moyen | au-dessous.| au-dessus.| +——————————————————————————————————+ | PÉRIODE 1841-46. | +——————————————————————————————————+ |Mortalité générale| 8,8 | 2,5 | 4,9 | 7,1 | 4,0 | +—————————+———-+———-+————+——————+—————-+ |Taux des suicides | 5,0 | 1 | 2,5 | 4 | 2,8 | +—————————+———-+———-+————+——————+—————-+ | PÉRIODE 1849-55. | +—————————+———-+———-+————+——————+—————-+ |Mortalité générale| 24,5 | 0,8 | 10,6 | 13,6 | 11,3 | +—————————+———-+———-+————+——————+—————-+ |Taux des suicides | 10,8 | 1,1 | 4,48 | 3,8 | 7,0 | +—————————+———-+———-+————+——————+—————-+ | PÉRIODE 1856-60. | +—————————+———-+———-+————+——————+—————-+ |Mortalité générale| 22,7 | 1,9 | 9,57 | 12,6 | 10,1 | +—————————+———-+———-+————+——————+—————-+ |Taux des suicides | 6,9 | 1,8 | 4,82 | 6,0 | 4,5 | +——————————————————————————————————+ */
Il est vrai que, si l'on compare, non plus les années successives d'une même période, mais les moyennes de périodes différentes, les variations que l'on observe dans le taux de la mortalité deviennent presque insignifiantes. Les changements en sens contraires qui ont lieu d'une année à l'autre et qui sont dus à l'action de causes passagères et accidentelles, se neutralisent mutuellement quand on prend pour base du calcul une unité de temps plus étendue; ils disparaissent donc du chiffre moyen qui, par suite de cette élimination, présente une assez grande invariabilité. Ainsi, en France, de 1841 à 1870, il a été successivement pour chaque période décennale, 23,18; 23,72; 22,87. Mais d'abord, c'est déjà un fait remarquable que le suicide ait, d'une année à la suivante, un degré de constance au moins égal, sinon supérieur, à celui que la mortalité générale ne manifeste que de période à période. De plus, le taux moyen de la mortalité n'atteint à cette régularité qu'en devenant quelque chose de général et d'impersonnel qui ne peut servir que très imparfaitement à caractériser une société déterminée. En effet, il est sensiblement le même pour tous les peuples qui sont parvenus à peu près à la même civilisation; du moins, les différences sont très faibles. Ainsi, en France, comme nous venons de le voir, il oscille, de 1841 à 1870, autour de 23 décès pour 1.000 habitants; pendant le même temps, il a été successivement en Belgique de 23,93, de 22,5, de 24,04; en Angleterre de 22,32, de 22,21, de 22,68; en Danemark de 22,65 (1845-49), de 20,44 (1855-59), de 20,4 (1861-68). Si l'on fait abstraction de la Russie qui n'est encore européenne que géographiquement, les seuls grands pays d'Europe où la dîme mortuaire s'écarte d'une manière un peu marquée des chiffres précédents sont l'Italie où elle s'élevait encore de 1861 à 1867 jusqu'à 30,6 et l'Autriche où elle était plus considérable encore (32,52)[7]. Au contraire le taux des suicides, en même temps qu'il n'accuse que de faibles changements annuels, varie suivant les sociétés du simple au double, au triple, au quadruple et même davantage (V. Tableau III, ci-dessous). Il est donc, à un bien plus haut degré que le taux de la mortalité, personnel à chaque groupe social dont il peut être regardé comme un indice caractéristique. Il est même si étroitement lié à ce qu'il y a de plus profondément constitutionnel dans chaque tempérament national, que l'ordre dans lequel se classent, sous ce rapport, les différentes sociétés reste presque rigoureusement le même à des époques très différentes. C'est ce que prouve l'examen de ce même tableau. Au cours des trois périodes qui y sont comparées, le suicide s'est partout accru; mais, dans cette marche en avant, les divers peuples ont gardé leurs distances respectives. Chacun a son coefficient d'accélération qui lui est propre.
Tableau III
Taux des suicides par million d'habitants dans les différents pays d'Europe.
/* +————————-+———-+———-+———-+————+————+————+ | |PÉRIODE|1871-75|1874-78|NUMÉROS D'ORDRE À LA | | |1866-70| | |1e pér. |2e pér. |3e pér. | +————————-+———-+———-+———-+————+————+————+ |Italie | 30 | 35 | 38 | 1 | 1 | 1 | +————————-+———-+———-+———-+————+————+————+ |Belgique | 66 | 69 | 78 | 2 | 3 | 4 | +————————-+———-+———-+———-+————+————+————+ |Angleterre | 67 | 66 | 69 | 3 | 2 | 2 | +————————-+———-+———-+———-+————+————+————+ |Norwège | 76 | 73 | 71 | 4 | 4 | 3 | +————————-+———-+———-+———-+————+————+————+ |Autriche | 78 | 94 | 130 | 5 | 7 | 7 | +————————-+———-+———-+———-+————+————+————+ |Suède | 85 | 81 | 91 | 6 | 5 | 5 | +————————-+———-+———-+———-+————+————+————+ |Bavière | 90 | 91 | 100 | 7 | 6 | 6 | +————————-+———-+———-+———-+————+————+————+ |France | 135 | 150 | 160 | 8 | 9 | 9 | +————————-+———-+———-+———-+————+————+————+ |Prusse | 142 | 134 | 152 | 9 | 8 | 8 | +————————-+———-+———-+———-+————+————+————+ |Danemark | 277 | 258| 255 | 10 | 10 | 10 | +————————-+———-+———-+———-+————+————+————+ |Saxe | 293 | 267 | 334 | 11 | 11 | 11 | +——————————————————————————————————+ */
Le taux des suicides constitue donc un ordre de faits un et déterminé; c'est ce que démontrent, à la fois, sa permanence et sa variabilité. Car cette permanence serait inexplicable s'il ne tenait pas à un ensemble de caractères distinctifs, solidaires les uns des autres, qui, malgré la diversité des circonstances ambiantes, s'affirment simultanément; et cette variabilité témoigne de la nature individuelle et concrète de ces mêmes caractères, puisqu'ils varient comme l'individualité sociale elle-même. En somme, ce qu'expriment ces données statistiques, c'est la tendance au suicide dont chaque société est collectivement affligée. Nous n'avons pas à dire actuellement en quoi consiste cette tendance, si elle est un état sui generis de l'âme collective[8], ayant sa réalité propre, ou si elle ne représente qu'une somme d'états individuels. Bien que les considérations qui précèdent soient difficilement conciliables avec cette dernière hypothèse, nous réservons le problème qui sera traité au cours de cet ouvrage[9]. Quoi qu'on pense à ce sujet, toujours est-il que cette tendance existe soit à un titre soit à l'autre. Chaque société est prédisposée à fournir un contingent déterminé de morts volontaires. Cette prédisposition peut donc être l'objet d'une étude spéciale et qui ressortit à la sociologie. C'est cette étude que nous allons entreprendre.
Notre intention n'est donc pas de faire un inventaire aussi complet que possible de toutes les conditions qui peuvent entrer dans la genèse des suicides particuliers, mais seulement de rechercher celles dont dépend ce fait défini que nous avons appelé le taux social des suicides. On conçoit que les deux questions sont très distinctes, quelque rapport qu'il puisse, par ailleurs, y avoir entre elles. En effet, parmi les conditions individuelles, il y en a certainement beaucoup qui ne sont pas assez générales pour affecter le rapport entre le nombre total des morts volontaires et la population. Elles peuvent faire, peut-être, que tel ou tel individu isolé se tue, non que la société in globo ait pour le suicide un penchant plus ou moins intense. De même qu'elles ne tiennent pas à un certain état de l'organisation sociale, elles n'ont pas de contre-coups sociaux. Par suite, elles intéressent le psychologue, non le sociologue. Ce que recherche ce dernier, ce sont les causes par l'intermédiaire desquelles il est possible d'agir, non sur les individus isolément, mais sur le groupe. Par conséquent, parmi les facteurs des suicides, les seuls qui le concernent sont ceux qui font sentir leur action sur l'ensemble de la société. Le taux des suicides est le produit de ces facteurs. C'est pourquoi nous devons nous y tenir.
Tel est l'objet du présent travail qui comprendra trois parties.
Le phénomène qu'il s'agit d'expliquer ne peut être dû qu'à des causes extra-sociales d'une grande généralité ou à des causes proprement sociales. Nous nous demanderons d'abord quelle est l'influence des premières et nous verrons qu'elle est nulle ou très restreinte.
Nous déterminerons ensuite la nature des causes sociales, la manière dont elles produisent leurs effets, et leurs relations avec les états individuels qui accompagnent les différentes sortes de suicides.
Cela fait, nous serons mieux en état de préciser en quoi consiste l'élément social du suicide, c'est-à-dire cette tendance collective dont nous venons de parler, quels sont ses rapports avec les autres faits sociaux et par quels moyens il est possible d'agir sur elle[10].
LIVRE PREMIER
CHAPITRE I
Le suicide et les états psychopathiques[11].
Il y a deux sortes de causes extra-sociales auxquelles on peuta prioriattribuer une influence sur le taux des suicides: ce sont les dispositions organico-psychiques et la nature du milieu physique. Il pourrait se faire que, dans la constitution individuelle ou, tout au moins, dans la constitution d'une classe importante d'individus, il y eût un penchant, d'intensité variable selon les pays, et qui entraînât directement l'homme au suicide; d'un autre côté, le climat, la température, etc., pourraient, par la manière dont ils agissent sur l'organisme, avoir indirectement les mêmes effets. L'hypothèse, en tout cas, ne peut pas être écartée sans discussion. Nous allons donc examiner successivement ces deux ordres de facteurs et chercher s'ils ont, en effet, une part dans le phénomène que nous étudions et quelle elle est.
I.
Il est des maladies dont le taux annuel est relativement constant pour une société donnée, en même temps qu'il varie assez sensiblement suivant les peuples. Telle est la folie. Si donc on avait quelque raison de voir dans toute mort volontaire une manifestation vésanique, le problème que nous nous sommes posé serait résolu; le suicide ne serait qu'une affection individuelle[12].
C'est la thèse soutenue par d'assez nombreux aliénistes. Suivant Esquirol: «Le suicide offre tous les caractères des aliénations mentales[13]».—«L'homme n'attente à ses jours que lorsqu'il est dans le délire et les suicidés sont aliénés[14]». Partant de ce principe, il concluait que le suicide, étant involontaire, ne devait pas être puni par la loi. Falret[15] et Moreau de Tours s'expriment dans des termes presque identiques. Il est vrai que ce dernier, dans le passage même où il énonce la doctrine à laquelle il adhère, fait une remarque qui suffit à la rendre suspecte: «Le suicide, dit-il, doit-il être regardé dans tous les cas comme le résultat d'une aliénation mentale? Sans vouloir ici trancher cette difficile question, disons en thèse générale qu'instinctivement on penche d'autant plus vers l'affirmative que l'on a fait de la folie une étude plus approfondie, que l'on a acquis plus d'expérience et qu'enfin on a vu plus d'aliénés[16]». En 1845, le docteur Bourdin, dans une brochure qui, lors de son apparition, fit quelque bruit dans le monde médical, avait, avec moins de mesure encore, soutenu la même opinion.
Cette théorie peut être et a été défendue de deux manières différentes. Ou bien on dit que, par lui-même, le suicide constitue une entité morbidesui generis, une folie spéciale; ou bien, sans en faire une espèce distincte, on y voit simplement un épisode d'une ou de plusieurs sortes de folies, mais qui ne se rencontre pas chez les sujets sains d'esprit. La première thèse est celle de Bourdin; Esquirol, au contraire, est le représentant le plus autorisé de l'autre conception. «D'après ce qui précède, dit-il, on entrevoit déjà que le suicide n'est pour nous qu'un phénomène consécutif à un grand nombre de causes diverses, qu'il se montre avec des caractères très différents; que ce phénomène ne peut caractériser une maladie. C'est pour avoir fait du suicide une maladiesui generisqu'on a établi des propositions générales démenties par l'expérience[17]».
De ces deux façons de démontrer le caractère vésanique du suicide, la seconde est la moins rigoureuse et la moins probante en vertu de ce principe qu'il ne peut y avoir d'expériences négatives. Il est impossible, en effet, de procéder à un inventaire complet de tous les cas de suicides et de faire voir dans chacun d'eux l'influence de l'aliénation mentale. On ne peut que citer des exemples particuliers qui, si nombreux qu'ils soient, ne peuvent servir de base à une généralisation scientifique; quand même des exemples contraires ne seraient pas allégués, il y en aurait toujours de possibles. Mais l'autre preuve, si elle peut être administrée, serait concluante. Si l'on parvient à établir que le suicide est une folie qui a ses caractères propres et son évolution distincte, la question est tranchée; tout suicidé est un fou.
Mais existe-t-il une folie-suicide?
II.
La tendance au suicide étant, par nature, spéciale et définie, si elle constitue une variété de la folie, ce ne peut être qu'une folie partielle et limitée à un seul acte. Pour qu'elle puisse caractériser un délire, il faut qu'il porte uniquement sur ce seul objet; car s'il en avait de multiples, il n'y aurait pas de raison pour le définir par l'un d'eux plutôt que par les autres. Dans la terminologie traditionnelle de la pathologie mentale, on appelle monomanies ces délires restreints. Le monomane est un malade dont la conscience est parfaitement saine, sauf en un point; il ne présente qu'une tare et nettement localisée. Par exemple, il a par moments une envie irraisonnée et absurde de boire ou de voler ou d'injurier; mais tous ses autres actes comme toutes ses autres pensées sont d'une rigoureuse correction. Si donc il y a une folie-suicide, elle ne peut être qu'une monomanie et c'est bien ainsi qu'on l'a le plus souvent qualifiée[18].
Inversement, on s'explique que, si l'on admet ce genre particulier de maladies appelées monomanies, on ait été facilement induit à y faire rentrer le suicide. Ce qui caractérise, en effet, ces sortes d'affections, d'après la définition même que nous venons de rappeler, c'est qu'elles n'impliquent pas de troubles essentiels dans le fonctionnement intellectuel. Le fond de la vie mentale est le même chez le monomane et chez l'homme sain d'esprit; seulement, chez le premier, un état psychique déterminé se détache de ce fond commun par un relief exceptionnel. La monomanie, en effet, c'est simplement, dans l'ordre des tendances, une passion exagérée et, dans l'ordre des représentations, une idée fausse, mais d'une telle intensité qu'elle obsède l'esprit et lui enlève toute liberté. Par exemple, de normale, l'ambition devient maladive et se change en monomanie des grandeurs quand elle prend des proportions telles que toutes les autres fonctions cérébrales en sont comme paralysées. Il suffit donc qu'un mouvement un peu violent de la sensibilité vienne troubler l'équilibre mental pour que la monomanie apparaisse. Or, il semble bien que les suicides sont généralement placés sous l'influence de quelque passion anormale, que celle-ci épuise son énergie d'un seul coup ou ne la développe qu'à la longue; on peut même croire avec une apparence de raison qu'il faut toujours quelque force de ce genre pour neutraliser l'instinct, si fondamental, de conservation. D'autre part, beaucoup de suicidés, en dehors de l'acte spécial par lequel ils mettent fin à leurs jours, ne se singularisent aucunement des autres hommes; il n'y a, par conséquent, pas de raison pour leur imputer un délire général. Voilà comment, sous le couvert de la monomanie, le suicide a été mis au rang des vésanies.
Seulement, y a-t-il des monomanies? Pendant longtemps, leur existence n'a pas été mise en doute; l'unanimité des aliénistes admettait, sans discussion, la théorie des délires partiels. Non seulement on la croyait démontrée par l'observation clinique, mais on la présentait comme un corollaire des enseignements de la psychologie. On professait alors que l'esprit humain est formé de facultés distinctes et de forces séparées qui coopèrent d'ordinaire, mais sont susceptibles d'agir isolément; il semblait donc naturel qu'elles pussent être séparément touchées par la maladie. Puisque l'homme peut manifester de l'intelligence sans volonté et de la sensibilité sans intelligence, pourquoi ne pourrait-il pas y avoir des maladies de l'intelligence ou de la volonté sans troubles de la sensibilité etvice versa? En appliquant le même principe aux formes plus spéciales de ces facultés, on en arrivait à admettre que la lésion pouvait porter exclusivement sur une tendance, sur une action ou sur une idée isolée.
Mais, aujourd'hui, cette opinion est universellement abandonnée. Assurément, on ne peut pas directement démontrer par l'observation qu'il n'y a pas de monomanies; mais il est établi qu'on n'en peut pas citer un seul exemple incontesté. Jamais l'expérience clinique n'a pu atteindre une tendance maladive de l'esprit dans un état de véritable isolement; toutes les fois qu'une faculté est lésée, les autres le sont en même temps et, si les partisans de la monomanie n'ont pas aperçu ces lésions concomitantes, c'est qu'ils ont mal dirigé leurs observations. «Prenons pour exemple, dit Falret, un aliéné préoccupé d'idées religieuses et que l'on classerait parmi les monomanes religieux. Il se dit inspiré de Dieu; chargé d'une mission divine, il apporte au monde une nouvelle religion… Cette idée, direz-vous, est tout à fait folle, mais, en dehors de cette série d'idées religieuses, il raisonne comme les autres hommes. Eh bien! interrogez-le avec plus de soin et vous ne tarderez pas à découvrir chez lui d'autres idées maladives; vous trouverez, par exemple, parallèlement aux idées religieuses, une tendance orgueilleuse. Il ne se croira pas seulement appelé à réformer la religion, mais à réformer la société; peut-être aussi s'imaginera-t-il être réservé à la plus haute destinée… Admettons qu'après avoir recherché chez ce malade des tendances orgueilleuses, vous ne les ayez pas découvertes, alors vous constaterez des idées d'humilité ou des tendances craintives. Le malade, préoccupé d'idées religieuses, se croira perdu, destiné à périr, etc.[19]». Sans doute, tous ces délires ne se rencontrent pas habituellement réunis chez un même sujet, mais ce sont ceux que l'on trouve le plus souvent ensemble; ou bien, s'ils ne coexistent pas à un seul et même moment de la maladie, on les voit se succéder à des phases plus ou moins rapprochées.
Enfin, indépendamment de ces manifestations particulières, il y a toujours chez les prétendus monomanes un état général de toute la vie mentale qui est le fond même de la maladie et dont ces idées délirantes ne sont que l'expression superficielle et temporaire. Ce qui le constitue, c'est une exaltation excessive ou une dépression extrême, ou une perversion générale. Il y a surtout absence d'équilibre et de coordination dans la pensée comme dans l'action. Le malade raisonne, et cependant ses idées ne s'enchaînent pas sans lacunes; il ne se conduit pas d'une manière absurde, mais sa conduite manque de suite. Il n'est donc pas exact de dire que la folie puisse se faire sa part, et une part restreinte; dès qu'elle pénètre l'entendement, elle l'envahit tout entier.
D'ailleurs, le principe sur lequel on appuyait l'hypothèse des monomanies est en contradiction avec les données actuelles de la science. L'ancienne théorie des facultés ne compte plus guère de défenseurs. On ne voit plus dans les différents modes de l'activité consciente des forces séparées qui ne se rejoignent et ne retrouvent leur unité qu'au sein d'une substance métaphysique, mais des fonctions solidaires; il est donc impossible que l'une soit lésée sans que cette lésion retentisse sur les autres. Cette pénétration est même plus intime dans la vie cérébrale que dans le reste de l'organisme: car les fonctions psychiques n'ont pas des organes assez distincts les uns des autres pour que l'un puisse être atteint sans que les autres le soient. Leur répartition entre les différentes régions de l'encéphale n'a rien de bien défini, comme le prouve la facilité avec laquelle les différentes parties du cerveau se remplacent mutuellement, si l'une d'elles se trouve empêchée de remplir sa tâche. Leur enchevêtrement est donc trop complet pour que la folie puisse frapper les unes en laissant les autres intactes. À plus forte raison, est-il tout à fait impossible qu'elle puisse altérer une idée ou un sentiment particulier sans que la vie psychique soit altérée dans sa racine. Car les représentations et les tendances n'ont pas d'existence propre; elles ne sont pas autant de petites substances, d'atomes spirituels qui, en s'agrégeant, forment l'esprit. Mais elles ne font que manifester extérieurement l'état général des centres conscients; elles en dérivent et elles l'expriment. Par conséquent, elles ne peuvent avoir de caractère morbide sans que cet état soit lui-même vicié.
Mais si les tares mentales ne sont pas susceptibles de se localiser, il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de monomanies proprement dites. Les troubles, en apparence locaux, que l'on a appelés de ce nom résultent toujours d'une perturbation plus étendue; ils sont, non des maladies, mais des accidents particuliers et secondaires de maladies plus générales. Si donc il n'y a pas de monomanies, il ne saurait y avoir une monomanie-suicide et, par conséquent, le suicide n'est pas une folie distincte.
III.
Mais il reste possible qu'il n'ait lieu qu'à l'état de folie. Si, par lui-même, il n'est pas une vésanie spéciale, il n'est pas de forme de la vésanie où il ne puisse apparaître. Ce n'en est qu'un syndrome épisodique, mais qui est fréquent. Peut-on conclure de cette fréquence qu'il ne se produit jamais à l'état de santé et qu'il est un indice certain d'aliénation mentale?
La conclusion serait précipitée. Car si, parmi les actes des aliénés, il en est qui leur sont propres, et qui peuvent servir à caractériser la folie, d'autres, au contraire, leur sont communs avec les hommes sains, tout en revêtant chez les fous une forme spéciale.A priori, il n'y a pas de raison pour classer le suicide dans la première de ces deux catégories. Sans doute, les aliénistes affirment que la plupart des suicidés qu'ils ont connus présentaient tous les signes de l'aliénation mentale, mais ce témoignage ne saurait suffire à résoudre la question; car de pareilles revues sont beaucoup trop sommaires. D'ailleurs, d'une expérience aussi étroitement spéciale, on ne saurait induire aucune loi générale. Des suicidés qu'ils ont connus et qui, naturellement, étaient des aliénés, on ne peut conclure à ceux qu'ils n'ont pas observés et qui, pourtant, sont les plus nombreux.
La seule manière de procéder méthodiquement consiste à classer, d'après leurs propriétés essentielles, les suicides commis par les fous, de constituer ainsi les types principaux de suicides vésaniques et de chercher si tous les cas de morts volontaires rentrent dans ces cadres nosologiques. En d'autres termes, pour savoir si le suicide est un acte spécial aux aliénés, il faut déterminer les formes qu'il prend dans l'aliénation mentale et voir ensuite si ce sont les seules qu'il affecte.
Les spécialistes se sont peu attachés, en général, à classer les suicides d'aliénés. On peut cependant considérer que les quatre types suivants renferment les espèces les plus importantes. Les traits essentiels de cette classification sont empruntés à Jousset et à Moreau de Tours[20].
I.Suicide maniaque.—Il est dû soit à des hallucinations, soit à des conceptions délirantes. Le malade se tue pour échapper à un danger ou à une honte imaginaires, ou pour obéir à un ordre mystérieux qu'il a reçu d'en haut, etc.[21]. Mais les motifs de ce suicide et son mode d'évolution reflètent les caractères généraux de la maladie dont il dérive, à savoir la manie. Ce qui distingue cette affection, c'est son extrême mobilité. Les idées, les sentiments les plus divers et même les plus contradictoires se succèdent avec une extraordinaire vitesse dans l'esprit des maniaques. C'est un perpétuel tourbillon. À peine un état de conscience est-il né qu'il est remplacé par un autre. Il en est de même des mobiles qui déterminent le suicide maniaque: ils naissent, disparaissent ou se transforment avec une étonnante rapidité. Tout à coup, l'hallucination ou le délire qui décident le sujet à se détruire apparaissent; la tentative de suicide en résulte; puis, en un instant, la scène change et, si l'essai avorte, il n'est pas repris, du moins pour le moment. S'il se reproduit plus tard, ce sera pour un autre motif. L'incident le plus insignifiant peut amener de ces brusques transformations. Un malade de ce genre, voulant mettre fin à ses jours, s'était jeté dans une rivière généralement peu profonde. Il était à chercher un endroit où la submersion fût possible, lorsqu'un douanier, soupçonnant son dessein, le couche en joue et menace de faire feu de son fusil s'il ne sort pas de l'eau. Aussitôt, notre homme s'en retourne paisiblement chez lui, ne songeant plus à se tuer[22].
II.Suicide mélancolique.—Il est lié à un état général d'extrême dépression, de tristesse exagérée qui fait que le malade n'apprécie plus sainement les rapports qu'ont avec lui les personnes et les choses qui l'entourent. Les plaisirs n'ont pour lui aucun attrait; il voit tout en noir. La vie lui semble ennuyeuse ou douloureuse. Comme ces dispositions sont constantes, il en est de même des idées de suicide; elles sont douées d'une grande fixité et les motifs généraux qui les déterminent sont toujours sensiblement les mêmes. Une jeune fille, née de parents sains, après avoir passé son enfance à la campagne, est obligée de s'en éloigner vers l'âge de quatorze ans pour compléter son éducation. Dès ce moment, elle conçoit un ennui inexprimable, un goût prononcé pour la solitude, bientôt un désir de mourir que rien ne peut dissiper. «Elle reste, pendant des heures entières, immobile, les yeux fixés sur la terre, la poitrine oppressée et dans l'état d'une personne qui redoute un événement sinistre. Dans la ferme résolution de se précipiter dans la rivière, elle recherche les lieux les plus écartés afin que personne ne puisse venir à son secours[23]». Cependant, comprenant mieux que l'acte qu'elle médite est un crime, elle y renonce pour un temps. Mais, au bout d'un an, le penchant au suicide revient avec plus de force et les tentatives se répètent à peu de distance l'une de l'autre.
Souvent, sur ce désespoir général, viennent se greffer des hallucinations et des idées délirantes qui mènent directement au suicide. Seulement, elles ne sont pas mobiles comme celles que nous observions tout à l'heure chez les maniaques. Elles sont fixes, au contraire, comme l'état général dont elles dérivent. Les craintes qui hantent le sujet, les reproches qu'il se fait, les chagrins qu'il ressent sont toujours les mêmes. Si donc ce suicide est déterminé par des raisons imaginaires tout comme le précédent, il s'en distingue par son caractère chronique. Aussi est-il très tenace. Les malades de cette catégorie préparent avec calme leurs moyens d'exécution; ils déploient même dans la poursuite de leur but une persévérance et, parfois, une astuce incroyables. Rien ne ressemble moins à cet esprit de suite que la perpétuelle instabilité du maniaque. Chez l'un, il n'y a que des bouffées passagères, sans causes durables, tandis que, chez l'autre, il y a un état constant qui est lié au caractère général du sujet.
III.Suicide obsessif.—Dans ce cas, le suicide n'est causé par aucun motif, ni réel ni imaginaire, mais seulement par l'idée fixe de la mort qui, sans raison représentable, s'est emparée souverainement de l'esprit du malade. Celui-ci est obsédé par le désir de se tuer, quoiqu'il sache parfaitement qu'il n'a aucun motif raisonnable de le faire. C'est un besoin instinctif sur lequel la réflexion et le raisonnement n'ont pas d'empire, analogue à ces besoins de voler, de tuer, d'incendier dont on a voulu faire autant de monomanies. Comme le sujet se rend compte du caractère absurde de son envie, il essaie d'abord de lutter. Mais tout le temps que dure cette résistance, il est triste, oppressé et ressent au creux épigastrique une anxiété qui augmente chaque jour. Pour cette raison, on a quelquefois donné à ce genre de suicide le nom desuicide anxieux. Voici la confession qu'un malade vint faire un jour à Brierre de Boismont et où cet état est parfaitement décrit: «Employé dans une maison de commerce, je m'acquitte convenablement des devoirs de ma profession, mais j'agis comme un automate et, lorsqu'on m'adresse la parole, elle me semble résonner dans le vide. Mon plus grand tourment provient de la pensée du suicide dont il m'est impossible de m'affranchir un instant. Il y a un an que je suis en butte à cette impulsion; elle était d'abord peu prononcée; depuis deux mois environ, elle, me poursuit en tous lieux,je n'ai cependant aucun motif de me donner la mort… Ma santé est bonne; personne dans ma famille n'a eu d'affection semblable; je n'ai pas fait de pertes, mes appointements me suffisent et me permettent les plaisirs de mon âge[24]». Mais dès que le malade a pris le parti de renoncer à la lutte, dès qu'il est résolu à se tuer, cette anxiété cesse et le calme revient. Si la tentative avorte, elle suffit parfois, quoique manquée, à apaiser pour un temps ce désir maladif. On dirait que le sujet a passé son envie.
IV.Suicide impulsif ou automatique.—Il n'est pas plus motivé que le précédent; il n'a aucune raison d'être ni dans la réalité ni dans l'imagination du malade. Seulement, au lieu d'être produit par une idée fixe qui poursuit l'esprit pendant un temps plus ou moins long et qui ne s'empare que progressivement de la volonté, il résulte d'une impulsion brusque et immédiatement irrésistible. En un clin d'œil, elle surgit toute développée et suscite l'acte ou, tout au moins, un commencement d'exécution. Cette soudaineté rappelle ce que nous avons observé plus haut dans la manie; seulement le suicide maniaque a toujours quelque raison, quoique déraisonnable. Il tient aux conceptions délirantes du sujet. Ici, au contraire, le penchant au suicide éclate et produit ses effets avec un véritable automatisme sans être précédé par aucun antécédent intellectuel. La vue d'un couteau, la promenade sur le bord d'un précipice etc., font naître instantanément l'idée du suicide et l'acte suit avec une telle rapidité que, souvent, les malades n'ont pas conscience de ce qui s'est passé. «Un homme cause tranquillement avec ses amis; tout à coup, il s'élance, franchit un parapet et tombe dans l'eau. Retiré aussitôt, on lui demande les motifs de sa conduite; il n'en sait rien, il a cédé à une force qui l'a entraîné malgré lui[25]». «Ce qu'il y a de singulier, dit un autre, c'est qu'il m'est impossible de me rappeler la manière dont j'ai escaladé la croisée et quelle était l'idée qui me dominait alors; car je n'avais nullement l'idée de me donner la mort ou, du moins, je n'ai pas aujourd'hui le souvenir d'une telle pensée[26]». À un moindre degré, les malades sentent l'impulsion naître et ils réussissent à échapper à la fascination qu'exerce sur eux l'instrument de mort, en le fuyant immédiatement.