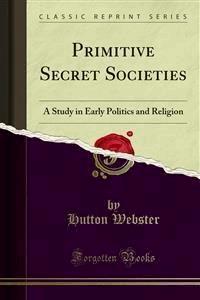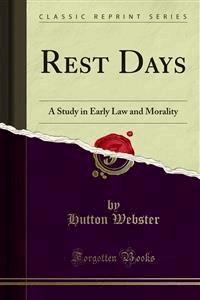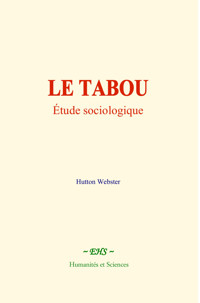
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Ce livre propose une étude du tabou, son origine, sa nature, ses aspects sociaux et économiques.
La langue anglaise a donné accès au mot taboo (en polynésien : tabu) depuis l'apparition du prestigieux récit où le capitaine Cook retrace son troisième et dernier voyage à travers le monde insulaire de l'océan Pacifique… Il ne semble pas impossible de combler une lacune dans le domaine de l'anthropologie sociale, en donnant un exposé approfondi du tabou, considéré comme un phénomène largement répandu dans le monde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 861
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Tabou
LE TABOU
Étude sociologique
PRÉFACE
La langue anglaise a donné accès au mot taboo (en polynésien : tabu) depuis l'apparition du prestigieux récit où le capitaine Cook retrace son troisième et dernier voyage à travers le monde insulaire de l'océan Pacifique. En 1888, James George Frazer, dans la neuvième édition de l'Encyclopœdia britannica, consacra un bref article à traiter du système du tabou, observé spécialement en Polynésie, son terrain d'élection par excellence. Depuis lors, Frazer lui-même et d'autres chercheurs, spécialisés dans l'étude de la magie et de la religion primitives, ont apporté à notre connaissance de ce sujet de notables contributions. Actuellement donc, il ne semble pas impossible de combler une lacune dans le domaine de l'anthropologie sociale, en donnant un exposé approfondi du tabou, considéré comme un phénomène largement répandu en ce monde.
Le présent ouvrage réunit une vaste documentation, sûre et digne de foi. Mais il ne saurait aucunement prétendre à revêtir un caractère exhaustif. En effet, c'est toute une encyclopédie qu'il faudrait élaborer pour présenter dans leur intégrité les matériaux recueillis à ce jour parmi les peuples primitifs ou antérieurs à la culture. A fortiori, combien de gros volumes ne seraient-ils pas nécessaires, si l'investigation s'étendait aux peuples de civilisation archaïque ! En vue de guider le lecteur qui voudrait consulter des sources d'information plus amples, je me réfère régulièrement, pour chacun de mes chapitres successifs, à d'autres ouvrages qui ont collectionné et décrit divers tabous particuliers.
Pour entreprendre une enquête de ce genre, on peut suivre des directions variées. Du point de vue de l'ethnographie, c'est la diffusion des tabous qu'on s'attachera à retracer. Historiquement, on cherche à préciser ce que furent, entre différents peuples, les contacts susceptibles d'expliquer cette diffusion. Le psychologue, pour sa part, tente de définir dans leurs multiples ramifications les idées sous-jacentes au système du tabou. Je ne me suis pas entièrement abstenu de mettre à contribution ces divers moyens d'aborder le sujet, mais j'ai principalement voulu montrer, ou essayer de montrer, quelle place importante revient aux tabous dans l'évolution culturelle du genre humain.
Les tabous constituent une série spécifique d'interdictions : « Tu [6]{1} ne dois pas... » Il ne faut pas les confondre (comme fait l'usage populaire) avec des conventions et réglementations d'ordre négatif, sans utilité patente. Les tabous doivent être distingués de certaines restrictions qui procèdent d'une vague notion de la mauvaise fortune inhérente à tels ou tels, objets ou temps ; ces restrictions-là se rencontrent dans les sociétés de culture encore inférieure, mais sous une forme atténuée des survivances en ont persisté dans nos propres milieux. Remarque plus importante encore : si l'on veut que la notion de tabou possède quelque valeur scientifique et prenne décidément place dans la théorie ethnologique, il importe de ne lui assimiler en rien d'innombrables prohibitions de caractère à la fois animiste et non animiste. Les tabous sont des prohibitions dont la violation produit automatiquement chez le délinquant un état d'impuissance rituelle - « maladie du tabou » -, et de cet effet fatal on n'est libéré, dans le cas où cela n'est pas impossible, que par une cérémonie de purification. Telle est la définition à laquelle je me suis résolument arrêté.
Inconnues sont l'origine et l'ancienneté de la plupart des coutumes ici considérées. Beaucoup d'entre elles, particulièrement celles qui concernent la reproduction, la mort et les défunts, remontent incontestablement à une antiquité très reculée, à l'enfance même de notre espèce. Bien que le caprice et l'absurdité s'y donnent souvent libre carrière, ainsi que, parfois, le dérèglement et la cruauté, elles n'en restent pas moins la plus impérieuse, des observances primitives, celle à laquelle le sauvage obéit de la manière la plus implicite. Les étudier, c'est acquérir quelque compréhension de l'évolution sociale à travers d'innombrables siècles ; c'est ouvrir un jour sur les ténèbres du lointain passé.
Chapitre I
La nature du tabou
Le type du libre sauvage, sans entrave aucune, sans inhibition, tel qu'aimaient à le décrire les écrivains romantiques du XIXe siècle, n'a pas plus de consistance que l'âge d'or lui-même : pure fiction. On doit reconnaître, bien plutôt, que tout sauvage est lié, pieds et mains, par la coutume ; il subit, en particulier, la contrainte de la coutume négative. Du berceau à la tombe il est pris dans les rets des prohibitions : « Tu ne dois pas... » Il lui est absolument interdit d'entretenir en soi une pensée, d'exprimer un sentiment, d'accomplir une action allant dans le sens opposé à celui de la volonté général. Comment dire l'extrême lenteur avec laquelle, où que ce soit, fut obtenue la réalisation de quelque indépendance personnelle ! Combien de reculs sont venus la contrarier et en interrompre la marche, qu'il s'agisse de la liberté de penser, de sentir ou d'agir pour soi-même et non pour la masse du troupeau !
Le juriste anglais John Austin, en développant des vues qui remontent en dernière analyse à un philosophe du XVIIe siècle, Thomas Hobbes, nous a familiarisés avec la conception de la loi, règle prescrite par le souverain à ses sujets, sans qu'il y ait lieu de distinguer si le souverain est un individu unique à qui l'on obéit, ou un groupe d'hommes possédant le pouvoir suprême. Cette notion d'une loi « positive » ne s'applique naturellement pas aux sociétés incultes ; là, les coutumes qui exercent leur empire constituent des réponses aux besoins de la communauté plutôt que des ordres arbitrairement imposés par quelque autorité supérieure. Le groupe, ou au moins l'ensemble de ceux de ses membres qui y occupent une position dominante, réagit favorablement ou défavorablement envers certains modes de conduite, qui, en conséquence, sont dès lors approuvés ou désapprouvés. Cela aboutit à la formation de certaines normes appliquées à la croyance et à la conduite. S'en écarter si peu que ce soit entraînera désormais un certain degré de réprobation, alors que les crimes les plus graves, par exemple la sorcellerie ou l'inceste, seront souvent punis soit directement par une sorte de « loi de lynch », soit indirectementpardes autorités judiciaires reconnues. Ce sont des sanctions sociales.
Il en existe aussi qui sont extrasociales. Quelqu'un transgresse-t-il des usages établis, on supposera souvent qu'il enflamme la colère de tels ou tels êtres spirituels, et que, faute d'avoir fait expiation, il subit de leur part quelquechâtiment dans ce monde ou dans l'autre. Les prohibitions qui procèdent de ce genre personnel de sanction présentent un caractère animiste. Le de cujus peut aussi être supposé appeler sur soi certain châtiment inévitable, sous la forme de maux inextricablement liés à l'infraction, tout comme, dans le monde physique, le feu brûle, l'eau mouille, le poison tue. Pareille explication est susceptible de rendre compte d'innombrables restrictions concernant certains aliments : à Madagascar, un soldat ne mangera pas un morceau de genou de bœuf, de peur de devenir faible des genoux comme un bœuf et inapte à la marche rapide ; il s'abstiendra également de consommer des rognons, parce qu'en malgache le même mot désigne le rein et le fait d'être abattu par une arme à feu ; si donc il absorbait le morceau de choix en question, il se verrait coucher en joue et tuer. Dans de pareilles restrictions, impossible de trouver la moindre trace d'une action punitive exercée par un agent, quel qu'il soit ; c'est le fait même de commettre l'acte prohibé qui déclenche la sanction, la peine. A nos yeux, la connexion causale entre l'infraction et ce qui la suit est imaginaire ; pour le sauvage, elle est aussi réelle que les êtres spirituels dont la présence et l'activité ne soulèvent à ses yeux pas le moindre doute. Pour caractériser des prohibitions ainsi pourvues d'une sanction tout impersonnelle, on dira qu'elles sont de nature sympathique ; elles impliquent, en effet, que les choses présentant entre elles quelque ressemblance ou analogie peuvent agir l'une sur l'autre à distance, de par une secrète sympathie. En dernière analyse, ce sont des prohibitions tout aussi impersonnelles que leur sanction, mais procédant de la croyance qui veut que de leur infraction résulte automatiquement pour le coupable une position des plus graves, car il devient « taboué », il est placé dans un « état tabou » ; or, cette condition n'est autre que l'impuissance rituelle, dangereuse pour lui-même et souvent aussi pour autrui. Excepté le cas où il en serait relevé, affranchi, par des mesures appropriées - mais qui ne sont pas toujours efficaces - la mauvaise fortune tombera lourdement sur lui et risquera de frapper aussi les siens. Ce mal à venir, on se le représente parfois sous la forme de la maladie ou même de la mort, mais, en d'autres cas, on ne l'imagine que vaguement. Quelles que soient les conséquences de l'infraction, il y a accord unanime sur leur réalité et sur la possibilité de leur caractère effroyable. Seules les prohibitions de cette nature peuvent être décrites comme étant des tabous.
« Taboo », tabou, du polynésien tabu, est l'un des rares vocables que les langues modernes doivent aux idiomes des insulaires de l'océan Pacifique. En anglais, on l'emploie aussi bien comme adjectif ou participe que comme substantif ; on en a même fait un verbe : un « taboo » est une prohibition ; un objet « taboo » ou « tabooed » est un objet frappé d'une prohibition ; « to taboo », c'est soumettre quelque chose à une prohibition. Le mot polynésien, quant à lui, reste toujours un adjectif : les formes substantive et verbale s'expriment par des mots et des phrases dérivés. Tabu semble être proprement le terme usité dans les îles Tonga ; on trouve tapu à Samoa, aux îles Marquises, dans l'archipel de la Société et en Nouvelle-Zélande ; kapu serait l'expression hawaïenne{2}. On a supposé que tapu dérive de ta, marquer, et de pu, adverbe de portée intensifiante. « Cela étant, le mot composé tapu ne signifie pas autre chose que « marquer complètement » ; il n'en vint à vouloir dire sacré, ou prohibé, qu'en un sens secondaire, parce que choses et emplacements sacrés sont communément marqués d'une manière particulière, afin que chacun puisse reconnaître qu'ils sont sacrés. » D'après une autre étymologie, tapu viendrait du nom de la conque-trompette, pu, et de ta, qui peut signifier frapper, aussi bien que marquer, et qu'on emploie également comme préfixe causatif. Anciennement, lorsqu'un chef annonçait une restriction cérémonielle en soufflant dans la conque qui lui servait de trompette, cette pratique aura pu être décrite par le mot composé ta-pu. Nous ne saurions retenir ni ces dérivations ni d'autres qui leur sont analogues, car le mot tapu ou tabu, avec les coutumes et croyances qu'il désigne, se laisse amplement suivre à la trace à travers l'ensemble du monde océanien.
Comme mot anglais, « taboo » a dû son expansion au capitaine Cook, qui l'emploie dans la relation de son troisième et dernier voyage autour du monde. Il aborda aux Tonga ou îles des Amis en 1777 ; à Tongatabu il s'entretint, à bord de son vaisseau, avec plusieurs chefs, tant supérieurs que subalternes. Quand on servit le dîner, aucun d'entre eux n'accepta de s'asseoir, aucun ne voulut manger quoi que ce fût des mets qu'on présentait. « J'exprimai la surprise que cela me causait ; ils dirent alors qu'ils étaient tous taboo (ce mot, de sens très compréhensif, signifie en général qu'une chose est prohibée) » Quelque temps après, Cook observa que, dans un groupe de gens qui prenaient leur repas, deux femmes recevaient la nourriture des mains d'autrui, et il apprit que ces femmes étaient taboo mattee. Il semble que, deux mois auparavant, l'une d'elles [14] avait lavé le cadavre d'un chef, et qu'en conséquence elle était astreinte à ne toucher aucun aliment durant cinq mois. L'autre femme, ayant rempli le même office envers la dépouille mortelle d'une personne de rang inférieur, subissait une prohibition analogue, mais pour une durée moins longue. Durant son séjour à Tongatabu, le célèbre voyageur eut l'heureuse fortune de se trouver présent à une certaine cérémonie qui s'accomplissait en l'honneur du fils du roi. Le roi lui-même demanda expressément à Cook de n'autoriser aucun de ses marins à quitter leur bord, « car, disait il, comme toutes choses allaient sous peu devenir taboo, si quelqu'un de notre peuple ou du leur venait à marcher à proximité (de ces choses), il serait frappé de verges ; que dis-je, il serait mateed, ce qui signifie tué ». Aucun indigène ne daignerait ou n'oserait divulguer la moindre information concernant la signification de la cérémonie. « Nos enquêtes reçurent rarement une réponse autre que : taboo, mot qui, je l'ai déjà noté, s'applique à maintes choses des plus diverses. »
On appelait les sacrifices humains tangata taboo, « et, quand il est interdit de manger quelque chose ou de s'en servir, ils disent que la chose est taboo ». Plustard, Cook trouva ce mot en usage dans les îles de la Société (Tahiti), mais, là, on l'appliquait uniquement à l'individu consacré et offert en sacrifice. Même rencontre aux îles Sandwich, où il semblait que fussent très strictement observés des règlements négatifs de tel ou tel genre, car c'était avec une grande insistance et en manifestant la crainte de commettre une infraction que les gens demandaient toujours si la chose particulière, quelle qu'elle fût, qu'ils désiraient voir ou que, sans le vouloir, nous pouvions montrer était taboo, ou, suivant leur prononciation, tafoo.
Le capitaine James King, qui prit le commandement de l'expédition en 1779, après la mort de Cook, et qui continua à rédiger la relation du voyage, fait, lui aussi, allusion au tabou chez les insulaires des Sandwich. Il note que le mot pouvait être appliqué aussi bien à des choses qu'à des personnes, et qu'on l'employait également pour désigner quelque chose de « sacré, ou d'éminent, ou de dévoué (au sens littéral de ce terme) ». King fut frappé de constater « l'obéissance on ne peut plus implicite et scrupuleuse » des indigènes à l'endroit des prohibitions qu'ils subissaient, mais il ne parvint pas à déterminer si cela procédait d'un principe religieux quelconque, ou simplement de la déférence envers l'autorité civile de leurs chefs. Cependant, il décrit ailleurs le tabou comme une sorte d' « interdiction religieuse ».
À Cook et aux autres navigateurs célèbres qui nous ouvrirent le monde océanien, ont bientôt succédé les missionnaires. En 1795, [15] la société des missions de Londres fut fondée « pour répandre la lumière de la vérité divine sur les régions enténébrées de la terre ». Parmi ses envoyés dans les mers du Sud, l'un des mieux qualifiés et l'un de ceux qui rendirent les plus grands services s'appelait William Ellis. Il passa huit années (1816-1824) aux îles de la Société et aux îles Sandwich ou Hawaï ; de retour en Angleterre, il publia en 1829 ses Polynesian researches, ouvrage considérable, dont la valeur n'a pas cessé de faire ses preuves jusqu'à ce jour.
Ce qu'Ellis relate du tabu polynésien concerne en particulier le groupe hawaïen.
« Dans la plupart des dialectes polynésiens, le sens usuel du mot tabu est « sacré ». Cependant, il n'implique aucune qualité morale ; ce qu'il exprime, c'est une connexion avec les dieux, ou une séparation d'avec les propos ordinaires exclusivement applicables à des personnes ou des choses considérées comme sacrées ; quelquefois il signifie : dévoué comme par un vœu. Les chefs qui font remonter leur généalogie aux dieux sont appelés arii tabu, chefs sacrés, à cause de leur affinité supposée avec les divinités ; on nommera de même un sanctuaire wahi tabu, lieu sacré, parce que dévoué exclusivement à la résidence et à l'adoration des dieux. Le mot est distinct de cet autre : rahui, prohiber, et il s'oppose à noa, qui signifie général ou commun... Tel semble bien être le sens exact du mot tabu, encore que les indigènes, quand ils parlent à des étrangers, en généralisent davantage l'emploi, car alors ils l'appliquent à toute espèce de chose prohibée ou impropre{3}.
« Bien qu'on en parle aussi à propos de sujets dépourvus de caractère sacré, le tabu était une cérémonie entièrement religieuse, et il ne pouvait être imposé que par les prêtres. Pour déclarer tabu quelqu'un ou quelque chose, on partait toujours d'un motif religieux, quoique cela se fît souvent à la requête des autorités civiles ; le roi chargeait toujours une sorte d'officiers de police, appelés kiaimoku, gardiens de l'île, de surveiller la stricte application du tabu.
« L’antiquité du tabu égalait celle des autres branches de la [16] superstition, dont lui-même formait une partie constitutive des plus importantes ; son application était à la fois générale et particulière, occasionnelle et permanente. Étaient toujours tabu, ou sacrés, les idoles, les temples, les personnes et les noms du roi, des membres de la famille régnante, ainsi que les personnes des prêtres, les embarcations appartenant aux dieux, les demeures, les habits et les nattes du roi et des prêtres, ainsi que les têtes des hommes dévoués à toute idole particulière. La chair des porcs, de la volaille, des tortues de mer, de diverses espèces de poissons, les noix de coco et presque tout ce qui s'offrait en sacrifice étaient tabu, à l'usage des dieux et des hommes. De là vient que, sauf en des cas où se manifestait une indulgence particulière, ces diverses choses étaient interdites aux femmes. Des emplacements particuliers, comme ceux où le roi se baignait, étaient eux aussi rendus tabu en permanence. On tabouait parfois une certaine île ou un certain canton, lorsque aucune personne comme aucun canot n'avait la permission de s'en approcher. Tels ou tels fruits, tels animaux, le poisson se trouvant dans un certain périmètre, étaient occasionnellement tabu pour plusieurs mois, interdits aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Parmi les époques, on tenait pour tabu :le temps qui marquait l'approche de quelque grande cérémonie religieuse ; celui qui précédait immédiatement le départ pour la guerre ; celui au cours duquel un chef était malade. La durée de ces temps tabu variait ; elle fut plus longue anciennement qu'à l'époque moderne... Avant le règne de Tamehameha, la période usuelle était de quarante jours ; sous ce règne, on la réduisit à dix ou cinq jours, quelquefois à un seul jour. A cet égard, les tabus,ou périodes de restriction, semblent avoir été plus longs aux Hawaï que dans les îles de la mer du Sud... Ces périodes étaient tantôt plus souples, tantôt plus strictes. Dans le premier cas, il y avait seulement pour les individus mise en demeure de s'abstenir de leurs occupations habituelles et d'observer le heiau, présentation des prières du matin et du soir. Autrement rigoureuse, la saison de tabu strict : il fallait éteindre tout feu et toute lumière dans l'île ou dans le district ; aucune embarcation n'avait le droit de circuler ; interdiction à qui que ce soit de prendre un bain ; excepté ceux dont la présence était requise dans le sanctuaire, personne ne devait être vu hors des habitations ; nul chien ne pouvait aboyer, aucun porc grogner, défense à tous les coqs de chanter, sinon, le tabu se trouvait brisé, et l'objet auquel on l'avait destiné était manqué. En pareil cas on muselait les chiens et les porcs ; quant aux volailles, on les cachait sous une calebasse, ou bien on les aveuglait au moyen d'un bandeau. Tout le menu peuple se prosternait, la, face contre le sol, devant les chefs sacrés circulant au dehors, en particulier durant [17] le tabu : ni le roi ni les prêtres n'étaient autorisés à toucher quoi que ce fût ; il fallait même qu'une autre personne portât leurs aliments à leur bouche. C'était souvent par voie de proclamation et par l'organe d'un crieur ou héraut qu'on décrétait le tabu ; ce fonctionnaire circulait, généralement le soir, requérant l'extinction de toute lumière et l'évacuation des chemins menant au rivage, qui devaient être laissés à la seule disposition du roi, tandis que les voies de circulation à l'intérieur des terres étaient à réserver uniquement aux dieux. Etc. Au reste, non pas toujours mais le plus souvent, le peuple n'était pas très surpris par cette annonce ; il en avait eu quelque avertissement. Parfois, pour décréter le tabu, on apposait sur les endroits ou les choses taboués certaines marques appelées unu unu ; la signification en était bien connue. Prohibitions et réquisitions inhérentes au tabu étaient strictement obligatoires ; la moindre inobservation de l'une d'elles entraînait peine de mort, à moins que les délinquants n'eussent quelques amis très puissants parmi les prêtres ou les chefs. Mais en général on les offrait en sacrifice, ils étaient étranglés ou livrés au feu ; ou bien encore on les exécutait à coups de pierres ou de gourdins dans les parvis du heiau{4}...
« Une institution dont l'influence revêtit des proportions tellement universelles, et qui comportait des exigences aussi inflexibles, contribua très matériellement à perpétuer la servitude et l'oppression des indigènes en général. Le roi, les chefs sacrés et les prêtres paraissent bien avoir été les seules personnes pour qui l'application du tabou était aisée. En revanche, la grande masse du peuple n'échappait à son influence durant aucune période de la vie ; aucune circonstance ne pouvait l'excuser d'avoir failli, si peu que ce fût, à ces rudes obligations. Les femmes, en particulier, en éprouvaient toute la force aussi dégradante qu'humiliante. Depuis sa naissance, l'enfant de sexe féminin n'avait pas le droit de recevoir pour sa nourriture la moindre parcelle de ce qui s'était trouvé sur l'assiette de son père, ou de ce qu'on avait cuit au feu de ce chef de famille. Au contraire, tout garçon, une fois sevré, prenait la même alimentation que son père ; aussitôt que cela lui était possible, il participait aux mêmes repas, tandis que la mère était tenue de prendre les siens dans une case extérieure ; que dis-je, il lui était même interdit de manger les mêmes sortes d'aliments. Quoi [18] d'étonnant, si l'abolitiondu tabu, qui émancipe les femmes si complètement et apporte à leur condition une amélioration si importante, fait l'objetde constantes congratulations ? On ne sera pas surprisdavantage en constatant que toute circonstance qui tendrait, fût-cedans une mesure des plus faibles, à faire revivre l'ancien tabu, soulève les appréhensions les plus alarmées. L'unique tabu en vigueur aujourd'hui n'est autre que le sabbat, appelé la tabu (jour sacré) ; ceux qui le comprennent semblent ne voir aucun inconvénient à ce qu'il s'étende encore et se perpétue. »
Ainsi s'exprime l'excellent missionnaire Ellis. Il montre très clairement que le système tabu jouait un grand rôle dans la vie des peuples polynésiens. S'harmonisant aisément avec le pouvoir des prêtres et celui de l'état, ce système devint, aux mains des classes dirigeantes, un instrumentum regni, unpuissant engin au service du contrôle politique et social. Ce fut même le principal support d'une société organisée suivant des lignes théocratiques.
Ellis considérait le système tabou comme particulier aux indigènes des mers du Sud. Mais, depuis lors, les études anthropologiques ont discerné la présence d'idées et de coutumes comparables à celles-là chez beaucoup d'autres peuples primitifs, et même parmi ceux qui possédaient déjà une civilisation, celle que nous appelons archaïque. Aussi, actuellement, « tabou » est-il une notion, une catégorie dont l'application trouve à s'exercer sur une étendue presque mondiale.
Il ne faut pas confondre les tabous avec ces prohibitions animistes, imposées par plus d'un législateur ancien, et insérées, sous forme de règlements positifs, dans l'organisme des codes de moralité et de religion qui, du monde antique, sont parvenus jusqu'à nous. Des dix commandements, par exemple, huit sont formulés négativement, et néanmoins, tels qu'ils se présentent maintenant à nous, ce ne sont pas des tabous ; ce sont les injonctions d'une divinité. Les prohibitions animistes, qui naturellement figurent en fort grand nombre surtout dans des collections telles que les lois de Manou, l'Avesta, le code mosaïque, ne sont en aucune manière inconnues des peuples incultes. Cependant, on a souvent incorporé des tabous à un système religieux, on les a attribués à un être spirituel, on les a appuyés sur la référence à l'autorité divine. Il en était ainsi en Polynésie où, comme Ellis le remarque, tabu exprime « une connexion avec les dieux » {5}. De même, dans les anciens codes [19] hindous, persans et hébreux, abondent les règles négatives qui, quoique tenues pour révélées par un dieu, laissent percer une ressemblance manifeste avec les ordonnances des sauvages les plus primitifs. Le problème, dès lors, consiste à remonter au delà de la prohibition animiste pour découvrir le tabou originel.
D'autre part, n'ont pas le caractère animiste toutes les prohibitions dont on déclare que la violation est punie par un être spirituel. Chez les sauvages, on conçoit fréquemment les « esprits » comme impersonnels plutôt que personnels ; quelques-uns sont même simplement considérés comme de vagues influences inhérentes à tous les objets extraordinaires, fixant l'attention et excitant la crainte. Dans le châtiment administré pour rupture du tabou, le rôle de semblables esprits est souvent ou ne peut plus arbitraire. Ils n'ont aucune initiative en ce qui concerne le pouvoir coercitif ou pénal ; c'est automatiquement que leur colère est déclenchée contre un délinquant ; ni prière ni sacrifice ne sauraient les apaiser. Lorsque les conséquences des violations sont conçues suivant cette ligne-là, on est bien en présence de tabous et non pas de prohibitions animistes {6}.
On ne doit pas davantage confondre les tabous avec des prohibitions sympathiques, avec les innombrables précautions et préjuges qui trouvent à s'expliquer par un raisonnement analogique quelconque. L'Indien du Paraguay qui s'abstient de consommer la chair du daim, de peur d'être rendu timide, mais qui prise fort un bon morceau de jaguar, afin d'accroître sa vigueur et sa hardiesse, estime tout simplement que les qualités de l'animal mangé passent à celui qui les mange. Agit suivant le même principe le petit Esquimau [20] qui refuse de jouer au jeu des ficelles avec ses mains, parce qu'il craint qu'au cas contraire, au cours de son existence d'adulte, ses doigts ne se prennent dans les crochets du harpon : le semblable produit le semblable. Il en est de même à Bornéo, de la femme qui, pendant que son mari va à la guerre, prend bien soin de cuire et de répandre des graines sur la vérandah de très bonne heure chaque matin, en sorte que ses mouvements puissent être agiles. Ce vaste domaine de recherches anthropologiques, exploré à fond par sir James George Frazer dans The golden bough, présente cependant un double aspect, tel le visage de Janus ; pour quiconque désire comprendre exactement la mentalité primitive, ses préceptes négatifs méritent peut-être autant d'attention que ses commandements positifs.
Les variétés principales des prohibitions sympathiques comprennent force restrictions concernant la grossesse et la naissance. Nombreux sont, par exemple, les cas de couvade ou « lit d'accouchement de (par) l'homme » (du mari) ; nombreuses, certaines règles d'abstinence observées par les chasseurs, les pêcheurs, les guerriers pendant leur absence de chez eux, et par les parents et amis qu'ils ont ainsi quittés ; au même ensemble ressortissent également : diverses mesures diététiques de caractère négatif ; beaucoup d'exclusions obligeant à éviter tels ou tels noms, et enfin, d'une manière générale, les coutumes d'abstention. Des prohibitions de ce genre n'ont joué qu'un faible rôle, ou même n'en ont joué aucun, dans la création ou l'évolution des institutions sociales.
Le primitif, ce « fragile fantôme vagabond », placé dans un monde hostile, y vit en proie à des frayeurs multiples et diverses. Ces craintes, ces terreurs sont souvent le produit d'une imagination luxuriante et d'une ignorance profonde comme les plus insondables abîmes. Aussi toute chose est-elle potentiellement dangereuse ; il faut l'éviter. Ces mouvements de recul, sous leurs formes les plus simples, sont presque aussi instinctifs que ceux des animaux inférieurs. Quand les liens entre membres de la communauté deviennent plus serrés, quand les habitudes, se renforçant, passent à l'état de coutume, on voit la simple tendance à éviter, à s'abstenir, se fixer désormais en prohibitions rigoureuses, interdisant tout ce qui semble porter préjudice tant à l'individu d'une manière immédiate qu'indirectement au groupe dont il fait partie constitutive. Si les objets, activités et situations tombant sous la prohibition sont réellement susceptibles de nuire, le tabou correspondant satisfait ce que nous sommes convenus d'appeler le sens commun. C'est un précepte utilitaire. Si la prohibition frappe ce qui, en fait, n'a rien de dommageable, elle ressortit à ce que nous qualifions de « superstitieux ». Mais, pour le sauvage, toutes ses prohibitions [21] indistinctement reposent sur une seule et même base : l'utilité. Toutes, elles s'accordent avec l'expérience. Elles ne sont pas irrationnelles. Il a toujours existé pour elles des raisons, même si le sauvage, quant à lui, ne peut en rendre compte et si l'enquêteur civilisé reste impuissant à discerner les émotions et les idées sur quoi, à l'origine, elles furent fondées. Qui donc interprétera jamais les imaginations, artifices et pensers, aussi aventureux que puérils, qui fourmillent dans l'esprit du primitif ?
Il reste néanmoins possible de suggérer quelques facteurs ayant opéré dans la création de prohibitions spécifiques qui revêtent le caractère de tabous. L'influence des rêves mérite d'être ici mentionnée, car on sait que pour le sauvage les rêves sont tout aussi réels que chacun des événements de sa vie à l'état de veille. Les songes à valeur de présage, qui ont donné naissance à toute la pseudo-science de l'oniromancie, peuvent aussi produire des tabous. « Tous leurs rêves, dit un observateur, sont pour eux (les nègres d'Afrique occidentale) autant de visites qu'ils pensent avoir ainsi reçues des esprits de leurs amis défunts. Les précautions, indications, avertissements venus à eux par cette voie, ils les reçoivent avec l'attention la plus sérieuse et la plus déférente, et, une fois réveillés, ils les traduisent toujours en actes. L'habitude, universelle, de raconter ses rêves a fortement stimulé l'habitude même de rêver ; dès lors, les heures du sommeil se caractérisent par un commerce avec les morts presque aussi nourri que celui qui, à l'état de veille, s'entretient avec les vivants. C'est, à coup sûr, l'une des raisons de l'excessive propension à la superstition qu'on observe chez ces tribus {7}. »
Il est permis d'attribuer aux visions une influence analogue, spécialement aux visions du sorcier ou magicien, dont les révélations sont fréquemment influencées par le jeûne, par l'usage de stimulants et de boissons narcotiques, par la danse ou par d'autres procédés encore, provoquant un état d'exaltation morbide. « Les tribus du sud-est de l'Australie, écrit Howitt, croient toutes que leurs ancêtres défunts et les membres de leur parenté également décédés les visitent pendant la nuit et leur donnent alors des conseils, ou des avertissements contre les dangers, ou encore leur communiquent des charmes en vers, efficaces contre la magie. Nombreux sont les cas de ce genre dont j'ai eu connaissance, et je sais aussi [22] que le sorcier a des visions qui sont pour lui des réalités. Pareil personnage, s'il est très réputé dans sa tribu, peut facilement produire un changement social, en annonçant à ses collègues un ordre reçu de certain être surnaturel... S'il trouve un accueil favorable, le degré suivant pourra consister à communiquer la même annonce, toujours comme commandement surnaturel, aux chefs assemblés lors d'une réunion cérémonielle. Le peuple de la tribu l'acceptera sans aucune hésitation {8}. »
Les craintes et les fâcheux pressentiments, suscités par de mauvaises fortunes de toute sorte, peuvent donner l'essor à des tabous. Les Chams d'Indochine appliquent un tabou (tabun) à une plantation de riz, si une personne ou un animal domestique tombe gravement malade après avoir travaillé là. Toutefois, encore faut-il que les premiers symptômes de la maladie se soient manifestés pendant que le sujet se trouvait dans la plantation. On cesse de cultiver tout champ taboué ; il faut le vendre à vil prix à un Annamite chrétien. Chez les Meithei du Manipour, si un homme se tue en tombant d'un arbre, les anciens de son clan se réunissent sous l'arbre, qu'ils déclarent tabou pour tous les membres du clan. Il se peut même que cette excommunication atteigne tous les arbres de la même espèce. Parmi les Indiens Pawnee, on estime que, si quelqu'un boit à une certaine source juste avant d'être atteint d'une sérieuse maladie, la source sera désormais « tabouée », eût-elle été en usage depuis de longues années et bien connue comme donnant une eau excellente. D'autres Indiens, les Mohave, ne mangent pas la chair du castor ; dans le cas contraire, croient-ils, leur cou enflerait. « Cette croyance résulta du fait que quelqu'un avait empoisonné des castors pour leur fourrure et que tous ceux qui mangèrent de cette viande moururent. Il n'en fallut pas davantage pour qu'on réputât malfaisants tous les castors sans distinction. »
Une fois que telle ou telle prohibition particulière a pris corps, il peut se faire qu'elle paraisse confirmée à la suite de certaines expériences, qui ne sont que des coïncidences.
Nous devons à William Mariner un remarquable récit de la vie qu'il mena aux îles Tonga durant la première décade du XIXe siècle. Mariner, un jeune Anglais cultivé, de bonne naissance, avait pris [23] la mer sur un bâtiment particulier, le « Port-au-Prince ». Après avoir croisé pendant plus d'une année à travers le Pacifique, ses compagnons et lui atterrirent dans l'une des îles Tonga. Or, presque tous les membres de l'expédition y furent massacrés par les indigènes. Mais le chef de Vavau, qui s'appelait Finau, se prit d'une vive sympathie pour Mariner et ordonna qu'on lui laissât la vie. Le jeune homme fut introduit et reçut l'hospitalité dans le domaine du chef ; une des femmes de ce personnage lui enseigna le langage et les coutumes du peuple des Tonga. Finau l'adopta même comme son propre fils et lui donna accès dans tous ses conseils royaux. Leurs relations amicales et même intimes durèrent jusqu'à ce que Finau vînt à mourir subitement. Ce chef de Vavau, qui semble avoir eu le tempérament nettement rationaliste, a souvent confié à Mariner ses doutes quant à l'existence d'êtres tels que les dieux : « Les gens sont fous, disait-il, de croire ce que les prêtres leur racontent. » Il fut frappé d'une maladie mortelle au moment même où il commandait la mise à mort d'un prêtre influent qui l'avait offensé. Le sacrilège ainsi décidé, quand il fut connu après la mort de Finau, frappa chacun de consternation, et le cri général ne fut autre que celui-ci : « Sa mort n'a rien de surprenant ; comment un chef vivrait-il après avoir exprimé des intentions aussi effroyables ? »
Sur l'une des pistes tracées entre la province de Tarlac et celle de Zambales, dans l'île de Luçon, se trouve une énorme pierre ronde et noire, en laquelle les négritos voient la résidence d'un esprit très puissant. Aucun nègre, et même en fait aucun indigène christianisé des deux provinces, ne passe jamais devant cette pierre sans y déposer une banane, une patate ou une autre offrande élémentaire. Si l'on s'en abstenait, sous une forme ou sous une autre le malheur frapperait le voyage. Or, il advint qu'un Espagnol, qui devait devenir plus tard le gouverneur de Zambales, arrivant en cet endroit, frappa la pierre du pied, au grand scandale de ses compagnons terrifiés. Il ne s'en tînt même pas là, car il osa entamer une banane déposée en ce lieu sacré, en manger un morceau et jeter le reste. Les indigènes restèrent persuadés que l'incident entraînerait pour son auteur d'effroyables conséquences. Ce qui est certain, c'est que, parvenu fort loin de là, il reçut entre les deux jambes une flèche tirée par des nègres sauvages, qui, apparemment, n'avaient pas eu connaissance de son « sacrilège ».
Les marques royales des souverains malais sont éminemment sacro-saintes. Quiconque aurait la témérité de s'en occuper serait réputé courir de grands dangers. Parmi les insignes de la royauté du sultan défunt de Selangor (un des États malais), figuraient deux grands tympanons et une longue trompette d'argent. On les gardait dans un récipient de fer galvanisé, posé sur des supports, [24] au milieu de la pelouse dans le jardin de la résidence de son Altesse. Précédemment, leur place avait été à l'intérieur de la maison, mais là ils avaient causé aux habitants force troubles et angoisses. Un jour, un certain Raja Baka posa fortuitement le pied sur le cylindre de bois d'un des tympanons. Il mourut à la suite de cette inadvertance. De plus, un nid de frelons vint à se former à l'intérieur du cylindre. Pour l'ôter, on réquisitionna un Chinois ; aucun Malais n'y eût jamais consenti. Or, au bout de quelques jours, le Chinois « enfla et mourut ». Ces coïncidences, c'est le sultan lui-même qui en donna connaissance à notre informateur, M. Skeat. Quand celui-ci exprima le désir d'examiner la trompette et les tympanons, on le supplia de n'en rien faire, car « personne ne pourrait dire ce qui arriverait ». Il passa outre et se livra même à ces investigations en présence du prince héritier. « Sur le moment, dit-il, je n'y pensais plus, mais, ce qui fut vraiment une très curieuse coïncidence, au bout de quelques jours seulement je fus saisi d'une violente attaque d'influenza de la nature de la malaria, si bien qu'il me fallut quitter le district et entrer à l'hôpital du chef-lieu. » On comprend que ce fait ait fort impressionné les Malais.
Le docteur Rivers, ayant des recherches à faire chez les Toda de l'Inde du Sud, vit ce travail contrarié par certains événements fâcheux, qui se produisirent pendant qu'il se trouvait en la compagnie des indigènes. Son séjour parmi eux durait déjà depuis quatre mois environ, lorsque diverses mésaventures atteignirent quelques-uns de ses principaux informateurs. « Un homme, qui m'avait signalé des lieux sacrés, tomba malade et se persuada qu'il allait mourir. Un autre perdit sa femme quelques jours après qu'il m'eut montré comment on procédait pour accomplir l'une des cérémonies toda les plus sacrées. Un troisième, de qui j'avais appris les détails d'un autre toda également sacro-saint au plus haut degré et relatif à la laiterie, eut à subir la perte de sa propre crémerie de village, qui fut la proie d'un incendie. » Les devins, consultés, attribuèrent ces événements à la colère des dieux toda, dont les secrets avaient été révélés à un étranger.
Le professeur Westermarck a eu l'occasion de visiter, dans les montagnes du grand Atlas, une caverne qui était réputée contenir toute une ville peuplée d'esprits. À proximité, il se trouva que ses compagnons abattirent un couple de pigeons. Peu après, son cheval vint à buter et à tomber sur un des indigènes, qui portait une arme à feu. Cette arme fut brisée, et l'homme resta paralysé durant plusieurs jours. Il fut déclaré au professeur que cet accident avait été causé soit par les esprits de la caverne, soit par un saint qui avait son sanctuaire dans le voisinage, et qu'en tout cas c'était la punition du meurtre des pigeons.
Lors d'une danse exécutée en l'honneur du soleil, un Indien kiowa, homme de guerre et sorcier réputé, viola de propos délibéré la règle qui interdit rigoureusement d'approcher un miroir (lequel fait partie de l'équipement de toilette de chacun, ou peu s'en faut), des taime, ensemble des images sacrées devant être exposées à la vue au cours de la cérémonie. Il essaya aussi, mais sans succès, d'empoisonner son rival, le gardien des taime, en grattant le mercure sur le revers du miroir, pour le mélanger au tabac qu'il donna à fumer à ce prêtre. Il ne s'écoula ensuite que fort peu de temps jusqu'à ce que, dans une chasse au bison, notre homme ne soit renversé de son cheval et tué. Prompte sanction de ses sacrilèges, aux yeux des Indiens.
C'est en chassant, eux aussi, des bisons, que les Indiens omaha virent se produire un autre sacrilège. Ils avaient coutume, pour aller à la rencontre de ce gros gibier, de procéder par quatre étapes successives et toujours régulières ; à la fin de chacune d'elles, le commandant de la chasse et les autres chefs s'asseyaient et fumaient. A cette lenteur dans la poursuite et à la division en quatre parties était attribué un caractère religieux. Or, au cours d'une de ces chasses, un homme vint au galop trouver les personnages officiels pendant qu'ils étaient arrêtés en fumant, et il leur représenta non sans impatience qu'ils ne progressaient vraiment pas assez vite. Le bison, disait-il, se déplace, il risque de vous échapper à cause de vos délais. Imperturbable, le commandant répondit : « Si ta méthode est meilleure, applique-la. » L'autre ne se le fit pas dire deux fois ; suivi des chasseurs, il se précipita avec impétuosité à l'assaut de la horde. Dans la confusion qui en résulta, plusieurs furent blessés, et l'impatient lui-même, son cheval s'étant renversé sur lui, demeura estropié pour la vie. On interpréta l'aventure comme un châtiment surnaturel de l'acte irrévérencieux par lequel avait été rompue la procédure établie.
Songes, visions, mauvaises fortunes, expériences de coïncidences ont indubitablement joué un rôle dans l'établissement de nombreux tabous et dans leur maintien en vigueur. Mais il est facile d'en exagérer l'importance. Certains tabous, qui actuellement paraissent dépourvus de sens, peuvent avoir été significatifs autrefois, quand ils prohibaient ce dont l'expérience avait manifesté les effets malsains, concernant une série quelconque d'activités usuelles : recherche de la nourriture, relations sexuelles, guerre, etc. Il se trouve des tabous pouvant avoir au fond, dans le présent, une utilité subsidiaire, car souvent on reconnaît à l'évidence qu'ils ont été délibérément désignés par des chefs de tribu, des magiciens, des prêtres. Le sauvage est, en effet, fort capable, en faisant appel à des craintes « superstitieuses », d'instaurer une règle pratiquement [26] utile ; c'est par ce moyen qu'il assure à la règle une prompte obéissance. Comme toutes les observances ressortissant à la coutume, les tabous jaillissent quelquefois de l'intérieur du groupe et sont perpétués par la tradition orale. Ils peuvent aussi être dus au commerce, amical ou non, avec un autre groupe. Dans d'autres cas encore, il y a lointaine mais pénétrante influence étrangère, aboutissant au contact et à la fusion de plusieurs cultures. Mais, quel qu'ait été le processus, l'issue finale ne change pas ; elle tient en deux mots : obscurité et déformation. Aussi, l'origine de la plupart des tabous disparaît-elle, engloutie sous le même voile de ténèbres cimmériennes qui, d'une manière générale, dérobe à nos yeux le point de départ des coutumes primitives. Chez les indigènes du sud de l'Afrique, une autorité déclare tout net que le plus grand nombre des tabous thonga sont « inexplicables », et ce dire trouve une application plus que locale.
Une fois établi, chaque tabou particulier tend à se multiplier sans fin. La fausse association d'idées qui agit de la sorte est la même que celle dont procèdent les prohibitions sympathiques : un objet devient tabou, qui, pour une raison quelconque, rappelle à quelqu'un quelque autre objet taboué. Les prohibitions s'empilent ainsi les unes sur les autres, comme l'Ossa sur le Pélion et le Pélion sur l'Olympe, afin de prévenir toute simple possibilité de danger dans l'effroyable labyrinthe d'un monde où toute chose est potentiellement périlleuse. La prolifération luxuriante des tabous, nourrie par une accumulation de rudes inférences, contribue à en expliquer le caractère infiniment mélangé.
Sous ses aspects sociologiques, le tabou se réfère à un système de prohibitions observées comme coutumes et développées en institutions chez les Polynésiens et parmi d'autres peuples. Les choses prohibées sont aussi nombreuses et variées que les expériences humaines, car toute personne, tout objet, toute action peut être tenu pour tellement dangereux que le moindre commerce avec lui retombe sur quiconque s'y livre. Le péril redouté n'apparaît jamais aux sens ; jamais on ne l'explique, on l'assume toujours. Il y a lieu, dès lors, de le traiter moyennant des précautions qui ne seraient pas requises s'il s'agissait d'autres objets. Ainsi, en Polynésie, il faut apporter de grands soins au maniement de ce qui fut tabu ; quant à ce qui était noa (« général » ou « commun »), on peut impunément s'abstenir d'y prendre garde. Sous ses aspects psychologiques, le tabou peut donc être défini comme la conception du danger mystique que présente un objet particulier et dont résultent des contraintes et des restrictions, centrées non pas sur ce qui est prohibé mais sur le fait même de la prohibition. C'est tout justela simple peur des conséquences de la désobéissance, et, puisque ces [27] conséquences sont souvent laissées indéterminées, l'impression de la peur prévaut absolument. À mesure que nous serons mieux renseignés sur la mentalité primitive, la nature du tabou se laissera mieux comprendre, et la recherche de ce qui la motive pourra s'étendre jusqu'à inclure une étude de l'esprit chez l'enfant, dans le peuple, et une étude du subconscient tel que le révélera la psychanalyse.
C'est donc la peur qui se trouve systématisée en tabou. La peur parcourt toute la gamme des réactions émotionnelles, depuis la crainte pieuse jusqu'à la terreur ; de la sorte, ce qui mystiquement comporte un danger peut être frappé de prohibition, comme provoquant tantôt un sentiment d'aversion, d'horreur, tantôt du respect et même de la vénération. On peut donc dire que la conception du tabou est souvent ambivalente, mais en soulignant, fait important, qu'au moins chez les peuples primitifs l'attitude de l'aversion est beaucoup plus prononcée que celle de l'attraction. La « crainte du Seigneur » est le « commencement de la sagesse » pour le sauvage, quoi qu'elle puisse être pour son frère civilisé. Jamais la différenciation des deux attitudes ne s'accomplit parfaitement, même dans les religions supérieures, car il subsiste toujours une certaine ambiguïté entre ce qui est redoutable parce que diabolique et ce qui l'est parce que divin. La « chose impure » et la « chose pure » possèdent semblablement le pouvoir, que ce soit le pouvoir de détruire ou celui de bénir{9}.
On peut parfois saisir sur le vif le processus de la différenciation, lorsqu'un peuple primitif entre en contact avec des missionnaires chrétiens. Dans les îles Tonga, le verbe tabui, « placer sous un tabou », s'emploie actuellement au sens de « bénir ». En Nouvelle-Zélande, [28] l'expression wairua tapu est traduite par « saint esprit ». Parmi les indigènes du Gabon, orunda signifie à l'origine « interdit à l'usage humain », « tabou » ou « taboué ». Sous l'influence de l'activité missionnaire, il a pris le sens de « sacré, pour l'usage spirituel », et dans les écritures mpongwe orunda traduit notre mot « saint ». Le docteur Nassau estime « ce choix malheureux, car le missionnaire doit expliquer qu'orunda, quandil se dit à propos de Dieu, ne désigne pas l’orunda employé pour l'humanité ».
Chez les Indiens dakota, le mot wakan se définit : mystérieux, incompréhensible, dans un état particulier ou puisqu'on ne le comprend pas, il est dangereux d'avoir commerce avec lui. De là, les applications de ce mot aux femmes pendant leurs époques ; de là aussi naquit, chez les Indiens les plus frustes, le sentiment les portant à estimer que, si la Bible, l'Église. le missionnaire, etc., sont wakan, il faut les éviter et les tenir à 1'écart, non pas comme étant mauvais ou dangereux, mais comme wakan. Ce mot semble être le seul qui veuille dire : saint, sacré, etc., mais son acception courante, indiquée ci-dessus, prête à méprise pour les païens.
Les objets mystiquement dangereux sont, en outre, des objets dynamiques. L'homme les reconnaît à ce qu'ils lui font ; c'est leur activité qui les lui laisse discerner. De cette manière de penser, si naturelle et en fait inévitable, quelques peuples primitifs en vinrent à isoler mentalement et souvent à indiquer par un nom spécial le pouvoir occulte qui se révèle en produisant des effets qui dépassent la capacité ordinaire de l'homme ou le cours normal de la nature. Ainsi les Ba-ila de la Rhodésie du Nord ont l'idée d'une force de caractère neutre et pénétrant toutes choses. En soi, la force n'est ni bonne ni mauvaise, mais elle peut être saisie par ceux qui possèdent le secret de la manipulation, et de la sorte elle peut être appliquée à un bon ou à un mauvais usage. Il y a danger à se commettre avec un objet dans lequel la force réside ; il est tabou (tonda). « Il y achez la personne tonda quelque chose qui met en péril le bien-être d'autrui ; certaine influence nocive, inhérente aux choses, actions et paroles tonda, ou mise par elles en mouvement, fait d'elles une source de péril non seulement pour la personne qui les manie, en fait usage ou les prononce, mais aussi parfois pour ses compagnons. En ce cas, les tonda peuvent exciter l'actif ressentiment de ceux qui en sont affectés, et le délinquant peut être puni par eux ; mais, en général, celui qui rompt le tabou est abandonné à la rétribution inhérente à sa propre faute. En d'autres termes, les actes ou les paroles dont il s'agit ont en eux-mêmes une essence maléfique, et par une sorte d'automatisme ils retombent sur le de cujus ou plus exactement libèrent le ressort qui met en marche contre lui le mécanisme caché de la nature. » Les Ba-ila [29] n'ont jamais formulé clairement leurs idées concernant cette force ; ils ne lui donnent aucun nom particulier.
En revanche, les membres du peuple elema de la Nouvelle-Guinée britannique savent comment l'appeler ; pour eux, c'est ahea, ou « chaleur magique ». La signification de ce mot a été transposée, de la chaleur purement physique du feu ou du soleil, à celle du magicien qui, de par sa condition, est susceptible de réaliser des performances dépassant la capacité humaine ordinaire. C'est ainsi que possèdent l'ahea de vieilles gens, des jouets sonores, certaines plaques de bois gravées et investies d'une grande sainteté, les charmes du magicien. L'ahea se trouve spécialement dans les feuilles et les morceaux d'écorce dont le magicien a le secret et fait usage, comme aussi dans le gingembre qu'il mastique tout exprès afin de se rendre « chaud ». Les choses où réside l’ahea sont « choses chaudes ». « Elles sont chargées de pouvoir, et ceux qui les manient sans autorité peuvent s'attendre à quelque choc fâcheux ; ou bien elles sont violentes et susceptibles d'éclater {10}. » Les insulaires d'Andaman ont un mot similaire, ot-kimil; s'il signifie « chaud » au sens usuel, il s'applique également à chaque chose supposée puissante en bien ou en mal dans l'existence. En particulier, divers animaux et végétaux, ainsi que les corps et les ossements des défunts, sont chargés de ce genre de « chaleur ». Tout contact avec eux est dangereux, mais, ce dommage, certaines précautions rituelles permettent de l'éviter.
La même notion d'un pouvoir occulte est définie plus expressément par le mot mélanésien et polynésien mana ; lameilleure manière de le rendre consisterait peut-être à réunir deux termes en quelque mesure démodés, sinon caducs : la « vertu » qui réside en un homme et la « grâce » qui descend sur lui. Des âmes désincarnées (spectres) et des esprits (qui, dès l'origine, furent dépourvus de corps) possèdent le mana ; peuvent aussi l'acquérir d'eux des gens, des animaux et même des choses inanimées. Des termes essentiellement analogues, dont le sens se rapproche beaucoup de celui de mana, se rencontrent chez les Malais, les Malgaches, chez divers peuples africains et parmi les Indiens d'Amérique.
Le pouvoir occulte résidant dans un objet mystiquement dangereux est transmissible ; en conséquence, il est capable d'affecter qui ou quoi que ce soit entrant en contact avec cet objet. Il faut considérer cette conception comme résultant de l'expérience, bien [30] qu'interprétée de travers. Le sauvage n'ignore pas que la morsure de, certains insectes et celle de certains serpents produisent des effets très pénibles et éventuellement fatals. Après une longue observation, il a appris que maintes plantes et maints fruits, quoique agréables au goût, ne sont pas bons à manger. Il s'est familiarisé avec diverses maladies qui peuvent se transmettre d'individu à individu, d'une famille à une autre, et quelquefois même apporter la mort à une communauté entière. Dans tous ces cas, la nature de la maladie en question lui est inconnue ; ce qu'il sait, c'est que le .contact de l'objet dangereux entraîne des conséquences désagréables. Combien plus pénibles encore sont nécessairement les conséquences du contact avec quelque chose de mystiquement dangereux, quelque chose de tabou !
Le contact qui déclenche automatiquement un pouvoir occulte est, le plus souvent, un contact corporel. L'objet est quelque chose a ne pas toucher, quelque chose d'intangible au sens le plus strict du moi. Criminel et chef divin sont tous deux en état de tabou, l'un comme impur, l'autre comme saint. Toucher l'un ou l'autre, c'est être affecté par leurs qualités mystérieuses et dangereuses. Le commerce sexuel est une forme de contact exceptionnellement intime ; aussi, lorsque les femmes sont en état d'impureté, les époux sont-ils tenus de vivre séparés. L'absorption de nourriture solide ou liquide implique, de même, un contact étroit ; d'où la grande variété des prohibitions alimentaires. Le contact peut s'établir par d'autres moyens encore : par la vue, comme lorsqu'un chef africain n'a pas même la permission de regarder tel cours d'eau déterminé ; par l'ouïe, comme lorsqu'il est interdit à des Australiennes d'écouter certains chants rituels ; par l'odorat, comme lorsqu'un Indien navaho s'abstient d'inhaler la fumée d'un feu fait de bois sacré ; par le langage, comme lorsqu'un Malgache a soin de ne pas prononcer un nom taboué. Même le simple voisinage peut suffire à transmettre un pouvoir occulte ; c'est le cas des personnes en état de tabou à qui défense est faite de s'approcher des récoltes qui poussent. Procul !Oprocul este, profani.
Avec l'autorité d'un tabou ne saurait rivaliser celle d'aucune autre prohibition. On n’en fait l'objet d'aucune réflexion, d'aucun raisonnement, d'aucune discussion. Un tabou se résume simplement en une interdiction impérative : « tu ne dois pas », en présence du danger appréhendé. Que telle ou telle infraction de la prohibition ait été bien intentionnée ou fortuite, cela n'entre pas en ligne de compte. Aucun adoucissement aux sanctions ne viendra correspondre soit à l'ignorance de celui qui a violé le tabou, soit au louable propos qui fut le sien. Il faut cependant remarquer que les conséquences d'une violation sont parfois tenues pour susceptibles de [31] varier avec la position sociale de son auteur. Il en est particulièrement ainsi en Polynésie, où chaque chef possédait sa provision de pouvoir occulte, ou mana. Plusson rang était élevé, plus il en avait, et par conséquent plus il pouvait opposer de résistance au mana résidant en quelque chose ou quelqu'un affecté d'un tabou. Par exemple, dans les îles Tonga, un membre du peuple ayant touché, même par hasard, le cadavre d'un chef devenait impur pour une durée de dix mois lunaires ; mais, si le délinquant était lui-même un chef, son impureté ne s'étendait que sur trois, quatre ou cinq lunaisons, selon le degré de la supériorité hiérarchique qui pouvait être celle du défunt par rapport à lui {11}. En Nouvelle-Zélande, le fils d'un chef pouvait rompre impunément un tabou, parce qu'il occupait un rang plus élevé que celui de son père. On nous rapporte aussi que, chez les Maori, un « homme puissant brisait souvent le tapu d'un inférieur ».
L'instruction concernant les tabous d'une tribu fait régulièrement partie des rites d'initiation qu'on trouve chez beaucoup de peuples primitifs. La connaissance des tabous s'acquiert de la sorte au sein du groupe familial. Ainsi, à Ontong Java, quand un garçon se met à grandir, on commence à lui enseigner quelles sont les restrictions essentielles auxquelles les hommes sont tenus de s'assujettir ; il saura donc, désormais, que certains sujets ne peuvent pas être discutés en présence de sa soeur, que toute chose en rapport avec la mort est à éviter et qu'il ne faut jamais s'approcher d'un temple ou d'un prêtre sans prendre de dues précautions. On l'avertit aussi que toute contravention aux tabous sera punie par les kipua, les esprits du mort. « Ses parents et d'autres gens avec qui il peut prendre contact lui citent, par douzaines, d'effrayants exemples. Tous les enfants savent ce qui arriva à Ke laepa, lorsque, désobéissant à ses parents, il osa s'aventurer vers le temple : on le trouva mort sur le seuil, tué par les kipua en courroux. Puis vint le tour de 'Oma. Ayant manifesté une vilaine curiosité envers la conformation sexuelle de sa soeur, il fut, en conséquence, transformé en pierre par ces mêmes esprits. Quelquefois, on se narre le soir des contes populaires ; il en est beaucoup qui racontent [32] les fâcheuses conséquences déchaînées par la rupture des tabous. De même à Tikopia, une des îles qui, avec Ontong Java, forment un avant-poste de la culture polynésienne, les enfants sont régulièrement instruits par leurs parents, chaque fois que la violation d'un tapu s'est produite ou semble être sur le point de survenir. Les habitudes à prendre pour en éviter les fâcheux effets sont inculquées au cours des années de la première enfance, alors que la jeune âme demeure le plus impressionnable.
On ne décrit pas toujours en détail ce qui résulte de la rupture des tabous. C'est parfois laissé à l'imagination excitée de son auteur, qui croit à la relation fatale de cause à effet (violation suivie de châtiment), tout aussi fermement que l'homme moderne est convaincu de voir infailliblement s'exercer les lois de la nature. Les tabous (sabe) qu'observe la tribu mowat ou mowatta, du district de Daudai (Nouvelle-Guinée britannique), ont comme sanction la peur de « quelque chose de désagréable » qui viendra atteindre soit la communauté soit le transgresseur. Dans les îles de l'Amirauté, au nord-est de la Nouvelle-Guinée, il y a relation directe entre l'observation des tabous et le succès. L'infortune dont on est convaincu qu'elle en suivra la violation est la principale force contribuant à les maintenir.
Les indigènes des îles Salomon attribuent la maladie, les accouchements difficiles, l'insuccès à la pêche ou dans le jardinage, la mauvaise fortune à la guerre, bref, la plupart des maux de cette vie, à la souillure rituelle résultant de la violation des tabous. Chez les Maori, celui qui rompait un tabou avait conscience de se trouver dans une position très grave, parce que son principe de vie sacré, son mauri, était sans protection et exposé à tout mauvais vent, à tous les traits de la magie noire, à chacune des influences malignes pouvant atteindre l'homme. « S'il ne se trouve, dans cette désolante extrémité, une personne pour le mener en hâte à un tohunga, ouprêtre expert, et le relever de ses inaptitudes consécutives au tabou violé, il aura probablement à subir un trépas précoce{12}. »
À Bornéo, chez les Dayak de la côte, celui qui fait quoi que ce soit de mali, ou taboué, rencontrera fatalement quelque malheur. « Il semble que les enfants eux-mêmes ont peur de ce mot ; le garçonnet volontaire et désobéissant laissera aussitôt tomber ce qu'il a pris dans sa main, si on lui dit qu'il est mali pour lui d'y toucher. » [33] Le docteur Matthew demandait un jour à certain Navaho ce qui arriverait s'il épousait une femme de son propre clan, violant ainsi la règle de l'exogamie et commettant un inceste. « Il m'arriverait malheur, dit cet Indien, je tomberais dans le feu et y serais consumé, la foudre me frapperait, le froid me gèlerait, ou bien je serais tué à coups de fusil, bref, il m'arriverait, vous dis-je, une catastrophe. »
Lorsque le coup appréhendé frappe effectivement, la croyance à l'efficacité du tabou se trouve amplement confirmée ; « à la sagesse justice est rendue par ses enfants. » Durant leur séjour chez les Warramunga, tribu de l'Australie centrale, MM. Spencer et Gillen apprirent la maladie dont souffrait alors un indigène d'âge moyen, qui avait pris une part active à la célébration des diverses cérémonies. « C'était un sorcier, mais, comme il n'était pas très avancé en âge, certains aliments tels la viande du casoar et de leuro, entre autres, lui étaient interdits et même, d'après la stricte étiquette, il était supposé apporter ces vivres-là aux sorciers plus âgés, pour leur ravitaillement. Or, non seulement il avait omis d'agir ainsi, mais, en plus d'une occasion, il était de notoriété publique qu'il avait lui-même consommé de la viande d'euro. Grave offense aux yeux de ses aînés, qui n'avaient pas laissé de l'avertir qu'à continuer de se comporter de la sorte il irait au-devant d'un grand malheur. Cela étant, lorsqu'il tomba malade, on attribua immédiatement cet événement au fait qu'il avait délibérément fait ce qu'il savait parfaitement être contraire à la coutume ; aussi personne ne fut surpris le moins du monde. Parmi les campeurs se trouvaient cinq « docteurs » ; le cas étant évidemment sérieux, on les appela tous en consultation. L'un d'eux, célèbre médecin sorcier de la tribu voisine, celle des Worgala, émit, après délibération solennelle, l'avis que les os d'un défunt, attirés par le feu du camp, étaient entrés dans le corps du patient et causaient tout le mal.
Les autres approuvèrent cette opinion. Mais, pour n'être pas surclassé par un étranger, le plus âgé des docteurs warramunga déclara qu'outre les os avait pénétré à l'intérieur du sujet un arabillia, ou excroissance d'un gommier. Quant aux trois personnages moins expérimentés, ils avaient l'air très grave, mais ils ne dirent rien, si ce n'est qu'ils admettaient pleinement le diagnostic formulé par leurs confrères. A toute éventualité, il fut convenu qu'on expulserait aussi bien les ossements que l'excroissance du gommier, ce qui eut lieu à la faveur des ténèbres, après force succions et frictions du corps du malade. Au reste, tous les efforts devaient rester inutiles ; le sujet, qui en réalité était atteint de dysenterie, succomba.
Plus souvent le châtiment à attendre se montre expressément. Cela peut être une maladie, sous une forme ou sous une autre, voire une maladie de langueur. Aux nombreux tabous alimentaires [34] qu'observent les jeunes garçons australiens, correspondent en général des pénalitésde ce genre. Dans l'état de Victoria, chez quelques tribus du Murray inférieur, les jouvenceaux, avant leur initiation, sont tenus de ne manger ni du casoar, ni de la dinde sauvage, ni du cygne, ni de l'oie, ni du canard noir, ni des oeufs d'aucun de ces oiseaux. « Que s'ils portaient la plus minime atteinte à cette loi, leurs cheveux deviendraient gris prématurément, tandis que les muscles de leurs membres dépériraient et s'atrophieraient {13}