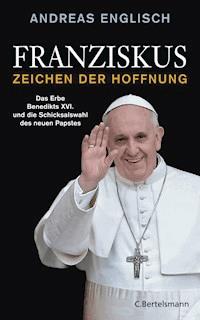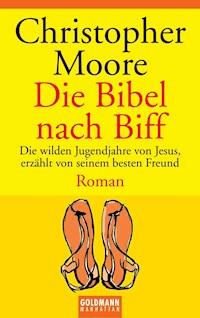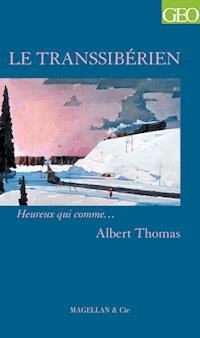
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Heureux qui comme…
- Sprache: Französisch
Découvrez les dessous d’un projet pharaonique et une magnifique aventure humaine
Albert Thomas (1878-1932), jeune étudiant, gagne en 1898 un prix d’excellence peu banal offert par la Compagnie des wagons-lits : un billet gratuit pour le Transsibérien. Son récit est un témoignage exceptionnel sur cette ligne mythique à la conquête du grand Est sibérien.
Texte extrait de La Russie, race colonisatrice, Impressions de voyage de Moscou à Tomsk, 1905.
Un témoignage étonnant qui nous transporte dans un incroyable voyage à la rencontre de la Russie et de ses habitants
EXTRAIT
Le train roule. La plaine environnante n’envoie aucun bruit. Elle s’étend, immense, des deux côtés de la voie. Des céréales, des pâturages, des bouquets d’arbres, en varient parfois l’aspect. Les chemises rouges des moujiks, les jupes des femmes qui moissonnent, çà et là de grands troupeaux de bœufs, quelques cigognes, arrêtent heureusement les yeux dans cette immensité. La plaine invite au voyage : elle attire, elle prend, comme la mer prend les gamins des pêcheurs ; et les paysans s’en vont, comme ils disent, « du côté où regardent les yeux ». Entre l’isba, qui s’abrite sous les arbres, et les feux de campement, qui rougissent dans la nuit les visages des émigrants en marche, il n’y a point de différence : demain, la foudre brûlera le village, donnera l’ordre de partir, ou les moujiks, d’eux-mêmes, l’abandonneront, comme ils laissent au matin les cendres de leur feu. Et l’on comprend alors, dans cet infini de la plaine, avec quelle passion les paysans voyageurs désirent Moscou, la cité sainte, avec son Kremlin superbe et ses cathédrales dorées, qui doivent surgir, là-bas, derrière l’horizon. C’est presque l’impatience du passager qui attend à la fin des longues traversées l’apparition de la côte. Et cette impatience nous saisit aussi.
A PROPOS DE LA COLLECTION
Heureux qui comme… est une collection phare pour les Editions Magellan, avec 10 000 exemplaires vendus chaque année.
Publiée en partenariat avec le magazine Géo depuis 2004, elle compte aujourd’hui 92 titres disponibles, et pour bon nombre d’entre eux une deuxième, troisième ou quatrième édition.
A PROPOS DE L’AUTEUR
Albert Thomas, né à Champigny-sur-Marne le 16 juin 1878 et mort à Paris le 8 mai 1932, est un homme politique français qui se distingua lors de la Première Guerre mondiale comme organisateur de la production d'armements et du travail ouvrier en temps de guerre. Il devint par la suite le premier directeur du Bureau international du travail à Genève.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 111
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA CONQUÊTE DE L’EST
Présenté par Charles Stépanoff
L’enfermement de la Russie sur elle-même, causé par la guerre avec l’Allemagne à partir de 1914, puis assumé délibérément après la révolution de 1917, a laissé longtemps méconnu l’exploit industriel et technique suprême accompli par le régime des tsars : la construction du chemin de fer transsibérien. De l’adoption du projet en 1892 à la jonction finale en 1907, la voie de chemin de fer la plus longue du monde fut construite en quinze ans seulement, avec six mille cinq cents kilomètres de rails, plus d’un millier de stations, et des centaines de villages de colonisation qui devinrent rapidement des villes confortables surgies en pleine taïga. Les difficultés furent énormes, et la démesure des chantiers entrepris à l’époque soviétique paraît moins surprenante quand l’on songe à ce précédent « tsariste ». Il fallut drainer ces innombrables marécages dont le sol de Sibérie est imbibé, aplanir les vallées étroites de l’Altaï, lancer des ponts au-dessus de fleuves qui comptent parmi les plus larges du monde (le pont sur l’Ob mesure sept cent quatre-vingt-quatorze mètres !), dynamiter les montagnes, et, constamment, faire face à la pénurie de main-d’œuvre dans ces régions encore désertiques, sans parler des épizooties qui frappaient les bêtes de transport. Dans l’infinie forêt touffue de la taïga, à travers la steppe désertique, le Transsibérien devait faire passer partout sa voie unique aux cent cinquante-deux centimètres de large, « l’écartement ample et paresseux russe de soixante pouces et demi » comme dit Nabokov, légèrement supérieur à la norme occidentale. Les travaux commencent simultanément en 1892 aux deux extrémités du tracé : à Ekaterinbourg dans l’Oural et à Vladivostok sur le Pacifique. En 1898, la ligne venant de l’ouest atteint déjà le lac Baïkal. En attendant l’achèvement du tronçon central, le Transbaïkalien, on décide que les trains traverseront cette véritable mer intérieure dans un énorme bac à vapeur brise-glace fabriqué en pièces détachées en Angleterre. Mais l’hiver, le bateau n’est pas assez puissant pour se frayer un passage à travers les glaces. Lorsque la guerre avec le Japon éclate en 1904, la ligne transsibérienne devient vitale pour la stratégie russe. On doit improviser une solution : des rails sont posés directement sur la glace, et les wagons sont tirés par des chevaux. Enfin, en 1907, le dernier tronçon, longeant le Baïkal à flanc de montagne, achève la ligne.
En France, assez curieusement, la référence littéraire et documentaire concernant cette prouesse extraordinaire de l’industrie humaine demeure La Prose du Transsibérien du poète Blaise Cendrars, publiée en 1913. Or, si ce texte est admirable par le souffle inspiré du poète et la puissance créatrice du conteur épique, il nous apporte peu sur le Transsibérien lui-même, et pour cause : d’après ses biographes, Cendrars n’a probablement jamais mis les pieds dans ce train. Si l’on considère la brièveté des périodes où le Transsibérien fut ouvert aux étrangers, entre travaux de construction, guerre russo-japonaise (1904-1905) et Première Guerre mondiale, on conçoit l’importance exceptionnelle que revêt le témoignage d’Albert Thomas. Le futur ministre et dirigeant socialiste n’a que vingt ans lorsqu’il s’embarque dans cette « grande maison roulante ». Étudiant brillant, plusieurs fois primé au concours général, il n’est pas seulement un fort en thème ; il a des rêves de justice sociale et il veut découvrir le monde. On peut imaginer sa surprise et sa joie lorsque ce fils de boulanger, jeune conscrit à l’École normale supérieure, reçut comme prix d’excellence de la Compagnie des wagons-lits un billet pour le Transsibérien. Cet événement influença tout le reste de sa vie, ses engagements politiques, son attachement pour la Russie, où il revint trois fois dans des conditions extrêmes, et sa lutte pour l’amélioration des conditions de travail des hommes.
En juillet 1898, lorsqu’il pénètre en Russie avec deux camarades également primés, Albert Thomas n’est pas franchement séduit par Moscou qu’il trouve trop occidental. Il visite le Kremlin avec un intérêt sérieux. Il le reverra plusieurs fois, en 1928 notamment, onze ans après la révolution bolchévique, et il notera que ses cathédrales « donnent l’impression d’être ouvertes à tous les vents. Elles ne sont plus reblanchies ni redorées tous les ans. Les bulbes sont devenus ternes »1. De Moscou à Tomsk, puis de Tomsk à Moscou, ce qui l’intéresse, ce ne sont pas les belles pierres, c’est le mouvement extraordinaire qui travaille cette société archaïque en proie à une industrialisation rapide, développée sur un immense territoire, et dont la lente et acharnée construction du Transsibérien fournit un symbole éclatant. À l’époque d’Albert Thomas, deux types de trains circulaient sur la voie transsibérienne : ceux de la Compagnie internationale des wagons-lits, aménagés avec un luxe occidental, et les trains russes d’État. Ces derniers, que les voyageurs européens apercevaient avec un peu d’effroi de leurs fenêtres, étaient l’instrument d’un massif mouvement de population dont Thomas s’est fait le témoin perspicace : car le but premier de la construction du Transsibérien, c’était la colonisation des terres vierges de la Sibérie par les populations paysannes de la Russie occidentale, un exode à l’échelle d’un continent, une véritable « conquête de l’Est ».
La ruée vers l’or, la conquête de l’Ouest, cette épopée américaine nous a été rendue familière par des œuvres romanesques et cinématographiques à grande diffusion. Or, à la même époque, se produisait une conquête incomparablement plus vaste, mais aussi moins spectaculaire et sanglante car plus respectueuse des populations indigènes. Les voyageurs français, les géographes, les journalistes se passionnèrent pour ce grand mouvement qui allait peut-être faire de la Russie la plus grande puissance du monde. Jusqu’où irait-elle ? Qui, de l’Angleterre ou de la Russie, l’emporterait dans la course à la conquête de l’Afghanistan ? Les Français pariaient plus volontiers sur leur allié russe et voyaient déjà les Cosaques, descendus en train jusqu’à Samarcande, déferler des montagnes afghanes par la passe de Khyber jusqu’à la plaine de l’Indus, s’emparer de Delhi et chasser les Anglais. Mais il n’en fut point ainsi. La guerre, puis, la révolution mirent entre la Russie et l’Europe le prisme de l’idéologie. Et l’on oublia bientôt l’ardeur avec laquelle on avait suivi la conquête de l’Est. En s’engageant dans la construction du communisme, la Russie rompait brutalement avec ses alliés européens, elle rompait avec son histoire tournée vers l’Europe depuis Pierre le Grand, et semblait redevenir un pays asiatique, sauvage, infréquentable. Plus que jamais la Russie des soviets faisait peur et on se souciait peu en Occident d’exalter le souvenir de la bravoure des moujiks qui avaient tout abandonné pour tenter leur chance vers des horizons inconnus, sous des climats très hostiles.
Dans son récit, avec une étonnante maturité, Thomas sait observer le peuple russe, tirer des réflexions des faits les plus anodins et déceler dans tout ce qu’il voit des problèmes historiques et politiques universels. En particulier, il est sensible aux conditions de vie des moujiks et des premiers ouvriers qu’il rencontre, aux problèmes sociaux « de la solution desquels dépendent (…) le progrès et la vie même d’une démocratie », comme il le dira plus tard. Rejoignant sans le savoir le philosophe russe Berdiaev, c’est dans le peuple paysan qu’il voit l’énergie et la vitalité inépuisables qui pourront permettre à une conscience nationale russe de se développer.
Aucun autre voyage ne pouvait faire mieux mesurer à Albert Thomas l’importance des chemins de fer dans la métamorphose des sociétés. Il découvre que le train n’est pas seulement un moyen moderne d’échange de marchandises comme on le concevait trop souvent à l’époque, mais un facteur puissant d’ébranlement des hiérarchies sociales. Ainsi, il n’est pas étonnant qu’Albert Thomas, fraîchement élu député en 1910, choisisse de participer, à la Chambre, à la commission des travaux publics et des chemins de fer. En 1914, il est chargé de l’organisation des chemins de fer, faisant la liaison entre l’état-major et le ministère des Travaux publics. Il publie un opuscule L’État et les compagnies de chemins de fer. Après avoir été ministre en 1916 et tenté de convaincre les socialistes russes de poursuivre l’effort de guerre contre l’Allemagne impériale, il est appelé aux hautes fonctions de directeur du Bureau international du travail. Fidèle à son maître Jaurès et hostile au bolchévisme, il consacra toute son énergie, d’abord à créer de toutes pièces cette organisation internationale siégeant à Genève, ensuite à améliorer concrètement la réglementation du travail dans de nombreux pays. Refusant de s’enfermer dans des tâches administratives et souhaitant voir de ses propres yeux les populations et leurs conditions de vie, comme il l’avait fait dans sa traversée juvénile de la Sibérie, il visita sans exception tous les pays d’Europe, se rendit en Amérique du Nord et du Sud, en Chine et au Japon. Sans doute se souvenait-il du premier de ses voyages au long cours, lorsqu’il était bercé par le cahotement inlassable des roues du Transsibérien, où il avait appris à donner comme fondement aux rêves de progrès social une observation attentive, parfois critique, volontiers poétique, des hommes et de leur travail.
1. À la rencontre de l’Orient, notes de voyage 1928-1929. (N.d.É.)
Texte extrait de La Russie, race colonisatrice,impressions de voyage de Moscou à Tomsk,publié en feuilleton dans Le Tour du monde en 1905.
L’orthographe des noms a été harmonisée.
LE TRANSSIBÉRIEN
Moscou. – Une déception.
– Le Kremlin, Acropole sacrée.
Jusqu’à Varsovie, l’on se sent en Allemagne encore, autant qu’en Russie : les wagons sont prussiens ; c’est en parlant allemand que l’on se fait comprendre. Mais, passé la Vistule, voici que les locomotives portent, à l’extrémité de leur cheminée, un capuchon tout noirci : des piles de bois, sapin ou bouleau, s’élèvent, régulières, sur le tender ; la nuit, parfois, un essaim d’étincelles voltige autour du train. Dans les wagons, larges et commodes, le samovar bout et les verres de thé circulent. Tout prend un nouveau caractère.
On est maintenant en Russie. Les gares, coquettes, avec leurs découpures, leurs boiseries, leurs toits verts, semblent toutes construites sur un même modèle. Chacun y entre, va, vient librement sur les quais : des enfants, des moujiks, sont venus voir passer le train ; des femmes, aux jupes de couleur vive, aux grands châles jaunes ou bleus, attendent, accroupies devant leurs paniers, et offrent aux voyageurs des poires, des framboises, de larges champignons sauvages, parfois aussi de petits objets de bois, faits au tour, ou taillés au couteau durant les longues veillées d’hiver. Tous ces paysans, aux yeux bleus, clairs et sans profondeur, aux traits lourds et comme endormis, ces enfants aux grosses joues pâles, à la tignasse rousse, ont un air résigné et doux ; ils jouissent naïvement de la vie, de l’agitation des voyageurs, de la locomotive qui manœuvre, de ce bel uniforme de gendarme que tous admirent. Le train parti, après les derniers trémolos de la cloche dont un employé fait trembler le battant, ils restent là encore, rêveurs.
Le train roule. La plaine environnante n’envoie aucun bruit. Elle s’étend, immense, des deux côtés de la voie. Des céréales, des pâturages, des bouquets d’arbres, en varient parfois l’aspect. Les chemises rouges des moujiks, les jupes des femmes qui moissonnent, çà et là de grands troupeaux de bœufs, quelques cigognes, arrêtent heureusement les yeux dans cette immensité. La plaine invite au voyage : elle attire, elle prend, comme la mer prend les gamins des pêcheurs ; et les paysans s’en vont, comme ils disent, « du côté où regardent les yeux ». Entre l’isba, qui s’abrite sous les arbres, et les feux de campement, qui rougissent dans la nuit les visages des émigrants en marche, il n’y a point de différence : demain, la foudre brûlera le village, donnera l’ordre de partir, ou les moujiks, d’eux-mêmes, l’abandonneront, comme ils laissent au matin les cendres de leur feu. Et l’on comprend alors, dans cet infini de la plaine, avec quelle passion les paysans voyageurs désirent Moscou, la cité sainte, avec son Kremlin superbe et ses cathédrales dorées, qui doivent surgir, là-bas, derrière l’horizon. C’est presque l’impatience du passager qui attend à la fin des longues traversées l’apparition de la côte. Et cette impatience nous saisit aussi.
Lorsqu’on a atteint Viasma, cette monotonie cesse : sur les pentes des collines vertes, que longent de petites rivières, des troupeaux de bœufs font de grandes taches mobiles. Les bois sont plus épais, plus fréquents ; au long de la voie, les bruyères agitent leurs clochettes roses. Des villages forment au lointain de grandes masses noires ; et au centre, toujours l’église les domine de ses clochetons bleus ou verts, au-dessus de ses murs blancs.
Enfin, voici Moscou !
C’est une déception. Moscou, c’était pour nous, pour notre imagination, la ville fabuleuse et lointaine, la ville orientale, splendide comme une cité des Mille et une Nuits, où la Grande Armée n’avait pénétré qu’avec une sorte de religieuse terreur. Et voici que nous ne trouvions qu’un fouillis de maisons basses, de cheminées d’usine, fumant parmi des dômes sans hauteur, de chantiers et d’ateliers.
Tandis que les drojkys2 nous menaient grand train vers le « bazar slave », le caractère moderne de ce quartier de la ville nous choquait encore davantage. Après un arc de triomphe d’allure berlinoise, nous suivions une large rue mal pavée. Comme les maisons étaient basses, à peine un ou deux étages, toute la vie semblait écrasée, sans élan. Au milieu de ces voies, les piliers des lampes électriques avaient le grand air ridicule des peupliers isolés dans une plaine. Sur les trottoirs, les chapeaux de paille et les vestons courts, à l’européenne, étaient plus nombreux que les blouses rouges. Des tramways forçaient nos drojkys