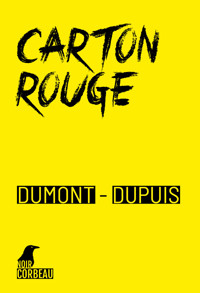Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un respectable professeur de piano est accusé de meurtre. « Erreur judiciaire ! » clame une ancienne élève. A-t-elle raison ou de vieux démons, enfouis depuis des lustres, ont-ils refait surface ? Roger Staquet et Paul Ben Mimoun, appelés à la rescousse, auront bien du mal à démêler cet imbroglio. Nismes, Oignies, Couvin, Walcourt, Malonne… détiennent leur part d’une vérité qui s’avérera surprenante.
À PROPOS DES AUTEURS
Agnès Dumont vit et enseigne à Liège,
Patrick Dupuis habite à Louvain-la-Neuve. Tous les deux sont nouvellistes : Agnès a publié plusieurs recueils aux éditions Quadrature, Patrick a fait de même aux éditions Luce Wilquin.
En 1997, Agnès a remporté le grand prix du concours Polar de la RTBF. Depuis 2005, Patrick participe à l’animation des éditions Quadrature.
Ensemble, ils se consacrent aujourd’hui aux aventures de Paul Ben Mimoun et Roger Staquet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Descriptif
La collection de romans policiers Noir Corbeau bénéficie du regard averti de François Périlleux, Commissaire Divisionnaire (e. r.), ancien chef de la Crime à la Police Judiciaire Fédérale de Liège.
Le Trou du diable
Alan Vandenberg troqua ses chaussures de ville contre de solides bottines de marche, agrippa son sac à dos et examina l’imposante colline boisée qui lui faisait face. Une belle balade en perspective.
Passionné de randonnées en solitaire, cet Ostendais avait appris qu’à Viroinval, dans la forêt qui séparait la villette française de Fumay du petit village belge de Oignies, se cachaient des entrées de mines aujourd’hui oubliées. D’anciennes ardoisières au fond desquelles, au dix-neuvième siècle, des hommes avaient risqué leur vie pour des salaires de misère. Alan, lui-même fils d’un mineur de Waterschei, avait eu envie de parcourir ce site prometteur. Il avait quitté Ostende à l’aube et venait de garer sa voiture à quelques dizaines de mètres de la frontière française, près d’une station-service en ruine dont le nom – Garage du Trou du diable – était encore lisible sur le fronton. Ce toponyme le fit sourire.
D’un pas alerte, il prit le sentier repéré sur sa carte d’état-major et entama la montée. Au bout de quelques minutes d’efforts, il aperçut, entre les arbres, un amas de cailloux entouré de poteaux reliés par du fil barbelé. Derrière, on devinait une cavité dans la roche. Plus bucolique que spectaculaire, constata Alan. Le noir de la pierre contrastait avec le bleu du ciel, le vert sombre des arbres et le jaune orangé des premières feuilles mortes allumées par les rayons du soleil… Il fallait se forcer pour imaginer que cette espèce de grotte avait été l’entrée d’une exploitation industrielle. La nature reprenait tous ses droits.
Il grimpa plus haut et tomba sur une deuxième ardoisière. Même topo. Il allait se décourager quand il remarqua, en contrebas sur sa gauche, une cavité plus large. La voûte surplombant l’ouverture du puits avait cédé et laissait voir un passage qui semblait praticable. Intrigué, Alan Vandenberg tenta de s’en approcher. Mal lui en prit : un caillou se déroba tout à coup sous ses pieds et il dégringola. Impossible de se rattraper, branches et pierres le suivirent dans sa chute. Le temps de s’imaginer blessé, inconscient, la jambe enflée ou fracturée, et il se retrouvait au fond du trou, étourdi. Il laissa son cœur reprendre un rythme normal avant de se relever.
Plus de peur que de mal. Il s’en tirait avec quelques égratignures et une bosse sur le front, causée par un bout d’ardoise ayant dévalé la pente moins vite que lui et à qui il avait servi de coussin d’accueil. Par chance, son smartphone était intact. Heureusement qu’il l’avait placé dans son sac à dos et pas dans la poche arrière de son pantalon ! Il enclencha la fonction « torche » pour examiner les lieux. Arriverait-il à rejoindre la surface tout seul ?
Sous la lumière crue de l’appareil, l’entrée de la grotte révélait un paysage lunaire, caillouteux, désertique. Mais Alan Vandenberg fut soulagé de constater qu’il lui serait facile de regagner l’air libre en escaladant l’éboulis qu’il avait devant lui. Soupir de soulagement, donc… qui se transforma vite en cri d’effroi !
Il n’était pas seul. Sur sa gauche, dans un couloir qui s’enfonçait en pente douce, une femme assise, appuyée au rocher, semblait dormir.
Samedi 9 octobre
— Vous reprendrez bien un peu de mon couscous, monsieur Staquet ?
Ces mots étaient prononcés avec une pointe d’accent bruxellois et Roger ne parvenait pas à s’y faire. Il savait pourtant que c’était le père de son ami Paul Ben Mimoun qui était d’origine marocaine et que Martine Lambert, sa maman, était une Bruxelloise pur jus. Mais rien n’y faisait : quand Paul l’avait invité à passer un week-end chez sa mère, il s’était mis en tête qu’il allait être accueilli par une grosse dame en foulard dans une maison pleine de coussins et de divans courant le long des murs. Un cliché qui s’était envolé dès qu’il avait rencontré son hôtesse. Une personne mince aux manières douces et aux yeux bleus rieurs, qui avait décoré son logis de tons pastel mettant en valeur la jolie pierre d’Entre-Sambre-et-Meuse.
Il accepta la repasse avec plaisir tandis que le fils de la maison remplissait à nouveau son verre. Les Ben Mimoun savaient recevoir et Roger ne regrettait pas d’avoir accepté leur invitation. Une belle occasion de rencontrer la mère de Paul mais aussi de découvrir Nismes, le plus gros village de Viroinval, où elle avait choisi de vivre sa retraite. Arrivé le matin même, il avait déjà exploré le bourg, niché au creux de sa vallée, au cours d’une première balade qui l’avait charmé : vieilles maisons de pierres tantôt grises, tantôt tirant sur le bleu selon la lumière, toits d’ardoise, ruelles. Une rivière – l’Eau Noire – traversait paresseusement le village de part en part… Autant d’atouts qui contrastaient avec l’univers moderne de Louvain-la-Neuve où il avait installé ses pénates.
Une chose, cependant, l’avait intrigué : aucune trace de Clarisse. La jeune femme qui les avait aidés lors de leurs précédentes enquêtes1 avait, semble-t-il, disparu. Paul n’était-il plus amoureux de sa belle Liégeoise ?
L’intéressé avait éclairci ce mystère alors qu’ils remontaient vers la maison :
— Pas un mot à ma mère concernant Clarisse. Elle souhaite tellement me voir casé qu’elle serait capable de prendre illico son téléphone pour l’inviter à nous rejoindre.
— Et alors ?
— Et alors quoi ? s’énerva Paul. Il n’y a rien entre Clarisse et moi et…
— Rien ?
Le ton ironique était évident.
— Moque-toi si tu veux, mais Clarisse accepterait très mal qu’on lui impose de jouer les belles-filles. Surtout si ma mère ajoute une allusion à son souhait de devenir grand-mère le plus vite possible.
Ainsi, les deux tourtereaux – comme Roger se plaisait à les appeler – n’étaient encore nulle part ! À une époque où, paraît-il, on se demandait mutuellement son prénom après avoir couché ensemble, c’était plutôt étonnant. Même lui, au temps de sa désormais lointaine jeunesse, aurait été plus rapide.
— Et si nous passions au dessert ?
Impossible de refuser une telle proposition pour une bonne fourchette comme Roger, malgré les deux portions de couscous qui avaient laissé peu de place dans son estomac. Il s’apprêtait à déguster des pâtisseries orientales dégoulinantes de sucre, mais à la place, la maman de Paul déposa quatre éclairs au chocolat sur la table.
— Le quatrième est pour le plus gourmand d’entre vous, précisa l’hôtesse. Il n’est toutefois pas interdit de le couper en deux.
— Après l’Orient, l’Occident, ne put s’empêcher de souligner Roger.
— Exact, monsieur Staquet. Mon défunt mari…
— Vous pouvez m’appeler Roger !
— Bien volontiers. Moi, c’est Martine. Mon mari, disais-je, m’a fait découvrir ses traditions et ma belle-mère, partie elle aussi, m’a initiée à la cuisine marocaine. Mais je reste fidèle à mes goûts, disons, historiques. J’ai toujours adoré les éclairs au chocolat et il y a à Petigny – le village d’à côté – un boulanger-pâtissier qui les réussit à merveille. Pourquoi m’en priver ? Et pourquoi en priverais-je mes invités ? Paul m’a dit que vous étiez fin gastronome et que vous aviez, chez vous, une cuisine de compétition ?
Roger se rengorgea, heureux que ses talents culinaires aient été remarqués. Décidément, la mère de Paul lui plaisait. Elle semblait heureuse d’avoir échangé son Bruxelles natal contre une jolie maisonnette dans un village qu’elle connaissait depuis longtemps car sa meilleure amie y habitait.
— L’immobilier est beaucoup moins cher ici ! avait-elle ajouté. Vous savez qu’en vendant mon appartement de Bruxelles, j’ai pu m’offrir cette maison et garder un bon bas de laine ?
— Et maintenant, Roger, un petit marc.
Ce n’était pas une question et il fut touché de l’attention. Paul connaissait depuis longtemps son penchant pour ce breuvage bourguignon. Une belle bouteille apparut sur la table. Prudent, Roger n’en prit qu’un doigt. Il avait l’intention de se coucher tôt et espérait passer une bonne nuit calme et reposante.
La suite des événements lui prouva qu’il se trompait.
** *
Paul Ben Mimoun ouvrit la porte de la cuisine et fit quelques pas dans le jardin. Une lune quasi pleine éclairait la pelouse, le bassin entouré d’hortensias et un bout de la prairie qui montait vers le bois tout proche. Il aspira la fraîcheur de la nuit à pleins poumons. Dans la pièce derrière lui, sa mère chipotait encore, il l’entendait ranger les tasses une à une, fermer un placard, rincer la carafe du percolateur avec soin : elle l’attendait, il le devinait, voulant profiter de chacune des minutes que son grand fils passerait sous son toit.
Il renonça à fumer une cigarette et revint se planter derrière elle, l’entourant de ses bras dans un mouvement affectueux, un peu maladroit.
— Tout va bien, maman ?
Elle rit, s’appuya une seconde contre son torse puis s’échappa aussitôt. Les gestes de tendresse, ils n’en avaient pas trop l’habitude dans la famille. Sans doute Martine Lambert aurait-elle aimé rester un moment de plus, blottie contre son fils, mais Paul savait qu’elle craindrait de le mettre mal à l’aise en abusant de cet instant de proximité qu’il venait de lui offrir.
— Tu veux encore une tasse de café ? Il en reste dans le thermos.
Paul accepta. Le café léger de sa mère ne risquait pas de l’empêcher de dormir. Il s’assit sur un coin de la table tandis qu’elle cherchait une ultime tâche à accomplir. Félix vint à la rescousse en miaulant dans ses jambes et elle lui servit quelques croquettes. Elle avait le dos tourné vers la gamelle quand elle se lança, mine de rien :
— Tu n’es pas triste que j’aie vendu l’appartement de Molenbeek ?
Paul, un peu surpris par la question, ne répondit pas tout de suite. Sa mère enchaîna :
— J’ai gardé toutes tes affaires, tu sais. Tes cours, tes bulletins, ton ballon de basket…
— Ne te tracasse pas, maman, tu as bien fait de venir ici. Le coin est si paisible, si calme, et puis tu habites près de chez Monique, maintenant. Ta meilleure amie depuis toujours.
Sa mère leva enfin les yeux vers lui et Paul y lut un tel soulagement qu’il en demeura interloqué. Jamais il n’aurait imaginé que la culpabilité pût la ronger à ce point : qu’était-elle allée imaginer ? Qu’il regrettait sa chambre d’ado ? Allons donc : sa vraie vie avait commencé quand il s’était installé à Namur et jamais il n’aurait voulu revenir en arrière. Pourquoi sa mère… mais d’autres pensées, plus sombres, vinrent se mêler aux premières : et si Martine lui prêtait le ressenti qui avait été le sien quand lui-même était parti ? La fameuse page qui se tourne, sans possibilité de revenir en arrière, c’était super quand on avait vingt ans, mais à bien y réfléchir, peut-être qu’à soixante, l’impression était tout autre.
Il prit un ton léger comme un souffle printanier pour ajouter :
— Tu exagères ! Pourquoi pas mes Playmobil, tant que tu y étais ?
Elle eut un petit rire gêné et il sut que ses chevaliers de plastique devaient l’attendre sur une étagère quelque part, avec leurs épées et leurs arbalètes, prêts à mener le combat, à le défendre contre un ennemi mortel : le temps qui passe.
Sa nuit fut paisible. Cette chambre où il n’avait pourtant presque jamais dormi, il s’y sentait chez lui grâce aux efforts de sa mère pour recréer l’atmosphère familière. Sans leur discussion dans la cuisine, il aurait sans doute jugé incongru de retrouver le poster de Michael Jordan punaisé en face de son lit mais avec ce nouvel éclairage, il en fut ému et s’allongea sous le regard confiant de son héros d’enfance, la légende des Chicago Bulls. Il s’endormit aussitôt, bercé par les légers ronflements qui émanaient de la chambre de Roger.
Dimanche 10 octobre
— Il faut que tu m’aides !
— Calme-toi, Monique, je t’en prie !
Ce sont les mots qui le tirèrent du sommeil. À travers les tentures mal fermées, un frais rayon de soleil se glissait déjà dans la chambre, mais Paul eut le sentiment que l’aube pointait à peine. Cette Monique était gentille mais un peu sans gêne quand même, se rappela-t-il en tentant de se rendormir. Débarquer un dimanche matin sans crier gare… Des souvenirs d’enfance lui remontèrent à l’esprit, Monique klaxonnant à tout va dans sa 4L lors d’un départ en vacances, Monique levant son verre avec un grand éclat de rire ou chantant à ses anniversaires tandis qu’il soufflait ses bougies…
Il tira la couette par-dessus sa tête : impossible de replonger dans le sommeil avec une pareille tornade dans la cuisine. Malgré les injonctions de Martine qu’il percevait par bribes – chut, Monique, pas si fort, tu vas réveiller Paul et son ami –, il était clair que sa grasse matinée était fichue, mais il refusait de capituler. Le nez dans l’oreiller, il respira la senteur délicate qui émanait de sa taie puis il bascula à nouveau sur le dos, les yeux ouverts fixés vers le plafond. Qu’est-ce qui pouvait provoquer un tel émoi chez la copine de sa mère ? La question, à dire vrai, ne l’intéressait qu’à moitié : sans doute, Jacob, son teckel, avait-il fugué une fois de plus. Pas de quoi alerter les pompiers ni prévenir la police fédérale.
— Je suis très inquiète, tu ne le connais pas…
La conversation continuait de lui parvenir par morceaux sans qu’il réussisse à lui donner un sens précis. Quand les effluves du café atteignirent ses narines, il sut que la partie était perdue et il décida de se lever. Quelle que fût la cause des émois matinaux de Monique, il allait bientôt être fixé.
** *
Roger n’avait pas fermé l’œil de la nuit. Du moins est-ce ainsi qu’en toute bonne foi il aurait évoqué ses heures de sommeil troublées, à plusieurs reprises, par un moustique intempestif. Seules les femelles piquaient, il le savait, et sans doute avait-il eu affaire à une drôlesse de la pire espèce, bien décidée à en découdre, à lui sucer la dernière goutte de son précieux sang, car elle avait vrombi à ses oreilles sans relâche.
Les battements d’ailes de ces bestioles pouvaient atteindre 2 300 mouvements à la seconde, avait-il lu quelque part, provoquant un tintamarre qui, au cœur de la nuit, s’apparentait davantage à un moteur d’avion à réaction. Destiné non à agacer les grincheux dans son genre, bien sûr, mais à capter l’attention des mâles des environs.
Couvert de papules allergiques, le vieux flic avait tenté, vers une heure du matin, de terrasser l’ennemi à coups de savate, convaincu qu’il appartenait à une division exotique et sanguinaire de moustiques-tigres, porteurs de la dengue ou du chikungunya. En vain.
Sur la pointe des pieds, il s’était rendu dans la salle de bains pour avaler un antihistaminique et enduire ses démangeaisons de pommade à l’arnica. Un tube dormait toujours dans sa trousse de toilette, encore un bon conseil d’Adeline, son épouse décédée, qui continuait de veiller sur lui.
Les charmes de la campagne, il serait inutile de les lui vanter avant un bon bout de temps, avait-il pesté en regagnant sa chambre. Ni de défendre devant lui la cause des moustiques, en évoquant la biodiversité ou la survie de l’écosystème. Selon son tribunal personnel, ils étaient condamnés à la peine capitale et basta.
La lumière à peine éteinte, le zonzon agressif avait repris de plus belle. Le combat avait encore duré un moment, jusqu’à ce que, excédé et sans la moindre culpabilité à l’idée de commettre un honteux carnage, Roger rallume une nouvelle fois sa lampe de chevet. D’un coup de pantoufle bien ajusté, il avait enfin réussi à écrabouiller l’ennemie qui, alourdie par tout le sang ingurgité, s’était aplatie contre la paroi dans une miniflaque rouge.
Au soulagement de Roger vint se mêler un soupçon de culpabilité : il avait sali le mur éclatant de Martine Lambert. Il lui proposerait de le repeindre, se promit-il. Ce fut sa dernière pensée avant de sombrer dans le sommeil.
** *
— Mais assieds-toi donc, tu me donnes le tournis !
Appuyé au chambranle de la porte, Paul dut bien constater que le souhait de sa mère n’allait pas être exaucé dans l’immédiat. Monique s’agitait, marchait entre la gazinière et le frigo tel un fauve captif et il eut bien envie de rebrousser chemin, d’éviter de l’affronter dans sa cage.
— Ah, te voilà enfin ! s’écria-t-elle en l’apercevant.
Paul sourit malgré lui. La grande Monique, stature imposante et bras de fort des Halles, n’avait pas changé. Un bandana fleuri coinçait toujours ses cheveux roux. Elle portait une large tunique en lin mauve et aussi un châle à franges qui évoquaient Woodstock, même si la copine de sa mère n’avait que sept ans au moment où le célèbre festival avait eu lieu. Tandis qu’elle se précipitait vers lui, il eut un peu de mal à déchiffrer son expression, curieux mélange de joie, de soulagement et d’inquiétude. Une seule certitude : quel que fût le problème – et la disparition de Jacob, le teckel fugueur, lui vint une nouvelle fois à l’esprit – il devrait jouer un rôle dans sa résolution. Partir à la recherche du cabot ne l’enthousiasmait guère, mais il constatait que leurs rapports, à Monique et lui, s’étaient peu à peu transformés au fil des années. Adieu l’époque où elle lui apprenait à nager. Aujourd’hui, c’était elle qui s’agrippait à lui comme à une bouée de sauvetage et ça ne lui déplaisait pas.
— Jacob a encore fugué ? lança-t-il, désinvolte, en se servant un mug de café.
— Jacob ?
Les deux femmes avaient répété le nom du chien en même temps, interloquées l’une et l’autre. Martine laissa le soin à son amie de rectifier et d’expliquer. De son côté, elle se contenta de secouer la tête en signe de dénégation puis elle se mit à griller du pain, à sortir miel et confitures, plus un bloc de Cheddar dont elle savait que Paul raffolait.
Les explications de Monique semblèrent tout d’abord assez confuses. Il est vrai que Paul était tiraillé entre les injonctions contradictoires des deux femmes ; les unes l’enjoignaient d’agir au plus vite pour sauver une victime qu’il ne connaissait pas, tandis que les autres, plus douces, insistaient pour qu’il mange au moins une tartine et goûte cette confiture de fraises, une nouvelle recette à laquelle on avait ajouté quelques zestes d’orange. Assis à la table de cuisine, Paul regardait alternativement l’un puis l’autre des visages penchés vers lui, tout en mastiquant avec application une large tranche de pain grillé enduite de confiture luisante.
— Alors ?
Elles avaient à nouveau parlé ensemble toutes les deux. Contraint de ne répondre qu’à une seule à la fois, Paul déclara :
— Délicieux !
Si Martine parut ravie d’un tel propos, le même mot provoqua la fureur de Monique :
— Mais non ! Je veux savoir ce que tu comptes faire ! Il y a urgence, tu t’en rends bien compte !
— C’est que… commença Paul, mais il fut aussitôt interrompu.
— Et de quelle nature est cette urgence ?
Roger Staquet avait posé la question sur un ton courtois qui coupa tout net le débit incohérent de Monique. Martine se précipita vers le percolateur tandis que son amie, comme tout à coup épuisée à l’idée de reprendre son récit une fois de plus, se laissait enfin tomber sur une chaise.
À son tour, Roger vint s’asseoir. Monique semblait hésiter. Devait-elle confier son problème à ce vieil inconnu aux cheveux humides, dont émanaient de légers effluves d’Aqua Velva ? Martine lui lança un signe discret, que Paul perçut néanmoins et qu’il traduisit comme une invitation à poursuivre.
— Monsieur Staquet est un ancien policier, ajouta sa mère à l’intention de son amie.
Ce dernier argument eut l’air de faire mouche. Monique gonfla son opulente poitrine, expira avec force et asséna à toute vitesse aux deux hommes médusés :
— On a retrouvé le corps d’une femme et mon ancien professeur de musique est accusé du meurtre. Il faut arrêter ça tout de suite. C’est une erreur judiciaire !
** *
— Qu’est-ce que tu en penses ?
— Sais pas… tu connais cette Monique mieux que moi. Elle est du genre à s’emballer pour un rien ?
— Du genre saint-bernard, c’est certain. Toujours prête à voler au secours des malheureux en péril. D’ailleurs, sans elle, je ne sais pas comment ma mère s’en serait sortie à la mort de mon père. Mais à ma connaissance, elle n’a jamais rien dramatisé. Si elle dit que c’est sérieux, on peut la croire sur parole.
Ils marchaient vers le centre de Nismes, du pas nonchalant de deux amis en train de digérer un petit-déjeuner trop copieux. Pensif, Roger avançait, les mains croisées dans le dos, tandis que Paul fouettait les herbes des bas-côtés à l’aide d’une vieille canne en bois qu’il venait de retrouver, sculptée jadis avec son premier canif de gamin. Ils croisèrent des familles endimanchées à la sortie de la messe, reçurent quelques bonjours cordiaux d’inconnus. Après les inondations de l’été, octobre resplendissait et tout le monde semblait heureux de profiter de cette belle matinée automnale.
— Et ce René Letellier, ça ne te dit vraiment rien ?
Rien de rien. Paul cherchait en vain dans sa mémoire depuis que Monique leur avait mentionné le nom du malheureux suspect. La brave femme en traçait pourtant un portrait enthousiaste : son prof de piano quand elle était jeune, un homme toujours si élégant, si délicat…
Paul fit un pas de côté pour éviter une crotte de chien, et précisa : des cours particuliers, Monique en avait suivi des tas, tout au long de sa vie. Poterie, vannerie, yoga et peinture sur soie, voire sculpture de totems à une époque. Et chaque fois, son professeur se parait de qualités exceptionnelles qu’elle vantait le temps que durait sa passade, jusqu’à ce qu’un nouveau gourou vienne supplanter le précédent.
Mais ce gourou-ci semblait avoir laissé plus de traces que les autres. Les deux hommes avaient bien remarqué le tremblement de Monique quand elle leur avait tendu sa photo. Pourtant, on y devinait juste une vague silhouette haute et mince, auréolée de cheveux fous.
— On aurait dit Pierre Richard, dans Le Grand blond avec une chaussure noire, tu ne trouves pas ? questionna Roger. J’ai l’impression que ces cours de piano ne datent pas d’hier. Quand on voit cette photo… Plus personne ne fait de polaroïd aujourd’hui.
— Tu as raison. Si ça tombe, je n’étais même pas né quand elle l’a prise. On aurait dû lui demander à quelle époque elle a mozartisé.
Roger apprécia le néologisme d’un clin d’œil.
— Ceci dit, en dehors de Charles Aznavour, qu’elle écorche souvent en conduisant, je ne lui ai jamais connu de liens très étroits avec la musique, ajouta Paul.
— Pas le genre à interpréter le Concerto 21 de l’ami Wolfgang, si je comprends bien.
— Pourquoi ce concerto-là plutôt qu’un autre ?
— Mon favori, tout simplement.
— Je ne te savais pas mélomane.
— Je ne le suis pas, mais j’adore ce morceau… Et la victime ?
Paul crut un moment que son ami perdait la boule : Mozart et puis, ex abrupto, retour à la victime. Il lança un regard inquiet vers Roger : « René Letellier ?… »
— Mais non, gros malin, je veux dire la « vraie victime », Valérie Janssens, celle que Letellier est accusé d’avoir tuée.
Mais là non plus, les souvenirs de Paul ne furent d’aucun secours. Forcément, même Monique ignorait qui était cette femme et les renseignements qu’elle avait réussi à glaner à son sujet étaient plutôt maigres : Valérie Janssens suivait des cours de piano. Veuve, trente-cinq ans, pas d’enfants. Une femme sans histoires, domiciliée à Walcourt. Letellier était la dernière personne à l’avoir vue en vie.
— Elle vivait à Walcourt ? Et elle se rendait à Couvin pour suivre ses cours de piano ? Car c’est bien là qu’habitait Letellier, non ? Trente kilomètres, ce n’est pas rien ! M’étonnerait qu’il n’y ait pas eu de bons professeurs plus près…
** *
Ils n’avaient rien promis à Monique. Tout au plus s’étaient-ils engagés à se renseigner, même s’ils ne connaissaient pas les collègues en charge de l’affaire. Le dossier avait été confié à une unité de la police judiciaire fédérale, sans lien avec Louvain-la-Neuve où Paul Ben Mimoun exerçait son métier d’inspecteur de police, ni Bruxelles, là où Roger avait terminé sa carrière.
Avisant une terrasse de bistrot, Paul proposa un arrêt.
— Déjà fatigué ? questionna Roger. À moins que tu n’aies pas bu assez de café ce matin ?
Le jeune flic sourit. Ils avaient quasiment dû s’enfuir de la maison pour échapper tant à la sollicitude maternelle qu’à la demande pressante de Monique qui voulait les voir voler au secours de Letellier sans plus tarder.
— Il y a une connexion Internet accessible de ce bistrot : je voudrais surfer un peu pour voir ce que dit la presse sur ce Letellier. Tu es d’accord pour un autre café ?
— Le dernier de la journée, alors. C’est une règle que je me suis fixée. Et puis, j’ai envie de dormir la nuit prochaine. Je risque déjà de passer des heures à me retourner dans mon lit en pensant à notre affaire…
— « Notre » affaire ? N’anticipe pas, Roger, n’anticipe pas… Si ça se trouve, à l’heure actuelle, Letellier a déjà avoué. À moins qu’il n’ait été relâché faute de preuves ou grâce à un alibi en béton.
Ils prirent place à une table ensoleillée que Paul abandonna très vite pour se rendre à l’endroit où, selon l’expression imagée de Roger, le roi se rendait à pied. À son retour, deux tasses de café étaient posées sur la table et Roger Staquet tirait sa tête des mauvais jours.
— Un problème ? questionna Paul.
Il connaissait son ami par cœur. Si quelque chose le chiffonnait, qu’il s’exprime au plus vite, on ne pourrait de toute façon pas passer outre avant qu’il ait vidé son sac.
— Pas vraiment, mais une belle connerie ! explosa Roger. Tu te rends compte que la jouvencelle callipyge qui trône derrière le bar m’a souhaité une bonne dégustation ! Une bonne dégustation ! Pour deux malheureux cafés qu’elle a amenés sans y adjoindre la moindre douceur.
Paul ne comprenait pas plus les raisons d’un tel énervement que le vocabulaire employé pour l’expliquer.
— « Jouvencelle callipyge » ? Tu ne saisis pas ? Mais regarde cette serveuse : c’est une femme, elle est plus jeune que toi et possède un derrière, disons, imposant ! Traduction : « Nana au gros cul », ça te va mieux ?
— Parle moins fort, elle pourrait nous entendre.
— M’en fous ! « Bonne dégustation ! » C’est la formule à la mode. Tu ne peux plus t’asseoir dans un restaurant sans qu’on te la serve, y compris avec un café tiède.
— Là, tu exagères, ce café m’a l’air bien chaud.
— M’en fous aussi ! Et je te parie que si on lui demande quelque chose, elle répondra « Pas de souci ! ». « Bonne dégustation » et « Pas de souci » : avec ces deux formules, maintenant, tu dis tout. Ces tics de langage m’énervent.
Durant cette diatribe, Paul avait repris sa place et tiré son smartphone de sa poche. Il le déposa à côté de sa tasse, but une gorgée et, souriant, s’adressa à son ami.
— Bon, ce café n’est pas mauvais, je trouve la jouvencelle plutôt jolie, le soleil brille et nous avons des questions concernant un meurtre qui affecte une personne que j’aime beaucoup. On avance ou tu continues à vitupérer sur les modes lexicales actuelles, ce qui, soit dit en passant, te fait passer pour un vieux encore plus grincheux que tu ne l’es réellement ?
Comme il l’avait prévu, Roger grommela encore un peu pour la forme puis se tut. Paul alluma son smartphone et se plaça de manière à ce que son ami puisse voir, lui aussi, ce qui allait apparaître sur l’écran…
Leurs recherches avortèrent, hélas, assez vite. Le site de La Nouvelle Gazette regorgeait toujours d’articles sur les inondations qui venaient de toucher la région : on cherchait des bénévoles pour nettoyer les berges du Viroin, on félicitait le bel élan de générosité qui avait offert plus de cent repas aux sinistrés de Couvin, les déchetteries étaient débordées. La recrudescence des cas de Covid-19 arrivait en seconde position.
Dans ce contexte de crise, La Morte du Trou du diable, malgré un titre accrocheur, relevait du simple fait divers et les renseignements fournis par l’article étaient assez vagues : « Vendredi soir, le corps sans vie d’une femme âgée de trente-cinq ans, Valérie Janssens, a été découvert par un touriste flamand. » Suivaient quelques lignes sur les émois du pauvre homme, un marcheur chevronné qui, après sa chute inopinée au Trou du diable, s’était retrouvé nez à nez avec le cadavre.
L’auteur avait toutefois tenté d’étoffer son article en rappelant un autre fait divers, peu connu : en 1932, une patrouille de scouts était déjà tombée sur un cadavre, lors d’une descente en rappel dans un fondry annexe du Fondry des Chiens. Les jeunes, en quête de sensations fortes, avaient choisi ce trou parce que c’était le plus profond et ils n’avaient pas été déçus. Ils y avaient trouvé un sac de marche, une paire de chaussures de rechange… et un squelette ! Après enquête, la police avait conclu à un accident.
— C’est si dangereux que ça de se promener autour de Nismes ? questionna Roger.
Selon Paul, il ne fallait pas exagérer, mais le Fondry des Chiens était une vraie curiosité géologique. Le temps, l’érosion et les hommes avaient creusé le plateau en différents endroits. On pouvait sans danger visiter le trou le plus imposant mais, encore aujourd’hui, il valait mieux faire attention où on mettait les pieds si on s’écartait des chemins. Alors, de nuit, sans éclairage et en 1914…
— Pourquoi 1914 ?
— D’après l’article, il y avait des pièces de monnaie près du cadavre et toutes avaient été frappées avant la Première Guerre mondiale.
Roger réfléchit un instant et murmura à voix basse, comme pour lui-même.
— Imaginons que le meurtrier ait eu vent de cette histoire. Elle a pu l’inspirer. Il aurait choisi une ardoisière du Trou du diable, en espérant que, dans ce coin désert, « son » cadavre puisse rester planqué quelques années avant d’être découvert. Si c’est le cas, il faudra chercher parmi les gens du village qui connaissent bien les lieux : historiens locaux, familles implantées dans le coin depuis longtemps, descendants des scouts ayant découvert les restes du voyageur égaré…
— Ça fait beaucoup de monde, rétorqua Paul. Et on n’est même pas certains que cette piste soit la bonne. N’oublie pas que les ardoisières sont à la limite de Viroinval et à plusieurs kilomètres de la zone des fondrys.
Roger s’ébroua sur son siège.
— Exact, monsieur l’agent. Mais gardons néanmoins ma petite idée dans un coin de la tête. On ne sait jamais…
** *
La seule insistance de Monique n’aurait pas suffi à les convaincre. D’autant que l’affaire Letellier ne semblait pas aussi simple qu’elle le croyait. Une ultime info, non confirmée, venait de fuiter sur les réseaux sociaux, selon laquelle on aurait découvert des traces de sang dans le jardin du vieux professeur de piano. Et c’était la dernière personne à avoir vu la victime en vie. « Si on lui déniche un mobile, la messe sera dite ! » avait anticipé Staquet.
Au retour de leur balade dominicale, ils avaient quasiment décidé de laisser tomber : la police judiciaire officielle se chargerait fort bien de mener l’enquête toute seule. Elle finirait par relâcher René Letellier si, malgré les apparences, il était bel et bien innocent. Comment l’aide d’un flic sans expérience couplée à celle d’un retraité de fraîche date pourrait-elle surpasser le boulot mené par une équipe chevronnée, disposant de moyens humains et logistiques dont eux-mêmes étaient totalement dépourvus ?
Allons : même s’il était déjà arrivé à leur improbable duo de remporter l’un ou l’autre joli succès dans des cas un peu embrouillés2, il leur fallait être réalistes et ne pas se prendre pour des héros sans faille, des justiciers capables d’en remontrer aux plus fins limiers de la police belge.
Paul se chargerait de faire entendre raison à la tumultueuse Monique. Et il avait pour ce faire un argument de poids qui lui était passé par la tête tandis que Roger et lui regagnaient la maison de sa mère. Qui sait si remuer ciel et terre pour sauver Letellier ne risquait pas, au contraire, d’attirer sur lui l’inimitié des enquêteurs officiels, peu susceptibles d’apprécier qu’on leur expliquât comment faire leur métier ? Quant à Roger, il lui restait une heure pour faire ses bagages avant de reprendre, à Mariembourg, le train vers Louvain-la-Neuve.
Lorsqu’ils atteignirent le hall coquet de Martine Lambert, le silence régnait dans la maison. Mais Roger eut l’impression – prémonition due à son instinct de flic ? – que ce calme avait quelque chose d’oppressant. Où étaient passées les deux femmes ? Contre toute attente, Monique serait-elle déjà partie ? Ou telle une Don Quichotte moderne, se serait-elle lancée seule dans son combat contre les moulins à vent judiciaires ?
Tout à coup, un bruit sourd leur parvint de la cuisine et les deux hommes s’y précipitèrent.
— Monique ! s’exclama Paul en découvrant l’amie de sa mère étendue sur le sol.
Elle était plus blême qu’un peignoir de thalasso. Par contraste, le filet de sang qui s’écoulait de sa tempe semblait d’un rouge quasi luminescent. Martine Lambert, accourue en même temps qu’eux, s’accroupit à ses côtés et se mit à marmotter des supplications : « Monique, réveille-toi, je t’en prie ; oh, mon Dieu, non, Monique, parle-moi… »
— Qu’est-ce qui s’est passé ? questionna Roger, tout en prenant le pouls de la victime.
Il était faible, léger comme un souffle de moineau sous ses doigts, mais bien perceptible néanmoins. Le vieux flic composa aussitôt le 112, tandis que Paul attrapait doucement sa mère par les épaules pour la faire reculer. Martine refusa de bouger.
— Un malaise soudain, expliquait Roger au téléphone.
Sans doute un AVC ou une crise cardiaque, selon lui. Cette pauvre femme s’était mise dans un tel état que son cœur avait lâché. Bien que basique, cette explication lui semblait, de prime abord, la plus crédible. Un coup d’œil vers la table de cuisine compléta le diagnostic : en tombant, Monique s’était cogné la tempe contre l’angle du plateau.
— Va lui chercher un plaid, suggéra Paul à sa mère.
Il la connaissait bien. Qu’elle se sente utile, chargée d’une mission, aussi minime fût-elle, c’était le seul moyen pour qu’elle accepte de s’éloigner un instant du corps inerte que sa sollicitude menaçait d’étouffer.
Martine Lambert prit appui sur la table et se releva ; sa frêle silhouette semblait tout à coup chargée d’un poids trop lourd pour elle. Paul, alarmé par son souffle court et ses narines pincées, craignit qu’elle ne fît un malaise à son tour. Il s’approcha pour l’aider et c’est alors qu’il découvrit un smartphone échoué sur le sol, à côté du corps de Monique. Il le ramassa tandis qu’une idée germait dans son esprit :
— Maman…
Sa mère, qui s’éloignait à la recherche du plaid, se retourna vers lui.
— Monique téléphonait quand…
Il eut très vite confirmation du bien-fondé de son intuition. Martine était à la salle de bain lorsqu’un célèbre solo de Mark Knopfler avait résonné dans la cuisine. Le meilleur guitariste de tous les temps, d’après Monique.
— La sonnerie de son smartphone… murmura Paul. Tu sais qui l’appelait ?
Hélas non. À leur arrivée, la guitare de Knopfler s’était tue et le téléphone gisait par terre.
— On va vérifier, déclara Roger. Ou plutôt, tu vas vérifier, dit-il à Paul, parce que moi, avec ces engins…
Mais le numéro n’était pas encodé. Les deux hommes échangèrent un regard et Roger acquiesça, sans qu’aucun mot ne fût prononcé. Tandis qu’il attrapait un torchon propre pour éponger la tempe ensanglantée de Monique, Paul enclenchait la touche de rappel :
— Centre de santé des Fagnes, bonjour, en quoi puis-je vous aider ?
Il eut bien du mal à remonter l’appel. Le numéro était celui de l’accueil. « N’importe qui peut utiliser ce téléphone… », commença la standardiste, d’un ton patient. « Un médecin de garde, une des infirmières, même un membre du personnel d’entretien… » Le jeune inspecteur interrompit l’inventaire pour souligner l’importance de sa demande. Il devait absolument savoir qui avait appelé Monique Ledent un quart d’heure plus tôt. Son insistance finit par payer : un interne, médecin de garde, remplaça la standardiste. Il avait contacté Monique pour lui signaler la tentative de suicide d’un certain… après consultation du dossier, le nom tomba : René Letellier.
« Monsieur Letellier a été placé en coma artificiel, poursuivit le jeune urgentiste. À son arrivée, bien que très affaibli, il pouvait encore s’exprimer. Juste avant de sombrer, il m’a fait promettre d’appeler Madame Ledent. Du coup, j’ai pris la liberté… ». Il semblait conscient d’avoir outrepassé les limites de sa fonction. D’autant que le patient, admis aux urgences, était sous mandat d’arrêt au moment des faits. Monsieur Letellier avait pourtant été vu par le médecin de permanence au commissariat, précisa l’urgentiste, mais peu après, il avait tenté de se pendre dans sa cellule en utilisant sa chemise qu’il avait torsadée. Ça avait occasionné pas mal de remous chez les policiers, ajouta le médecin, comme pour souligner que s’il avait commis une erreur dans le respect des procédures, il n’était sans doute pas le seul. Il accepta de donner son nom – Max Cordeau – avant de raccrocher.
Letellier dans le coma. Et la nouvelle avait tellement troublé Monique qu’elle en avait fait un malaise. Voilà une histoire qui prenait des proportions… mais Paul n’eut pas l’occasion d’analyser la situation plus en détail : une sirène hululait, toute proche, et bientôt deux ambulanciers balèzes, au physique de culturistes survitaminés, firent irruption dans la cuisine. La pièce sembla aussitôt rétrécir, mais les deux hommes prirent la situation en main :
— Comment s’appelle-t-elle ? Elle a avalé quelque chose ?
Martine fournit les informations demandées d’une voix sans timbre. L’un des ambulanciers s’accroupit :
— Monique, vous m’entendez ? Serrez-moi la main ! demanda-t-il tandis que l’autre s’efforçait de dégager la pièce.
— Reculez, s’il vous plaît, laissez-nous travailler !
Roger s’effaça et Paul posa un bras sur les épaules de sa mère :
— Viens, maman…
— Je veux l’accompagner.
— On va les suivre, je te le promets.
À leurs pieds, les ambulanciers s’activaient à mettre en place minerve et masque à oxygène. « À trois, on soulève… » Ils glissèrent le grand corps de Monique sur une civière, comme s’il ne pesait pas plus lourd qu’un enfant de cinq ans, et quittèrent aussitôt la maison.
— Où l’emmenez-vous ? questionna Martine.
— Centre de santé des Fagnes, cria l’un des culturistes avant de claquer la portière.
La sirène reprit son hululement strident, emportant Monique vers son destin. Elle n’avait toujours pas repris connaissance. Martine empoigna son sac et ses clés, prête à la suivre.
— Tu es toujours en pantoufles, maman !
Tandis qu’elle enfilait une paire de chaussures, Paul et Roger échangèrent quelques mots en aparté : les tentatives de suicide n’étaient pas rares, en cas d’erreur judiciaire, ils le savaient.
— Mais pourquoi Letellier voulait-il qu’on appelle Monique ? murmura Roger.
— Pourquoi prend-elle cette affaire tellement à cœur ? poursuivit Paul. Au point de faire un malaise cardiaque en apprenant…
— Je suis prête, déclara bientôt Martine Lambert.
Sa petite silhouette se dressait derrière eux, bien droite, déterminée. Malgré sa gracilité, elle laissait clairement entendre qu’il aurait fallu être plus costauds qu’ils ne l’étaient pour l’empêcher de rejoindre l’hôpital séance tenante. Il ne leur restait qu’à obéir.
** *
— Arrête de tirer sur cette laisse, Jacob !
Il n’était pas loin de vingt-deux heures. Dans le ciel sombre, une lune opalescente éclipsait l’éclairage public cent pour cent LED dont la commune de Viroinval était si fière.
— Jacob ! s’évertua encore Roger, mais le teckel, attiré par l’Eau Noire, n’en faisait qu’à sa guise. Il voulait descendre un des plans inclinés qui permettait de rejoindre la rivière canalisée, au milieu du village. Roger empoigna le cabot par son collier afin de le remettre dans le droit chemin.
Malgré son envie de regagner son appartement au plus tôt, il n’était pas rentré à Louvain-la-Neuve ce soir-là. Le souvenir de son combat contre le moustique-tigre, transmetteur potentiel de maladies exotiques fatales, était toujours très vif dans son esprit mais, d’une part, il en était sorti vainqueur et, d’autre part, deux femmes en détresse comptaient désormais sur lui. Ou plutôt sur Paul et lui : Madame Ben Mimoun tout d’abord, très ébranlée par la situation, et son amie Monique. Les médecins lui avaient diagnostiqué un AIT ou un AVC, et même si Roger ne saisissait qu’à moitié la subtile différence entre les deux, il avait bien compris que le cas était sérieux.
Martine avait pu rester à son chevet un moment, tandis que les deux hommes, à sa demande, étaient retournés à Nismes lui chercher des effets de toilette.
— Fouille dans mes affaires, l’armoire bleue de la salle de bain, avait ordonné Martine à son fils. Il y a au moins une brosse à dents neuve, du dentifrice et du savon, des gants de toilette… ça la dép