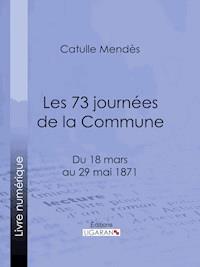
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Que veut dire ceci ? où allons-nous ? Qui nous mène ? D'où vient le vent qui souffle ? Est-ce une tempête qui va tout bouleverser profondément, n'est-ce qu'une rafale soudaine et peu durable ? S'agit-il, en un mot, d'une révolution ou simplement d'une émeute ? Aujourd'hui 18 mars, vers quatre heures du matin, j'ai été réveillé par un bruit de pas nombreux. De ma fenêtre, dans le brouillard terne, entre les maisons closes, j'ai vu passer une escouade de soldats."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un Parisien, resté à Paris malgré la Commune, écrivait chaque soir ce qu’il avait vu et entendu dans la journée. Il guettait les évènements, interrogeait les opinions, observait la ville, puis il écrivait. De là un assez grand nombre de feuillets, récits, réflexions, impressions notées à la hâte. Je les ai réunis, et j’en ai fait ce volume. Il eût été possible, d’après ces notes comparées et condensées, de composer un véritable livre ; j’ai préféré publier simplement un Journal. En attendant que le moment soit venu, pour un autre ou pour moi, d’une œuvre définitive, vous trouverez ici une histoire au jour le jour de nos misères, un tableau, retouché à chaque heure, de Paris pendant la Commune, et, çà et là, les pensées d’un esprit sincère et sans parti pris.
30 mai 1871.
C.M.
Que veut dire ceci ? où allons-nous ? Qui nous mène ? D’où vient le vent qui souffle ? Est-ce une tempête qui va tout bouleverser profondément, n’est-ce qu’une rafale soudaine et peu durable ? S’agit-il, en un mot, d’une révolution ou simplement d’une émeute ?
Aujourd’hui 18 mars, vers quatre heures du matin, j’ai été réveillé par un bruit de pas nombreux. De ma fenêtre, dans le brouillard terne, entre les maisons closes, j’ai vu passer une escouade de soldats. Ils marchaient lentement, enveloppés dans leurs capotes grises ; quelques-uns rasaient les murs. Il tombait une petite pluie fine. Je suis descendu à la hâte et j’ai interrogé deux traînards.
– Où allez-vous ? ai-je demandé.
– Nous ne savons pas, a répondu l’un.
– Il paraît que nous allons à Montmartre, a dit l’autre.
Ils allaient à Montmartre, en effet. Dès cinq heures du matin, le 88e de ligne a occupé le plateau de la butte et les petites rues avoisinantes. Plus d’un, parmi ces pauvres lignards, connaissaient ces ruelles pour les avoir gravies le dimanche en compagnie de quelque payse aux joues de pomme, en service chez des bourgeois du quartier. On se promenait sur la place Saint-Pierre, on s’arrêtait devant la baraque du tir, admirant l’adresse des uns, raillant la maladresse des autres. Quand on avait deux sous dans la poche, on jetait une grosse boule dans la gueule d’un monstre imaginaire peint sur une planche carrée ; la payse trouvait les macarons excellents. Mais ce matin il n’y avait ni payse ni jeux de macarons sur la place Saint-Pierre. Il a fallu se tenir immobile, l’arme au pied, dans la boue. Ces pauvres diables de lignards ne devaient pas être contents.
Ah ! les canons de la garde nationale, ces maudits canons ! Qu’ils aient beaucoup servi contre les Prussiens, c’est ce que personne ne saurait affirmer. Ils se sont tenus coi pendant le siège ; on n’entendait parler d’eux que le jour où on les payait et le jour où on les baptisait, ils étaient neufs, élégants et jolis, et ne semblaient pas le moins du monde avoir envie de se noircir de poudre. On pouvait du moins espérer qu’ils garderaient toujours leur attitude pacifique, et que, n’ayant pu être utiles, ils ne seraient jamais dangereux. Eh bien ! pas du tout. Le mal qu’ils n’ont pas fait à la Prusse, c’est à la France qu’ils le font. Ironie cruelle ! ces canons, c’était Paris lui-même, tout entier, qui s’était fait bronze pour se défendre. On avait fabriqué ces pièces de sept, de huit, de vingt-quatre, ces mitrailleuses américaines, avec l’épargne des ménagères riches ou pauvres, avec les louis des hommes opulents et les liards des meurt-de-faim ; les artistes avaient offert leurs talents, les poètes leurs vers, les marchands leurs recettes, pour qu’on achetât des canons, des canons encore. Toutes les bouches à pain s’étaient privées pour qu’on eut des bouches à feu. Et voici que maintenant ces engins de guerre, qui n’ont pas servi pour la guerre nationale, causent la discorde civile, et au lieu de sauver Paris, le ruinent.
Ce sont ces canons que le 88e de ligne est allé chercher à Montmartre. Il les a pris d’abord, mais on les lui a repris, ou, pour mieux dire, il les a rendus. À qui ? à la foule, à des femmes, à des enfants. Quant aux chefs, on ne sait ce qu’ils sont devenus. On raconte pourtant que le général Lecomte a été fait prisonnier et conduit au Château-Rouge. Place Pigalle, à neuf heures, des chasseurs d’Afrique font une charge assez vigoureuse les gardes nationaux répondent par un feu de peloton. Un officier de chasseurs s’avance ; il tombe, frappé d’une balle. Ses soldats s’enfuient, la plupart chez les marchands devins, où ils fraternisent avec les patriotes qui offrent à boire. On m’affirme à l’instant même que le général Vinoy était à ce moment tout près de la place Pigalle, à cheval. Des femmes ont fait cercle autour de lui et l’ont hué. Un enfant lui a lancé une pierre, un autre lui a jeté sa casquette à la tête. Le général, piquant des deux, a disparu. Gardes nationaux et soldats se promènent bras dessus, bras dessous, à Montmartre et sur les boulevards extérieurs. Ils commencent à se répandre dans Paris. Je viens de voir passer un groupe passablement aviné. Toute cette affaire ressemble un peu à ces duels qui se terminent par des déjeuners.
Que va devenir ceci ? Nul ne saurait le dire. À qui la faute ? aux maladroits.
Certainement, les gardes nationaux de Montmartre n’avaient pas le droit de garder des canons qui appartenaient à la garde nationale tout entière ; ils n’avaient pas le droit d’inquiéter la tranquillité renaissante, le commerce refleurissant, les étrangers revenus, Paris enfin, par ces gueules de bronze tournées vers nos maisons, et le gouvernement, en bonne justice, pouvait et même devait faire cesser cet état de choses. Mais l’emploi de la force était-il indispensable pour parvenir à ce résultat ? Avait-on épuisé tous les moyens de conciliation ? Ne pouvait-on espérer encore que, gagnés par la lassitude, les citoyens de Montmartre finiraient par abandonner les canons qui, déjà, étaient à peine gardés, et, gênés eux-mêmes par leurs propres barricades, repaveraient leurs places et leurs rues ? M. Thiers et ses ministres n’ont pas été de cet avis ; ils ont préféré agir et sévir. Fort bien. Mais quand on prend de telles résolutions, il faut être sûr de les accomplir. Dans des circonstances d’une telle gravité, ne pas réussir, c’est avoir eu tort de tenter.
Eh ! dira-t-on, le gouvernement pouvait-il supposer que les lignards lèveraient la crosse en l’air, que les chasseurs, après avoir perdu un seul officier, ne songeraient plus qu’à tourner le dos, et que tous les exploits des troupes régulières se borneraient à de copieuses bombances en compagnie des insurgés ? Non seulement le gouvernement aurait pu supposer cela, mais je ne conçois pas qu’il ait pu un seul instant espérer un dénouement qui ne fût pas absolument celui-là. Comment ! depuis bien des jours déjà, les soldats oisifs erraient dans les rues avec les gardes nationaux ; ils logeaient chez les Parisiens, mangeaient leur soupe, courtisaient leurs femmes, leurs filles ou leurs bonnes. Déshabitués de la discipline par le relâchement que la défaite avait introduit dans l’organisation militaire, désabusés du prestige que les chefs essayent en vain de conserver après des désastres, importunés de leur uniforme qui désormais ne pouvait plus leur inspirer de fierté, ils devaient évidemment être tentés de se mêler à la population, de se confondre parmi ceux à qui l’humiliation de la défaite incombait moins directement. Le soldat vaincu voulait se cacher dans le citoyen. D’ailleurs, les généraux, les colonels, les capitaines ne connaissaient-ils pas l’esprit des troupes ? Faut-il admettre qu’ils se soient grossièrement trompés à ce sujet, ou qu’ils aient trompé le gouvernement ? Donc celui-ci pouvait et par conséquent devait être en situation de prévoir le résultat de sa tentative de répression. Il avait peut-être le droit de sévir, mais il n’avait pas celui d’ignorer qu’il n’en avait pas le pouvoir. Maintenant, cent mille fusils, chassepots, tabatières et pistons, trinquent chez les vendeurs de vins frelatés et d’alcool. Le gouvernement se tirera-t-il de l’impasse où il s’est précipité tête baissée ?
À trois heures, il y avait un groupe assez considérable – soldats, gardes, femmes, enfants – dans une des rues avoisinant l’Élysée-Montmartre. La personne qui m’a raconté ceci ne se rappelle pas le nom de la rue. On pérorait vivement, avec de grands gestes. Il était surtout question du général Lecomte, accusé d’avoir par trois fois ordonné à ses troupes de faire feu sur la milice citoyenne.
– Il a bien fait, dit un vieillard qui était là, écoutant.
Il y eut à ces mots une tempête de jurons et d’imprécations.
– Il avait reçu de ses chefs l’ordre de s’emparer des canons et de disperser les attroupements, reprit le vieillard avec calme ; il devait obéir.
Les hurlements redoublèrent. Une femme, une cantinière, s’approcha de l’homme qui s’exposait ainsi à la fureur de la foule, le regarda sous le nez et dit :
– C’est Clément Thomas !
C’était, en effet, le général Clément Thomas ; il n’était pas en uniforme. Les injures les plus grossières lui furent adressées par cent bouches à la fois, et, selon toute apparence, la colère du groupe ne se serait pas bornée à des paroles si un homme ne s’était écrié :
– Ah ! tu défends ce scélérat de Lecomte ? eh bien, nous allons te mettre avec lui. Ça fera une jolie paire de…
Ce projet fut approuvé, et M. Clément Thomas fut conduit, non sans avoir à subir plus d’un outrage, au Château-Rouge, où le général Lecomte était enfermé depuis le matin.
À partir de ce moment, le récit que j’ai recueilli diffère peu des différentes versions qui circulent dans la ville.
Vers quatre heures les deux généraux furent tirés de leur prison par une centaine de gardes nationaux. On avait attaché les mains du général Lecomte. M. Clément Thomas n’avait pas de liens. On les conduisit sur le sommet de la butte Montmartre. On s’arrêta devant le n° 6 de la rue des Rosiers. C’est une petite maison que j’ai été voir depuis ; il y a un jardin devant ; elle a l’air bourgeois et paisible. Ce qui se passa dans cette maison ne sera peut-être jamais su. Était-ce là que siégeait alors le Comité central de la garde nationale ? Le Comité s’y trouvait-il tout entier, ou n’y était-il représenté que par quelques-uns de ses membres ? Plusieurs personnes supposent que la maison n’était pas occupée, et que les gardes y firent entrer les prisonniers pour faire croire à la foule qu’on allait procéder à un jugement, et pour donner ainsi une apparence de légalité à l’exécution qu’ils préméditaient.
Il faut ajouter que, d’après certains témoignages, il y avait des lignards parmi les gardes qui entouraient les généraux.
Le procès – en supposant qu’il y ait eu procès – ne fut pas long.
À l’un des bouts de la rue, il y a un mur de clôture ; c’est là que furent conduits les condamnés.
Dès qu’on eut fait halte, un officier de la garde nationale saisit violemment M. Clément Thomas par le collet de son habit, le secoua à plusieurs reprises, et enfin lui plaça un revolver sur la gorge.
– Avoue, dit-il, que tu as trahi la République.
M. Clément Thomas ne répondit que par un mouvement d’épaules. Alors l’officier se retira.
Le général se trouvait seul et debout devant la muraille.
Qui donna le signal ? On ne sait. Une vingtaine de détonations éclatèrent à la fois. M. Clément Thomas tourna sur lui-même et tomba, la face en avant.
– À ton tour ! dit un des assistants au général Lecomte.
Celui-ci, de lui-même, sortit des rangs, enjamba le cadavre de Clément Thomas, s’adossa au mur, et attendit.
– Feu ! cria un officier.
Il y a une heure, j’ai rencontré rue des Acacias une vieille femme qui offrait pour 3 francs une balle qu’elle avait retirée du plâtre de la muraille, au bout de la rue des Rosiers.
Il est dix heures du soir. Si je n’étais point si las, je me dirigerais vers l’Hôtel de Ville. On dit que la garde nationale s’en est emparée ; le 18 mars continue le 31 octobre. Mais cette journée m’a horriblement fatigué, j’ai à peine la force d’écrire ce que je viens de voir et d’entendre çà et là.
Sur les boulevards extérieurs, les débits de liqueurs regorgent d’ivrognes. Il y a des badauds pour regarder boire ces hommes qui se vantent d’avoir fait une révolution. Quand « le coup » a réussi, il se trouve toujours un tas de chenapans pour dire : « C’est moi qui ai fait le coup ». On cause, on rit, on chante. À chaque pas des fusils en faisceaux. Au coin du passage de l’Élysée-des-Beaux-Arts s’amoncelait, quand je suis passé, un tas grouillant d’hommes couchés. Plus loin, j’ai vu tout un bataillon, l’arme au pied, prêt à se mettre en marche. À l’entrée de la rue Blanche et de la rue Fontaine, quelques pavés posés les uns sur les autres voudraient avoir l’air d’une barricade. Rue des Abbesses, j’ai compté trois canons ; une mitrailleuse menace la rue des Martyrs. Rue des Acacias, un homme a été arrêté et conduit au poste par une patrouille de gardes nationaux ; j’ai entendu dire qu’il avait volé. Arrêter un ou deux voleurs, c’est une des traditions de l’émeute parisienne. D’ailleurs, le désordre n’est pas excessif. Si tous les hommes ne portaient pas l’uniforme, on pourrait croire que c’est un soir de fête populaire ; les vainqueurs s’amusent.
Il y avait peu de soldats, ce soir, parmi les fédérés : ils sont peut-être rentrés dans les casernes, par habitude, pour manger la soupe.
Sur les grands boulevards, des groupes tumultueux commentent les évènements de la journée. Au coin de la rue Drouot, un officier du 117e bataillon lit à haute voix, ou plutôt récite (car il a l’air de la savoir par cœur !) la proclamation de M. Picard, affichée dans l’après-midi :
Le gouvernement vous appelle à défendre votre cité, vos foyers, vos familles, vos propriétés.
Quelques hommes égarés, se mettant au-dessus des lois, n’obéissant qu’à des chefs occultes, dirigent contre Paris les canons qui avaient été soustraits aux Prussiens.
Ils résistent par la force à la garde nationale et à l’armée.
Voulez-vous le souffrir ?
Voulez-vous, sous les yeux de l’étranger prêt à profiter de vos discordes, abandonner Paris à la sédition ?
Si vous ne l’étouffez pas dans son germe, c’en est fait de la République et peut-être de la France !
Vous avez leur sort entre vos mains.
Le gouvernement a voulu que vos armes vous fussent laissées.
Saisissez-les avec résolution pour rétablir le régime des lois, sauver la République de l’anarchie qui sera sa perte ; groupez-vous autour de vos chefs. C’est le seul moyen d’échapper à la ruine et à la domination de l’étranger.
Le ministre de l’intérieur,
ERNEST PICARD.
Le groupe écoute avec attention, crie deux ou trois fois : « Aux armes ! » et se dissipe. Un instant je crois qu’il va s’armer en effet. Il va tout simplement renforcer un autre groupe formé sur l’autre trottoir.
Cette inaction des amis de l’ordre a été, il faut bien le reconnaître, générale aujourd’hui. Paris est divisé depuis le matin en deux portions : l’une qui agit et l’autre qui laisse faire.
À vrai dire, quand même elle l’aurait voulu, je ne sais trop comment la partie paisible de la population parisienne aurait pu s’y prendre pour résister à l’émeute. « Groupez-vous autour de vos chefs ! » conseille la proclamation. Fort bien ! cela est facile à dire, c’est moins aisé à faire. Pour se grouper autour des chefs, il faut savoir où ils sont. Où étaient-ils aujourd’hui ? La scission produite dans la garde nationale par le coup d’État du Comité central a eu pour conséquence première de désorganiser les commandements. Comment distinguer, à quoi reconnaître, où trouver les capitaines, les commandants, les colonels qui sont restés fidèles à la cause de l’ordre ? On sonne, il est vrai, le rappel et l’on bat la générale dans tous les quartiers de Paris. Mais qui fait battre la générale et qui fait sonner le rappel ? Le Gouvernement régulier ou le Comité révolutionnaire ? Plus d’un bon bourgeois, prêt à faire son devoir – car, à Paris, nul n’est lâche – et qui avait déjà endossé sa vareuse et bouclé son ceinturon, ne s’est pas décidé à obéir au clairon ou au tambour, de peur que, par suite d’une confusion probable, il n’allât grossir les forces de l’émeute au lieu de se joindre aux défenseurs de la loi. Il est naturel de rester chez soi quand on ne sait pas où l’on irait. D’ailleurs, l’armée a lâché pied. Les mauvais exemples sont contagieux. Est-il équitable de demander à des pères de famille, à des négociants, à des bourgeois enfin, soldats par occasion, un effort devant lequel de vrais soldats ont reculé ? Ajoutons à ces considérations que le Gouvernement est en fuite. Il reste peut-être quelques ministres à Paris, mais, depuis plusieurs heures déjà, le bruit s’est répandu que la plupart de nos gouvernants sont allés rejoindre l’Assemblée à Versailles. Je ne blâme pas ce départ un peu précipité ; il était peut-être indispensable, mais que voulez-vous ? on aime à avoir auprès de soi les gens dont on défend la cause et on se bat mal pour des absents.
Cependant, de la Madeleine au Gymnase, les cafés regorgent de filles et de gandins. Tandis qu’on se saoule sur les boulevards extérieurs, on se grise ou à peu près sur ce qu’on nomme les grands boulevards. Toute la différence gît dans les qualités différentes des boissons. Quel peuple sommes-nous, bon Dieu !
C’est aujourd’hui le lendemain. J’avais hâte de savoir ce qui s’était passé cette nuit et quelle attitude avait prise Paris revenu de sa première surprise. Qui sait ? La nuit avait peut-être porté conseil. Le Gouvernement et le Comité central avaient peut-être réglé leurs différends ; il se pouvait que tout fût fini.
Dans la rue matinale, tout était paisible. Les boutiques étaient ouvertes comme à l’ordinaire. Cuisinières et ménagères allaient et venaient. J’ai rencontré un brave homme avec lequel je causais parfois, les nuits de garde, du temps où l’on allait aux remparts.
– Eh bien ! lui ai-je demandé, qu’y a-t-il de nouveau ?
– De nouveau ? je ne sais pas. Ah ! oui, il paraît qu’il y a eu quelque chose hier à Montmartre.
Ceci me fut répondu au centre même de la ville, dans la rue de la Grange-Batelière. Il y a à Paris de ces prodigieux indifférents. Je parie, qu’en cherchant un peu on finirait par découvrir dans quelque quartier reculé un homme qui se croit encore gouverné par Napoléon III et qui n’a entendu parler de la guerre avec la Prusse que comme d’une éventualité improbable.
Sur les boulevards, peu d’agitation. Des enfants crient des journaux. Je n’aime pas à être renseigné par les feuilles publiques. Si impartial, si sincère que soit un reporter, il ne peut présenter les faits que d’après la façon dont il en a été impressionné. Or, il m’est presque impossible d’évaluer l’importance d’un fait d’après des impressions étrangères.
Je me suis dirigé vers la rue Drouot, prévoyant des affiches. Que d’affiches, en effet ! et des affiches blanches, s’il vous plaît ! Ceci indiquait que Paris avait un gouvernement, le blanc étant la couleur officielle, même sous la République rouge.
J’ai pris un crayon et j’ai copié à la hâte les proclamations de nos nouveaux maîtres. Je crois que j’ai agi prudemment. Tout est si vite oublié, les proclamations et les hommes ! Où sont les affiches d’antan ?
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.
Au Peuple.
CITOYENS,
« Le peuple de Paris a secoué le joug qu’on essayait de lui imposer. »
Quel joug, messieurs du Comité, pardon, citoyens ? Je vous assure que moi, qui, pourtant, fais partie du peuple, je ne me suis pas le moins du monde aperçu qu’on essayât de m’imposer un joug. Il s’agissait, si j’ai bonne mémoire, de quelques canons, et il n’y avait pas le moindre joug dans toute cette affaire. Et puis, cette expression : « le peuple de Paris » est singulièrement exagérée. Certainement les habitants de Montmartre et leurs frères des quartiers excentriques font partie du peuple, et n’en-sont pas, je suis tout disposé à le reconnaître, la portion la moins saine ni la moins digne d’intérêt, (j’ai toujours préféré un charbonnier de la chaussée Clignancourt à un gandin de la rue Taitbout), mais enfin, ils ne sont pas le peuple tout entier. Donc, votre phrase ne signifie pas grand-chose ; et en outre, avec sa métaphore démodée, elle est d’une rhétorique un peu vieillotte. Je crois qu’il eût mieux valu dire tout simplement :
« Citoyens, les habitants de Montmartre et de Belleville ont gardé les canons qu’on voulait leur prendre. »
Mais cela n’aurait pas eu l’air d’une proclamation. Chose extraordinaire ! on a beau bouleverser le pays tout entier, le style officiel demeure inébranlable. On triomphe des gouvernements, on ne peut pas triompher des lieux communs. Continuons à lire :
« Calme, impassible dans sa force, il a attendu, sans crainte comme sans provocation, les fous éhontés qui voulaient toucher à la République. »
La République ? encore une expression impropre : c’est aux canons qu’on voulait toucher.
« Cette fois, nos frères de l’armée… »
Ah ! vos frères de l’armée ! Ce sont vos frères parce qu’ils ont levé la crosse en l’air. Dans ces familles-là, on n’est parent que lorsqu’on est du même avis.
« Cette fois, nos frères de l’armée n’ont pas voulu porter la main sur l’arche sainte de nos libertés. »
Allons, bon ! les canons sont « l’arche sainte » à présent ! Métaphore bien biblique d’ailleurs pour des gens qui ne doivent pas aimer les calotins.
« Merci à tous, et que Paris et la France jettent ensemble les bases d’une République acclamée avec toutes ses conséquences, le seul gouvernement qui fermera pour toujours l’ère des invasions et des guerres civiles.
L’état de siège est levé.
Le peuple de Paris est convoqué dans ses sections pour faire ses élections communales. La sûreté de tous les citoyens est assurée par le concours de la garde nationale.
Hôtel de ville de Paris, le 19 mars 1871.
Le Comité central de la garde nationale :
ASSY, BILLIORAY, FERRAT, LABITTE, Ed. MOREAU, Ch. DUPONT, VARLIN, BOURSIER, MORTIER, GOUHIER, LAVALLETTE, Fr. JOURDE, ROUSSEAU, Ch. LULLIER, BLANCHET, G. GRILLARD, BARROUD, H. GERESME, FABRE, POUGERET. »
Par exemple, il y a un reproche qu’on ne pourra pas adresser à la nouvelle émeute parisienne : c’est celui d’avoir mis à sa tête des gens d’une incapacité démontrée : Celui qui oserait affirmer que chacun des personnages nommés ci-dessus n’a pas plus de génie qu’il n’en faut pour sauver deux ou trois nations, m’étonnerait considérablement. Il est dit dans un drame d’Hugo qu’un enfant sans parents prouvés, doit être supposé gentilhomme ; un inconnu peut, au même titre, passer pour un homme de génie.
Mais il y avait sur les murs de la rue Drouot bien des proclamations encore :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.
Aux gardes nationaux de Paris
CITOYENS,
« Vous nous aviez chargés d’organiser la défense de Paris et de vos droits. »
Ah ! pour cela, non, mille fois non ! Je vous ai accordé – parce que vous paraissiez y tenir – que des canons étaient une arche sainte, mais, sous aucun prétexte, je n’avouerai que je vous aie chargé d’organiser n’importe quoi ! Je ne vous connais pas, je n’ai jamais entendu parler de vous, il n’est personne que j’ignore au monde autant que Ferrat et Labitte, si ce n’est Grillard et Pougeret (cependant j’étais garde national et je ne me suis pas plus mal enrhumé qu’un autre, sur les remparts, pour le roi de Prusse), je ne sais ni ce que vous voulez, ni où vous conduisez ceux qui vous suivent, et je puis vous affirmer qu’il y a bien à Paris une centaine de mille hommes qui, eux aussi, se sont parfaitement enrhumés, et qui, à l’heure qu’il est, sont absolument, à votre endroit, dans le même cas que votre serviteur.
« Nous avons conscience d’avoir rempli cette mission. »
Vous êtes bien bons d’avoir pris cette peine, mais du diable si je me souviens de vous avoir donné aucune mission d’aucune espèce !
« Aidés par votre courage et votre sang-froid !… »
Ah ! messieurs ! vous me flattez.
« Nous avons chassé ce gouvernement qui vous trahissait. »
« À ce moment, notre mandat est expiré… »
Le mandat que je vous avais donné, toujours ?
« Et nous vous le rapportons, car nous ne prétendons pas prendre la place de ceux que le souffle populaire vient de renverser.
Préparez donc et faites de suite vos élections communales, et donnez-nous pour récompense, la seule que nous ayons jamais espérée : celle de vous voir établir la véritable République.
En attendant, nous conservons, au nom du peuple, l’Hôtel de Ville.
Hôtel de Ville, Paris, 19 mars 1871.
Le Comité central de la garde nationale,
ASSY, BILLIORAY, etc… etc… etc… »
À côté de cette affiche, il y en a eu une autre non moins signée des citoyens Assy, Billioray et autres, et annonçant que les élections communales auront lieu mercredi prochain 22 mars, c’est-à-dire dans trois jours.
Voilà donc le résultat de ce qui s’est passé hier, et la révolution du 18 mars peut être racontée en quelques paroles :
Il y avait des canons à Montmartre ; le Gouvernement a voulu les prendre et n’a pas pu, grâce à la fraternité couarde des lignards. Une société secrète, composée de quelques délégués de quelques bataillons, a profité de cette occasion pour affirmer hautement quelle représentait la population tout entière, et pour lui ordonner d’élire – qu’elle l’ait désiré ou non – la Commune de Paris.
Que va faire Paris, entre ces dictateurs sortis l’on ne sait d’où, et le gouvernement réfugié à Versailles ?
Paris ne fait rien. Il regarde les évènements comme on regarde couler l’eau. D’où vient cette indifférence ? La surprise, la disparition des chefs pouvait, hier, excuser son inaction. Mais une nuit s’est passée. Chaque homme a eu le temps d’interroger sa conscience et d’en recevoir une réponse. On a eu le temps de se reconnaître, de se concerter, on aurait eu le temps d’agir. Pourquoi n’a-t-on rien fait ? pourquoi ne fait-on rien ? Les généraux Clément Thomas et Lecomte ont été assassinés, cela est aussi incontestable qu’odieux. Paris tout entier veut-il partager avec les criminels la responsabilité du crime ? Le gouvernement régulier a été chassé ; Paris consent-il à cette expulsion ? Des hommes sans mandat, ou du moins munis d’un mandat insuffisant, ont usurpé le pouvoir. Paris s’abandonne-t-il lui-même au point de ne pas résister à cette usurpation ? Non, certes ; il exècre le crime, il n’approuve pas l’expulsion du gouvernement de la République, et il ne reconnaît pas aux membres du Comité central le droit de lui imposer leurs volontés. Pourquoi donc reste-t-il immobile et patient ? Ne craint-il pas qu’on lui applique le proverbe : Qui ne dit mot consent ? D’où vient que moi-même, au lieu d’écrire sur ces feuilles volantes mes impressions passagères, je ne prends pas un fusil pour punir les criminels, et résister au despotisme ? Ah ! c’est que la situation, nous le sentons tous, est singulièrement complexe. Le gouvernement qui s’est retiré à Versailles a commis de telles fautes, qu’il est difficile de se ranger de son parti sans arrière-pensée. La faiblesse, la maladresse qu’ont montrées pendant le siège la plupart de ceux qui le composent, leur opiniâtreté à demeurer sourds aux vœux légitimes de la capitale, nous ont mal disposés à défendre un état de choses qu’il nous était impossible d’approuver sans réserve. En somme, ces révolutionnaires inconnus, coupables à coup sûr, mais sincères peut-être, revendiquent pour Paris des droits que Paris presque tout entier est porté à réclamer. Il nous est impossible de ne pas reconnaître que les franchises municipales sont désirées et désormais nécessaires. Voilà pourquoi, bien qu’épouvantés par les excès qu’ont déjà commis et que commettront encore les dictateurs du 18 mars, bien que révoltés à la seule idée du sang qui a coulé et qui coulera encore, – voilà pourquoi nous demeurons sans prendre parti. Les torts anciens du gouvernement légitime de Versailles refroidissent notre zèle pour lui, et quelques idées justes formulées par le gouvernement illégitime de l’Hôtel de Ville diminuent notre horreur de ses crimes et notre appréhension de ses forfaits.
Puis – pourquoi ne pas oser le dire ? – Paris, impressionnable, nerveux, romanesque, admire toutes les audaces, et n’a qu’une sympathie modérée pour les prudences. On peut sourire, comme je le faisais tout à l’heure, des proclamations emphatiques du Comité central, mais cela n’empêche pas de reconnaître que sa puissance est réelle, et que la façon farouche dont il l’a tout à coup révélée, ne manque pas d’un certain caractère de grandeur. On a pu remarquer avec malignité que plus d’un patriote, hier soir, sur les boulevards extérieurs et aux environs de l’Hôtel de Ville, avait bu un peu plus que de raison en l’honneur de la République et de la Commune ; mais cela n’a pas empêché d’éprouver une surprise voisine de l’admiration à la vue de ces bataillons accourus de plusieurs quartiers à un signal invisible, et, en définitive, prêts à se faire tuer pour défendre… quoi ? des canons, mais des canons qui, à leurs yeux, étaient le symbole palpable de leurs droits et de leurs libertés. Pendant ce temps, l’Assemblée nationale légiférait à Versailles et le Gouvernement allait la rejoindre. Paris ne suit pas ceux qui fuient.
La butte Montmartre est en fête. Le temps est admirable : on va voir les canons et considérer les barricades. Hommes, femmes, enfants, gravissent les rues à pic ; tout ce monde paraît très joyeux… de quoi ? il ne le sait pas lui-même. À Paris, on ne peut pas résister au soleil ; s’il pleuvait, la ville serait en deuil. On a fermé sa boutique, on a mis ses plus beaux habits, on ira dîner au cabaret. Qui fait cela ? les ennemis-nés du désordre, les petits négociants, les petits bourgeois. Contradiction étrange ! mais que voulez-vous, il fait si beau ! Hier, on n’a pas travaillé à cause de l’insurrection ; c’était comme un dimanche. Aujourd’hui on fait le lundi de l’émeute.
Enfin, au milieu de ces troubles, où chacun va sans savoir où, entre le Comité central qui fait des proclamations et le gouvernement de Versailles qui réunit des troupes, il s’est trouvé des hommes qui ont prononcé quelques paroles raisonnables.
Ces hommes, dès à présent, peuvent être certains qu’ils sont approuvés et qu’ils seront obéis par Paris, – par le Paris honnête et intelligent, par le Paris prêt à favoriser celui des deux partis qui prouvera que la justice est avec lui.
Les députés et les maires de Paris ont fait afficher la proclamation suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.
CITOYENS,
Pénétrés de la nécessité absolue de sauver Paris et la République en écartant toute cause de collision, et convaincus que le meilleur moyen d’atteindre ce but suprême est de donner satisfaction aux vœux légitimes du peuple, nous avons résolu de demander aujourd’hui même à l’Assemblée nationale l’adoption de deux mesures qui, nous en avons l’espoir, contribueront, si elles sont adoptées, à ramener le calme dans les esprits.
Ces deux mesures sont : l’élection de tous les chefs de la garde nationale et l’établissement d’un conseil municipal élu par tous les citoyens.
Ce que nous voulons, ce que le bien public réclame, en toute circonstance, et ce que la situation présente rend plus indispensable que jamais, c’est l’ordre dans la liberté et par la liberté.
Vive la France ! Vive la République !
Les représentants de la Seine :
Louis BLANC, V. SCHŒLCHER, Edmond ADAM, FLOQUET, Martin BERNARD, LANGLOIS, Édouard LOCKROY, FARCY, BRISSON, GREPPO, MILLIÈRE.
Les maires et adjoints de Paris :
1er Arrondissement : Ad. ADAM, MELINE, adjoints. – 2e Arrondissement : TIRARD, maire, représentant de la Seine ; Ad. BRELAY, CHÉRON, LOISEAU-PINSON, adjoints. – 3e Arrondissement : BONVALET, maire ; Ch. MURAT, adjoint. – 4e Arrondissement : VAUTRAIN, maire ; LOISEAU, GALLON, adjoints. – 5e Arrondissement : JOURDAN adjoint. – 6e Arrondissement : HÉRISSON, maire ; À. LEROY, adjoint. – 7e Arrondissement : ARNAUD (de l’Ariège), maire, représentant de la Seine. – 8e Arrondissement : CARNOT, maire, représentant de la Seine. – 9e Arrondissement : DESMARET, maire. – 10e Arrondissement : DUBAIL, maire ; A. MURAT, DEGOUVES-DENUNQUES, adjoints. – 11e Arrondissement : MOTU, maire, représentant de la Seine ; BLANCHON, POIRIER, TOLAIN, représentant de la Seine. – 12eArrondissement : DENIZOT, DUMAS, TURILLON, adjoints. – 13e Arrondissement : Léo MEILLET, COMBES, adjoints. – 14e Arrondissement : HÉLIGON, adjoint. – 15eArrondissement : JOBBE-DUVAL, adjoint. – 16e Arrondissement : Henri MARTIN, maire et représentant de la Seine. – 17e Arrondissement : François FAVRE, maire ; MALOU, VILLENEUVE, CACHEUX, adjoints. – 18e Arrondissement : CLEMENCEAU, maire et représentant du peuple ; J.-B. LAFONT, DEREURE, JACLARD, adjoints.
Il y a deux heures que cette proclamation a été affichée, et je n’ai pas encore rencontré une seule personne qui ne l’approuve entièrement. Les députés de la Seine et les maires de Paris, par suite de la fuite à Versailles du Gouvernement, sont, naturellement, nos chefs légitimes. Nous les avons élus ; qu’ils nous dirigent. C’est à eux qu’il appartient de réconcilier l’Assemblée avec la Cité ; et il nous semble qu’ils ont pris le meilleur moyen d’opérer cette conciliation, en dégageant des exagérations de l’émeute tout ce que ses réclamations ont de légitime et de pratique. Donc, qu’ils soient loués pour cette tentative vraiment patriotique ! Et qu’ils se hâtent d’obtenir de l’Assemblée la reconnaissance de nos droits. En cédant à la demande de nos députés et de nos maires, le Gouvernement ne pactisera pas avec l’insurrection ; bien au contraire, il en triomphera radicalement, puisqu’il lui enlèvera tout prétexte d’existence et éloignera d’elle, d’une façon définitive, tous les hommes à qui la justice de quelques parties de son programme fermait les yeux sur la façon illégale et violente dont ce programme est formulé.
Si l’Assemblée consent, il ne restera plus du 18 mars que le souvenir, pénible sans doute, d’une journée sanglante, et d’un grand mal sera sorti un grand bien.
Quoi qu’il arrive, nous sommes résolus – nous, c’est-à-dire tous ceux qui, sans avoir suivi le Gouvernement à Versailles et sans avoir pris une part active à l’insurrection, désirent également le rétablissement du pouvoir légitime et le développement des libertés municipales – nous sommes résolus à suivre où ils nous conduiront nos députés et nos maires. Ils représentent en ce moment la seule autorité légale qui nous semble avoir équitablement apprécié les difficultés de la situation, et si, tout espoir de conciliation étant perdu, ils nous disaient de prendre les armes, nous les prendrions.
Ce soir, 21 mars, Paris a je ne sais quel air de contentement ; il espère, il espère dans les députés et les maires, il espère même dans l’Assemblée nationale. On parle de la manifestation des amis de l’ordre, on l’approuve. Un étranger, un Russe, M. A.J., habitant Paris depuis dix ans et par conséquent Parisien, m’offre les renseignements suivants dont je prends note à la hâte :
Aujourd’hui, à une heure et demie, un groupe dont je faisais partie s’est formé place du Nouvel-Opéra. Nous étions vingt personnes à peine, nous avions un drapeau sur lequel était écrit : « Réunion des amis de l’ordre. » Ce drapeau était porté par un soldat de la ligne, employé, disait-on, de la maison Siraudin. Nous avons monté les boulevards jusqu’à la rue Richelieu ; sur notre passage les fenêtres s’ouvraient ; on criait : « Vive l’ordre ! vive l’Assemblée nationale ! à bas la Commune ! » Très peu nombreux au départ, nous fûmes bientôt trois cents puis cinq cents, puis mille. Notre troupe suivit la rue Richelieu, grossissant toujours. Place de la Bourse, un capitaine de la garde nationale, à la tête de sa compagnie, voulut nous arrêter. Nous passâmes outre ; la compagnie présenta les armes à notre drapeau, et les tambours battirent aux champs. Après avoir parcouru, de plus en plus nombreux, les rues qui avoisinent la Bourse, nous revînmes sur les boulevards, où éclata autour de nous le plus vif enthousiasme. Devant la rue Drouot on fit halte ; la mairie du IXe arrondissement était occupée par un bataillon affilié au Comité, par le 229e bataillon, je crois. Bien qu’une collision fût possible, nous nous engageâmes dans la rue, résolus à faire notre devoir, qui était de protester contre le renversement de l’ordre et le mépris des lois établies, mais il ne nous fut fait aucune résistance. Les gardes nationaux accourus devant la porte de la mairie nous présentèrent les armes, et nous allions continuer notre chemin, lorsque quelqu’un fit remarquer que notre drapeau, où, comme je l’ai dit, on lisait : « Réunion des amis de l’ordre, » pouvait nous exposer à être pris pour des « réactionnaires, » et qu’il fallait y ajouter ces mots : « Vive la République ! » Les personnes qui marchaient en tête de la manifestation firent halte ; quelques-unes d’entre elles entrèrent dans un café, et là, écrivirent à la craie, sur le drapeau : « Vive la République ! » Puis, nous nous remîmes en marche, suivant les voies les plus larges, de plus en plus nombreux et acclamés de toutes parts. Un quart d’heure plus tard, nous arrivâmes rue de la Paix, nous dirigeant vers la place Vendôme, où étaient réunis, en foule, des bataillons du Comité, et où siège, comme on sait, l’état-major de la garde nationale. Là, comme devant la mairie Drouot, les tambours battirent aux champs et on nous présenta les armes ; bien plus, un officier vint prévenir les chefs de la manifestation qu’un délégué du Comité central les priait de se rendre à l’état-major. C’était moi, en ce moment, qui portais le drapeau. Nous nous avançâmes en silence. Quand nous fûmes arrivés sous le balcon, entourés par les gardes nationaux, dont l’attitude, en général, était pacifique, nous vîmes paraître sur ce balcon un homme assez jeune, sans uniforme, mais ceint d’une écharpe rouge et entouré de plusieurs officiers supérieurs ; il prit la parole et dit : « Citoyens, au nom du Comité central… » Dès lors il fut interrompu par des sifflets innombrables et par ces cris : « Vive l’ordre ! vive l’Assemblée nationale ! vive la République ! » Malgré ces interruptions hardies, nous ne fûmes l’objet d’aucune violence, ni même d’aucune menace, et, sans plus nous inquiéter du délégué, nous fîmes le tour de la colonne, et, après avoir regagné le boulevard, nous allâmes vers la place de la Concorde. Là, quelqu’un émit l’avis de se rendre chez l’amiral Saisset, qui habitait rue Pauquet, quartier des Champs-Élysées. Un homme à la figure grave, à cheveux gris, fit observer que l’amiral Saisset était à Versailles.
– Mais, ajouta-t-il, il y a parmi vous plusieurs amiraux.
Il se nomma. C’était l’amiral De Chaillé. À partir de ce-moment, il se tint à la tête de la manifestation, qui traversa le pont de la Concorde et gagna le faubourg Saint-Germain.
Toujours acclamée, toujours plus considérable, elle parcourut successivement les rues principales de ce quartier. Chaque fois qu’elle passait devant un poste, les gardes présentaient les armes.
Place Saint-Sulpice, un bataillon se rangea pour nous laisser passer.
Nous descendîmes ensuite le boulevard Saint-Miche et le boulevard de Strasbourg. Pendant ce trajet, un groupe assez nombreux se joignit à nous ; il était précédé d’un drapeau tricolore sur lequel on lisait : « Vive l’Assemblée nationale ! » Désormais, les deux drapeaux flottèrent près l’un de l’autre en avant de la manifestation renforcée.
« Comme nous allions déboucher sur le boulevard Bonne-Nouvelle, un homme, vêtu d’une redingote et coiffé d’un chapeau de feutre gris, se précipita sur moi qui portais l’étendard des « Amis de l’ordre. » Un nègre, vêtu de l’uniforme de la garde nationale et qui marchait à mon côté, me rendit le service de le repousser. Alors, l’homme au chapeau de feutre se retourna contre la personne qui portait l’autre étendard, saisit le drapeau, et, avec une force assez extraordinaire, il en cassa sur son genou la lance qui paraissait fort solide pourtant.
De ceci, il résulta quelque tumulte. L’homme fut empoigné, emporté, enlevé. Je crains qu’il n’ait été maltraité trop gravement. Nous remontâmes les boulevards.
À notre aspect, l’enthousiasme des promeneurs était vraiment excessif, et l’on peut dire sans exagération que nous étions environ trois ou quatre mille personnes quand nous fûmes de retour sur la place du Nouvel-Opéra où nous devions nous séparer.
Un zouave grimpa à un arbre devant le Grand-Hôtel, et attacha notre drapeau à la branche la plus élevée.
Il fut convenu qu’on se réunirait le lendemain, en uniforme, mais sans armes, à la même place. »
Ce récit diffère un peu de ceux qui ont été publiés dans les journaux ; mais j’ai d’excellentes raisons pour le considérer comme absolument véridique.
Que produira cette manifestation ? Les gens qui désirent : « l’ordre par la liberté et dans la liberté, » réussiront-ils à se réunir en assez grand nombre pour réduire à la raison, sans avoir recours à la force, les nombreux et puissants partisans de la future Commune ? Quoi qu’il arrive, cette manifestation prouve que Paris n’entend pas qu’on dispose de lui sans son consentement. Jointe à la tentative, auprès de l’Assemblée nationale, de nos députés, elle n’aura pas été inutile à la pacification prochaine. Il circule ce soir, dans les groupes moins amers, je ne sais quelles espérances heureuses de concorde et de calme.
Des feux de peloton ! Sur qui ? sur les Prussiens ? Non, sur des Français, sur des gens qui passent, sur des gens qui crient : « Vive la République et vive l’ordre ! » des hommes blessés ou morts qui tombent, des femmes qui fuient, les boutiques qui se ferment avec un bruit de fusillade, Paris entier qui s’effare, voilà ce que je viens devoir et d’entendre ! C’en est donc fait de nous cette fois ? Nous verrons dans nos rues les barricades sanglantes, nous rencontrerons les sinistres brancards d’où pendent des mains noircies de poudre, et chaque femme pleurera, le soir, quand le mari tardera à rentrer, et les mères auront peur. La France, hélas ! la France, cette mère douloureuse aussi, succombera, tuée par ses propres enfants.
Je sortais du passage Choiseul. J’allais, en compagnie d’un ami, vers les Tuileries, occupées depuis hier par un bataillon dévoué au Comité central. Arrivés au coin de la rue Saint-Roch et de la rue Neuve-des-Petits-Champs, nous vîmes, au bout de cette dernière, dans la direction de la rue de la Paix, une foule assez compacte.
– Que se passe-t-il donc ? demandai-je à mon ami.
– Je crois, me dit-il, que c’est une manifestation sans armes qui se rend à la place Vendôme. Tout à l’heure, elle est passée sur le boulevard, en criant : « Vive l’ordre ! »
En parlant ainsi, nous nous étions rapprochés de la rue de la Paix. Tout à coup un bruit horrible éclata. C’était la fusillade ! Une fumée blanche s’éleva le long des murs, et, de toutes parts, on crie, on s’épouvante, on fuit, et, à cent pas devant nous, je vois tomber une femme. Est-elle blessée ou morte ? Qu’est-ce que ce massacre ? Que s’est-il passé, à Paris, en plein jour, sous ce grand soleil joyeux ? Nous avons à peine le temps de gagner une rue transversale, et nous suivons la foule qui s’échappe, et les magasins se ferment, et la sinistre nouvelle se répand de toutes parts dans Paris consterné.
Elle se répand avec une rapidité extraordinaire, mais très diversement ; ici on atténue, plus loin on exagère. « Il y a deux cents victimes, » dit l’un. « Il n’y avait pas de balles dans les fusils, » dit l’autre. Sur la cause du conflit les opinions varient singulièrement. Peut-être ne saura-ton jamais d’une manière certaine ce qui s’est passé sur la place Vendôme et dans la rue de la Paix. J’étais à la fois trop près et trop loin du théâtre de l’évènement ; trop près, car j’ai failli être tué ; trop loin, car je n’ai rien vu que la fumée de la poudre et la fuite des passants.
Ce qu’il y a de certain, c’est que la manifestation d’hier, qui avait réussi à grouper un très grand nombre de citoyens autour de son drapeau, a voulu renouveler aujourd’hui sa tentative de pacification par le nombre désarmé. Trois ou quatre mille personnes s’engagèrent vers deux heures de l’après-midi dans la rue de la Paix, en criant : « L’ordre ! l’ordre ! vive l’ordre ! » Le Comité central avait sans doute donné des consignes sévères, car les premières sentinelles de la place, loin de présenter les armes à la manifestation comme elles l’avaient fait hier, refusèrent formellement de lui laisser continuer sa route. Alors, que se passa-t-il ? Deux foules étaient en présence, l’une sans armes, l’autre armée, surexcitées toutes les deux, l’une voulant aller en avant, l’autre décidée à barrer le chemin. Un coup de pistolet fut tiré. Ce fut un signal. Les chassepots s’abaissèrent. La foule armée fit feu et la foule sans armes se dispersa dans une fuite désespérée, laissant sur son chemin des morts et des blessés.
Mais, ce coup de pistolet, qui l’a tiré ? « Un des citoyens de la manifestation, et, en outre, on a arraché leurs fusils aux sentinelles, » affirment les partisans du Comité central, et ils produisent, entre autres témoignages, celui d’un général étranger qui, d’une fenêtre de la rue la Paix, aurait assisté à l’évènement. Leur assertion est peu soutenable pourtant. Quel esprit sérieux admettra qu’une foule évidemment pacifique ait commis un pareil acte d’agression ? Quel homme eût été assez stupide pour exposer une telle quantité de personnes sans armes et pour s’exposer lui-même, par un défi aussi criminellement inutile, à d’inévitables représailles ? Le récit d’après lequel le coup de pistolet aurait été tiré sur la place Vendôme, au pied de la colonne, par un officier de la garde fédérée, donnant ainsi le signal de faire feu aux citoyens placés sous ses ordres, ce récit, si improbable que paraisse un tel excès de froide barbarie, est de beaucoup le plus vraisemblable.
Et maintenant des femmes pleurent leurs maris, leurs fils, morts, blessés. Combien de victimes ? On ne sait pas encore le nombre exact. Un lieutenant de la garde nationale, M. Barle, a reçu une balle dans le ventre. M. Gaston Jollivet, qui a eu autrefois le tort grave à nos yeux de publier une ode comique où il s’efforçait de railler mon illustre et bien-aimé maître Victor Hugo, mais qui n’avait pas tort d’être au nombre de ceux qui réclamaient l’ordre et souhaitaient la concorde, a eu, dit-on, le bras gauche fracassé. M. Otto Hottinger, un des régents de la Banque de France, est tombé, frappé de deux balles, au moment où il relevait un blessé.
Un de mes amis m’affirme que, une demi-heure après la fusillade, il a essuyé le feu de deux gardes nationaux au guet, au moment où il sortait d’une porte-cochère.
Au coin de la rue de la Paix et de la rue Neuve-des-Petits-Champs, gisaient encore, à quatre heures, un vieillard en blouse tombé en croix sur le cadavre d’une cantinière, et un soldat de la ligne dont la main morte, crispée, serrait la hampe d’un drapeau tricolore.
Ce soldat, serait-ce celui dont m’a parlé mon ami M. A.J. dans son récit de la première manifestation, et qui était, disait-on, un employé de la maison Siraudin ?
Bien d’autres victimes encore ! M. de Pêne, directeur du Paris-Journal, dangereusement blessé par une balle qui lui a traversé la cuisse ; M. Portet, lieutenant aux éclaireurs Franchetti, très gravement atteint au cou et au pied droit ; M. Bernard, un négociant, qui est mort ; M. Giroud, un agent de change, qui est mort aussi. À chaque instant, des noms nouveaux s’ajoutent à la funèbre liste.
Où nous conduira cette révolution, qui a commencé par le meurtre de deux généraux et continue par l’assassinat des passants ?
Au milieu de ces effrois et de ces horreurs, j’ai vu une chose triste aussi, souriante pourtant. Imaginez une idylle qui serait une élégie. Trois carrosses de louage descendaient la rue de Notre-Dame-de-Lorette ; c’était une noce. Dans la première voiture, il y avait la mariée, assez jolie et toute jeune, qui pleurait. Le marié, dans le second véhicule, n’avait pas l’air content. Les chevaux marchant très lentement à cause de la descente, je me suis approché et j’ai interrogé un garçon d’honneur. Il s’était passé quelque chose de bien désagréable. On était allé à la mairie, pour être unis, mais à la mairie il y avait, au lieu de maire ou d’adjoints, un poste de gardes nationaux. Le sergent avait offert de remplacer le magistrat municipal, les grands parents n’avaient pas consenti à cet arrangement, et on s’en retournait fiancés comme devant. Cela était bien malheureux.
– Bah ! dit une commère qui passait, ils se marieront demain. On a toujours le temps de se mettre la corde au cou.
Sans doute, ils se marieront demain ; mais ils auraient voulu être mariés aujourd’hui, ces enfants. Cela ne les regarde pas, les révolutions. Qu’est-ce que cela aurait fait à la Commune que ces amants eussent été époux aujourd’hui ? Est-on sûr, d’ailleurs, de retrouver le bonheur échappé ? Ah ! cette émeute, je la hais à cause des cadavres et des veuves ; je lui en veux aussi à cause de ces jolis, yeux qui pleurent sous une couronne de fleurs d’orangers.
La mairie du IIe





























