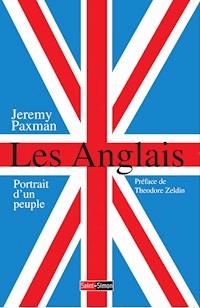
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Saint-Simon
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Un essai sociologique et anthropologique pour mieux comprendre la "British touch"
Comment les connaître, comment les comprendre, pourquoi les aimer ?
Tout, peut-on croire, a été écrit sur les Anglais, depuis André Maurois en passant par les Carnets du major Thompson de Pierre Daninos. Tout, sauf ce portrait intime, écrit de l’intérieur par Jeremy Paxman, le journaliste britannique le plus célèbre du Royaume-Uni. Décalé, subtil et incisif, Jeremy Paxman a accompli un travail minutieux et plein d’esprit pour décrypter la mystérieuse « British touch » et séparer le mythe de la réalité. L’Empire, les Français, le cinéma, la littérature, le foot, la femme anglaise, l’heure du thé, la politique, l’alcool, la religion… Loin des clichés éculés, tout est passé au crible, des sujets les plus sérieux aux histoires les plus cocasses.
« Qu’y a-t-il derrière leur passion pour les jeux de hasard ? À partir de quoi ont-ils développé leur très particulière approche de la sexualité et de l’alimentation ? Où ont-ils puisé leur remarquable aptitude à l’hypocrisie ? »
Souvent excentriques, les Anglais restent pourtant les maîtres du savoir-vivre. Que pensent-ils d’eux-mêmes ? Le célèbre journaliste signe ici un récit sans pitié, pour le plus grand plaisir du lecteur. Apparemment, les Anglais s’y sont pleinement retrouvés, qui ont fait du portrait-miroir de Jeremy Paxman un best-seller. Leurs voisins Français gagneront beaucoup à lire cet ouvrage de référence.
La culture anglaise n'aura bientôt plus de secret pour vous !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né dans le Yorkshire en 1950,
Jeremy Paxman vit à Londres. Diplômé de Cambridge, il a débuté sa brillante carrière journalistique comme correspondant à l’étranger de
Panorama et de
Tonight, avant de rejoindre la BBC en 1988. Auteur de plusieurs livres à succès, il est respecté par ses pairs et redouté par ses invités. Il présente le
Newsnight, le grand rendez-vous d’information de la BBC 2.
EXTRAIT
Demandez à quiconque, quelle que soit sa nationalité, ce qu’il aimerait être.
Dans 99 % des cas, la réponse sera : « Anglais ».
Il fut un temps où les Anglais savaient ce qu’ils étaient. La liste des définitions était toute prête : ils étaient polis, flegmatiques, réservés, et ils avaient des bouillottes en guise de vie sexuelle, au point que le monde occidental pouvait se demander comment ils se reproduisaient ; ils étaient actifs plutôt que cérébraux, écrivains plutôt que peintres, jardiniers plutôt que gastronomes, ils tenaient à leurs distinctions de classe, à leurs préjugés et à leur incapacité à manifester leurs sentiments ; ils connaissaient leur devoir et l’accomplissaient. La force d’âme poussée jusqu’aux limites du raisonnable était un de leurs signes distinctifs. « Par Dieu, j’ai perdu ma jambe », remarquait lord Uxbridge tandis que les obus explosaient de toutes parts autour de lui, à quoi le duc de Wellington répliqua : « Et comment, par Dieu ! » Un soldat blessé à mort dans une tranchée de la Somme était censé réagir à la hauteur du mythe et se recommander stoïquement de « ne pas ronchonner ». Leur honneur était leur bien le plus précieux, leurs engagements toujours fiables : la parole d’un gentleman était aussi fiable qu’un pacte scellé dans le sang.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pour Jessica, Jack et Victoria
Préface
Comment un journaliste devient un héros
« Je n’ai jamais été aussi heureux qu’en pêchant à la ligne », affirme Jeremy Paxman. Tout en reconnaissant que « les gens pensent souvent que c’est une activité pour simplets ruminants », il estime qu’elle « demande une telle concentration mentale qu’on ne peut plus s’inquiéter de quoi que ce soit d’autre ». Mais qu’est-ce qui tracasse Paxman ? À quoi cherche-t-il à échapper ?
Ces questions ne se situent pas seulement à un niveau personnel. Paxman est un héros anglais, rival des pop stars que Tony Blair, jadis, tenait pour l’incarnation de la Grande-Bretagne « cool ». Son message diffère nettement du leur : « Pourquoi, peut-il ainsi demander, les contribuables devraient-ils donner de l’argent au gouvernement afin que celui-ci le confie à des hommes politiques qui eux-mêmes le repassent à des agences publicitaires dans le seul but d’insulter notre intelligence ? » Plusieurs millions de téléspectateurs voient en lui leur allié, leur porte-parole, un Robin des Bois moderne qui, au lieu de dépouiller les riches, oblige les tenants du pouvoir à livrer la vérité aux masses, lesquelles estiment qu’elles y ont droit.
Une jeune femme m’explique qu’hésitant à poser des questions aux politiciens, elle aime que Jeremy Paxman le fasse pour elle, en se montrant à la fois plein d’autorité et d’une réelle humilité. Une autre écrit que « son grand front plissé paraît exprimer le courroux que nous éprouvons tous lorsque nous le voyons interviewer des dirigeants qui débitent sophismes et clichés hypocrites au lieu de reconnaître honnêtement leurs erreurs ». Elle apprécie « son indignation morale toujours prête à exploser », son refus des mensonges, ajoutant : « Il peut être colérique, cinglant, provocateur, méprisant, mais ces travers deviennent de séduisantes qualités quand ils sont agrémentés de l’humour avec lequel il se considère lui-même. Il donne l’impression de s’engager entièrement dans tout ce qu’il ressent, et cette intensité, cette ferveur sont des plus impressionnantes. »
Une autre encore reconnaît qu’elle le voit comme « la coqueluche des femmes, mais avec un cerveau. Nous aimons toutes les hommes intelligents et il l’est, incontestablement, mais c’est aussi quelqu’un qui vieillit avec classe. Ses cheveux grisonnants lui donnent un air très distingué. Il a cette sorte de compétence et de sérieux que je trouve très attirante. J’adore quand il a la dent dure contre les gens qu’il interviewe. Je suis moi-même sarcastique à l’extrême et donc j’apprécie ces moments. Ce n’est pas un robot et il a un sourire craquant. Ma mère le trouve super, elle aussi, et elle a 56 ans ! »
C’est ainsi que le perçoivent celles et ceux qui ne connaissent de lui que sa personnalité télévisuelle. Pour découvrir ce qui se cache derrière ce visage et cette voix, il faut lire le livre qu’il a consacré à la pêche à ligne, sa marotte et selon lui le sport le plus populaire de l’Angleterre, avant même le football ou le cricket, puisqu’il compte quelque quatre millions d’adeptes assidus. Les pêcheurs, dit-il, cherchent toujours à excuser le fait de rentrer bredouille en se lamentant sur un âge d’or mythique, le temps où les rivières n’étaient pas polluées. Une permanente mélancolie pèse sur eux et ils n’ont pas de plus grand plaisir que de se complaire dans la nostalgie de leurs exploits passés, dans « la douce chaleur du souvenir des difficultés surmontées ». Râleurs dans l’âme, ils ne sont pas pour autant des vrais pessimistes, au contraire, car leur sport est finalement une constante victoire de l’espoir sur la dureté de l’expérience.
Cela mérite d’être comparé avec ce que Paxman avance à propos des Anglais dans le présent livre, ce mélange de mélancolie naturelle et de détermination, cet attachement passéiste à la campagne alors qu’ils ont choisi une vie résolument urbaine, ces lamentations sur la perte de leur conscience identitaire et leur incapacité à s’inventer une passion qui remplacerait leur gloire disparue. En décrivant les pêcheurs à la ligne et les Anglais, il dresse un portrait de lui-même.
Lorsque je l’ai rencontré en chair et en os, il m’a confié : « J’ai l’impression de ne faire partie d’aucun milieu, ni social, ni intellectuel. Je me suis toujours senti décalé. » Il a été fortement marqué par sa jeunesse provinciale, sans aucun contact avec les familles des professions libérales. Après s’être considéré comme un enfant du Yorkshire, ce qui aurait laissé promettre de solides racines, il a découvert que sa famille, à seulement quelques générations près, était en réalité composée de paysans illettrés ayant quitté le Suffolk à la recherche de travail, devenus marchands de fruits et légumes et collecteurs de loyers avant de s’intégrer à la moyenne bourgeoisie. Enfant, il n’a pratiquement jamais visité Londres, puis il a été le premier de son entourage familial à fréquenter l’université, « une expérience qui m’a transformé », raconte-t-il. Il lui a fallu attendre « tardivement, jusqu’à quarante ans passés », pour commencer à se sentir un peu à l’aise en société. Il ne se jugeait pas en droit de fréquenter les personnes qu’il rencontrait grâce à son travail, ni même de leur poser les questions qu’il risquait : « Si quelqu’un s’était cabré un jour en me disant : “Non, mais pour qui vous vous prenez, à m’interroger de cette manière ?”, je pense que je l’aurais mérité. C’est une réaction qui n’a rien de bizarre. Il est parfaitement naturel de se sentir intimidé en face de ceux qui ont de l’autorité. »
Il n’est pas surpris de constater qu’il suffit au premier ministre de son pays de répliquer à ses opposants qu’il pense agir selon ses convictions pour que ces derniers le remercient poliment et ne le questionnent plus. C’est seulement lorsqu’il déclare : « Voilà, c’est cela que je crois, mais je peux me tromper » que ses censeurs commencent à s’agiter. Remarque de Paxman : « Quand vous êtes un chef de gouvernement qui envoie des troupes en Irak, vous avez sacrément intérêt à ne pas vous tromper ! »
Désormais, constate-t-il, « je suis capable d’entrer dans une salle sans être mort de peur, mais je ne m’accorde pas la moindre autorité sur quoi que ce soit ». Une sincère modestie tempère ses ambitions. Après avoir étudié la littérature anglaise à Cambridge, il a essayé d’écrire un roman, mais insatisfait du résultat, il a décidé d’arrêter. Il a caressé en son temps un projet d’essai sur l’Europe, seulement il ne se sentait « pas à la hauteur, vraiment effrayé par la complexité du sujet ». Il aime les mots, cependant, et c’est pourquoi il rédige des livres qu’il juge « simplement un travail de journaliste, une contribution au débat. J’essaie de découvrir. C’est tout ce que j’ai voulu faire ».
Plutôt de gauche durant ses années de formation, il décrit le jeune Paxman plus exactement comme « quelqu’un de rebelle par instinct, anti-tout ». Cette révolte l’a quitté, tout comme l’illusion de changer le monde, « sinon par petites touches, chacun dans sa sphère bien limitée. Je reconnais mes limites, maintenant. La réalité finit par vous rattraper, tôt ou tard. C’est vers la quarantaine que j’ai compris qu’il n’y a jamais de solution idéale, seulement des compromis qui peuvent être acceptables ou non ».
Son récent livre consacré à la figure de l’« animal politique » constitue une tentative pour mieux cerner la logique des responsables qu’il met sur le gril journalistique. Une espèce très étrange, a-t-il conclu : « Il m’arrive souvent d’avoir du mal à m’endormir parce que je ne leur ai pas posé la bonne question, ou que j’ai été trop agressif, ou pas assez. Eux, par contre, ils dorment comme des nouveau-nés. Ce sont des gens qui ne sont pas faits comme vous et moi. » Selon lui, les hommes politiques de Grande-Bretagne sont d’éternels insatisfaits en raison de la concentration des pouvoirs aux mains du premier ministre et de trois ou quatre de ses plus proches collaborateurs, les membres du cabinet ne faisant qu’obéir aux instructions. Néanmoins, des centaines de prétendants voudraient désespérément pouvoir grimper les échelons. « Comment être heureux si l’on ne sait pas jouir du présent ? », s’interroge Jeremy Paxman. Faire une carrière dans la politique n’a aucun sens. Néanmoins, il rêve d’un ré-enchantement de la politique.
Sa mission impossible, c’est d’amener les gouvernants à dire la vérité. Mené devant les caméras de télévision, son combat le plus célèbre, celui qui l’a hissé au rang de héros national quand bien même il n’en est pas sorti vainqueur, l’a vu répéter rien moins que quatorze fois la même question à un ministre conservateur qui lui refusait une réponse claire. Au cours de la guerre en Irak, il a demandé au ministre de la Santé combien d’hôpitaux de campagne l’armée britannique était en mesure de déployer. « Suffisamment », lui a-t-on répondu. « Combien est-ce, suffisamment ? », a insisté Paxman. Réponse : « Tout dépend des circonstances. » Le journaliste savait que l’armée en avait à peine deux quand il lui en aurait fallu dix…
Jeremy Paxman trouve sa réputation d’agressivité injustifiée. Si les dirigeants politiques étaient plus francs, admet-il, ses interviews ne seraient pas si tendues. Quand son interlocuteur n’est pas un menteur patenté, il se montre de la plus grande courtoisie et sait rendre la conversation très plaisante. Il déteste la violence au point qu’après plusieurs années passées comme correspondant de guerre au Salvador et au Liban il a reconnu qu’il ne pouvait plus supporter de voir des gens s’entre-tuer : « J’ai eu assez de cadavres devant les yeux », dit-il. Certains journalistes sont capables de garder un regard distancié sur de tels spectacles, mais pas lui : « C’est trop navrant. C’est une horreur. »
Même s’il est moins macabre, le travail de chroniqueur politique présente de réelles difficultés. Le rôle de Paxman est d’amener les tenants du pouvoir à rendre des comptes, un exercice qu’ils n’aiment pas. Lorsqu’il a demandé par courrier à Tony Blair de bien vouloir développer une remarque qui lui avait été attribuée, et selon laquelle la plupart des trajectoires politiques individuelles se concluent par un échec, il n’a jamais reçu de réponse. Interviewant le premier ministre à la télévision, il a voulu savoir si Bush et lui priaient ensemble. Blair a refusé de répondre, sans doute parce qu’il savait que la Grande-Bretagne est l’une des nations les plus païennes au monde. Quand il a proposé au ministre Alan Milburn, l’un des principaux poulains de Blair, de le laisser passer une journée avec lui afin de l’observer en action, il a dû relancer son secrétariat à dix reprises au téléphone – la méthode Paxman : ne jamais renoncer – avant d’obtenir une proposition de date si lointaine qu’elle équivalait à un refus implicite.
« La politique est malade en Grande-Bretagne », dit-il, mais il n’a pas de remède. Il rend ses professionnels responsables de cet état, sans pour autant proclamer que ce sont tous des filous : au contraire, il est persuadé que la majorité d’entre eux croit sincèrement être en mesure de rendre le monde meilleur, et que certains y sont en effet parvenus. Cela ne l’empêche pas de les trouver en général inadaptés à leur tâche. Paxman a calculé que 62 % des premiers ministres du pays étaient orphelins de père, de mère ou des deux dès l’âge de quinze ans. Tony Blair en avait onze quand son père a eu une grave crise cardiaque, et sa mère est décédée lorsqu’il était jeune homme. Le secrétaire général du Parti travailliste a ainsi confié un jour à Paxman : « Je n’ai jamais bien connu mon père. C’est le parti qui m’a servi de figure paternelle. Le parti a toujours été là pour me remonter le moral quand j’avais besoin. »
Paxman a des besoins différents : « Si j’avais le temps, j’étudierais la religion. Pour moi, c’est la seule question vraiment importante. Je suis athée, ou bien je crois l’être. Je n’en suis pas si sûr. C’est une question sur laquelle j’aimerais avoir une réponse. » L’Angleterre n’est sans doute pas l’endroit le plus favorable à cette quête. Un archidiacre, par exemple, lui a déclaré un jour : « Vous, vous êtes athée et moi, je suis l’Église anglicane. Je suis sur votre longueur d’ondes à 99 % »… Après des siècles de guerres de religion, ce pays a choisi de ne plus se revendiquer de quelque foi inébranlable que ce soit.
Tout en portant un regard critique sur ses compatriotes, Paxman est profondément heureux d’être Anglais. Il ne s’imaginerait pas autrement, ni vivre ailleurs. Le contraste avec son frère est frappant : diplomate, actuellement numéro deux de l’Ambassade britannique à Paris, celui-ci a épousé une Française et leurs enfants parlent couramment français à la maison, ainsi qu’italien. Ce qui nous prouve qu’il n’existe pas deux Anglais similaires, quand bien même ils seraient frères. Comme la France, la Grande-Bretagne compte soixante millions de minorités. Et l’on ne s’étonnera donc pas que tant d’Anglais n’aient pas une vision arrêtée de ce qu’ils sont, de ce qu’ils partagent ensemble, ni de la direction dans laquelle il faudrait chercher la vérité.
Héros, Paxman l’est parce qu’il va plus loin que les vedettes de la musique pop, elles aussi vecteurs d’un malaise auquel aucun spécialiste ne peut apporter de remède. La moindre victoire que cet homme remporte sur l’hypocrisie est également la vôtre. Qu’il ne sache pas ni ne proclame où ce combat conduira ne vous permet pas de l’accuser de faire des promesses qu’il ne pourrait tenir.
Ce livre démontre très bien, en s’appuyant sur l’histoire ainsi que sur l’actualité, et avec maints détails curieux, combien il est compliqué d’être anglais, peut-être encore plus que d’être français. J’espère qu’il rendra ses lecteurs d’outre-Manche plus indulgents envers nos manies et nos incertitudes.
Theodore Zeldin
Professeur à l’université d’Oxford et doyen de St. Antony’s College (Institut de recherches internationales), Theodore Zeldin est reconnu comme l’un des historiens les plus importants et les plus originaux de notre époque. Grand connaisseur de la France, il a notamment écrit une Histoire des passions françaises : 1848-1945 (Seuil, 1980) et les deux best-sellers Les Français (Seuil, 1984) et Les Françaises et l’histoire intime de l’humanité (Fayard, 1994). (N.d.E.)
Avant-propos
C’était si facile d’être Anglais, jadis… Personne au monde n’était plus reconnaissable qu’un Anglais. À sa façon de s’exprimer, de se comporter, de s’habiller, et à cette manie qu’il avait de boire des litres de thé, on ne pouvait se tromper. Désormais, tout est plus compliqué. Lorsqu’il nous arrive de tomber sur un homme à l’air pincé, avec une prédilection pour le tweed et les vilaines chaussures, cela nous amuse parce que cette image conventionnelle des Anglais est morte. De nos jours, les ambassadeurs de ce pays seront musiciens ou écrivains plutôt que diplomates ou hommes politiques.
Même s’ils étaient titulaires de passeports britanniques comme les Écossais, les Gallois et certains Irlandais, les Anglais de l’époque impériale pouvaient se considérer « English » ou « British » avec la même facilité. Aujourd’hui, rien n’indignera plus un Écossais que d’entendre l’un de ses voisins du Sud confondre allègrement les deux termes. En théorie, les élections de mai 1999 au nouveau Parlement écossais et à l’Assemblée galloise ont été conçues par le Parti travailliste dans le but de cimenter l’union britannique. C’était peut-être le cas. Ce qui est sûr, c’est que cette union-là a bien changé. L’Écosse, qui était déjà une nation structurée, possède maintenant ses propres institutions politiques dont la tendance sera sans doute d’affirmer toujours plus leurs prérogatives. Cette transformation se note même dans la langue : à Londres, les informations écossaises sont de plus en plus souvent qualifiées de « nationales » quand elles étaient jadis « régionales », et dans une note de service la BCC a même recommandé à ses employés de renoncer au terme de « principauté » à propos du pays de Galles.
Il y a aussi le facteur européen. Qui peut prédire jusqu’où iront les ambitions – ou illusions – collectives des élites politiques du continent ? Si des États-Unis d’Europe finissent par apparaître et fonctionner, le Royaume-Uni deviendra une structure superflue. Et puis, il faut compter avec la conscience très aiguë qu’aucun pays n’est en mesure de contrôler dans son coin les grands mouvements du capital dont la prospérité de ses citoyens dépend entièrement. La fonction principale des gouvernements nationaux est toujours plus d’ordre culturel.
Ces quatre données (la fin de l’Empire, les fissures apparues dans le Royaume dit « uni », la force d’attraction de l’Europe et le caractère incontrôlable des flux économiques internationaux) m’ont amené à me poser la question : « Être Anglais, finalement, c’est quoi ? » Quand bien même il aborde des sujets politiques, ce livre n’est pas un essai politique au sens étroit du terme. J’ai voulu essayer de comprendre les racines de l’actuel malaise identitaire des Anglais en remontant dans le passé, et notamment à cette image de l’Anglais « idéal » qui a pu faire flotter son drapeau dans le monde entier.
Certaines de ces influences historiques sont assez faciles à repérer. Leur statut d’insulaires, la place occupée par la Réforme protestante dans la consolidation de la nation, le grand attachement à la liberté individuelle, définissent pour beaucoup les Anglais d’hier et d’aujourd’hui. Mais il y a des aspects plus opaques, moins évidents à cerner : pourquoi, par exemple, les Anglais éprouvent-ils ce contentement à se sentir incompris ou persécutés ? Qu’y a-t-il derrière leur passion pour les jeux de hasard ? À partir de quoi ont-ils développé leur très particulière approche de la sexualité et de l’alimentation ? Où ont-ils puisé leur remarquable aptitude à l’hypocrisie ?
J’ai cherché des réponses en voyageant à travers le pays, en rencontrant des gens et en lisant. Au bout de quelques années, j’ai un peu avancé et je me suis retrouvé devant de nouvelles questions. Je viens aussi de remarquer que je traite ici des Anglais en écrivant constamment « ils », alors que je me suis toujours considéré comme étant des leurs : jusqu’au bout, donc, ils restent insaisissables.
1. Nostalgie
Demandez à quiconque, quelle que soit sa nationalité, ce qu’il aimerait être. Dans 99 % des cas, la réponse sera : « Anglais ».
CECIL RHODES
Il fut un temps où les Anglais savaient ce qu’ils étaient. La liste des définitions était toute prête : ils étaient polis, flegmatiques, réservés, et ils avaient des bouillottes en guise de vie sexuelle, au point que le monde occidental pouvait se demander comment ils se reproduisaient ; ils étaient actifs plutôt que cérébraux, écrivains plutôt que peintres, jardiniers plutôt que gastronomes, ils tenaient à leurs distinctions de classe, à leurs préjugés et à leur incapacité à manifester leurs sentiments ; ils connaissaient leur devoir et l’accomplissaient. La force d’âme poussée jusqu’aux limites du raisonnable était un de leurs signes distinctifs. « Par Dieu, j’ai perdu ma jambe », remarquait lord Uxbridge tandis que les obus explosaient de toutes parts autour de lui, à quoi le duc de Wellington répliqua : « Et comment, par Dieu ! » Un soldat blessé à mort dans une tranchée de la Somme était censé réagir à la hauteur du mythe et se recommander stoïquement de « ne pas ronchonner ». Leur honneur était leur bien le plus précieux, leurs engagements toujours fiables : la parole d’un gentleman était aussi fiable qu’un pacte scellé dans le sang.
Nous sommes en 1945. La guerre, qui paraissait ne devoir jamais finir et qui a dominé chaque minute de la vie du pays, s’achève. On va pouvoir souffler, enfin, même si la Luftwaffe a laissé ses souvenirs béants dans toutes les cités industrielles. Dans les villes moyennes, relativement épargnées, la rue principale est un patchwork de petits commerces car, pour reprendre la remarque assassine de Napoléon, nous avons là une nation de boutiquiers*1. Quoiqu’il n’y ait pas grand-chose à acheter dans les magasins. Et le soir venu, on s’offrira peut-être une visite au cinéma local.
Il est tentant d’approuver Churchill lorsqu’il affirmait que la Seconde Guerre mondiale a été « le plus grand moment » de l’histoire de son pays. Il se référait à l’Empire britannique, certes, mais les valeurs de l’Empire étaient justement celles que les Anglais aimaient à croire qu’ils avaient inventées. Et il est certain que la guerre, ainsi que les années qui ont immédiatement suivi, ont été de mémoire d’homme le dernier instant où ce peuple a eu une image claire et positive de lui-même. Un reflet renvoyé par des films tels que In Which We Serve (Ceux qui servent en mer, 1942), de Noel Coward, où les survivants d’un destroyer britannique coulé par les chasseurs allemands, du capitaine au dernier matelot, se rappellent l’histoire du navire et par là même celle de leur pays, qui dans leur représentation apparaît comme un endroit propre, bien ordonné et hiérarchisé, dans lequel le conflit mondial est survenu tel un contretemps qu’il fallait supporter, telle une averse en pleine fête du village, une contrée où règnent la chasteté et l’esprit de sacrifice, où les femmes savent tenir leur place et les enfants aller au lit sans rechigner. À un moment, on voit le quartier-maître prêt à embarquer et sa belle-mère lui demander quand il reviendra à terre :
« Tout dépend d’Hitler.
– Ah, mais pour qui se prend-il, celui-là ? s’indigne la belle-maman.
– Bonne question. »
Ce genre de propagande éhontée, justement parce qu’elle était destinée à un peuple confronté au risque de voir sa culture disparaître, nous montre avec clarté comment les Anglais aimaient à se considérer. Ce qui ressort de ce film, et de bien d’autres, est le portrait d’une nation stoïque, honorable, disciplinée, discrète, délibérément « popote ». De gens qui préféreraient sans hésitation soigner leurs rosiers plutôt que d’aller défendre le monde contre la tyrannie fasciste.
Ayant vécu toute ma vie dans cette Angleterre sortie de l’ombre d’Hitler, je dois avouer mon admiration pour le pays tel qu’il paraissait être alors, et cela malgré toute son étroitesse d’esprit, son hypocrisie et ses préjugés. Il avait été poussé dans une guerre qu’il s’était maintes fois promis d’être en mesure d’éviter, et ce faisant avait précipité de plusieurs décennies la fin de sa prééminence mondiale. Aujourd’hui, les révisionnistes contestent les clichés héroïques d’une Grande-Bretagne isolée et luttant dignement contre un ennemi sans foi ni loi, mais il n’en demeure pas moins une vérité : oui, cette nation est restée seule face aux nazis à l’été 1940, et si elle n’avait pas assumé ce rôle toute l’Europe aurait été la proie du fascisme. Est-ce uniquement grâce à son isolement géographique si, au contraire de tout le continent européen, de la France à la Baltique, il ne s’est pas trouvé en son sein de forces significatives pour choisir de jouer la carte nazie ? Peut-être. Mais la géographie n’est pas neutre, justement : c’est elle qui définit les peuples.
Il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de tentatives d’explication de ce que la Seconde Guerre mondiale a provoqué dans la culture collective anglaise. Aucune ne peut dénier le fait que dans ce combat titanesque les Anglais ont toujours eu la notion la plus claire de ce pour quoi ils se battaient, et donc de ce qu’ils « étaient », en tant que peuple. Cela n’avait rien à voir avec la fierté d’Hitler envers sa « Patrie ». C’était une motivation beaucoup plus humble, plus personnelle et à mon avis d’une force infiniment plus grande, même si d’une extrême discrétion. On en trouve un écho émouvant, et très finement campé, dans Brief Encounter (Brève rencontre, 1945), ce film de David Lean qui narre le coup de foudre sans lendemain d’un bon docteur et d’une femme mariée dans la salle d’attente de la gare de Milford, personnages auxquels Trevor Howard et Celia Johnson prêtent leur physique typiquement anglais.
Que nous apprend sur le compte des valeurs britanniques ce classique du cinéma anglais, dans lequel les héros choisissent de renoncer à leur passion naissante, l’un en acceptant l’offre d’emploi dans un hôpital sud-africain, l’autre en retournant à son honnête mais ennuyeux mari ? D’abord, la confirmation de cet immémorial principe, à savoir que l’« on n’est pas sur cette terre pour prendre du bon temps ». Ensuite, l’importance du sens du devoir dans un pays où la plus grande partie de la population adulte s’était habituée à porter un uniforme. Et surtout, surtout, le message essentiel : il faut savoir contrôler ses émotions. C’était en 1945 mais cela aurait pu être vrai dix, voire vingt ans plus tard. Les modes pouvaient changer mais il continuait de pleuvoir, et le policeman au coin de la rue demeurait une figure familière. Malgré l’apparition de l’État providence dans l’après-guerre, chacun connaissait sa place. Conduites par des chauffeurs en uniforme, les petites camionnettes continuaient à livrer le lait et le pain à chaque foyer tous les matins. On savait qu’il y avait des choses « qui se faisaient » et d’autres « qui ne se faisaient pas ».
On pourrait dire de ces gens qu’ils étaient convenables, assez travailleurs pour réaliser leurs modestes ambitions, et qu’ils s’étaient accoutumés à se voir comme les agressés, non les agresseurs, et à rester stoïques sous le feu ennemi. Le symbole tranquille était celui des troupes britanniques résistant à l’assaut furieux des Français à Waterloo, ou du dôme de la cathédrale Saint-Paul continuant à se dresser dans la dévastation semée par les bombes nazies. Tout en ayant une conscience aiguë de leurs droits, ces gens reconnaissaient avec satisfaction qu’ils « ne s’occupaient pas trop de politique ». Le cuisant insuccès des extrémistes de gauche ou de droite à obtenir une représentation parlementaire prouvait leur profond scepticisme envers tous ceux qui leur faisaient miroiter la terre promise. Ils étaient modestes, enclins à la mélancolie, mais en aucune manière religieux au-delà de quelques principes de base : l’anglicanisme n’était rien de plus qu’une invention politique qui avait élevé le statut de « brave type » à un niveau plus ou moins comparable à la canonisation. Au cas où ils devaient indiquer leur allégeance religieuse dans le cadre de quelque enquête administrative, ils inscrivaient sereinement « C of E » (pour « Church of England », Église anglicane) tout en sachant très bien que personne n’exigerait d’eux d’aller à la messe ou de donner tous leurs biens aux pauvres.
En 1951, le quotidien People lançait une grande enquête destinée à mieux connaître ses lecteurs. Après avoir épluché quelque onze mille réponses pendant trois ans, le coordinateur du projet, Geoffrey Gorer, parvenait à la conclusion que la nation britannique n’avait guère changé en l’espace d’un siècle et demi. En surface, les transformations avaient certes été considérables : une population habituée à l’anarchie était devenue respectueuse de la loi, compatissante jusqu’à la sensiblerie après avoir été friande de combats de chiens, d’ours tenus en laisse et de pendaisons publiques, soucieuse d’honnêteté publique après avoir toléré la corruption généralisée. Mais, mais… « Ce qui semble rester une constante est la farouche réticence envers toute forme de contrôle excessif, l’amour de la liberté ; la force d’âme ; un faible intérêt pour la chose sexuelle, comparé à la plupart des pays voisins ; la priorité donnée à l’éducation dans la formation de la personnalité ; le tact et la discrétion envers les sentiments d’autrui, et enfin un très solide attachement aux valeurs du mariage et de la famille […]. Les Anglais forment un peuple extrêmement uni et même, d’après mon humble hypothèse, plus uni que jamais dans toute son histoire. Lorsque j’étudiais la première vague de questionnaires qui m’est parvenue, le constat qui me venait constamment à l’esprit était : “Comme la vie que mènent ces individus a l’air ennuyeuse !” Et aussitôt, un autre : “Quels braves gens !” C’est le double jugement que je conserve à la fin de mon travail. »
Les raisons de cette cohésion étaient assez évidentes pour un pays qui sortait d’une guerre affreuse et venait de subir tant de sacrifices. Il présentait aussi une relative homogénéité à la fois psychologique et démographique, puisqu’il avait été contraint de se soumettre plus encore à la discipline et n’avait pas connu d’immigration de masse. Enfin, il restait insulaire, non seulement au sens géographique du terme mais aussi parce que la communication de masse n’avait pas encore rendu possible l’avènement du village planétaire.
C’était le monde de ceux qui sont aujourd’hui grands-parents, l’univers de la reine Élisabeth et du duc d’Édimbourg. La jeune princesse avait épousé le lieutenant de vaisseau Philip Mountbatten en 1947, c’est-à-dire en pleine période d’austérité, quand les pommes de terre étaient rationnées à trois livres hebdomadaires par personne et le bacon à trente grammes. Les noces royales avaient apporté une touche de rêve et de magie à ce terne quotidien, Élisabeth abandonnant le calot militaire qu’elle avait arboré si souvent pendant la guerre pour revêtir une robe en satin brodée de dix mille semences de perles. Dans la logique de Brève rencontre, de Celia Johnson et de Trevor Howard, ils pouvaient s’attendre à vivre de longues années ensemble et c’est ce qui allait se passer, en effet. Mais c’était la dernière génération à assumer ce code de conduite : lorsque, à l’instar d’un quart des couples qui s’étaient mariés la même année, ils allaient atteindre leurs noces d’or en 1997, les valeurs de Celia Johnson et de Trevor Howard n’étaient déjà guère plus qu’une curiosité pour anthropologues. À ce moment, moins de 10 % des unions matrimoniales pouvaient prétendre à une telle longévité. En net contraste avec l’immédiat après-guerre, où beaucoup d’entre elles avaient renoncé à leur emploi pour libérer des postes de travail à l’intention des hommes revenus du front, les femmes constituaient désormais près de la moitié de la population active, et elles étaient bien souvent à l’initiative des procédures de divorce qui mettaient fin à la majeure partie des deux cent mille mariages prononcés chaque année. À l’époque des noces d’or royales, trois de leurs quatre enfants avaient vu leur expérience conjugale s’achever par un échec, l’héritier de la couronne avait divorcé de la femme qui aurait pu devenir la prochaine reine et celle-ci avait trouvé la mort dans un tunnel parisien, en compagnie de son amant, le play-boy Dodi Al-Fayed dont le père, Mohammed, à la tête de la plus célèbre boutique de cette nation de boutiquiers*, avait coutume de passer des enveloppes bourrées de billets de banque à des députés conservateurs qui se vantaient d’appartenir au parti dépositaire des traditions d’intégrité et d’honneur britanniques… L’enterrement de Diana, d’ailleurs, allait provoquer des manifestations de deuil public tellement étrangères au comportement « typiquement british », comme ces milliers de bougies allumées dans les parcs ou les fleurs lancées sur le passage du cortège funéraire, que la génération de la Seconde Guerre mondiale ne pouvait que regarder bouche bée, et se sentir soudain comme des touristes dans leur propre pays.
Ceux qui jetaient des fleurs vers le cercueil de la princesse ne pouvaient avoir appris ce geste qu’à la télévision, car il s’agit d’une coutume du monde latin. Mais si l’influence des mass media ne peut être sous-estimée, s’il est vrai que les modes culinaires, vestimentaires ou musicales ne sont plus depuis longtemps des produits « locaux », même ce qui peut encore être caractérisé d’authentiquement « national » est l’expression d’une population radicalement transformée. Au cours du demi-siècle qui a suivi le débarquement à Tilbury de quatre cent quatre-vingt-douze immigrants arrivés de Jamaïque à bord du navire Empire Windrush, le paysage racial du pays a été bouleversé. L’immigration de masse, concentrée sur l’Angleterre stricto sensu, a créé des zones entières où le terme de « minorités ethniques » est devenu un abus de langage. En 1998, ainsi, ce sont les enfants de race blanche qui sont devenus « minoritaires » dans les collèges secondaires de la proche banlieue londonienne, où plus d’un tiers des élèves n’étaient même plus de langue maternelle anglaise.
Si le peuple anglais a changé, la physionomie du pays est devenue elle aussi méconnaissable. Évitant les évocations bucolico-réactionnaires d’une contrée de bocages et de jardins, George Orwell a voulu dresser un paysage de fumées industrielles, de boîtes aux lettres rouge vif et d’hommes qui juraient en patientant devant les bourses du travail pour célébrer l’« anglicité » en temps de guerre dans Le Lion et la Licorne. À part les fameuses boîtes aux lettres, pratiquement plus rien ne se veut made in England dans ce territoire qu’habitent aujourd’hui les Anglais, sinon les lampadaires rococo et flambant neufs qui cherchent à donner une touche victorienne aux rues piétonnes, si tant est que les citadins de l’époque victorienne se soient adonnés aux plaisirs douteux du Big Mac. Même dans des villes comme Oxford ou Bath, plus attachées que d’autres à se revendiquer du passé britannique, les échoppes où l’on pouvait jadis acheter des clous au poids, trouver du cake fait maison, ou donner un accroc à recoudre sur sa veste, ont été remplacées par des vendeurs de tee-shirts et de souvenirs bon marché. Partout, le petit commerce a cédé la place à de grandes surfaces hautement spécialisées, que ce soit dans les ustensiles de cuisine ou les vêtements pour bébé. La nation de boutiquiers est devenue un pays de caisses enregistreuses, et les policiers ne patrouillent plus les rues qu’en voiture, ou restent dans leurs fourgons blindés, attendant le grabuge.
À la faveur d’un autre texte publié dans le Evening Standard en 1946, George Orwell décrivait ce qui était selon lui le pub idéal, qu’il avait poétiquement baptisé « The Moon under Water » (La Lune à l’eau). Assez animé pour vous mettre à l’aise, assez tranquille pour y avoir une conversation, avec un décor indifférent au passage du temps et d’amicales serveuses qui appelaient tout le monde « mon cher », il servait la bière brune la plus crémeuse, de solides déjeuners à l’étage et, à toute heure, des sandwichs à la saucisse de foie, des moules, du fromage et des pickles. Dans le grand jardin derrière, les enfants pouvaient jouer à la balançoire ou au toboggan…
À la fin de son essai, Orwell révélait ce dont la plupart de ses lecteurs se doutaient déjà : cet endroit rêvé n’existait pas. Mais ce n’est plus le cas : il y a aujourd’hui pas moins de quatorze pubs Moon under Water, propriété d’un important conglomérat de brasseurs de bières dont le siège social se trouve à Watford. Celui de Manchester s’enorgueillit d’être le plus grand de tout le pays, avec ses trois bars sur deux étages et ses soixante-cinq serveurs. Le samedi soir, des centaines de jeunes s’y saoulent bruyamment et agressivement… à la bière américaine.
Apparemment, donc, l’Angleterre n’est plus, mais plus du tout ce qu’elle était. Les notions d’effort collectif, de sacrifice, d’austérité, de parcimonie, ont été balayées, ne survivant que pour une infime minorité. Et cependant cette identité insaisissable, « par procuration » pourrait-on presque dire, est tout ce que les Anglais peuvent avoir. J’en ai fait la découverte embarrassée au début des années 1990, lors des obsèques en Afrique du Sud d’un ami et collègue qui s’était tué au volant de sa voiture à cause d’une urgence professionnelle. L’église était située dans un quartier blanc prospère, avec de grosses BMW garées partout et des panneaux promettant une « réponse armée immédiate » sur les enclos en fil de fer barbelé des villas. La cérémonie était conduite par un prêtre afrikaner libéral qui ne semblait pas avoir bien connu John, et le chœur assuré par les femmes de ménage de l’immeuble où mon ami avait eu son bureau. Elles étaient pauvres, certaines pieds nus, mais lorsqu’elles ont entonné Nkosi Sikeleli Afrika, l’hymne national noir, une tendre passion a fait vibrer la nef pseudo-gothique : elles aimaient chanter, oui, mais surtout elles « croyaient » en ce qu’elles chantaient. Après avoir prononcé une très simple oraison funèbre, le prêtre a annoncé le chœur suivant en se référant à une feuille photocopiée. C’était l’énigmatique poème de William Blake, Jérusalem. Se tournant vers les visiteurs, il a tonné : « Chantez, vous autres Anglais, chantez ! » Nous nous sommes timidement lancés, sans parvenir à la moitié de l’intensité, de l’émotion des femmes de ménage. Avec sa mélodie poignante et ses paroles pleines de mystère, Jérusalem est certainement ce qui se rapproche le plus d’un hymne anglais et cependant nous n’arrivions pas à mettre de conviction dans notre chant. La gêne, sans doute, mais avant tout le fait que les Anglais n’ont pas, à proprement parler, de refrain national, pas plus qu’ils n’ont un vêtement distinctif de leur culture. Quand les participantes au concours de Miss Monde se sont vues demander de défiler en habit traditionnel de leur pays, Miss Angleterre est apparue ridiculement attifée en… hallebardier de la Tour de Londres.
Tandis que la fête nationale anglaise, le 23 avril, est à peine remarquée, des cérémonies « britanniques » forgées de toutes pièces, comme l’anniversaire de la Reine, sont marquées par des tirs d’artillerie, des levers de drapeaux et des garden parties dans les ambassades de Sa Majesté. Ce qui pourrait passer pour une danse typiquement anglaise, le « morris-dancing », n’est en fait qu’un maladroit divertissement de pub pratiqué par des hommes barbus et vociférants. Quand l’Angleterre rencontre le pays de Galles ou l’Écosse sur le terrain de football ou de rugby, les Gallois peuvent entonner Land of our Fathers ou Hen Wlad fy Nhadau, les Écossais The Flower of Scotland, alors que l’équipe anglaise se contente de fredonner piteusement l’hymne national « britannique », plaintive glorification de la monarchie dont la mission est de cimenter une union de plus en plus disparate. Il existe plus de cinq cents chants écossais connus et pratiqués, mais entrez dans un pub d’Angleterre et demandez à l’assistance ne serait-ce qu’une ligne d’une vieille chanson folklorique, telle que The Yeomen of England ou There’ll always be an England, et vous n’obtiendrez qu’un silence stupéfait. Ou pire : la seule chose que les fans anglais puissent glapir avec enthousiasme durant un match de rugby sera un ancien chant d’esclaves noirs, Swing Low, Sweet Chariot, et dans un stade de foot quelque chanson pop passée de mode, aux paroles généralement affligeantes.
Que signifie cette indigence en matière de symboles nationaux ? D’aucuns avanceront qu’elle prouve, tout simplement, une certaine confiance en soi. Aucun Anglais ne pourrait assister sans étonnement au serment d’allégeance que les écoliers américains prêtent chaque matin, tant cette manifestation de patriotisme lui paraîtra naïve, pour ne pas dire plus. Il observera avec une indulgence ironique les Irlandais arborer un trèfle à la boutonnière lors de la Saint-Patrick, se gardant bien, sauf rare exception, d’en faire de même avec une rose lors de la Saint-Georges. Cette sagace retenue débouche vite sur l’opinion que tout témoignage public de fierté nationale révèle non seulement un manque de tact caractérisé mais s’apparente à un acte que la morale réprouve. En 1948 déjà, George Orwell notait que « dans les milieux de gauche, il y a toujours une sorte d’embarras à se dire Anglais, et une sorte d’obligation à railler la moindre institution anglaise, qu’il s’agisse des courses hippiques ou du pudding au rognon. Paradoxalement mais indubitablement, l’intellectuel anglais trouvera en général plus honteux de se tenir au garde-à-vous pendant l’exécution du God Save the Queen que d’aller voler dans le tronc du pauvre ».
De nos jours, le patron de cinéma qui s’aviserait de renouer avec la coutume de diffuser l’hymne national avant le début de la projection viderait sa salle en un clin d’œil. À l’époque où Orwell exprimait son irritation, le dédain de l’intelligentsia libérale envers les emblèmes patriotiques était facile, car les Anglais n’avaient guère à cultiver les symboles de leur spécificité nationale : quand on tient le haut du pavé du principal empire mondial, ce n’est pas nécessaire. Et il était important de gommer les identités respectives des pièces constitutives du « Royaume-Uni », construction volontariste par excellence. Si la tribu de colons protestants transplantée en ce milieu hostile qu’était l’Irlande du Nord devait s’accrocher farouchement à ses signes distinctifs, partout ailleurs, aux confins du monde celtique, les Anglais étaient tout disposés à coexister avec des identités traditionnelles dont la persistance même prouvait que l’Union était bien ce qu’ils voulaient qu’elle soit, une confluence de diversités. D’où les surnoms attribués aux Écossais (« Jocks »), aux Gallois (« Taffies »), aux Irlandais (« Paddies » ou « Micks »), alors que les Anglais, autre preuve de leur incontestable domination, n’en recevaient aucun.
Au contraire de ces derniers, Écossais ou Gallois n’ont jamais fait taire leur conscience identitaire pour embrasser le statut de Britanniques. N’importe qui pouvait aspirer au modèle de l’Anglais ou de l’Anglaise par excellence en étudiant à Eton – ce qui expliquait son succès auprès des enfants des nouveaux riches, et ses nombreuses imitations à travers l’Empire, depuis l’Inde jusqu’au Malawi –, mais un jeune et entreprenant Écossais avait toujours le loisir, s’il le désirait et sans que cela ne soit en rien contradictoire, de revenir à ses traditions ancestrales. Conservant son propre système juridique et éducatif, l’Écosse a peut-être compensé la perte de son indépendance par un sens très aigu de son histoire, « une identification à ses morts qui pouvait s’étendre jusqu’à la douzième génération », ainsi que le remarque Robert Louis Stevenson dans Le Barrage d’Hermiston. Variante du plaid des Highlanders, un habit « traditionnel », le kilt, a été réinventé pour leur usage identitaire, et c’est peut-être même l’œuvre… d’un Anglais : Thomas Rawlinson, le directeur quaker d’une fonderie qui avait eu l’idée d’habiller ainsi ses ouvriers. Au moment même où les Anglais devaient se résigner à plus de discipline pour servir les intérêts de la grande industrie et de la colonisation, sir Walter Scott chantait la liberté idéalisée du montagnard des Highlands. S’étonnera-t-on, alors, qu’à la désintégration de l’Empire les Écossais aient eu de nombreux repères auxquels se référer ?
Les Anglais, qui n’avaient pas ce type de refuge identitaire, ont logiquement été beaucoup plus affectés par l’effondrement du pouvoir britannique, d’autant que les autres composantes du Royaume-Uni pouvaient leur remontrer non sans aigreur qu’ils avaient été les artisans de leur propre perte. Préparant une anthologie de nouvelles en 1998, la romancière A. S. Byatt a trouvé qu’un recueil d’essais destiné à présenter la diversité des traditions culturelles consacrait cinquante-cinq pages à la culture écossaise, vingt à celle des Antilles anglophones, vingt-sept aux Gallois, et vingt-huit aux Irlandais. Les seules allusions à l’identité anglaise, trois au total, n’apparaissaient que dans la préface, et à chaque fois pour fustiger « l’hégémonie de l’Angleterre ». Commentaire de l’écrivain : « On a l’impression que les Anglais n’existent que pour être critiqués et rejetés. »
Naturellement enclins à la morosité, les intéressés ne pouvaient que prendre au pied de la lettre ce dédain général. Sans vouloir exagérer ce trait national – le nombre de suicides reste l’un des plus faibles d’Europe, bien loin derrière la Hongrie et même la Suisse –, c’est un fait que les Anglais semblent se satisfaire de l’idée que leur pays est voué à l’échec. Une romancière bien connue ici, E. M. Delafield, définit ainsi les quatre articles du credo anglais : premièrement, « Dieu est un Anglais, probablement sorti d’Eton » ; deuxièmement, « toute femme respectable est par nature frigide » ; troisièmement, « il vaut mieux être passé de mode que dans le coup », et quatrièmement, « l’Angleterre court à la ruine ». Visitant Londres en 1955, Nirad Chaudhuri s’émerveillait devant un homme politique d’avoir trouvé le pays extrêmement accueillant et civilisé : « Vous l’avez connu sous un jour très favorable », devait être le sombre commentaire de son interlocuteur.
Ce peuple étonnamment réservé et pessimiste ne peut pas continuer indéfiniment sur cette voie. Le voici gouverné par un parti qui puise ses principes outre-Atlantique et dont la direction de la coterie directionnelle vient du nord de la frontière. Voici que l’Écosse et le pays de Galles gagnent une autonomie grandissante, tandis que l’envahissante Union européenne préfère ostensiblement aux États-nations la complexe logique d’un cœur fédéral relié à un puzzle de régions. La désintégration de l’Empire a fini par atteindre les îles Britanniques, et ce sont les premières colonies qui seront les dernières à conquérir leur indépendance, alors que les pressions extérieures se font irrésistibles. « Nous arrivons à la fin de l’aventure britannique », affirme l’écrivain de gauche Stephen Haseler dans The English Tribe (La Tribu anglaise) : « Un millénaire de développement séparé, dont près de trois siècles marqués par les succès d’un État-nation sûr de lui, s’achève sous l’action conjuguée de la globalisation et de la dynamique européenne ».
Et allons-y avec l’Apocalypse. Dans une philippique de deux cent quarante-sept pages, Clive Aslet, le rédacteur en chef du bucolique magazine Country Life, tente de donner à la crise d’identité nationale des raisons aussi convenues que le passage au système métrique, l’abandon du bon vieux passeport bleu marine pour le document brunâtre imposé par l’UE, le féminisme, les nouveaux motifs des tweeds Harris, les fast-foods et le triomphe de la culture « jeune ». « Jour et nuit, on entend les ogres de Bruxelles arpenter les couloirs de l’Union européenne en criant par-dessus le Channel “Mmmh, mmmh, je sens les coutumes, les goûts et la cuisine de l’Anglais, par ici !” », n’hésite pas à écrire Aslet, mais est-il vraiment persuadé que le génie d’un peuple se résume à ses poids et mesures, ou au fait de rouler à gauche ? Croit-il réellement – et la question s’adresse aussi à Haseler, de l’autre côté de l’éventail politique – que d’autres pays de l’espace européen, du Portugal à la Suède, ne sont pas soumis aux mêmes pressions ?
Partout où je me suis adressé dans mon enquête préliminaire au présent livre, la comparaison est immanquablement revenue : les Anglais regardent leur ennemi historique par-delà la Manche et ils ne peuvent masquer leur jalousie. « Voyez les Français, m’a ainsi expliqué un député conservateur, ils ont les mêmes problèmes que nous mais au moins ils savent ce qu’ils sont, même s’ils ignorent où ils vont. Nous, nous ne savons pas où nous allons, et surtout nous n’avons plus la moindre idée de qui nous sommes. Pas la moindre ! » La confirmation paraît lui être donnée par un sondage du supplément Éducation du Times auprès de huit cent cinquante écoliers de dix et onze ans en France et en Angleterre, dont les résultats ont été publiés sous le titre typiquement auto-flagellatoire « Anglais et peu fiers de l’être ». Donc, 75 % des petits Français auxquels on demandait s’ils éprouvaient de la fierté envers leur pays ont répondu positivement, contre seulement 35 % chez les potaches anglais. Pressés d’expliciter les raisons de cette conviction, les premiers ont répondu « parce qu’on est libres », ou « nous sommes tous égaux », ou « c’est un beau pays ». L’un d’eux a même écrit : « Car la France est un pays magnifique et démocratique et accueillant. » Les petits Anglais, pour leur part, avançaient des raisons telles que « il ne fait jamais trop chaud ni trop froid », « l’eau est propre, la nourriture est saine », « les Anglais sont des gens honnêtes », « c’est un pays indépendant », ou encore « Manchester United est un club anglais ». Ces réponses sont intéressantes, et pas nécessairement pour la conclusion implicitement tirée par l’auteur du titre. Ce qu’elles montrent, c’est qu’à onze ans les enfants anglais avaient déjà assimilé l’approche intellectuelle de la tradition britannique, un pragmatisme plutôt lucide, tandis que leurs camarades français récitaient surtout des slogans pas mal éculés. Un esprit plus analytique se serait donc demandé si l’absence de chauvinisme était un tel handicap, et si un pays dont les autorités éducatives éprouvaient le besoin de soumettre ses élèves à un bourrage de crâne quant à ses admirables vertus était forcément plus sûr de lui que d’autres.
Mais là encore cette incapacité à voir le bon côté des choses est toute anglaise, et la certitude qu’il y a « quelque chose de pourri en Angleterre » est solidement ancrée dans la pensée collective. Un peuple ne peut s’entendre dire pendant des décennies que sa civilisation est en plein déclin sans finir par y croire. D’autant que tous les partis politiques ont promis de rendre au pays son intégrité et ses marques, et que cela s’est à chaque fois révélé être un mensonge éhonté. L’affaire n’aurait aucune espèce d’importance en Italie, où les gens ne croient pas en leurs institutions et ne font confiance qu’à des structures comme la famille, le village, la ville, qui restent ostensiblement vivantes. Les Anglais, eux, avaient foi dans les « corps constitués », et qu’en reste-t-il ? L’Empire s’est dissous, l’Église d’Angleterre n’est plus que l’ombre d’elle-même et le Parlement est toujours moins crédible.
Aux causes extérieures de l’incertitude semble s’ajouter un désarroi plus intime, très personnel. Quand j’ai demandé à l’écrivain Simon Raven sa définition de l’anglicité, il m’a répondu par un constat presque élégiaque : « J’ai toujours “espéré” qu’être Anglais signifiait : courtoisie, cricket, considération mutuelle entre les classes sociales, ne pas envier son voisin, respect envers les femmes, fair-play avec l’ennemi. Mais maintenant, je me le demande… » L’acteur John Cleese, non content de commencer à ressembler aux vieux colonels blanchis sous le harnais qu’il a jadis parodiés, s’exprime maintenant comme l’un d’eux : « Si nous avions eu cette conversation il y a trente ans, j’imagine que nous aurions pu avancer tout un tas de généralisations. De nos jours, il n’y a plus rien qui tienne la route, apparemment. » Chroniqueur impertinent et jardinier accompli, Roy Strong va encore plus loin dans le réquisitoire : « La famille est en déroute, la religion discréditée, alors d’où pourrait venir l’identité ? Qu’est-ce qui fait que l’Angleterre est encore un pays ? Pas grand-chose, fichtre ! »
Lorsque j’ai eu l’idée d’écrire cet essai, j’ai adressé une lettre au célèbre auteur dramatique Alan Bennett, présenté lors d’une conférence de presse à New York comme « ce que nous, en Angleterre, appelons un trésor national », c’est-à-dire ni plus ni moins que les jardins de Sissinghurst ou un pot de marmelade de framboises du Women’s Institute. Qui, dès lors, pouvait mieux comprendre le fait national anglais que lui ? Je me rappelais particulièrement une scène remarquable de sa pièce The Old Country





























