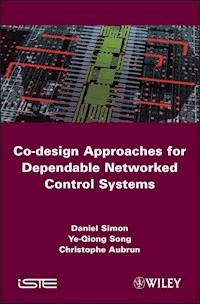Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Isca
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Jeune étudiant des années 60, Philippe voyage de déboires en bonheurs sentimentaux, de l'Angleterre à la Colombie, et construit au passage un avenir plein de promesses.
« Lui et ses camarades essayaient de vivre leur jeunesse, de faire des découvertes, d’affronter la vie sous ses différentes formes, mais également de goûter aux plaisirs, de ressentir des moments de joie et de partage…»À travers les années de formation et les débuts de la vie professionnelle du principal protagoniste de ce roman, c’est le portrait de la génération de Mai 1968 qui s’esquisse. D’une époque où le vieux monde se transforme et où on croit aux lendemains meilleurs.
Tour à tour chronique sociale et politique, histoire d’une éducation sentimentale et récit de voyage, ce livre nous entraîne de Neuchâtel à Londres, puis – en repassant par Neuchâtel – jusqu’en Colombie, à Bogota. Sur fond de musique des sixties et d’écrans de cinéma se dessine ainsi un destin.
L’auteur accorde une place importante au décor, décrivant en détail le milieu neuchâtelois, mais aussi les lieux qu’explore son protagoniste, à Londres comme dans ses voyages autour de Bogota et en Amérique latine, jusqu’au retour en Europe sur un transatlantique. Fortement implanté dans la réalité historique des années 1964 à 1976, ce « roman vrai » s’inscrit dans la grande lignée des romans d’apprentissage par la diversité des expériences qu’il relate : émotions, rencontres, réussites et échecs, amitiés et amours diverses, découverte du monde…
Vivez à travers le regard du héros de cette histoire, les espoirs de cette génération dont les nouvelles valeurs se centrent sur l'épanouissement personnel, les relations sociales et le désir d'une vie neuve.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né en 1945 à Genève,
Daniel Simon a vécu presque toute sa vie dans le canton de Neuchâtel. Il a enseigné le français et l’histoire, principalement au Lycée Blaise-Cendrars de La Chaux-de-Fonds. Depuis sa retraite, il se consacre entre autres à l’écriture et a publié en 2019 un roman aux éditions Mon Village :
L’Année où sa vie a basculé. Il est marié et père de trois enfants.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur
L’année où sa vie a basculé, Éditions Mon Village, 2019.
Ce roman a été publié en feuilleton dans « ArcInfo » du 9 juin au 6 octobre 2020.
Daniel Simon
Les Annéesde formation
Crédit photographique
Couverture : Rue du Seyon, Neuchâtel, manifestation des étudiants, mai 1968.
Pierre Treuthardt, Feuille d’Avis de Neuchâtel (ArcInfo).
Première partie : Université de Neuchâtel, 2021.
Photographie N. Simon.
Deuxième partie : Le trio de l’amitié, Londres, 1969.
Photographie D. Simon.
Troisième partie : Collège du Mail, 2021.
Photographie N. Simon.
Quatrième partie : Bogota, 1976.
Photographie D. Simon.
© 2021, Daniel Simon.
Reproduction et traduction, même partielles, interdites.Tous droits réservés pour tous les pays.
ISBN 978-2-940444-78-6
Avant-propos
Retour de certains personnages
Après la publication de L’Année où sa vie a basculé (septembre 2019), l’auteur s’est lancé dans un nouvel ouvrage intitulé Les Années de formation, qui traite d’une histoire autonome à une époque différente, avec la réapparition de certains personnages du premier livre sous des noms différents et vivant dans un autre contexte. Cependant, chacun des deux livres se suffit à lui-même et peut être lu indépendamment de l’autre.
Les illusions de la réalité
Bien que l’ouvrage s’inscrive dans des lieux, situations ou événements réels, et s’inspire de ce qu’a vécu l’auteur, il appartient au genre romanesque qui permet de se situer entre réalité et fiction. Comme l’auteur le disait dans la postface du premier ouvrage, « [le] genre romanesque permet de traiter de la réalité et de la fiction, mais encore de mélanger ces deux notions, de jouer avec elles, donnant l’impression que les personnages sont à la fois réels et irréels […]. Le romancier peut emprunter à ses souvenirs, son vécu, recourir à ses sources, sans être contraint à une soi-disant reproduction authentique du réel ou une improbable objectivité. Il n’a pas la prétention de dire la vérité, car le fait même d’écrire est un parti pris, avec la subjectivité que cela implique. »
Première partie
Neuchâtel
Octobre 1964 – septembre 1968
1
Àla fin de son gymnase à Neuchâtel, Philippe a décroché son baccalauréat pédagogique cantonal, préparant surtout à la formation d’enseignants pour l’école primaire. S’offre à lui la nouvelle opportunité de pouvoir accéder à l’université en faculté des lettres, à condition qu’il passe un examen préalable de latin – en attendant, cela ne l’empêche pas de suivre les cours.
L’université de Neuchâtel, la plus petite de Suisse, dont le bâtiment principal se situe avenue du Premier-Mars, tout proche du gymnase cantonal, compte environ mille cent étudiants avec une prédominance masculine – seule la faculté des lettres, la plus importante, présente un rapport moins déséquilibré entre hommes et femmes. Le premier jour de son entrée dans l’alma mater, en octobre 1964, Philippe se tient à l’écart des nouveaux étudiants qui discutent, un peu fébriles, dans l’attente de pénétrer dans la salle de cours. Christiane – une camarade du gymnase, devenue sa petite amie – et lui sont les deux seuls représentants de la section pédagogique. Presque tous viennent de la section littéraire ; il reconnaît quelques visages. Désormais il fait partie des « lettreux », il a choisi le français moderne, l’histoire et la philosophie pour les trois branches principales de sa licence.
La première année, tout en suivant les cours universitaires, le jeune homme se consacre principalement à la préparation de l’examen préalable de latin. Pour cela, comme rien n’est prévu dans le cadre universitaire, il doit recourir à des leçons privées. Le travail qui l’attend est important, car il n’a jamais fait de latin, et le niveau requis est assez élevé, proche de celui du baccalauréat de la section littéraire.
Dès le mois de juillet, sans attendre la rentrée universitaire, le futur étudiant a contacté Mme Leuba (surnommée la Tota) pour des leçons privées de latin. C’est une personne âgée, assez grosse, à demi impotente, très austère, antipathique au possible, qui loge dans une vieille maison (la pièce où elle le reçoit, surchargée de livres, ressemble à une sorte de grenier sombre). D’emblée elle place le niveau assez haut pour le débutant qui a beaucoup de peine à suivre. Mais il est bien décidé à travailler et à persévérer. Après quelques leçons, il part comme prévu en vacances. À son retour, son ancienne camarade du gymnase et lui prendront les leçons ensemble. Mais elle lui écrit pour l’avertir que, sous la contrainte de ses parents, elle a dû commencer avec la Tota. Elle lui fait part de ses impressions en ces termes :
« Je dois t’avouer que je déteste déjà Mme Leuba, c’est une… je voulais dire sorcière ! Je tremble déjà deux heures avant la leçon et après j’ai envie de pleurer, il me faut trois heures pour me remonter le moral… »
Lorsqu’ils se retrouvent ensemble avec la « sorcière », cela va mieux. L’apprentissage du latin se poursuit de manière intensive. Il ressemble à un bourrage de crâne. Dans les derniers mois, Philippe veut accélérer sa préparation. Pour cela, il recourt à une autre personne, un étudiant très jovial, ancien boulanger qui, sur le tard, à environ quarante ans, a entrepris avec succès des études de latin et de grec. Vers la fin de sa première année, il réussit son examen préalable de latin, puis aux sessions d’été et d’automne ses autres examens, à l’exception de la grammaire. Sa petite amie Christiane, quant à elle, va finalement changer d’orientation. Elle renonce à l’université pour l’école normale qui prépare à l’enseignement primaire.
*
Philippe est maintenant bien intégré à l’université où il s’est fait de nouveaux camarades. Par contre il est assez déçu par ses professeurs qui, pour la plupart, donnent des cours ex cathedra, se contentant de lire ou de réciter leur matière – ce qui bien entendu ne facilite pas les rapports entre professeurs et étudiants.
En français, l’un de ses maîtres (en fin de carrière) donne l’impression, dans son cours public, de s’adresser prioritairement aux dames âgées en chapeau de la bourgeoisie neuchâteloise, assises au premier rang. L’autre, nommé depuis un an à l’université, après un long enseignement au gymnase, s’efforce à l’éloquence et s’exprime trop souvent d’une manière emphatique. Un jour, l’étudiant, avec une de ses camarades, s’amuse à pasticher ironiquement ses analyses littéraires à partir du quatrain suivant :
Simone inaccessible sur ses jolis monts
Acceptez, en l’honneur de vos vingt et trois ans,
D’illusoires liqueurs à mettre sous la dent
Et l’idéale amitié de Serge Siron.
« 1.Avertissement.Il est des œuvres dont on redoute l’approche, en raison d’un sentiment de respect et de crainte. On a peur d’en altérer la perfection. Ce quatrain est sans doute au nombre de ces œuvres qui dépassent par leur envergure le niveau le plus élevé de la littérature.
» 2. Sources. a) Sources externes : nuls dieux sur ce point ne viendront éclairer notre recherche…
» b) Sources internes : tout porte à croire que ce poème a été composé pour un anniversaire. Notre quatrain est donc un poème de circonstance. Ou peut-être le poète, amant timide, a-t-il choisi cette occasion pour déclarer sa flamme ?
» 3.Architecture et structure. Nous avons à faire à un quatrain régulier, c’est-à-dire quatre alexandrins avec rimes a-b-b-a. Cependant nous remarquons qu’à une structure horizontale correspond une structure verticale ; en effet, la première lettre de chaque vers donne SADE en lecture verticale. Il s’agit peut-être d’une éventuelle allusion à l’érotisme… Les rimes sont généralement riches par leur sonorité pleine. Les césures sont irrégulières au vers 1 (7 + 5), au vers 2 (3 + 9) et au vers 4 (7 + 5). Mais c’est un art très maîtrisé, car ces coupes irrégulières ont pour but de rompre la monotonie de l’hémistiche. Ce quatrain comporte aussi une omniprésence de l’allitération du son [s] : au vers 1 (quatre fois), au vers 2 (deux fois) et au vers 4 (deux fois). On peut y voir un rapprochement avec le vers célèbre de Racine, tiré de la tragédie Andromaque (dernière tirade d’Oreste à la fin de la pièce) : « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? »
» 4. Vocabulaire. « Inaccessible », « jolis monts », « illusoires », « mettre sous la dent », « idéale amitié », « Sade » : le professeur se réfère très explicitement à des dictionnaires (édition, page), puis relève des rapprochements et oppositions entre différents termes.
» 5. Sens et interprétation. Dégager le sens et l’interprétation du quatrain, pour le professeur, va consister en bonne partie à le paraphraser et à répéter plus ou moins la même chose avec des variantes de mots… »
Blague à part, ce professeur est l’auteur de plusieurs publications, en particulier de recueils de poésie qui lui ont attiré une certaine notoriété. Par ailleurs, il est un spécialiste de Jean-Jacques Rousseau pour lequel il ressent une véritable passion.
Les cours ex cathedra sont parfois polycopiés par des étudiants et circulent dans les facultés où ils sont vendus, ce qui ne semble pas poser de problème. Mais un jour, au début de son cours à l’auditoire des lettres, ce même professeur jaillit de son pupitre, se précipite en haut des gradins, agresse verbalement un étudiant qui a polycopié un de ses cours, coupable à ses yeux de violation de la propriété intellectuelle, et l’expulse de la salle. Finalement, grâce peut-être à la médiation de son fils cadet (étudiant de la même volée que Philippe), les choses s’arrangent. Le professeur de littérature française accepte que ses cours soient à l’occasion polycopiés, mais en dégageant toute responsabilité par rapport à leur contenu.
Quant au professeur de littérature médiévale, c’est un spécialiste renommé et qui sait toucher son auditoire. Dommage qu’il manifeste par moments une attitude misogyne. Philippe peut en témoigner, en particulier lors d’un séminaire où une étudiante s’est chargée d’une présentation de texte (qu’elle a acceptée, comme personne ne se proposait) : le professeur ne tarde pas à l’interrompre, puis, de plus en plus énervé, la rudoie avec des propos désobligeants (voire humiliants) qui la laissent livide. À une autre occasion, il se laisse emporter en disant sans ménagement à une jeune femme qu’elle ferait mieux de faire du tricot.
Deux professeurs se partagent l’enseignement de l’histoire. Le premier, en histoire suisse, transmet son savoir avec une certaine éloquence non dépourvue d’un peu d’emphase. Le second, titulaire de la chaire d’histoire générale depuis 1928, est un spécialiste renommé du Moyen Âge et de la Seconde Guerre mondiale.
On peut le voir le soir, attablé au rez-de-chaussée du Café du Théâtre, fidèle à ses ballons de rouge successifs, en compagnie de notables de la ville, alors que les étudiants qui fréquentent aussi ce lieu sont installés aux galeries du premier étage.
Il donne pour l’essentiel de son enseignement alternativement deux cours, l’un sur les relations franco-bourguignonnes, l’autre sur la guerre des blindés. Il tient dans ses mains des feuilles jaunies qu’il récite dans un français recherché, d’une voix un peu chevrotante, apparemment indifférent à la vingtaine ou trentaine d’étudiants présents. Les deux historiens sont par ailleurs des spécialistes des affaires militaires et des officiers supérieurs de l’armée suisse.
L’enseignement de la philosophie se fait également en duo. L’un des maîtres – sérieux, s’exprimant bien, mais desservi par une voix fluette qui lui donne un air de timidité – est chargé de l’histoire de la philosophie. L’autre, dont la spécialité est la philosophie allemande, assez jovial, à l’accent neuchâtelois, aime les digressions.
En première année, Philippe suit avec grand intérêt un cours de logique. Le professeur, connu hors des frontières, donne aussi un cours à l’université de La Sorbonne à Paris. Par contre l’enseignement de la grammaire par un professeur à la limite du mépris envers ses étudiants ne lui convient pas.
*
Philippe vit avec sa mère dans un immeuble locatif de la rue de la Favarge, dans le quartier de Monruz (à l’ouest de la ville de Neuchâtel, sur le littoral). Leur petit appartement de deux pièces avec une cuisine suffisamment grande se trouve au dernier étage, ce qui leur permet de jouir d’une belle vue sur le lac tout proche.
Après deux ans de vie séparée, ses parents ont divorcé en 1958. Il n’a plus revu son père depuis la séparation. La famille est réduite à deux enfants depuis la mort du deuxième fils en 1960. Le frère aîné travaille à l’étranger.
Attablés à la cuisine, la mère et son fils cadet prennent leur repas.
« Comment ça va, tes études ?
– Jusqu’à présent plutôt bien. Le plus important pour ma première année, c’est que j’ai réussi l’examen préalable de latin.
– Oh oui ! Encore toutes mes félicitations, tu le mérites bien, car tu t’es donné beaucoup de peine.
– Tu peux le dire, mes neuf mois d’un travail intensif m’ont permis d’atteindre mon but. Ensuite je viens de réussir mes examens d’histoire et de français, à l’exception de la grammaire. La deuxième année commence la semaine prochaine, elle ne devrait pas poser trop de problèmes.
– Est-ce que tu te plais aux études ?
– Ça dépend, certains cours sont ennuyeux, mais dans l’ensemble cela se passe plutôt bien. Et puis la liberté académique dont on dispose est appréciable – la fréquentation des cours n’est pas obligatoire, à part pour les séminaires. Quant à l’ambiance entre les étudiants, elle est assez bonne, je me suis fait pas mal de nouveaux camarades. Plusieurs sont devenus de véritables amis.
– Tant mieux, profite de ces conditions favorables. Je ne devrais peut-être pas te le dire, mais je suis fière de toi et t’envie, moi qui aurais voulu faire des études mais en ai été empêchée pour des raisons financières.
– Tu sais, maman, je te suis reconnaissant ; sans ton soutien et tes encouragements, je n’aurais sans doute pas entrepris d’études.
– À propos, j’ai reçu quelques nouvelles de ton frère. Il n’est pas très content dans son bureau d’architecture de Bruxelles. Il se plaint de la monotonie de son travail, parle de chercher un nouvel emploi.
– Dommage qu’il n’ait pas pu poursuivre ses cours d’architecture par correspondance, car en restant dessinateur en bâtiment, il doit se contenter de tâches subalternes – « tirer des barres toute la journée », comme il nous a dit un jour.
– En effet, mais Jean-Paul a toujours été instable et insatisfait, il n’a pas encore trouvé sa voie.
– Et toi, comment ça va ton travail ?
– Je suis contente chez le docteur Fischer qui me traite comme une collaboratrice et me fait confiance. Il m’a engagée pour la comptabilité. Son ex-femme y a introduit une sacrée pagaille ! Ce qui explique que beaucoup de patients ne recevaient plus de factures ou qu’elle oubliait d’envoyer des rappels lorsqu’ils ne payaient pas. Après une tâche longue et ardue, on y voit plus clair maintenant. L’argent commence à rentrer.
– Tant mieux s’il récupère son argent.
– Je dois encore te dire que jeudi à midi, je ne serai pas là pour faire le repas. Le docteur Fischer m’a invitée aimablement au restaurant pour me parler des effets bénéfiques de l’acupuncture.
– Pas de problème, j’irai manger au foyer des étudiants. J’y retrouverai probablement des amis.
– As-tu besoin d’argent ?
– Non, merci ! Tu m’en donnes assez. »
2
Sur le plan sentimental, Philippe a été souvent amoureux, mais longtemps s’est trouvé dans l’impossibilité de s’ouvrir aux élues de son cœur. Très renfermé, timide, il ignorait les choses de l’amour. Il faut dire que ses parents n’avaient jamais abordé avec lui la question de la sexualité. À son époque on n’en parlait guère, ni à l’école, ni entre camarades. La masturbation, pensait-on, rendait malade, la religion la considérait comme un péché. Il a préféré vivre ses passions en imagination, car il était incapable de les traduire dans la réalité. C’est ce qui s’était passé à l’âge de onze ans, lors de son premier amour exalté, spirituel, imaginaire, qui dura avec des périodes d’exaltation, mais aussi d’oubli provisoire, environ cinq ans.
La première fois qu’il a véritablement une petite amie date du début du mois d’octobre 1963 (à l’âge de dix-neuf ans environ). La rencontre est favorisée par des circonstances particulières, la liesse populaire de la fête des vendanges à Neuchâtel, connue loin à la ronde. Cette liaison avec une jeune fille de son âge, assez timide au premier abord, petite, au physique très maigre, secrétaire de profession, dure six mois. Cela lui permet de s’ouvrir à l’autre, d’éprouver des sentiments réels, même s’ils sont parfois contradictoires et qu’ils n’aboutissent pas à une relation complète. Elle l’aime, mais lui a des doutes. Finalement il se persuade qu’il ne l’aime pas, par conséquent qu’il faut la quitter. La rupture est brutale et cruelle. Il la fait venir dans sa chambre, reste un bon moment sans rien dire. Comme il semble figé, elle s’approche et lui demande ce qui ne va pas. Il lui répond alors : « Je ne t’aime pas, je te quitte. » Elle accuse le coup sans rien dire, puis elle annonce d’une voix faible : « Je m’en vais. » Il l’accompagne à l’arrêt du bus. Il tente de lui dire quelque chose, mais elle l’arrête. Déjà elle monte dans le véhicule. C’est fini.
Un mois et demi après, commence une nouvelle liaison, appelée à durer. Pourtant, au départ, elle s’apparente au schéma d’une passion imaginaire. Dans son journal, Philippe s’exprime ainsi sur sa genèse :
« Une salle de classe au cours de l’année du bac au gymnase. Des élèves, les profs qui parlent et moi qui me sens un peu absent. La salle de cours suscite parfois chez moi une occasion de rêver et de laisser mon esprit vagabonder. Une fille devant moi attire mon attention. Je la vois de trois quarts, ou de profil quand elle appuie sa tête sur son bras gauche allongé sur la table. Elle l’effleure de sa joue, écrit sur une feuille de papier qu’elle fixe d’un regard oblique. Lorsqu’elle pose son stylo, elle a l’air de tracer de sa main libre des dessins imaginaires. Elle ne semble pas écouter. Les yeux grands ouverts comme perdus dans un lointain horizon, sans doute rêve-t-elle… Puis comme pour chasser ses pensées, elle agite brusquement la tête, ses cheveux caressent ses joues. Ou alors elle se redresse et se tient droite, dévoilant ainsi une poitrine discrète.
» Cette jeune fille, prénommée Christiane, paraissant absente et indifférente à ce qui se passe dans la classe, se trouve dans mon champ de vision entre ma table et le pupitre professoral. Mon regard s’y arrête souvent. Cette présence étrange, irrationnelle, commence progressivement à me fasciner. Je me sens en quelque sorte en communion avec cette âme, me laisse entraîner dans ses rêves et les miens. Petite, légère, ni jolie, ni laide, elle me séduit par son expressivité envoûtante. Elle ne dit rien, mais je crois deviner son langage secret. Pourtant elle ne m’appartient pas, car elle échappe à la réalité. Mais je suis un peu son complice. »
Le début de leur relation commence véritablement au printemps 1964.
Ils vont apprendre à se connaître, se découvrent progressivement des affinités intellectuelles, une envie de communication, une attirance réciproque. Elle habite près de la gare, juste au-dessus de la rue de la Côte. Depuis peu Christiane bénéficie à l’étage d’une chambre indépendante dans la maison de ses parents, avec un accès propre derrière l’habitation, ce qui facilite les visites du petit ami. Celui-ci dispose librement de sa chambre la journée, pendant que sa mère travaille. Les amoureux aiment se promener, se parlent beaucoup, souvent avec exaltation, rient aussi. Depuis chez elle, ils ont l’habitude d’aller dans la forêt des Cadolles, au nord de la ville, et de poursuivre leur marche jusqu’au vallon de l’Ermitage, alors que depuis chez lui ils atteignent la forêt au nord de La Coudre, longent sa lisière jusque dans le haut de Saint-Blaise où ils découvrent le vallon du Villaret, au pied de la montagne de Chaumont. En possession d’un permis de conduire et provisoirement d’une voiture, car sa mère a l’intention d’apprendre à conduire, Philippe peut amener son amoureuse sur des lieux plus lointains.
Il se rappelle en particulier une excursion faite depuis de la localité d’Erlach (Cerlier en français), située au bord du lac de Bienne et dominée par un élégant château. Depuis la jetée du port, ils contemplent la superbe vue à l’est sur l’île Saint-Pierre et, en face, sur la rive nord du lac avec en arrière-fond la haute montagne de Chasseral, dont la crête dépourvue d’arbres est bien visible. Il prend des photos de Christiane, surtout des gros plans. Il conservera les plus expressives pour son album. Les amoureux décident de marcher jusqu’au bout de l’île Saint-Pierre. Pas d’autre possibilité que d’aller à pied sur un chemin de terre. Au début, un rideau de roseaux borde des deux côtés l’étroite route. Ils ne tardent pas à s’aventurer sur un petit sentier qui oblique sur leur droite à travers la végétation pour entrevoir la rive sud. De retour sur le chemin principal, ils poursuivent tranquillement leur marche jusqu’au port desservi par de grands bateaux blancs. Depuis la jetée, ils contemplent à nouveau le très beau paysage tout en se ravitaillant. Ils repartent jusqu’à l’extrémité orientale de l’île, s’accordent un bain de pieds (même si l’eau est encore fraîche au milieu du printemps), reviennent par l’autre rive jusqu’à la ferme-restaurant, située non loin de là. Avant de rentrer par le même chemin de terre, ils visitent la chambre où a habité Jean-Jacques Rousseau pendant les six semaines heureuses de son séjour.
Ils font d’autres excursions : sur le littoral, à Chaumont (par le funiculaire), la descente des gorges de l’Areuse depuis Noiraigue (effectuant au préalable l’aller en train) ou celle des gorges de Douanne dans le canton de Berne (prenant d’abord le funiculaire de Gléresse pour Prêles), à Cudrefin sur la rive sud du lac de Neuchâtel (en bateau ou en voiture), à La Tourne, au mont Racine, et encore en d’autres endroits.
Toutes ces promenades au contact de la nature font partie en quelque sorte d’une période souvent exaltée et romantique. Elles rappellent aussi leur relative insouciance quand on considère qu’elles se sont passées dans les trois derniers mois de leur préparation du baccalauréat.
Ils aiment bien aller également au cinéma. Tant au ciné-club que dans les salles commerciales, ils privilégient les grands films classiques comme ceux de Charlie Chaplin, Sergueï Eisenstein, Alfred Hitchcock, Marcel Carné et bien d’autres, sans négliger les grands réalisateurs de leur époque comme Luchino Visconti, Akira Kurosawa, Ingmar Bergman, Federico Fellini, Alain Resnais ou François Truffaut.
Jusque-là, dans leurs rapports physiques, ils se sont contentés de gestes de tendresse, de caresses superficielles et de baisers sensuels. Mais à la fin du printemps 1964, intervient un palier supplémentaire.
Les voilà installés à l’écart pour un pique-nique en haut d’un pâturage en bordure de la forêt. Le temps est magnifique. Après le repas, ils se couchent sur l’étroite couverture pour un bain de soleil. Christiane enlève sa jupe, se retrouve en jupon, car, dit-elle, « Je ne veux pas la froisser ». Philippe le prend comme une invitation à explorer son intimité, il ne se fait pas prier.
À partir de là, ils vont parler ouvertement des relations sexuelles. Tous deux sont entrés dans leur vingtième année, mais ils préfèrent attendre, ils ne se sentent pas encore prêts.
Semaine heureuse que leur voyage de bac à Florence, début juillet, où ils n’hésitent pas à s’afficher en couple. L’ambiance est chaleureuse, toute la classe a réussi, à l’exception de Véronique qui a tout de même tenu à accompagner ses camarades.
Pendant les vacances d’été, ils passent une semaine en France au Grau-du-Roi avec Claude – un cousin français qui dirige un camping au bord de la mer – et sa famille. Ils vont ensuite rejoindre les parents de Christiane en Espagne dans un autre camping. Mais les amoureux doivent se séparer à la frontière, car les douaniers ne laissent pas passer Philippe, faute de passeport (on ne rentre pas comme ça dans l’Espagne franquiste avec une simple carte d’identité, même si on est Suisse !). Christiane va prendre un bus pour retrouver ses parents, alors que son petit ami, tout penaud, se contente de quelques jours sur la plage de Lacanau Océan (à cinquante kilomètres de Bordeaux), puis projette de visiter quelques-uns des châteaux de la Loire, avant de rentrer prématurément à Neuchâtel.
En roulant, il constate que la Mini Cooper dont il dispose ne tient plus la route dans les virages. L’explication en est bien simple, les deux pneus avant sont lisses. Pas d’autre solution que de les changer ! Un autre inconvénient survient le lendemain quand il veut visiter le château de Chenonceau. Les grilles d’accès sont fermées, une heure à attendre avant leur ouverture. Il décide alors d’escalader la porte, y parvient non sans peine, s’engage sur le chemin menant au château. C’est alors qu’il se fait surprendre par un gardien furieux et scandalisé. Celui-ci lui reproche sans ménagement son acte contraire à la loi, insiste sur la violation de la propriété, d’autant plus pour un monument national.
« Je vais faire un rapport à André Malraux, mon ministre de tutelle, ça va vous coûter cher ! »
Tout en marchant vers la sortie pour expulser le fraudeur, il entreprend une sorte d’enquête policière pour savoir comment il est entré, veut connaître son identité et ses coordonnées, puis relève le numéro d’immatriculation de son véhicule…
Au bout d’une bonne demi-heure, il le lâche enfin tout en répétant ses menaces.
« Je vais écrire mon rapport à André Malraux, ça va vous coûter cher ! »
Vers la fin des vacances, Christiane traverse « une crise d’adolescence » (pour reprendre son expression). Elle consiste à s’accuser, à se trouver tous les défauts du monde, à se détruire. Ce côté masochiste n’est pas nouveau. Philippe essaie de la rassurer.
À la veille de leur entrée à l’université, intervient une première tentative de rupture des liens amoureux. Mais une semaine après, suite à un appel de Christiane, c’est la reprise de leur relation sentimentale. Dans l’enchaînement, sur l’initiative de la petite amie qui l’accueille dans sa chambre, ils font l’amour pour la première fois.
Le lendemain dimanche, en se promenant avec sa mère, il en est encore tout impressionné, peine à suivre la conversation sur les bienfaits de l’acupuncture. Il a l’esprit ailleurs. Depuis la nuit dernière, Philippe a pris conscience qu’il est maintenant un homme et Christiane une femme.
Un mois plus tard survient une deuxième tentative de rupture. Il propose de transformer leurs liens d’amour en amitié. Mais comme la précédente, cette tentative ne dure pas plus d’une semaine, quand ils se retrouvent – à l’initiative de Philippe cette fois. Il s’ensuit une période amoureuse avec des hauts, des bas et des contradictions qui va durer presque jusqu’à la fin de l’année.
À la mi-décembre 1964, une nouvelle les met à l’épreuve : Christiane craint d’être enceinte. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le couple ne prenait pas suffisamment de précautions : ni préservatif, ni pilule, seulement une abstinence pendant les périodes supposées d’ovulation. Cette annonce va les déstabiliser. Lui n’est pas prêt à assumer ses responsabilités. Quant à la jeune fille, elle ne se voit pas en mère et redoute les réactions de ses parents. Le médecin chez lequel travaille la mère de Philippe examine Christiane et lui prescrit des médicaments. Les tensions sont fortes de part et d’autre, le jeune couple ne parvient pas à dialoguer sereinement, les parents de Christiane enveniment les choses avec leur fille. Finalement celle-ci, quelques jours avant Noël, retrouve ses règles – on ne saura pas si c’était dû aux effets des médicaments. Mais le lendemain, vidé par l’épreuve, déçu par sa compagne, écœuré par l’attitude des parents de Christiane qui l’a mis hors de lui, il lui dit qu’il la quitte, provoquant ainsi leur troisième tentative de rupture.
Dans sa solitude, Philippe a tout le temps de réfléchir à la situation. Plus les jours passent, plus il se rend compte qu’il a mal réagi, que ses critiques étaient exagérées ou infondées. En réalité il a eu peur et n’a pas été à la hauteur de la situation. Une dizaine de jours plus tard, il retrouve Christiane pour reconnaître ses torts, s’excuser, lui confier qu’il l’aime toujours. C’est dur pour elle, mais peu à peu ils retrouvent leurs sentiments amoureux.
Trois mois plus tard, au printemps 1965, ils prennent conscience de la détérioration de leurs sentiments et décident de rompre. Cette quatrième tentative de rupture, qu’ils croient définitive, va durer en fait cinq semaines. Ensuite le couple se reforme, mais en réalité, ce n’est plus la passion qui l’anime. Ils se voient moins souvent, s’accordent beaucoup de libertés. Philippe est de plus en plus accaparé par la vie universitaire ; il voit souvent ses amis, aime à discuter avec eux d’un peu de tout quand ils se retrouvent dans les bars ou cafés, s’intéresse aux événements du monde, à la politique, à la littérature, au cinéma… Ils en passent du temps à refaire le monde ! Christiane, elle, sort très peu, ne connaît pas grand monde, n’a pas vraiment d’opinions. Elle ne se plaît pas à l’université, décide d’arrêter ses études à la fin de la première année.
Sans véritable surprise, à la fin des vacances d’été pendant lesquelles ils se sont peu vus, chacun étant parti de son côté, ils se rendent compte qu’il vaut mieux mettre fin à leur couple. C’est leur cinquième tentative de séparation, mais celle-là pourrait bien être une rupture définitive, quitte à garder des relations amicales.
Dans ce retour sur le passé sentimental de Philippe, il faut inclure sa passion imaginaire pour Sylviane.
Quand il la rencontre pour la première fois à l’arrêt de bus de l’université, il est tout de suite attiré par cette jeune femme. Un vrai coup de foudre. Elle penche légèrement la tête vers le sol, ses cheveux châtain clair font ressortir un visage très expressif. Elle est très jolie, d’une beauté encore adolescente et un rien envoûtante. Il la revoit souvent, car elle vient d’entrer à la faculté des lettres de l’université de Neuchâtel où elle suit comme lui des cours de français et de philosophie. Cela lui permet de l’observer. Très assidue, elle prend des notes en penchant légèrement la tête de côté, ses cheveux mi-longs ont tendance à tomber, elle les remet en place d’un geste précis. Elle réagit parfois aux propos du professeur par une moue dessinée sur ses lèvres ou un mouvement de tête destiné à sa voisine. Un jour ils se retrouvent dans une position inattendue. Elle descend une des deux rampes latérales de l’auditoire des lettres, précédée d’un étudiant. Celui-ci s’écarte pour le laisser monter au moment où Sylviane saute l’avant-dernière marche sans regarder devant elle. Un peu surprise, elle se trouve nez à nez avec Philippe. Elle s’excuse dans un grand sourire un peu complice, qu’il lui rend. Il remarque la clarté de ses yeux. C’est la première fois qu’il la voit de si près.
Dans le cadre d’un séminaire de philosophie, elle présente un exposé sur Nabert. Il est si occupé à la regarder, son excitation intérieure est telle, qu’il a de la peine à la suivre, mais tombe sous le charme de sa voix. À la fin du cours, alors que plusieurs étudiants l’entourent, il s’approche timidement et, le cœur battant, lui pose une question sur son travail. C’est la première fois qu’il lui adresse la parole. Elle lui répond gentiment, mais ils en restent à un très bref échange, car ses copines l’entraînent.
Les mois s’écoulent, l’amoureux transi nourrit son imaginaire de ses fantasmes et de ses rêves tout en se gardant bien d’aborder Sylviane.
Un soir, il va au cinéma ; au programme, LesEnfants du paradis, un film du réalisateur français Marcel Carné (Jacques Prévert pour le scénario et les dialogues) datant de 1945 avec d’excellents interprètes. Philippe est bouleversé par l’amour malheureux du couple d’amants Garance (Arletty) et Deburau (Jean-Louis Barrault), la fidélité de l’épouse (Maria Casarès), l’imbrication de l’art et de la vie, l’anarchisme et le cynisme de Lacenaire (Marcel Herrand), la primauté de l’esthétisme chez le comédien Frédérick Lemaître (Pierre Brasseur), la fameuse dernière séquence où le mime Deburau marche à contre-courant dans la foule de Carnaval, poursuivant la quête désespérée de son amour… Tout cela résonne en lui, touche une sensibilité presque maladive. Il sort du cinéma dans un état de crise. Arrivé au Café du Théâtre, la vue de Sylviane avec son partenaire amplifie les sentiments qui le poursuivent…
À la fermeture du café, il suit la voiture de l’ami qui la raccompagne chez elle. Il se cache derrière la villa et attend. Bientôt il aperçoit de la lumière à l’étage. Si près d’elle – il suppose que la chambre éclairée est la sienne – il est paralysé. Philippe reste fixé sur cette fenêtre éclairée qui exerce sur lui une véritable fascination. Des pensées confuses agitent son esprit. Travaillé par une imagination exaltée, il se voit pénétrer dans ce sanctuaire illuminé où doit se recueillir sa sylphide. Il n’entreprend rien. Au bout d’une demi-heure environ, la lumière s’éteint. Il quitte les lieux, rejoint la voiture, rentre chez lui, dominé par des sentiments mélangés de mélancolie, de tristesse, de révolte impuissante et de solitude.
3
À la fin du mois d’octobre 1965, sa deuxième année à l’université commence. Il ne se fait pas trop de souci. Moins présent aux cours, il peut compter sur la petite équipe sympathique des historiens. Il y en aura toujours un qui prêtera volontiers ses notes en cas d’absence. C’est à peu près la même chose en français, où il dispose en plus des cours polycopiés. En dehors de la préparation intensive des examens, la vie universitaire permet de prendre du bon temps. Il ne s’en prive pas.
Philippe fréquente le bar Au Galop, juste à côté de l’université. Il est presque toujours sûr de rencontrer une ou plusieurs de ses connaissances. Peu de temps après la réussite de son examen préalable de latin, il découvre les albums d’Astérixle Gaulois, écrits par Goscinny et dessinés par Uderzo, dont le petit village gaulois résiste héroïquement aux légions romaines. Cela le fait beaucoup rire et compense en partie le dur travail fourni pour apprendre la langue ancienne. Dans ce bar se côtoient, entre autres personnes, des joueurs de dés (une sorte de poker) et d’échecs auxquels il ne manque pas de se mêler à l’occasion.
Il se rend également dans un autre bar, Le 21, situé précisément au 21 du faubourg du Lac, installé au sous-sol du cinéma Apollo. Ce lieu diffuse de la musique pop et permet d’entendre les dernières découvertes en la matière. Le jeune homme a la chance de vivre dans les années 1960, où ce genre de musique s’est créé et développé. Les Beatles, bien sûr, mais il préfère les Rolling Stones, plus engagés, avec un chanteur, Mick Jagger, à l’énergie inépuisable, et un guitariste, Keith Richards, aux riffs ravageurs (dès leur premier tube planétaire, « (I Can’t Get No) Satisfaction », en 1965). Il aime aussi beaucoup The Animals, révélés par leur succès mondial, « The House of the Rising Sun », en 1964 (adapté en français sous le nom « Le pénitencier », chanté par Johnny Hallyday). L’année suivante le groupe au chanteur convaincant (Eric Burdon) et au claviériste très doué (Alan Price) confirme avec un morceau revendicateur : « It’s My Life (and I’ll do what I want) » (« C’est ma vie (et j’en ferai ce que je veux) »). Il apprécie aussi les Who. Ceux-ci se font remarquer en 1965 par leur succès prometteur, « My Generation », qui en annonce d’autres. Bien entendu, il y a une abondance d’autres groupes, chanteurs et musiciens remarquables dans cette décennie.
La musique pop va passionner les jeunes, mais aussi des personnes de tous les âges. Elle est propagée par la vente énorme des disques et par la diffusion des radios, comme la célèbre émission d’Europe n° 1, Salut les copains. Son animateur, Daniel Filipacchi, a su trouver les mots pour en parler et détecter les chanteurs et musiciens les plus talentueux, même si parfois il a avantagé ses compatriotes (on est sur une chaîne privée française).
À Neuchâtel, c’est à La Rotonde, située faubourg du Lac et empiétant sur le Jardin anglais, qu’on vient danser en fin de semaine dans la grande salle le jerk sur les musiques pop à succès. Philippe y participe avec des camarades. Ils se mêlent aux danseurs, se lâchent, chacun gesticule librement à sa manière, la danse en couple étant réservée aux slows.
Parmi les lieux de détente, quand il sort le soir, il va volontiers au Café du Théâtre, situé au centre-ville, où des étudiants se retrouvent régulièrement à la galerie du premier étage.
*
Peu à peu, Philippe devient contestataire, il se forme des convictions nettement de gauche, à travers ses discussions, ses lectures aussi, dont celle du NouvelObservateur auquel il est abonné. Ses amis du Haut (Le Locle, La Chaux-de-Fonds), parmi lesquels Paul-Robert, en sciences économiques, et François, en lettres (philosophie, français), adhèrent à la dialectique du marxisme. Le second a eu le privilège, au gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds, de suivre les leçons de français de l’écrivain Yves Velan (auteur d’un premier livre remarqué, Je). Ses relations avec Alejandro et Vasco lui ouvrent les yeux sur les dictatures ibériques ; celles avec ses amis noirs africains du Rwanda (appartenant au clan dominant des Tutsi), Jean, Marc et Shadrack, le sensibilisent aux problèmes du tiers-monde, sur lesquels l’ouvrage de l’agronome René Dumont, provoquant un scandale à sa parution, L’Afrique noire estmal partie, avait déjà attiré l’attention dès 1962. Il décrivait méthodiquement les handicaps du continent africain, les problèmes de corruption, les conséquences de la décolonisation. Le Bulgare Miroslav, lui, dénonce les régimes communistes soutenus par l’URSS. Intarissable, il a toujours quelque chose à raconter. Il se lie aussi d’amitié avec Jean-Pierre, un étudiant du Jura bernois qui loge au foyer des étudiants et occupe le petit bureau de la Fédération des étudiants neuchâtelois, quand il est chargé de tâches administratives en tant que membre du bureau de la FEN.
*
Au début de l’année 1966, il se retrouve seul dans l’appartement de la Favarge. Le docteur Fischer s’est installé à Lausanne. La mère de Philippe a suivi son employeur ; elle a trouvé un petit logement assez économique dans le haut de la ville. Son budget est assez serré, mais elle s’en sort grâce à son salaire, une modeste pension versée par son ex-mari pour l’entretien du deuxième enfant (le premier a déjà vingt-sept ans) et la bourse d’études obtenue pour Philippe. Elle ne refuse jamais d’argent à son fils quand il en a besoin. Jusqu’ici il en a gagné un peu grâce à de petits boulots. Philippe reste naturellement en contact avec sa maman. Ils se téléphonent, il lui rend visite, en particulier le dimanche. Maintenant qu’il vit seul, Philippe va assez souvent en semaine manger au foyer des étudiants, proche de l’université. La nourriture est bonne, assez équilibrée, et si on a encore faim, on peut obtenir des suppléments gratuits en allant à la cuisine. Quant au prix, il est très raisonnable. Il y retrouve les habitués, avec lesquels les liens s’établissent facilement. Il revoit son ami Jean-Pierre qui l’invite à l’occasion à prendre le café dans sa chambre, en compagnie de sa voisine de palier. Elle s’appelle Walli, c’est une étudiante venant d’Allemagne de l’Est, un peu plus âgée qu’eux ; elle suit les cours du séminaire de français moderne à l’université. On la surnomme par plaisanterie la Prussienne, à cause de son attitude un peu trop rigide, ce qui ne l’empêche pas d’être une bonne camarade.
Cependant il sait aussi cuisiner. Cela lui arrive de se préparer des repas avec, d’habitude, de la salade, différents légumes, des pommes de terre nature, une tranche de viande ou du poisson. Le soir, il se contente de restes ou d’un pique-nique.
Maintenant que sa mère est partie, il lui est plus facile d’inviter ses connaissances. La semaine dernière, Elisabeth, fille sensuelle aux cheveux châtain clair tombant sur les épaules, s’est même proposée pour faire un repas avec des amis. Son steak au poivre avec les garnitures a été très apprécié. La soirée s’est déroulée dans la gaieté. Ce que Philippe aime chez elle, c’est sa générosité et sa franchise. Mais elle a parfois sa face cachée, quand elle affiche un visage hermétique, dur et froid – image sans doute de son insatisfaction.
« Vous les Blancs, ce que vous pouvez être sérieux et stressés… Cool mec, cool ! » s’exclame dans un éclat de rire Jean, le Rwandais, devenu un de ses meilleurs amis au cours des nombreuses occasions où ils ont discuté ensemble. Il lui a confié ses problèmes culturels, existentiels et sentimentaux – sa liaison avec une jeune femme blanche, la discrète Anne-Françoise. Il est d’avis de ne pas trop se poser de questions quand le moral n’est pas très haut. Philippe est très heureux de dialoguer avec cet être si chaleureux, de découvrir qu’une sensibilité commune les rapproche. La compréhension, si difficile à obtenir entre deux personnes, semble facilitée par une sympathie mutuelle.
Quant à son cousin, Marc, il est plus sûr de lui, engagé politiquement. Il ne se gêne pas pour dénoncer les méfaits du colonialisme en Afrique noire, l’impérialisme américain (que ce soit en Amérique latine, au Vietnam ou ailleurs), les problèmes raciaux aux États-Unis, le régime d’apartheid en Afrique du Sud.
Un jour, pourtant, il lui confie, dépité, une défaillance surprenante dans sa vie intime : « Le temps d’un flash, voilà ce qu’a duré mon dernier rapport sexuel ! C’est la première fois que cela m’arrive, je n’y comprends rien… »
Installé côté fenêtres dans l’aula des lettres, Philippe laisse errer son regard à travers les vitres sur le jardin de l’université et au-delà sur le vénérable bâtiment de l’École supérieure de commerce qui masque en grande partie la vue sur le lac. D’habitude, il s’oblige à prendre des notes pour se concentrer sur les cours, mais ce matin il n’est pas à son affaire. Ces savoirs livresques en français et en histoire, ces spéculations en philosophie, lui paraissent déconnectés de la réalité. Ce sentiment, il l’éprouve parfois aussi dans les discussions estudiantines où l’on s’illusionne en refaisant le monde. Trop de mots, trop de passivité, un besoin d’action contrarié, la conscience d’être paumé, impuissant, seul… Décidément, ce matin, son vague à l’âme le pousse à se poser des problèmes existentiels.
Une réforme de la licence ès lettres vient d’être décidée par les autorités universitaires. Les nouveaux étudiants devront choisir deux branches principales et une branche secondaire, cette dernière étant abandonnée après l’acquisition de la demi-licence. S’y ajoute l’obligation nouvelle de rédiger, dans l’une des disciplines principales, un mémoire de licence, initialement limité à quarante pages. Cette innovation est proposée aux étudiants de première et deuxième années. Philippe y voit son avantage. Il continuera jusqu’au terme de ses études le français et l’histoire, mais la philosophie sera reléguée au rang de branche secondaire. Certes, il apprécie l’enseignement de l’histoire de la philosophie, mais ne se sent pas à l’aise avec l’autre professeur dans ses cours et séminaires. Récemment il a dû présenter un texte de Hegel auquel il n’a pas compris grand-chose. Heureusement le professeur a largement suppléé son ignorance, même si l’étudiant n’a pas mieux compris l’auteur de La Phénoménologie del’esprit.
*
Au début de février 1966, son ami Jean-Pierre le met au courant de l’intention de la Fédération des étudiants neuchâtelois de créer un théâtre universitaire. L’idée initiale est due à l’enthousiasme communicatif et l’entregent d’un étudiant algérien à l’université de Neuchâtel, prénommé Omar, qui va se démener pour trouver des appuis dans les autorités et des soutiens financiers. Une première séance d’information est prévue dans la pièce d’accueil du premier étage du foyer des étudiants. Il s’y rend. La FEN a bien fait les choses, elle a convaincu, avec l’aide d’Omar, le metteur en scène neuchâtelois François Flühmann (du Théâtre de poche neuchâtelois) de piloter le projet. Les premiers contacts sont très positifs, le metteur en scène fait part de ses intentions, répond bien aux questions – un échange fructueux s’engage avec lui. Parmi les présents, une douzaine de participants, plus de la moitié ont déjà une expérience du théâtre et se disent prêts à s’engager. Ce n’est pas le cas de Philippe, qui n’a jamais joué ; il ne sent pas de prédispositions à s’exposer comme acteur, car il est plutôt timide, du genre introverti, ne se voit pas sur une scène de théâtre. Cependant, par intérêt littéraire, par curiosité également, il veut bien participer à une prochaine rencontre, fixée une semaine plus tard dans le même lieu. Cette fois François Flühmann entre directement dans le concret en présentant deux pièces de l’auteur contemporain Eugène Ionesco, Jacques ou laSoumission et L’Avenirest danslesœufs. Il arrive à convaincre les participants de se lancer dans ce projet. Philippe lit les deux pièces et trouve à la bibliothèque, dans un livre sur l’auteur, un article publié dans L’Express d’octobre 1955 de Marie-Claude Hubert à propos de la représentation des deux pièces mises en scène par Robert Postec :
« Dans Jacques ou la Soumission et dans L’Avenir est dans les œufs, pièces écrites au tout début de sa carrière théâtrale, peu après La Cantatrice chauve, Ionesco présente, en deux mouvements successifs, le drame d’un jeune homme qui ne supporte pas les compromis qu’imposent à tout individu la famille et la société. Les deux pièces donnent à entendre son cri de révolte. Dans Jacques, Ionesco le met aux prises avec ses parents et ses futurs beaux-parents qui, ligués contre lui, veulent le forcer à rentrer dans le rang. […] Les trois refus du héros et ses trois soumissions constituent l’action dramatique qui revêt la structure répétitive propre à Molière […].
» […] Au début de L’Avenir est dans les œufs où le spectateur retrouve Jacques, trois ans après, en pleine lune de miel, celui-ci ne veut rien savoir de la mort. […] C’est lorsque son père lui annonce pour le convaincre qu’il se doit d’assurer la descendance, qu’il se réveille de cet état de semi-conscience, de léthargie, et qu’il se ressaisit, refusant à nouveau l’existence. […] Mais il chute à nouveau et se renie lui-même en acceptant la procréation. Sa faute, c’est de perpétuer la vie. »
Philippe reste assez sceptique. Cependant à la séance suivante consacrée à l’analyse et la compréhension des deux pièces, François Flühmann, grâce à sa bonhomie et son enthousiasme, entraîne chacun dans le vif du sujet. Le projet est adopté. On assiste à la création du Théâtre universitaire neuchâtelois (TUN) ; les répétitions peuvent commencer. Quandil sera question de la distribution des rôles, le metteur en scène pourra compter sur trois acteurs confirmés pour les personnages clés. Philippe se fait un peu forcer la main pour accepter de jouer ; il interprétera un personnage secondaire, celui du père.
Au début du printemps, deux articles consacrés au nouveau Théâtre universitaire neuchâtelois paraissent dans LaTribuneuniversitaire. Le premier est dû à l’initiateur du projet, Omar, qui raconte succinctement sa genèse, définit son but : « participer au développement et à la diffusion de la culture ; faire connaître un répertoire inconnu ou peu joué, des formes théâtrales nouvelles ou oubliées ». Puis il parle du choix des pièces et annonce la première représentation à Neuchâtel. L’article se poursuit par les questions posées au metteur en scène François Flühmann qui a bien voulu y répondre.
« Pourquoi avez-vous choisi Ionesco ?
– Faire du théâtre vivant. Prendre le risque de présenter un auteur très discuté et ne pas se réfugier dans un répertoire traditionnel archiconnu. […] De plus, le problème de Jacques est celui de tous les étudiants.
– Quel est le thème de ces deux pièces ?
– Jacques est un jeune homme révolté qui refuse pendant un certain temps d’adhérer à la société ; peu à peu il devra se soumettre, se marier, assurer la continuité de la race blanche. Il sera finalement submergé par le matérialisme d’une société qui méprise l’individualisme et qui condamne tout ce qui ne donne pas de résultats concrets. C’est aussi la parodie du drame bourgeois.
– Comment concevez-vous leur mise en scène ?
– J’ai essayé de clarifier le thème central et de présenter la pièce sous la forme d’un match qui oppose Jacques et ses parents. De chaque côté de la scène, deux panneaux indiqueront au spectateur les points marqués par l’une ou l’autre équipe. Le décor sera conçu comme une sorte de cage de laquelle on ne peut pas s’évader. […] Mon principal but est de montrer que le théâtre de Ionesco n’est pas aussi incompréhensible qu’on le pense. À l’aide d’un langage cocasse et déroutant, parce que nouveau, il exprime une vision très originale du XXe siècle et de ses problèmes. »
Après trois mois et demi d’intenses répétitions, la première représentation est à l’affiche du Théâtre de Neuchâtel (situé à côté de l’hôtel de ville), très bien rempli pour la circonstance. C’est un succès, François Flühmann félicite sa jeune troupe. Un peu paralysé par le trac, le néophyte n’a pas vraiment réussi à sortir son personnage du père ; il en est déçu.
Voici des extraits du compte rendu paru le lendemain dans la Feuilled’avis de Neuchâtel sous les initiales de R. Lw., avec en gros titre « Enthousiasme juvénile hier soir au Théâtre de Neuchâtel. Pour sa toute première le Théâtre universitaire neuchâtelois a mangé du bourgeois à la sauce Ionesco » :
« Débuts prometteurs, hier soir, du Théâtre universitaire neuchâtelois. À peine sorti… de l’œuf. Une salle pleine à craquer, débordante de jeunesse et d’enthousiasme, composée pour les trois quarts d’étudiants venus applaudir leurs condisciples. […]
» Le choix d’un auteur comme Eugène Ionesco, pour les débuts d’une jeune troupe, m’avait causé quelque appréhension. Eh bien non, finalement, ce fut au contraire une trouvaille : le farfelu du bonhomme permettant sans doute bien mieux aux jeunes acteurs d’enfarfeluter leur manque de métier au nez et à la barbe naissante d’un jeune auditoire qui ne demandait que ça. Et qui, du moment qu’on lui fournissait sa… production intensive de farfelu se montra très bon public, public facile, le zygomatique toujours prêt à l’emploi pour n’être pas en retard d’un rire à chaque jonglerie de mots, à chaque invention cocasse. […]
» Le ridicule des idées toutes faites, des agissements types en certaines situations, l’absurdité des attitudes et conceptions conventionnelles, tout cela éclate en drôleries de situations, de mots (et quelles trouvailles torrentielles, quelles tirades étonnamment, sentencieusement saugrenues !).
» Double idée épatante : le décor de la pièce (fauteuil et canapé perdant leurs entrailles de crin et de ressorts), enclavé dans un vaste filet de gardien de but. Car la lutte de Jacques contre sa famille, contre la société, est arbitrée par un commentateur, présentée comme un match où l’on marque les points. Des points sans logique numérique non plus.
» Deuxième trouvaille : les visages peints des acteurs, sur lesquels on retrouve les mêmes couleurs dans la même famille […], allusion on ne peut plus… colorée à un racisme de classe, de clan. […]
» À en juger par l’accueil délirant de la salle, Ionesco a fait bien du chemin depuis ce jour de 1950 où sa Cantatrice chauve faisait s’indigner les notables qui constituaient la majeure partie du public du théâtre des Noctambules. »
Le critique littéraire passe ensuite en revue les acteurs et actrices.
« Les meilleurs acteurs sur scène – Henri Falik, grand-père pitre effroyable, incarnation vivante du gâtisme familial – Mireille Rezzonico, jeune mariée, éloquent symbole de la cage hors de la cage, de cette évasion rêvée qui n’est elle-même que convention […], cette actrice de la Bourgade a d’ailleurs une fort bonne diction et un sens certain du geste sobre et par là-même significatif – Éric Diacon, qui incarnait Jacques, sort lui aussi du même poulailler. Mieux dirigé, il aurait pu se montrer plus cocasse dans son entêtement : un sombre plus caricaturé – Alice Rothpletz est pétulante ; son plaisir à jouer est évident, physique […] – Luce Steigmeyer, un peu criarde joue juste […] – Jacqueline Rossier, grand-mère, devrait un peu pousser sa voix ; son personnage de composition est réussi […]. Quant aux autres, ils sont d’honnêtes acteurs amateurs qu’on sent heureux de découvrir les planches. Et la voix du présentateur (Marc-André Oes) est un peu livresque, récitative…
» Mais qu’on ne voie ici que quelques notations dictées par une vive sympathie à l’égard de cette troupe universitaire qui démarre en force dans le sens du théâtre anticonventionnel. Car l’ambiance ce soir-là était “hot” et ce sont des… ovations sans fin qui ont accueilli dans un délire juvénile la chute du rideau. »
Encore quelques échos dont témoigne l’acteur Henri Falik dans son article humoristique intitulé « Que je vous conte ici l’irrésistible ascension du Théâtre universitaire de Neuchâtel », paru dans LaTribuneuniversitaire n° 6 de novembre 1966 :
« 20 mai 1966 : première représentation au Grrrrrrand Théâtre de Neuneu. Salle comble (de joie bien sûr). Tous les copains des comédiens sont là. Le théâtre contient environ six cents places. […] Un trac terrible qu’on avait ! Pensez, les copains, jouer dans une salle bondée, nous les débutants ! […] Mais nous, on avait mis tout notre cœur là-dedans. Grisés qu’on était […].
» Ce fut un délire : rappels ! bravos ! congratulations ! félicitations ! embrassades ! C’était formidâââble ! »
Une semaine après, une deuxième représentation a lieu à La Chaux-de-Fonds au théâtre Saint-Louis. Mais cette fois-ci le Théâtre universitaire n’a pas été bon. Sans doute faut-il l’imputer aux suites de l’euphorie du Théâtre de Neuchâtel, la fatigue et un manque de concentration.
Comme le dit Henri, dans sa narration de « l’irrésistible ascension du TUN », « et puis c’est la fin… la séparation… Bonnes vacances ! À la rentrée !… À la prochaine pièce…
» C’est qu’on y croit, nous, à nos vacances. Mais c’est compter sans Omar. Voilà-t-il pas qu’un mois plus tard cet énergumène a une autre idée fumeuse.
» “Hé les amis, y a un festival culturel étudiant à Paris au mois de septembre. Si comme ça qu’on y va…”
» Et voilà qu’on remet ça. On se refarcit ce sacré Eugène. Et tout ça en pleine période de vacances ! »
Il faut encore parer au remplacement de deux actrices indisponibles, puis se soucier des finances. Qu’à cela ne tienne, l’indispensable Omar ne tarde pas à engager les personnes adéquates, puis se lance dans la recherche difficile de mécènes – il trouve finalement Pro Helvetia, qui finance une grande partie du voyage.
Le « XIVe Festival international culturel étudiant, organisé cette année par l’Union nationale des étudiants de France (UNEF), a lieu à Paris du 8 au 22 septembre 1966. Il est placé sous le patronage de presque tous les ambassadeurs de la quarantaine de pays participants et de personnalités françaises marquantes du monde des lettres (comme André Malraux et Jack Lang). Le festival groupe plusieurs activités dont le théâtre, les danses folkloriques, les chants, concerts, colloques, films. Ces activités se déroulent chaque soir simultanément en divers endroits de Paris et de sa banlieue » (informations tirées du compte rendu du voyage du Théâtre universitaire neuchâtelois pour la FEN, rédigé par Philippe, chargé des affaires culturelles de la FEN, en collaboration avec Omar, responsable du TUN).