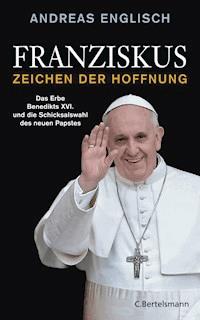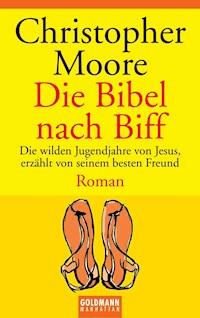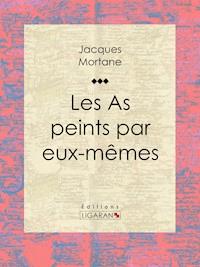
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
"""Les As peints par eux-mêmes"" de Jacques Mortane est un livre captivant qui nous plonge au cœur de l'univers des artistes. À travers une série de portraits, l'auteur nous dévoile les personnalités fascinantes et les parcours singuliers de ces artistes talentueux. De la peinture à la sculpture, en passant par la musique et la danse, chaque artiste nous livre son histoire, ses inspirations et ses aspirations. Au fil des pages, nous découvrons des témoignages authentiques et émouvants, qui nous transportent dans un monde où la créativité et l'expression artistique sont reines. ""Les As peints par eux-mêmes"" est un ouvrage incontournable pour tous les amateurs d'art, qui souhaitent plonger dans l'intimité des artistes et comprendre les motivations qui les animent. Une lecture enrichissante et passionnante qui nous invite à explorer les multiples facettes de l'art et à apprécier la diversité des talents qui le composent.
Extrait : ""Quelle idée se faisait-on, avant les mois d'août 1914, du rôle que l'aviation serait appelée à jouer dans une guerre ? Quelles différentes utilisations en escomptait-on ? A quelles réalisations est-on parvenu aujourd'hui, tant au point de vu des appareils que des méthodes aériennes ?"""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335016369
©Ligaran 2015
Quelle idée se faisait-on, avant le mois d’août 1914, du rôle que l’aviation serait appelée à jouer dans une guerre ? Quelles différentes utilisations en escomptait-on ? À quelles réalisations est-on parvenu aujourd’hui, tant au point de vue des appareils que des méthodes aériennes ? Autant de questions que le recul du temps, après trente-deux mois de campagne, permet d’envisager aujourd’hui avec une suffisante perspective. Simple coup d’œil, bien entendu, restreint aux limites d’une préface aux plus glorieux exploits de nos poilus de l’azur. Hommage liminaire à leur bravoure et à leur virtuosité. Mise au point n’ayant rien de définitif et que les modifications quotidiennes, à travers lesquelles l’aviation vole chaque jour de progrès en progrès, condamnent à une vérité en quelque sorte momentanée, mais qui peut dès à présent faire toucher du doigt au public l’immensité de la tâche accomplie en deux ans et demi par les aviateurs français.
Les conditions de la guerre aérienne avaient été, en temps de paix, prévues d’une manière extrêmement vague et tout à fait incomplète. L’aviation apparaissait sous la forme d’on ne sait quelle cavalerie de l’air qui devait s’illustrer entre les nuages en de brillantes rencontres de patrouilles. Ici encore, l’idée de l’exploit individuel dominait nos conceptions. Ici encore, nous étions aux antipodes de ce que la réalité allait nous offrir sur les champs de bataille et nous n’avions aucune idée précise de ce que dans une guerre de canons, de chemins de fer, d’automobiles, dans un duel de machines bien plus que de soldats, l’avion pouvait apporter à une armée d’éléments de victoire. Tantôt l’imagination s’arrêtait uniquement sur des duels vertigineux à 3 000 mètres en l’air, dont aussi bien aucun profit militaire ne semblait devoir être attendu, sinon d’établir la supériorité sportive des aviateurs français sur leurs adversaires allemands. Tantôt, en se représentant des destructions d’armées et des villes foudroyées du haut des airs, elle dépassait dans ses anticipations romanesques le domaine des possibilités et du vraisemblable. Elle voyait trop court ou voyait trop gros. Le rôle considérable de l’avion de repérage, auxiliaire indispensable, œil vigilant et perçant de l’artillerie, l’efficacité de l’avion de bombardement, frappant les communications de l’ennemi, l’affaiblissant à l’heure des attaques, lui coupant les jarrets, paralysant ses nerfs, on n’en avait, à vrai dire, qu’une prévision rudimentaire. Mais de cette guerre et de ses modalités formidables, en vérité qu’avait-on prévu ?
Le résultat fut que nous nous mîmes en campagne avec une aviation dont la force numérique était à peine égale, était même plutôt inférieure à celle des Allemands, alors que les ailes, invention française, due au génie des Ader et des Chanute, animées par une autre invention française, le moteur de Forest, auraient dû posséder dans notre camp une écrasante supériorité. Il fut, en outre, que les diverses spécialisations de l’avion n’étaient rien moins que délimitées. Nous entêtant sur notre conception trop sportive de l’aviation de guerre, nous possédions un nombre de monoplans sensiblement égal à celui de nos biplans. Les premières semaines d’hostilités nous firent vite comprendre notre erreur et la justesse des vues du capitaine Saconney donnant sa préférence à « la poutre armée inflexible » : le biplan.
Pour faire œuvre utile, qu’il s’agisse de combat, de reconnaissance ou de bombardement, l’avion doit en effet enlever, outre son pilote, au moins un passager ; or, à force de moteur égale, un monoplan biplace n’est pas plus vite qu’un biplan à deux places. Ajoutez que sa rapidité ascensionnelle est médiocre, s’il est chargé, et que le poids utile qu’il peut emporter est infiniment inférieur à celui qu’enlève un biplan ; enfin qu’à l’exception des appareils à vision totale, comme le parasol Morane-Saulnier, la vue y est limitée par les plans, le tir également. Enfin une solidité moindre.
L’an dernier, sur vingt-trois types d’avions en service – pour ne compter que les principaux – le nombre des monoplans n’était plus que de huit et, dans la catégorie des hydravions, de trois sur neuf. La proportion des monoplans était donc réduite à un tiers des appareils. Aujourd’hui, sur une dizaine de types, un seul monoplan, le Morane-Saulnier parasol. Nos constructeurs ont mis au point, dans la catégorie légère, des petits biplans, comme le Nieuport, de dimensions très réduites et d’extrême vitesse, que nos aviateurs ont aussitôt baptisés du sobriquet de « Bébés ». Les 160 kilomètres à l’heure de 1916 ont été dépassés. L’envergure de l’appareil est si faible au regard de la puissance du moteur que le biplan Nieuport de l’an dernier, avec une envergure et une longueur de 7 mètres et 18 mètres de surface portante, enlevait un moteur de 80 H.P. et 250 kilogrammes de charge utile, alors que des biplans de même puissance motrice exigeaient, selon les types, des surfaces portantes de 42 mètres et de 60 mètres. Dans la catégorie lourde, avions de bombardement, grâce au principe de la pluralité des moteurs, les mêmes progrès ont été réalisés et notre armée de l’air possède aujourd’hui des appareils susceptibles d’enlever un poids d’explosifs considérable. Voyez plutôt. Le biplan Caudron à deux moteurs le Rhône de 80 H.P. chacun, placés parallèlement à la carlingue, emporte ses 500 kilogrammes de charge utile et les emporte même, peut-on dire, à tire-d’aile, puisque sa vitesse atteint 135 kilomètres à l’heure. Confortablement muni d’explosifs, cet oiseau bombardier peut donc, si l’occasion s’en présente, se montrer redoutable chasseur et c’est un plaisir que sa mitrailleuse ne se refuse guère. Avec ses trois moteurs, deux 80 H.P. le Rhône aux flancs de la carlingue et un 140 H.P.à l’arrière actionnant chacun une hélice, le biplan Caproni-Esnault-Pelterie, de vitesse moindre, 115 kilomètres à l’heure, enlève cinq passagers, deux pilotes et deux mécaniciens, un observateur, une charge utile de 1 100 kilos.
Il est évidemment délicat de donner des précisions sur les nouveaux types qui sortent en ce moment de nos usines. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que le Spad de chasse atteint les 200 kilomètres à l’heure et qu’il y a tout lieu d’espérer les plus beaux succès avec le Sopwith de reconnaissance.
Quant à l’efficacité de la « charge utile » dont nos avions de bombardement assurent la distribution, le témoignage des Allemands eux-mêmes s’en est maintes fois porté garant. Les carnets de route trouvés sur des officiers ou sur des hommes de troupe faits prisonniers nous ont dit avec des accents de rage, qui ne sont pas pour nous déplaire, la puissance destructive de nos torpilles de 90, de 155 et de 220, quand leur charge de mélinite descend du ciel sur un emplacement tenu par l’ennemi. Nos bombes Claude possèdent une telle force explosive, que leurs éclats sont parfois projetés jusqu’à 700 et 800 mètres du point de chute ! Tantôt nous apprenons qu’une seule bombe tombant sur un bivouac tue huit hommes et en blesse trente-deux, abattant par surcroît une dizaine de chevaux. Ailleurs, dans un rassemblement de cavalerie, une bombe : trente tués ; une seconde bombe : trente tués encore et cinquante chevaux.
Prévue dès le temps de paix par Ader, qui en avionnerie militaire avait vu si juste et si loin, la fléchette dès le début de la guerre a donné dans l’arrosage de larges zones des résultats excellents. Cette petite tige de 12 centimètres de long sur un diamètre de 8 millimètres avec un poids de 19 gr. 25 a prouvé d’éclatante manière son extraordinaire force de pénétration. Lâchée de 2 000 mètres de haut, elle arrive avec la même puissance que si, placée sur le crâne d’un homme, elle subissait tout à coup le choc d’un poids de 40 kilogrammes tombant de 1 mètre de haut. Sa légèreté permet à l’aviateur d’emporter de très grandes quantités de projectiles. Cinq mille fléchettes ne pèsent qu’une centaine de kilogrammes et une boîte de cinq cents fléchettes suffit à couvrir utilement une surface de 200 mètres de long sur 50 de large. L’homme touché l’est presque toujours sérieusement. La pointe d’acier pénètre avec facilité de 7 à 8 centimètres dans le crâne ; frappant l’épaule, elle disparaît dans le corps ; touchant le pied, elle le cloue au sol. Protestant contre la « cruauté » de ce projectile, bien plus barbare, n’est-ce pas ? que la balle explosive, les gaz asphyxiants et les jets de pétrole enflammé, un journal bavarois écrivait au lendemain des premières expériences : « Un major vient de publier un rapport des cas mortels observés par lui et produits par des flèches lancées des aéroplanes français. Il déclare qu’un jour plusieurs compagnies, durant l’après-midi, étant au repos et faisant peu d’attention à deux avions qui volaient au-dessus d’elles, soudain les chevaux à la longe commencèrent à ruer et des cris de douleur s’élevèrent parmi les hommes, dont plusieurs étaient littéralement fichés à terre. Une vingtaine de soldats furent blessés avant qu’on eût pu savoir d’où venaient ces flèches et qu’on eût pu se mettre à l’abri dans des voitures. La force avec laquelle ces flèches frappent doit être très grande, car un cas s’est présenté, d’une flèche perçant le crâne d’un homme et causant une mort instantanée. On calcula qu’un tiers des flèches avait porté ; l’efficacité de cette arme est donc prouvée d’une façon convaincante. »
Autre précieux témoignage, celui d’un correspondant de guerre américain, M. Irwin Cobb, autorisé par le Grand Quartier Général allemand à suivre les armées ennemies en France et qui d’un drachen a assisté à un de nos arrosages de fléchettes : « Décrivant des demi-cercles, oscillant au milieu des obus que l’artillerie allemande lui envoyait, montant, descendant, jouant à travers les nuages et les shrapnells, l’oiseau français lâchait méthodiquement ses stocks de fléchettes et le long des lignes des milliers de fourmis grises couraient des tranchées de l’avant à celles de l’arrière, disparaissaient, rentraient dans leurs fourmilières ou, quand elles n’avaient pas le temps de se terrer, jonchaient le sol, petits insectes gris à jamais immobiles. L’effet terrible du projectile, je pus le constater sur un hussard prussien, qui fut transpercé du sommet du crâne à la plante du pied droit ! »
On croit en vérité rêver, quand on songe aux armes dont aux premiers mois de la guerre disposaient nos aviateurs pour voler à l’attaque des aéros allemands. L’armement d’un dragon, d’un chasseur en patrouille ! Souvenez-vous des premiers communiqués aériens. Le 7 octobre 1914, le pilote Gaubert, ayant à son bord le capitaine d’artillerie Blaise, surprend un Taube et, grâce à son habileté, évolue de façon à l’attaquer par-derrière et à le surplomber d’une trentaine de mètres, permettant à son passager d’envoyer aux deux aviateurs allemands huit balles de carabine. Par malheur pour les Boches, le capitaine Blaise est un excellent fusil et les Deutsche Nachrichten étaient le lendemain obligées de confesser que le lieutenant Finger, blessé au cours d’un combat aérien à 2 300 mètres d’altitude entre Metz et Verdun, était mort de ses blessures et son compagnon très grièvement estropié par un atterrissage un peu brusqué, où l’oiseau allemand avait émietté sa carcasse. Quelques semaines plus tard, un de nos aviateurs abattait encore un pilote allemand à coups de fusil, un autre encore près d’Arras se débarrassait de son adversaire avec vingt coups de carabine. Le 18 novembre 1914, un de nos Morane, monté par un lieutenant et un caporal, parti pour reconnaître les organisations défensives de l’ennemi dans la région de Dompierre, se heurte à un appareil allemand. Les nôtres ont pour toute arme un revolver. Ils ne se dérobent pas et entament la lutte contre la mitrailleuse allemande ! Seule la rupture d’un des haubans tranché par une balle les contraint à prendre du champ.
À trois reprises, Gilbert a été le héros de ces trop inégales rencontres. La première fois, le 2 novembre 1914, au cours d’une reconnaissance avec le capitaine de Vergnette, commandant son escadrille, où de trois balles il envoie l’Allemand s’écraser sur le sol ; la deuxième fois, avec son mécanicien Bayle comme tireur, sur un Morane-Saulnier, quand il attaque, le 18 du même mois, à 2 500 mètres, entre Albert et Bapaume, trois Albatros qui sont venus jeter des bombes sur Amiens. Des trois Allemands, armés de mitrailleuses, deux s’esquivent, le troisième est pris en chasse. Une poursuite folle de trente-cinq minutes, pendant laquelle l’Albatros déroule vainement des bandes de cartouches, à un moment glisse à 2 mètres sous l’appareil de Gilbert, fuit éperdument, bête désemparée, traquée, devant le mousqueton de Bayle, ne doit enfin son salut – avec pas mal de plomb dans l’aile – qu’au manque de munitions des Français aux environs de Montdidier. Obligé d’enlever ses gants pour tirer par un froid de 16 degrés, Bayle descendit d’avion avec les mains gelées. C’est encore avec un mousqueton de cavalerie que, dans la première quinzaine de janvier 1915, Gilbert remporte une troisième victoire. En compagnie du lieutenant de Puechredon comme observateur, il rentrait d’une reconnaissance menée sur les lignes allemandes du Nord, quand, à 20 kilomètres de Lille, il découvre volant à bonne distance devant lui un Taube occupé à repérer en paix nos positions. Gilbert accentue le train, de Puechredon préparant balles et mousqueton, et suit sa proie pendant une heure jusqu’aux environs d’Amiens avec une telle habileté que les Allemands ne se doutent pas un instant de la filature. Quand ils s’aperçoivent enfin de la présence du chasseur, Gilbert est à peine à 20 mètres derrière eux. Alors l’affaire se règle vivement. L’observateur allemand, le capitaine de Falkenstein, se retourne, pousse un cri de fureur. Gilbert s’écarte, laisse le champ libre à son passager. Quatre détonations, posément espacées. La première balle frappe en plein cœur le capitaine allemand ; la deuxième atteint l’avant-bras du pilote, et la troisième, pénétrant derrière la nuque, lui traverse le cou ; quant à la quatrième, elle va droit au radiateur. Le compte est bon. Le Taube descend, d’une descente un peu agitée, bien que le pilote allemand reste encore suffisamment maître de sa direction, et se pose au milieu des lignes françaises. L’avion de Gilbert atterrit doucement à côté du vaincu, qui vient alors à lui et, tendant sa main valide, offre à son vainqueur ce magnifique témoignage d’estime : « Je suis fier, monsieur, d’avoir eu pour adversaire un homme de votre valeur ! »
Le capitaine de Falkenstein avait été tué net. Une note de service signée d’un général, trouvée dans ses papiers, observait d’un ton aigre-doux que l’escadrille allemande ne se distinguait guère depuis quelques semaines. Pour prendre sa revanche, elle tombait bien mal en rencontrant Eugène Gilbert !
Si le temps est déjà loin où nos aviateurs attaquaient l’adversaire dans des conditions aussi navrantes d’infériorité et n’avaient à compter que sur leur merveilleuse virtuosité, sur leur courage et leur cran sans pareil, il ne faut pas oublier que l’initiative de notre cher et glorieux Garros, oiseau aujourd’hui captif dans une geôle allemande, trahi par une panne stupide, a joué un rôle considérable dans les progrès qu’a réalisés l’armement de nos avions de chasse. Dès les premiers jours de la guerre, l’idée le hantait de mettre au point l’aéro-mitrailleuse. Attaché à la défense aérienne du camp retranché de Paris, il travaille tout l’hiver 1914-1915, luttant sans trêve contre la routine et l’entêtement des uns, la jalousie imbécile des autres, sans se laisser décourager par des accidents de fabrication, qui semblent vingt fois devoir ruiner ses espérances. Enfin, il tient son dispositif, une gouttière en acier, qui de son monoplan, un Morane-Saulnier parasol, lui permet de tirer avec sa mitrailleuse dans le champ de rotation de l’hélice sans briser les pales.
Au printemps de 1915, les galons de sous-lieutenant sur la manche, il reçoit l’ordre d’aller dans le Nord, où les taubes deviennent, sur Dunkerque, particulièrement audacieux, essayer son invention. Pilote, observateur et tireur, l’admirable Garros tient les trois rôles à lui seul et son début est un coup de maître. Voici comment il le racontait lui-même le 3 avril 1915, à son ami Jean Ajalbert, qui lui a consacré depuis sa captivité tant de pages d’une émouvante et paternelle tendresse : « Cher vieil ami, vous savez que j’en ai eu un finalement ! Vous devez être curieux d’avoir quelques détails et je vais vous les donner en quelques mots. J’étais parti seul avec 95 kilos d’obus pour les lancer sur une gare teutonne [ son monoplan ayant été abîmé dans le garage par un coup de vent, Garros avait, en effet, confié son dispositif à un autre appareil, muni par surcroît d’un lance-obus de 155 ]. Arrivé à 10 kilomètres de nos lignes, je vois assez loin et bien au-dessus de moi, 500 mètres plus haut, un appareil sur lequel nos batteries tiraient. Je manœuvre pour lui couper la retraite, tout en m’efforçant de prendre la hauteur qui me manquait. Cela dure six à huit minutes. Arrivé à bonne hauteur, je m’approche : les batteries nous tirent dessus dans le tas. J’ouvre le feu à 30 mètres. Je recharge ma mitrailleuse trois fois. Au bout de quelques balles, l’ennemi fuit en désordre et en descendant à toute allure. Je ne le lâche pas d’un mètre. Le combat dure dix minutes. Il se termine à 1 000 mètres d’altitude ; criblé comme une passoire, l’albatros prend feu subitement, une immense flamme l’environne et il descend en tourbillon. C’est tragique, affreux. Au bout de vingt-cinq secondes de chute au moins (qui paraissent longues), l’appareil s’écrase sur le sol dans une grande fumée.
Je suis allé en auto voir les débris ; les premiers arrivés avaient raflé tous les objets, armes, insignes, etc. Je fais des démarches énergiques pour les récupérer. Les deux cadavres étaient dans un état horrible : ils étaient nus et saignants ! Le passager avait une balle dans la tête. On n’a pas examiné le pilote, qui était trop mutilé. Les restes de l’appareil étaient percés de balles un peu partout. Le combat s’est passé presque au-dessus des tranchées et les troupes ont pu suivre toutes les phases à plusieurs kilomètres. Il paraît même que les Allemands étaient sortis de leurs trous pour mieux voir : les nôtres ont pu en dégringoler quelques-uns. Inutile de vous dire ma satisfaction d’un succès aussi complet, malgré un certain écœurement du spectacle. Je suis seul à avoir combattu sans passager. Mais ce qui me rend surtout heureux, c’est le sentiment d’avoir créé seul, et malgré tous les risques de l’inconnu en aviation, l’instrument qui m’a porté au succès. C’est cela, par-dessus tout, ma joie. »
Dans la prison allemande où il languit, les ailes repliées, cela doit être aussi sa consolation de soldat de savoir tout ce que de son idée il est sorti de perfectionnements pour notre aviation de combat. La question de l’emplacement de la mitrailleuse a été judicieusement résolue. C’est ainsi que dans le biplan Nieuport de chasse et dans le biplan Caudron, elle s’installe sur le plan supérieur et n’est par conséquent nullement gênée par le cercle de rotation de l’hélice. Dans le biplan Caudron bimoteur, les deux moteurs étant placés parallèlement à la carlingue et séparés par un large espace, le tir est de même parfaitement libre. Le mitrailleur du monoplan Deperdussin à l’abri de son protège-corps est surélevé au-dessus du plan de l’hélice. Pour les biplans et hydravions biplans Maurice Farman, pour les biplans Henri Farman, la question ne se pose pas, puisque moteur et hélice sont à l’arrière du pilote. Dans de nouveaux appareils, munis de canons, le poids mort est d’environ 150 kilos dont il faut à l’aviateur accepter le sacrifice. Mais que d’avantages inestimables ! Et tout d’abord la possibilité pour l’avion-canon de tirer à la fois contre un objectif aérien et contre un objectif terrestre. Les pilotes et les observateurs des Fokkers, en dépit de leurs deux mitrailleuses, dont une en tourelle, en savent quelque chose.
Sans sous-estimer le courage de leurs adversaires, nos aviateurs peuvent prétendre dans le duel aérien à une incontestable supériorité. Les chiffres le prouvent. L’état-major allemand essaye de faire croire à l’univers qu’il a, en 1916, perdu en tout et pour tout 221 appareils. Voilà une de ces informations à la manière de l’agence Wolff, dont il est aussi bien coutumier ! La vérité est qu’en 1916, dans les combats avec les seuls aviateurs français, les Allemands ont perdu un total de 417 avions. Il nous est plus facile pour fixer leur religion – et celle des neutres – d’en établir le décompte : 2 appareils en janvier, 17 en février, 22 en mars, 27 en avril, 41 en mai, 18 en juin, 49 en juillet et autant exactement en août, 70 en septembre, 41 en octobre, 39 en novembre, 42 en décembre. À l’exception des trois derniers mois de l’année – où le mauvais temps diminue la fréquence des combats aériens – la progression, on le voit, a été rapide et constante, elle a marqué à chaque mois l’ascendant de plus en plus grand de notre aviation sur l’aviation allemande. Pour répondre à la prétention de l’état-major ennemi, il faut encore ajouter qu’en plus de ces 417 aéros, dont la destruction a été contrôlée rigoureusement dans les services de nos escadrilles, 195 autres avions ont été vus par nos pilotes tombant à pic, grièvement, sinon mortellement frappés, dans les lignes de l’adversaire. C’est donc de 600 unités que l’aviation de chasse française a diminué l’aviation allemande et on sait, du reste, que sur le front anglais les pertes aériennes ennemies ont été sévères. En quintuplant le chiffre officiel allemand, les neutres obtiendront, à une dizaine près, le chiffre sincère et auront une donnée exacte pour juger de la valeur de nos glorieux as.
Mais leur qualité n’est-elle pas de notoriété universelle ; leurs prouesses, de l’incontestable histoire ? L’admirable virtuosité dont ils font preuve chaque jour, ils la possédaient dès le temps de paix ; avec Garros, avec Brindejonc des Moulinais, avec Gilbert, elle avait émerveillé le monde entier. En la personne de l’infortuné Pégoud elle avait excité à Berlin même l’hypocrite et haineuse admiration de Guillaume II et de ses généraux. Elle est aujourd’hui, dans le ciel embrasé par la guerre, avec leur intrépidité, leur plus bel atout.
Fantastiques loopings, virages vertigineux sur l’aile, chutes sur la queue de l’appareil, descentes et montées en cheminée, toutes ces acrobaties de l’air, qui leur sont des jeux familiers, à l’heure du combat à 2 000 mètres, font d’eux de déconcertants et insaisissables duellistes. N’a-t-on pas vu l’un de nos aviateurs contraindre un aviatik à atterrir dans les lignes françaises en le mettant, par des évolutions incessantes, dans le vent de son hélice, ou, comme on dit dans le sport aérien, en le « soufflant » ?
Tactique audacieuse et bien française encore ce coup du vol piqué, remarquablement réussi contre un aviatik par l’aviateur anglais Marc Helsen, à l’époque où du côté des Alliés le fusil seul répondait à la mitrailleuse allemande. Helsen volait au petit matin à 2 000 mètres environ au-dessus d’Ypres, quand, entre les nuages, il découvre soudain un avion ennemi. Repéré, l’Allemand refuse le combat ; il cherche à fuir. L’Anglais s’élance à sa poursuite, le rejoint en dix minutes de vol rapide, le survole et entame la lutte. Mais les coups de mousqueton de son observateur n’atteignent que l’aile de l’aviatik, qui se met à taper terriblement de la mitrailleuse. Une balle arrive dans le capot à quelques centimètres du réservoir d’essence. C’est le moment de jouer serré et de vider le sac aux stratagèmes. Brusquement Helsen se laisse tomber en vol piqué. L’Allemand ne doute pas de la chute de son adversaire et descend immédiatement en vol plané. Alors d’un redressement subit, Helsen se rétablit et renverse les rôles. Il tient maintenant son ennemi sous lui, à 5 mètres. Une première balle transperce le bras du pilote allemand, qui besogne à équilibrer son appareil. Une deuxième touche au cœur le réservoir d’essence. L’aviatik s’allume, flambe comme un bouchon de paille et s’écrase au sol dans une gerbe suprême, le fuselage en miettes, avec ses passagers calcinés.
La seule tactique que les nôtres ignorent, c’est la fuite. Les duels les plus disproportionnés, ils les acceptent, en chevaliers ! Un contre deux ! Un contre trois ! Au champ clos de l’air, la dérobade n’est point leur fait. C’était le 5 février 1915, à neuf heures et demie du matin ; un taube était signalé à Sainte-Menehould, survolant nos lignes près du Four-de-Paris. Le pilote X… (nos aviateurs n’avaient alors droit qu’à l’anonymat pour récompense de leurs exploits), accompagné d’un sergent mitrailleur, file aussitôt dans la direction indiquée, déniche son oiseau et le charge à une cinquantaine de mètres. L’Allemand fait demi-tour et glisse vers l’horizon ; mais la mitrailleuse française ne le lâche pas, malgré la menace de deux aviatiks arrivant à tire-d’aile au secours de leur camarade d’escadrille. Une balle heureuse arrête à temps le gibier, qui cascade, glisse sur l’aile et tombe en secouant dans la flamme et la fumée ses lambeaux de toile déchiquetée.
Les deux aviatiks sont déjà là, avec qui il faut en découdre. X… et son mitrailleur, d’un seul coup de feu, règlent le sort du plus rapproché, qui pique dans le vide. À l’autre, maintenant ! Mais les obus allemands encadrent les nôtres, les serrent dans une étreinte de plus en plus étroite d’explosions. X… a juré d’abattre sa troisième pièce. Il l’abattra, en dépit des canons boches. À 1 500 mètres, il redresse son appareil, reprend de la hauteur, s’attaque au survivant. Il l’aborde à coups de mitrailleuse, en dessous, à 40 mètres. Au bout d’une minute, l’aviatik éperdu glisse sur l’aile et s’esquive vers ses lignes. Trop tard. X… le suit en un vol plané presque vertical, lui fauche les ailes et la queue, et l’envoie au sol.
Pour rendre l’hommage qu’elle mérite à notre aviation de combat, l’état-major français vient, à deux reprises, de sortir de sa réserve un peu sévère et de mettre sous les yeux de la France et du monde les merveilleux tableaux de chasse de nos deux plus fameuses escadrilles. Née au mois d’août 1915, la N.65 dès ses débuts en Lorraine, sous les ordres du capitaine Gounet-Thomas, est une de celles qui se sont le plus distinguées, à Verdun. Quatorze avions pour entrée de jeu, quatre autres renvoyés dans leurs lignes désemparés et un peu brutalement, quatre drachen incendiés. Elle en était en mars, pour 1917, à son cinquantième ennemi abattu. Sa cohésion, son splendide esprit de corps, on les a bien vus le jour où, le capitaine Féquant ayant pris la suite du capitaine Gounet-Thomas tombé au champ d’honneur, sur la tombe encore ouverte de Boillot frappé dans un duel par trop inégal, tous ses pilotes jurèrent de le venger magnifiquement. Le jour même dans l’après-midi, Nungesser attaquait un fokker qui venait s’écraser au sol. D’une escadrille voisine, Navarre accourait pour apporter à la vengeance sa contribution et incendiait un second Allemand. Le surlendemain, le capitaine Féquant offrait aux mânes de Boillot une troisième victime. Pour un Français, trois Allemands. C’est le compte.
Sur la Somme, la N.65 recueille la même somme de gloire qu’à Verdun. Menée par le capitaine Féquant, qui donne l’exemple en payant largement de sa personne, elle reprend sa chasse irrésistible et fructueuse. Ses as, on les connaît. Ils sont illustres. C’est Nungesser. Toute l’énergie physique et morale ramassée en un seul homme. Grièvement blessé dans un accident d’aviation, réformé n° I, il se réengage, refuse un congé de convalescence de trois mois, rejoint au front son escadrille. Se dépensant sans compter, malgré son état de santé, en six jours il totalise dix-neuf heures de chasse, livre douze combats, force tous ses adversaires à la fuite, à l’exception de deux… qu’il abat.
Le 25 avril 1916, avec un sang-froid extraordinaire, il attaque un groupe de trois avions allemands et en culbute un. Deux jours plus tard, il livre seul un combat à six adversaires, en envoie un à terre et rentre, les vêtements criblés de balles, avec un appareil blessé dans tous ses organes essentiels, le moteur transpercé, les commandes atteintes. Au début de janvier dernier enfin, il offre aux Boches des étrennes superbes : en une seule matinée, deux avions et une saucisse ! Un prestigieux palmarès de douze citations à l’ordre de l’armée avec vingt-quatre avions ennemis descendus.
Et dans la gloire de nos héros côte à côte avec Nungesser, voici l’un des benjamins de l’aviation française, le sergent Sauvage, mort aujourd’hui après sept victoires en quelques mois ; l’adjudant de Bonnefoy, le successeur de Féquant, devenu chef de groupe ; le capitaine du Plan, dont les pilotes ont sur la Somme abattu officiellement vingt-sept avions allemands, sans compter une dizaine d’autres contraints à de rudes atterrissages. La N.65 n’a-t-elle pas tous les titres à la crâne devise qu’elle a faite sienne d’un mot du capitaine Jacques de Siéyès descendant d’appareil deux doigts emportés par les balles ennemies, et répondant au camarade qui lui disait : « Alors ? Les Boches t’ont eu ? – Allons donc ! »
Mais c’est à l’escadrille N.3 que revient sans conteste le record des victoires aériennes. La N.3 ! Les cigognes ! Dès le premier jour, sous le nom de B.L.3, alors composée de Blériots, elle a été sur la brèche et a commencé la campagne sur le front de Belfort ; vers le milieu de 1915, sous les ordres du capitaine Brocard, elle s’est spécialisée dans la chasse. C’est elle, on peut le dire sans être injuste vis-à-vis des autres, qui a vraiment créé la tactique aérienne de combat et qui a donné les directives.
Son ardeur, son esprit offensif, son mordant, que les pertes les plus douloureuses n’ont jamais pu réussir à émousser, viennent de lui valoir l’honneur suprême de la fourragère avec une magnifique citation. Tant à Verdun que sur la Somme, en cinq mois, du 19 mars au 19 août de l’an dernier, elle a livré 338 combats, abattant 38 avions, 3 drachen et obligeant 36 autres avions fortement atteints à atterrir. Dans les trois mois qui ont suivi, elle en a détruit une nouvelle série de 36. Depuis la mobilisation jusqu’au 1er janvier 1917, elle peut s’enorgueillir d’un formidable total de 820 combats, où 83 avions allemands ont officiellement trouvé leur perte, non compris les saucisses et les avions dont le sort exact n’est pas connu, mais dont il est tout à fait présumable que beaucoup sont allés se fracasser au sol dans les lignes allemandes.
La N.65 a Nungesser. La N.3 a son rival de gloire, l’as des as, Guynemer, à qui le président de la République remettait avant-hier au nom de la Russie la croix de Saint-Georges et les galons de capitaine. Notre grand ami italien M. Bissolati assistait ému à la cérémonie. Quand Guynemer, très pâle, eut salué, il se pencha à l’oreille de M. Poincaré, murmurant pour ne pas blesser la modestie charmante du merveilleux pilote : « Ce que j’admire, c’est son air juvénile et sa simplicité. Qu’il est jeune, ce soldat, qui est un homme ! » Oui, avec son gentil sourire d’adolescent, son courage, qui jaillit de source, sans l’ombre de forfanterie, sa ténacité, Guynemer est bien le type du héros de chez nous. Au début de la guerre, potache de dix-neuf ans, dont on ne voulait pas, rien ne l’a rebuté, ni les décisions des majors, impitoyables devant sa maigreur de jeune lycéen, ni les ajournements de quatre conseils de révision. Les portes de la gloire ne voulaient pas s’ouvrir devant lui. Allons donc ! Il saurait bien les forcer, et le capitaine d’aujourd’hui, chevalier de la Légion d’honneur, chevalier de Saint-Georges, titulaire de plus de palmes qu’aucune croix de guerre n’en saurait jamais porter, débuta contre vents et marées sur l’aérodrome de Pau en portant les bidons d’essence et d’huile.
Si la route de Tipperary est longue, le chemin des honneurs fut pour lui singulièrement bref. Il en est aujourd’hui, en mai, à son trente-huitième triomphe. En un seul mois, du 28 décembre 1916 au 27 janvier 1917, il a envoyé au sol 7 avions allemands !
Et comme ils sont dignes de lui, tous ses camarades de la N.31 le sous-lieutenant Dorme, toute la science du combat, avec ses 22 victoires ; le lieutenant Heurteaux, toute la fougue, avec son tableau de chasse de 21 Allemands ; Deullin encore, qui vient de compter son quatorzième avion, Chainat son neuvième, de la Tour son septième. Les journaux d’outre-Rhin ont publié récemment avec des och ! d’orgueil teutonique le total des succès de leurs as : le lieutenant von Richthofen en tête. Il est inférieur de près de la moitié à celui des nôtres.
Depuis trois mois, il n’est pas une semaine qui n’ait vu un de nos aviateurs prendre place au rang des as. Le 29 décembre, trois as en quelques heures : le lieutenant Loste, le soldat Martin, l’adjudant Lufbery ; en janvier, le maréchal des logis Hauss et l’adjudant Jailler ; le 1er février, l’adjudant Madon. Hier encore, du 10 au 15 avril, trois nouveaux as naissaient à la gloire des communiqués : le capitaine Lecour-Grandmaison, le sous-lieutenant Languedoc et le maréchal des logis Rousseau. Le lieutenant Pinsard, qui envoyait dans ces cinq jours trois Allemands au sol, compte aujourd’hui sa douzième victoire.
Il est un autre record, que l’aviation allemande s’est montrée jusqu’ici impuissante à disputer à la nôtre : celui des expéditions lointaines et des bombardements à longue distance. Quels raids aériens ont-ils pu réussir, les aviateurs allemands ? Quelles grandes croisières de l’air peut-on inscrire à leur actif ? Des incursions sur Dunkerque, sur Amiens, sur Arras, sur Compiègne, sur Châlons et sur Reims, sur Nancy ou sur Belfort, oui, de brèves apparitions nocturnes, impossibles à empêcher, un tour de quelques minutes à la faveur des ténèbres ou du brouillard à une dizaine de kilomètres de leurs lignes, le temps de lâcher quelques bombes, d’assassiner une femme ou un enfant, et de fuir. Au début de la guerre, ils sont venus sur Paris, le dimanche 30 août, puis les trois premiers jours de septembre ; le 27 encore, où ils essayaient d’atteindre la Tour Eiffel et blessaient la petite Denise Cartier ; le 12 octobre, où leur tentative d’incendier Notre-Dame avorte parfaitement. Négligeons l’avion boche qui, en mai 1915, parvint, en se maquillant à la française, à se glisser jusqu’à nous, pour retourner d’une bombe un parterre de géraniums à Vaugirard et écorner d’une autre le coin d’un balcon. Quels exploits en vérité, quand leurs armées étaient à Chantilly et à Meaux, que d’avoir tué bravement de 2 000 mètres de haut 6 personnes et d’en avoir blessé 17 !
À ces provocations de résultat militaire nul, l’Allemagne de l’Ouest sait quelles réponses nous avons opposées. Dès septembre 1914, les aviateurs anglais rendaient à Cologne et à Dusseldorf les visites faites à Paris, en y embrasant les hangars à dirigeables. En novembre, deux jours après notre bombardement de Rheinau et de Schwetzingen, c’était l’affaire de Friedrichshafen menée par une escadrille anglaise, partie de Belfort, au grand dommage des ateliers de zeppelins et d’un de leurs récents chefs-d’œuvre. Dans la première quinzaine de décembre, la série commence sur Fribourg-en-Brisgau, dont la gare, les magasins et les hangars d’aviation sont appelés désormais à en voir de rudes, et c’est encore un revenez-y des Français, cette fois, sur Friedrichshafen.
Dès lors, ces lointaines et heureuses randonnées ne cessent plus. Chaque semaine, le communiqué nous en apporte la réconfortante nouvelle. Le capitaine Happe file en plein Wurtemberg, à 150 kilomètres de Belfort, détruire sur le Neckar la poudrerie de Rothveil, l’une des plus importantes de l’Allemagne. Descendant à 1 500 mètres pour assurer la précision de son bombardement, d’un premier obus de 90 il crève les réservoirs d’acide, et de trois autres allume la poudrerie tout entière, dont les flammes montent jusqu’à quelques mètres de son appareil. « Dégâts légers », affirmèrent, bien entendu, le lendemain les Allemands, en riant jaune. Pesant mensonge !
Quand nous nous décidons, après une trop longue patience, à faire payer les bombardements aériens de nos villes du front par des expéditions en force, l’affaire est encore bien plus sérieuse pour les Allemands et les représailles autrement sensibles. Le 27 mai 1915, une escadrille composée de 18 avions, chargée de 1 000 kilos de projectiles, incendie ou démolit à Ludwigshafen les usines de produits chimiques de la Badische Anilin, qui occupent tout un quartier de la ville. 47 obus de 90 et 2 de 155 couvrent de feu les bâtiments. L’annexe située à quelques kilomètres de là, à Oppau, subit le même sort avec 36 obus de 90. À l’exception d’un seul, contraint à l’atterrissage et que son équipage brûla, tous nos avions rentrèrent sains et saufs après ce raid splendide de 400 kilomètres.
Les Badois de Carlsruhe payent à leur tour pour les nôtres, et en juin 1915, 23 avions français s’en vinrent troubler avec leur mélinite le « repos de Charles ». Le palais du Margrave, la grande poste, le monument de Frédéric-Charles apprennent à souffrir ce que Reims et Arras ont souffert. Les dégâts matériels – les Nouvelles de Bâle nous l’apprenaient quelques jours plus tard – sont considérables et les victimes nombreuses. Suffisent-elles à venger les mères de Dunkerque, de Nancy et de Châlons dont les petits enfants ont été tués, quand ils sortaient de l’école, heureux et gambadants ? Non. Et malgré toutes les précautions prises, une garde aérienne vigilante et les 350 kilomètres du voyage aller et retour, les Badois revoient encore, dans la nuit du 22 juin dernier, un groupe de 19 avions français.