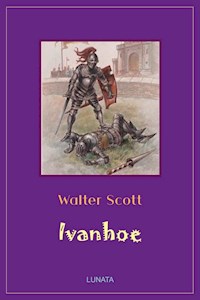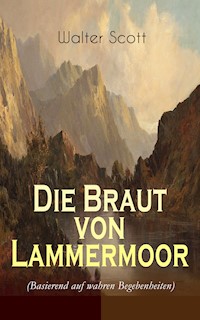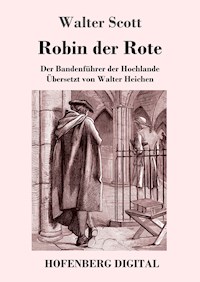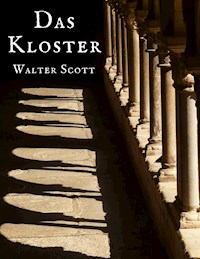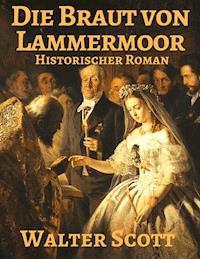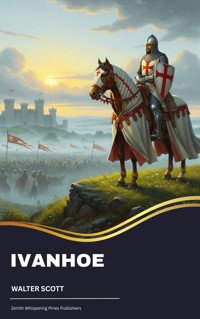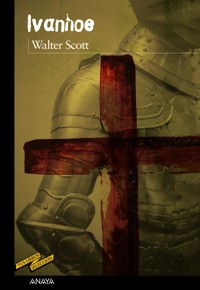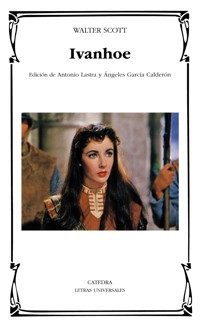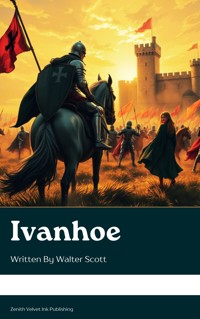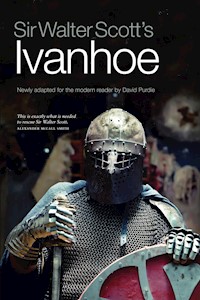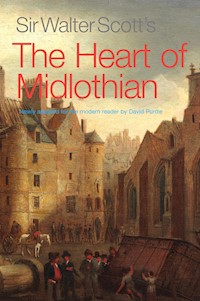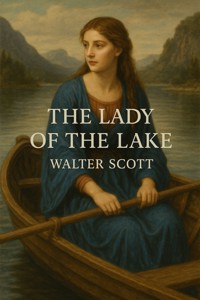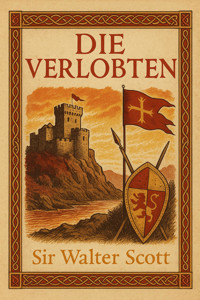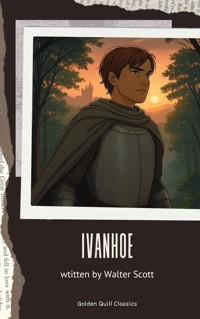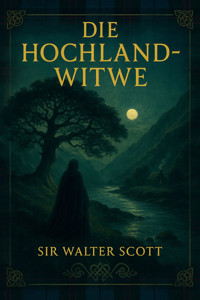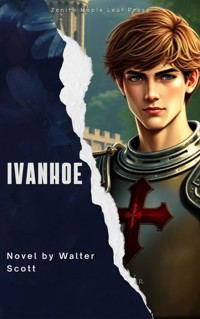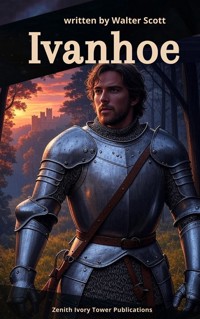Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Paris, Furne, 1830 - Traduction Auguste-Jean-Baptiste Defauconpret - Première publication en 1822 - Le roman raconte les efforts de Nigel Olifaunt, Lord Glenvarloch, pour empêcher la vente du château de ses ancêtres et de son domaine. Dans ce but, il se rend à Londres pour obtenir le remboursement d'un prêt que son père avait fait au roi Jacques VI d'Écosse. Toutefois, le favori du roi, le duc de Buckingham, désire récupérer cette terre, et le roi se montre réticent à satisfaire la requête de Nigel. Un ami de Buckingham, Lord Dalgarno, tente de mettre Nigel dans une situation désavantageuse en lui inventant une vie de dissipation. Ces rapports mensongers amènent le roi à éloigner Nigel de la cour. Apprenant la trahison de Dalgarno, Nigel le provoque en duel et le bat dans le parc royal de Saint-James, une offense punie par la perte de ses droits. Il sollicite la faveur du roi, mais est enfermé dans la tour de Londres...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 988
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Scott
LES AVENTURESDE NIGEL
Paris, Furne, 1830
Traduction Auguste-Jean-Baptiste Defauconpret
Première publication en 1822
Table des matières
ÉPÎTRE SERVANT D’INTRODUCTION
CHAPITRE PREMIER.
CHAPITRE II.
CHAPITRE III.
CHAPITRE IV.
CHAPITRE V.
CHAPITRE VI.
CHAPITRE VII.
CHAPITRE VIII.
CHAPITRE IX.
CHAPITRE X.
CHAPITRE XI.
CHAPITRE XII.
CHAPITRE XIII.
CHAPITRE XIV.
CHAPITRE XV.
CHAPITRE XVI.
CHAPITRE XVII.
CHAPITRE XVIII.
CHAPITRE XIX.
CHAPITRE XX.
CHAPITRE XXI.
CHAPITRE XXII.
CHAPITRE XXIII.
CHAPITRE XXIV.
CHAPITRE XXV.
CHAPITRE XXVI.
CHAPITRE XXVII.
CHAPITRE XXVIII.
CHAPITRE XXIX.
CHAPITRE XXX.
CHAPITRE XXXI.
CHAPITRE XXXII.
CHAPITRE XXXIII.
CHAPITRE XXXIV.
CHAPITRE XXXV.
CHAPITRE XXXVI.
CHAPITRE XXXVII.
Mentions légales
L’ÉMOULEUR : « Une histoire !… – Dieu vous bénisse !
« Je n’en ai point à vous conter. »
CANNING, Poésie de l’Anti-Jacobin.
ÉPÎTRE SERVANT D’INTRODUCTION
LE CAPITAINE CLUTTERBUCK
AU RÉVÉREND DOCTEUR DRYASDUST.
MON CHER MONSIEUR,
Je suis fort reconnaissant des civilités dont vous avez bien voulu m’honorer dans votre lettre obligeante : je m’empresse d’y répondre, et j’adhère entièrement à votre citation de – quàm bonum et quàm jucundum ! – Nous pouvons en effet nous considérer comme issus de la même famille, ou, selon le proverbe de notre pays, comme enfans du même père ; vous n’aviez pas besoin d’excuse, révérend et cher monsieur, pour me demander tous les renseignemens qu’il est en mon pouvoir de vous fournir sur l’objet de votre curiosité. L’entrevue dont vous me parlez eut lieu dans le courant de l’hiver dernier, et elle est si profondément gravée dans ma mémoire, que je n’ai besoin d’aucun effort pour en rassembler les détails les plus minutieux.
Vous savez que la part que je pris à la publication du roman intitulé LE MONASTÈRE a fait de moi une espèce de personnage dans le monde littéraire de notre métropole écossaise. Je ne reste plus, dans la boutique extérieure de nos libraires, à marchander les objets dont j’ai besoin, avec un commis peu attentif, coudoyé par des enfans qui viennent acheter des Corderius et des cahiers, ou par des servantes marchandant un sou de papier ; mais je suis accueilli avec cordialité par le Bibliopole lui-même, qui me dit en m’abordant : – Capitaine, faites-moi le plaisir d’entrer dans l’arrière-boutique. – Jeune homme, approchez donc une chaise au capitaine Clutterbuck. – Voilà la gazette, capitaine, – la gazette d’aujourd’hui ; – ou bien : Voici l’ouvrage nouveau ; – voilà un plioir ; ne craignez pas de couper les feuilles, ou mettez-le dans votre poche et emportez-le chez vous ; – ou bien : Monsieur, nous vous traiterons en confrère, vous l’aurez au prix de libraire. – Peut-être encore, s’il sort des presses du digne commerçant, sa libéralité pourra même s’étendre jusqu’à dire : – N’allez pas, monsieur, faire porter en compte une pareille bagatelle ; c’est un exemplaire tiré en sus. Je vous prie de recommander l’ouvrage aux littérateurs vos amis.
Je ne parle pas de ces fines parties littéraires où les convives se réunissent, rangés autour d’un turbot, d’un gigot de mouton ou de quelque autre mets, non plus que de la circulation d’une excellente bouteille de la meilleure bière noire de Robert Cockburn, ou même de sa bière royale, pour animer notre conversation sur de vieux livres, ou nos plans pour en faire de nouveaux. Ce sont là des douceurs réservées à ceux qui ont été investis des privilèges et franchises de la corporation des lettres, et j’ai l’avantage d’en jouir complètement.
Mais tout change sous le soleil, et ce n’est pas sans un vif sentiment de regret que, dans mes visites annuelles à la métropole, je me vois privé de l’accueil franc et cordial de l’ami judicieux et obligeant qui le premier me fit connaître au public, dont l’esprit eût suffi à une douzaine de beaux parleurs de profession, et qui avait plus de gaieté originale qu’il n’en aurait fallu pour faire la fortune d’un pareil nombre. Cette grande perte a été suivie de la perte, momentanée j’espère, d’un autre libraire de mes amis, qui, par ses vues élevées et ses idées libérales, a non-seulement fixé dans sa patrie l’entrepôt de la littérature nationale, mais y a établi une cour littéraire, faite pour commander le respect aux personnes même les plus portées à s’écarter de ses règles. L’effet de ces changemens, opérés en grande partie par la rare intelligence et les habiles calculs d’un homme qui a su tirer un parti plus avantageux qu’il n’aurait osé l’espérer lui-même des talens en tous genres que produisait son pays, sera sans doute plus sensible quand une nouvelle génération aura succédé à la nôtre.
J’entrai dans la boutique du carrefour pour m’informer de la santé de mon digne ami, et j’appris avec satisfaction que son séjour dans le midi avait diminué les symptômes alarmans de sa maladie. Profitant alors des privilèges dont j’ai déjà parlé, je m’avançai dans ce labyrinthe de chambres petites et sombres, ou, pour parler le langage de nos antiquaires, dans ces cryptes qui forment le derrière de cette célèbre librairie. Cependant, en passant d’une pièce dans une autre, remplies les unes de vieux bouquins, les autres de livres, qui, rangés sur les rayons dans un ordre uniforme, me parurent être les publications du débit le plus lent parmi les ouvrages modernes, je ne pus résister à une sainte terreur qui s’empara de moi, lorsque je songeai au risque que je courais de déranger quelque barde inspiré, donnant cours à sa fureur poétique, ou peut-être d’interrompre la solitude encore plus formidable d’une bande de critiques occupés à mettre en pièces une proie abattue à leurs pieds. Dans cette supposition, j’éprouvais par anticipation les tortures de ces devins des Highlands que le don fatal de deuteroscopie force de voir des choses cachées aux yeux des autres mortels, et qui sont, pour me servir de l’expression de Collins,
Tels que les malheureux qu’égare un vain délire,
Et qui, d’un œil hagard, ont aperçu soudain
Des spectres préparant leur travail clandestin.
Cependant l’impulsion irrésistible d’une vague curiosité m’entraînait toujours à travers cette enfilade de pièces obscures, lorsque, comme le joaillier de Delhi dans la maison du magicien Bennaskar, je parvins dans une chambre voûtée, consacrée au secret et au silence, et je vis, assise près d’une lampe et occupée à lire une seconde épreuve couverte de ratures, la personne, ou peut-être je devrais plutôt dire l’Eidolon ou l’apparition de l’auteur de Waverley. Vous ne serez pas surpris de l’instinct filial qui me fit reconnaître aussitôt les traits de ce vénérable fantôme, en même temps que je pliai le genou en lui adressant cette salutation classique : – Salve, magne parens ! Cependant le spectre m’interrompit en me présentant un siège, et en me donnant à entendre que ma présence n’était pas inattendue, et qu’il avait quelque chose à me dire.
Je m’assis avec une soumission respectueuse, et je tâchai de bien remarquer les traits de celui auprès de qui je me trouvais d’une manière si inespérée ; mais je ne puis donner à Votre Révérence aucune satisfaction sur ce point ; car, outre l’obscurité de l’appartement et l’agitation de mes nerfs, je me sentais accablé par un sentiment de respect filial, qui m’empêcha de bien saisir et de me rappeler ce que, sans doute, le personnage qui était devant moi pouvait avoir envie de tenir secret. En effet, ses formes étaient si bien voilées et couvertes, soit par un manteau, soit par une robe de chambre, ou par quelque autre vêtement de ce genre, qu’on aurait pu lui appliquer ces vers de Spenser :
Et cependant les traits de son visage
N’auraient pu faire encor déterminer
Quel sexe avait l’étrange personnage.
Quoi qu’il en soit, je continuerai, comme je l’ai commencé, à me servir du genre masculin ; car, malgré les raisons fort ingénieuses, et qui ont presque l’air de l’évidence, alléguées pour prouver que deux femmes à talent sont l’auteur de Waverley, je m’en tiens à l’opinion générale, celle qu’il est du sexe le moins aimable. Il y a dans ses écrits trop de choses
Quæ maribus sola tribuuntur1
pour me permettre d’en douter un instant. Je vais répéter, sous la forme de dialogue, aussi exactement que possible, ce qui s’est passé entre nous ; je ferai seulement observer que, dans le cours de la conversation, son affabilité dissipa insensiblement ma timidité, et que je finis peut-être par retrouver toute la confiance qu’il m’était permis d’avoir.
L’AUTEUR DE WAVERLEY. – Je désirais vous voir, capitaine Clutterbuck, car vous êtes la personne de ma famille pour qui j’ai le plus de considération, depuis la mort de Jedediah Cleishbotham ; et je crains de vous avoir fait tort en vous assignant le Monastère pour votre part dans mon héritage. J’ai envie de vous en indemniser en vous nommant parrain de cet enfant qui n’a pas encore vu le jour (il me montrait du doigt l’épreuve). – Mais d’abord, parlons du Monastère : qu’est-ce que le monde en dit ? Vous êtes répandu, et il vous est facile de le savoir.
LE CAPITAINE CLUTTERBUCK. – Hem ! hem ! c’est une question délicate. Je n’ai pas entendu les éditeurs s’en plaindre.
L’AUTEUR. – C’est l’essentiel ; mais encore un ouvrage insignifiant est quelquefois remarqué par ceux qui ont quitté le port avant lui, avec la brise en poupe. Qu’en disent les critiques ?
LE CAPITAINE. – L’opinion… générale… est qu’on n’aime pas la Dame Blanche.
L’AUTEUR. – Je pense moi-même qu’elle ne devait pas faire fortune, mais plutôt à cause de l’exécution que de la conception du personnage. Si j’avais évoqué un esprit follet, à la fois fantasque et intéressant, capricieux et bon ; une sorte de lutin qui n’eût été enchaîné par aucune loi fixe ni aucun motif d’action ; fidèle et passionné, quoique tourmentant et léger…
LE CAPITAINE. – Pardonnez-moi, monsieur, si je vous interromps ; je crois que vous faites la description d’une jolie femme.
L’AUTEUR. – Ma foi, je le pense aussi. Il faut que je donne à mes esprits élémentaires un peu de chair et de sang comme aux hommes. Leurs traits sont esquissés en lignes trop déliées pour le goût actuel du public.
LE CAPITAINE. – On objecte également que votre Nixie2 aurait dû avoir une noblesse plus soutenue ; les plongeons qu’elle fait faire au prêtre ne sont pas des amusemens de naïade.
L’AUTEUR. – Ah ! on devrait pardonner quelque chose aux caprices de ce qui n’est après tout qu’un follet de meilleure espèce. Le bain dans lequel Ariel, la création la plus délicate de l’imagination de Shakspeare, fait entrer notre joyeux ami Trinculo, n’était ni à l’ambre ni à la rose. Mais personne ne me verra ramer contre le courant. Que m’importe qu’on le sache ! J’écris pour l’amusement du public ; et quoique je n’aie nulle intention de jamais briguer la popularité par des moyens que je croirais indignes de moi, d’un autre côté je ne m’obstinerai pas à défendre mes propres erreurs contre l’opinion générale.
LE CAPITAINE. – Vous abandonnez donc dans cet ouvrage (jetant à mon tour les yeux sur l’épreuve) le mystique, la magie, et tout le système des signes, des prodiges et des présages ? Il n’y a ni songes, ni prédictions, ni allusions cachées aux événemens futurs ?
L’AUTEUR. – Pas une égratignure de Cock-Lane, mon fils. – Pas un seul coup sur le tambour de Tedworth. – Pas même le léger bruit que fait dans la boiserie ce faible animal présage de mort. Tout est simple et à découvert ; un métaphysicien écossais pourrait en croire jusqu’au dernier mot.
LE CAPITAINE. – Et la fable en est sans doute simple et vraisemblable ; début intéressant, marche naturelle, conclusion heureuse, comme le cours d’un beau fleuve qui s’échappe en bouillonnant de quelque grotte sombre et pittoresque ; roulant majestueusement son onde, sans jamais ralentir ni précipiter sa marche, il visite, comme par un instinct naturel, tous les objets intéressans du pays qu’il parcourt ; à mesure qu’il avance, son lit devient plus large et plus profond ; enfin, vous arrivez à la catastrophe finale, comme le fleuve dans un port imposant, où les bâtimens de toutes sortes baissent voiles et vergues.
L’AUTEUR. – Hé ! hé ! que diable veut dire tout cela ? Mais c’est la veine poétique d’Ercles, et il faudrait quelqu’un qui ressemblât bien plus que moi à Hercule, pour créer une histoire qui jaillît et marchât sans jamais se ralentir ; qui visitât, devînt plus large, plus profonde, et tout ce qui s’ensuit. Je serais enfoncé dans la tombe jusqu’au menton avant d’avoir fini ma tâche ; et pendant ce temps-là, toutes les saillies et les bons mots que j’aurais imaginés pour l’amusement de mon lecteur resteraient à moisir dans mon gosier, comme les proverbes de Sancho restaient dans le sien lorsqu’il avait encouru la disgrâce de son maître. Il n’y a jamais eu un roman écrit sur ce plan depuis que le monde existe.
LE CAPITAINE. – Pardonnez-moi, Tom Jones.
L’AUTEUR. – Il est vrai, et peut-être même Amélie. Fielding se faisait une haute idée de la dignité d’un art dont il peut être considéré comme le fondateur. Il a rendu le roman digne d’être comparé à l’épopée. Smolett, Lesage et autres, secouant la rigueur des règles qu’il avait posées, ont écrit plutôt un récit des différentes aventures que rencontre un individu dans le cours de la vie, qu’ils n’ont suivi le plan d’une épopée régulière et bien liée, où chaque pas nous rapproche de plus en plus de la catastrophe finale. Ces grands maîtres se sont contentés d’amuser le lecteur sur la route, et la conclusion n’arrive que parce qu’une fin est nécessaire, comme le voyageur descend à l’auberge parce qu’il se fait nuit.
LE CAPITAINE. – C’est une manière fort commode de voyager, pour l’auteur du moins. Bref, monsieur, vous êtes de l’avis de Bayes, lorsqu’il dit : – Que diable signifie le plan, si ce n’est pour amener de jolies choses ? –
L’AUTEUR. – En supposant que cela soit, et que je puisse écrire avec agrément et esprit quelques scènes jointes ensemble sans peine ni embarras, mais qui renferment assez d’intérêt pour apporter un soulagement aux souffrances du corps, pour distraire l’inquiétude de l’esprit, dérider un front sillonné par les fatigues du jour, chasser les mauvaises pensées ou en suggérer de meilleures, exciter un paresseux à étudier l’histoire de son pays ; en un mot, pour offrir à tout le monde un amusement innocent, excepté à ceux que cette lecture détournerait de l’accomplissement de devoirs sérieux ; l’auteur d’un pareil ouvrage, quelque mal exécuté qu’il fût, ne pourrait-il pas, afin de faire excuser ses erreurs et ses négligences, s’écrier comme cet esclave qui allait être puni pour avoir répandu la fausse nouvelle d’une victoire : – Ô Athéniens ! serai-je châtié pour vous avoir donné un jour de bonheur ?
LE CAPITAINE. – Serez-vous assez bon pour me permettre de vous raconter une anecdote de mon excellente grand’mère ?
L’AUTEUR. – Je ne vois guère ce qu’elle peut avoir de commun avec ce qui nous occupe, capitaine Clutterbuck.
LE CAPITAINE. – On peut l’admettre dans notre dialogue sur le plan de ceux de Bayes. – La bonne dame, Dieu veuille avoir son ame ! joignait à une grande finesse d’esprit beaucoup de dévotion, et elle ne pouvait jamais entendre de mauvaises langues mal parler d’un ministre, sans prendre chaudement le parti de celui-ci. Il y avait cependant un certain grief pour lequel elle abandonnait toujours la cause de son révérend protégé : c’était du moment qu’elle apprenait qu’il avait prêché un sermon en forme contre les calomniateurs et les médisans.
L’AUTEUR. – Et où en voulez-vous venir avec tout cela ?
LE CAPITAINE. – C’est que j’ai entendu dire à des ingénieurs qu’on risque d’indiquer le côté faible à l’ennemi, en prenant trop de soin pour le fortifier.
L’AUTEUR. – Mais encore une fois, je vous prie, où en voulez-vous venir ?
LE CAPITAINE. – Hé bien donc, sans plus de métaphores, je crains que cette nouvelle production, dans laquelle vous avez la générosité de paraître me donner quelque part, n’ait un grand besoin d’indulgence, puisque vous croyez devoir commencer votre défense avant que l’affaire soit en jugement. Je gagerais une bouteille de bordeaux que la fable est conduite sans ordre.
L’AUTEUR. – Une pinte de porto, vous voulez dire, je pense ?
LE CAPITAINE. – De bordeaux, vous dis-je, et du bon bordeaux du Monastère. Ah ! monsieur, si seulement vous vouliez suivre les conseils de vos amis, pour tâcher de mériter au moins une partie de la faveur que vous avez obtenue du public, nous boirions tous du tokay.
L’AUTEUR. – Peu m’importe ce que je bois, pourvu que le breuvage soit sain.
LE CAPITAINE. – Songez alors à votre réputation et à votre gloire.
L’AUTEUR. – À ma gloire ? – Je vous ferai la réponse que, dans la défense du fameux Jem Mac-Coul, un de mes amis, homme de beaucoup d’esprit, de talent et d’instruction, fit à la partie adverse, lorsqu’elle reprochait à son client son refus de répondre à certaines questions, auxquelles, disait-on, tout homme qui aurait quelque égard pour sa réputation n’hésiterait pas à répliquer : – Mon client, dit-il (j’ajouterai encore en passant que Jem était debout derrière lui dans le moment, ce qui formait une bonne scène), mon client a le malheur de ne s’inquiéter nullement de sa réputation ; et je n’agirais pas avec loyauté vis-à-vis de la cour, si je disais qu’elle mérite en aucune manière sa sollicitude. – Hé bien, moi, je suis, quoique par des motifs bien différens, dans cet heureux état d’insouciance. Que la gloire soit pour ceux qui ont une forme substantielle. Une ombre (et un auteur qui n’est personne est-il autre chose ?) ne peut jeter d’ombre.
LE CAPITAINE. – Peut-être maintenant n’êtes-vous pas aussi inconnu qu’autrefois. Ces lettres au membre qui représente l’université d’Oxford au parlement…3
L’AUTEUR. – Prouvent l’esprit, le génie et la délicatesse de l’auteur ; et je voudrais sincèrement qu’il en eût fait usage pour quelque objet plus important : elles prouvent, du reste, que l’incognito que j’ai conservé a engagé un talent précoce dans une discussion épineuse et délicate. Mais une cause, quoique ingénieusement plaidée, n’est pas pour cela gagnée. Vous devez vous souvenir que tous les témoignages qui avaient été si habilement rassemblés pour prouver les titres de sir Philip Francis aux Lettres de Junius semblaient d’abord irrécusables ; cependant ces raisonnemens ont perdu leur force, et Junius, dans l’opinion générale, est aussi inconnu que jamais. Mais ni la flatterie ni la violence ne pourront me déterminer à dire un mot de plus à cet égard. Dire qui je ne suis pas serait un pas pour dire qui je suis ; et comme je n’ambitionne aucunement, pas plus qu’un certain juge de paix cité par Shenstone4, la rumeur ou les on dit que de tels ouvrages font naître dans le monde, je continuerai de garder le silence sur un objet qui, selon moi, ne mérite pas tout le bruit qu’on en a fait, et encore moins les débats sérieux dans lesquels le jeune auteur de ces lettres a déployé tant d’esprit.
LE CAPITAINE. – Mais en admettant, mon cher monsieur, que vous n’ayez pas besoin de vous inquiéter de votre réputation personnelle, ni de celle de tout homme de lettres sur qui vos fautes pourraient retomber, permettez-moi de dire que la reconnaissance que vous devez naturellement au public, pour l’accueil obligeant dont il vous a honoré, ainsi qu’aux critiques, pour la manière indulgente dont ils vous ont traité, devrait vous engager à donner plus de soin à vos histoires.
L’AUTEUR. – Je vous exhorte, mon fils, à éloigner de votre esprit toute espèce d’hypocrisie, comme aurait dit le docteur Samuel Johnson. Quant aux critiques, ils ont leur affaire, et moi la mienne. Vous savez ce que disent les nourrices :
Les enfans en Hollande ont du plaisir à faire
Ces fragiles jouets, qu’avec même plaisir,
Nos enfans, à leur tour, brisent en Angleterre.
De même je suis l’humble pourvoyeur des critiques, le chacal5 trop occupé à leur chercher de la pâture, pour avoir le temps de m’inquiéter s’ils l’avalent ou la rejettent. – Quant au public, je suis vis-à-vis de lui à peu près comme le facteur de la poste qui laisse un paquet à la porte d’un individu. S’il contient quelque nouvelle agréable, un billet d’une maîtresse, une lettre d’un fils absent, un ordre de paiement d’un correspondant qu’on croyait en faillite, la lettre est reçue avec joie, lue, relue, pliée, ajoutée à la liasse, et déposée en sûreté dans le bureau. Si ce qu’elle renferme est d’une nature fâcheuse, si elle vient d’un créancier exigeant ou pressant, on donne au diable le correspondant, on jette la lettre au feu, et le port en est sincèrement regretté ; tandis que le porteur des dépêches, dans l’un ou l’autre cas, n’y pense pas plus qu’aux neiges de l’hiver précédent. La seule bienveillance que le public accorde réellement à un auteur, c’est qu’il est assez disposé à accueillir avec une sorte d’indulgence les ouvrages qui sortent de la plume d’un ancien favori, ne fût-ce que par suite d’un esprit d’habitude, tandis que l’auteur a naturellement une haute idée du goût de ce public, qui a si libéralement applaudi à ses productions. Mais je nie que, d’une part ou d’autre, on ait le droit de réclamer aucune reconnaissance proprement dite.
LE CAPITAINE. – Le respect pour vous-même, alors, devrait vous avertir d’être prudent.
L’AUTEUR. – Oui, si la prudence pouvait augmenter mes chances de succès. Mais, à vous dire vrai, les ouvrages et les morceaux dans lesquels j’ai réussi ont généralement été écrits avec la plus grande rapidité ; et, lorsque j’en ai vu comparer certaines parties à d’autres qu’on trouvait beaucoup mieux finies, j’en appelais à ma plume et à mon écritoire, témoins que les passages dont je m’étais si mal tiré étaient ceux qui m’avaient coûté le plus de travail. Du reste, je doute de l’effet salutaire de trop de relâche par rapport au public et à l’auteur. Il faut battre le fer tandis qu’il est chaud, et mettre à la voile quand le vent est bon. Si un auteur heureux n’occupe pas la scène, un autre s’en empare aussitôt. Si un écrivain reste dix ans avant de faire paraître un second ouvrage, il est supplanté par d’autres ; ou, si le siècle est assez pauvre en hommes de génie pour qu’il n’ait pas à craindre cette rivalité, sa réputation même devient son plus grand ennemi. Le public s’attendra à trouver le nouvel ouvrage dix fois meilleur que celui qui l’a précédé ; l’auteur espérera une popularité dix fois plus grande, et il y a cent contre un à parier qu’on sera trompé de part et d’autre.
LE CAPITAINE. – Cela peut justifier un certain degré de rapidité dans le travail d’un instant ; mais il ne faut pas perdre de vue ce vieux proverbe : Hâte-toi lentement. Vous devriez au moins prendre le temps nécessaire pour bien arranger votre plan.
L’AUTEUR. – C’est là le difficile, mon fils. Croyez-moi, je n’ai pas été assez sot pour négliger les précautions ordinaires. Il m’est arrivé bien souvent de disposer le plan d’un ouvrage, de le diviser par volumes et par chapitres détachés, de construire une fable qui pût se développer graduellement d’une manière frappante, capable de tenir en suspens la curiosité, de l’exciter même ; et qui, enfin, se terminât par une catastrophe remarquable. Mais je crois qu’un démon se place sur le bout de ma plume quand je me mets à écrire, et la détourne du but. Les caractères se développent sous ma main ; les incidens se multiplient, l’histoire languit pendant que les matériaux augmentent ; ma construction régulière se change en une irrégularité gothique, et l’ouvrage est achevé long-temps avant que j’aie atteint l’objet que je me proposais.
LE CAPITAINE. – Avec de la résolution et une patience déterminée, vous pourriez remédier à cet inconvénient.
L’AUTEUR. – Hélas ! mon cher monsieur, vous ne connaissez pas la force de la tendresse paternelle. Lorsque je rencontre un caractère tel que le bailli Jarvie, ou Dalgetty, mon imagination s’échauffe, et mes idées s’éclaircissent à chaque pas que je fais dans la campagne ; quoiqu’elle m’entraîne bien loin de la route tracée, et qu’elle me force de franchir haies et fossés pour rentrer dans le bon chemin. Si je résiste à la tentation, comme vous me le conseillez, mes idées deviennent prosaïques, plates et lourdes ; j’écris d’une manière pénible pour moi-même, et je sens un abattement toujours croissant ; les couleurs brillantes dont mon imagination avait revêtu les incidens disparaissent, et tout devient terne et sombre. Je ne suis plus le même auteur, pas plus que le chien condamné à tourner pendant plusieurs heures pour faire marcher la roue d’une machine ne ressemble au même animal courant gaiement après sa queue, et prenant librement ses ébats sans gêne et sans contrainte. Bref, monsieur, dans ces occasions, je crois que je suis ensorcelé.
LE CAPITAINE. – Ma foi, monsieur, si les sortilèges s’en mêlent, il n’y a plus rien à dire, il faut bien marcher quand le diable nous pousse. Et telle est sans doute la raison qui fait que vous ne lancez aucun ouvrage sur la scène, comme vous y avez été si souvent engagé ?
L’AUTEUR. – Je pourrais alléguer, comme une excellente raison pour ne pas écrire de pièces de théâtre, mon incapacité pour construire un plan. Mais à vous parler franchement, ce qui a fait penser à des juges trop prévenus que je pouvais avoir quelques dispositions pour ce genre de littérature, ce sont ces lambeaux d’anciennes comédies qu’ils ont considérés comme le fruit de mon cerveau, parce qu’ils ont été tirés d’une source inaccessible aux compilateurs. La manière dont je devins le possesseur de ces fragmens est si extraordinaire, que je ne puis m’empêcher de vous la raconter.
Vous saurez qu’il y a une vingtaine d’années j’allai dans le Worcestershire pour voir un de mes anciens amis qui avait servi avec moi dans les dragons.
LE CAPITAINE. – Vous avez donc servi, monsieur ?
L’AUTEUR. – Que j’aie servi ou non, cela revient au même : le titre de capitaine est très-utile en voyage. – Je trouvai par hasard la maison de mon ami remplie d’hôtes ; et, comme d’usage, je fus condamné (le château étant fort ancien) à habiter l’appartement hanté. J’ai, comme l’a dit un illustre contemporain, vu trop de spectres pour y croire ; ainsi je m’apprêtais à m’endormir, bercé par le vent qui sifflait à travers les tilleuls dont les branches obscurcissaient la clarté de la lune réfléchie dans la chambre à travers les vitraux de la croisée, lorsque je vis une ombre plus épaisse se placer entre la lune et moi ; je distinguai sur le plancher de l’appartement…
LE CAPITAINE. – La Dame Blanche d’Avenel, je présume ? vous en avez déjà raconté l’histoire.
L’AUTEUR. – Non : je vis une femme avec une coiffe ronde, une bavette et un tablier, les manches retroussées jusqu’au coude, tenant d’une main une boîte à farine, de l’autre une cuiller à ragoût. Je pensai d’abord que c’était la cuisinière de mon ami qui se promenait tout endormie ; et comme je savais le prix qu’il attachait à Sally, qui retournait aussi bien une omelette qu’aucune fille du comté, je me levai pour la conduire tranquillement à la porte. Mais lorsque je m’approchai d’elle, elle s’écria : – Arrêtez, monsieur ; pour qui me prenez-vous donc ? Paroles qui me semblèrent si bien dictées par la circonstance, que je ne m’en serais guère inquiété, sans le son de voix creux et surnaturel dont elles étaient prononcées. – Sachez donc ; dit-elle sur le même ton, que je suis le spectre de Betty Barnes. – Qui se pendit d’amour pour le cocher de la diligence, pensai-je ; voilà une belle œuvre. – De cette malheureuse Élisabeth ou Betty Barnes, continua-t-elle, qui fut long-temps cuisinière de M. Warburton, ce laborieux amateur, mais, hélas ! ce trop négligent dépositaire de la plus volumineuse collection de pièces de théâtre qui ait jamais existé, et dont, pour la plupart, les titres seuls sont restés pour orner les préfaces des éditions variorum de Shakspeare. Oui, étranger, ce sont ces mains fatales qui ont voué à la graisse et à la flamme ces nombreux et lourds in-quarto, qui, s’ils existaient encore, feraient perdre la tête à tout le club de Roxburgh. Voici les doigts coupables qui flambèrent des volailles grasses et essuyèrent des assiettes sales avec les ouvrages perdus de Beaumont et Fletcher, de Massinger, Johnson, Webster, je dirai plus… de Shakspeare lui-même.
Comme tout amateur des antiquités dramatiques, j’éprouvais un choc mortel pour mon ardente curiosité en voyant que des pièces citées dans le répertoire des théâtres, objet de tant de recherches, avaient été comprises dans l’holocauste des victimes que cette malheureuse avait sacrifiées au lieu de la bonne chère. Il n’est donc pas étonnant que, comme l’ermite de Parnell,
J’aie à l’instant rompu les liens de la crainte,
M’écriant en accens entrecoupés d’horreur :
Ô femme abominable ! – À peine ma fureur
Avait-elle lâché cette unique parole,
Que Betty brandissant en l’air sa casserole…
– Prenez garde, s’écria-t-elle ; prenez garde que la colère à laquelle vous vous livrez si mal à propos ne vous fasse perdre l’occasion que j’ai encore d’indemniser le monde du tort que lui a fait mon ignorance. Dans ce caveau au charbon, qui n’a point servi depuis long-temps, gisent, souillés de graisse et de noir, le petit nombre de fragmens de ces anciens drames qui n’ont pas été entièrement détruits. Ainsi donc…
Hé bien ! pourquoi cet air d’étonnement, capitaine ? je vous jure que c’est la vérité ; à quoi me servirait de vous faire un mensonge ? comme dit mon ami le major Longbow.
LE CAPITAINE. – Un mensonge, monsieur ? ah ! Dieu me garde d’employer cette expression envers une personne aussi véridique que vous ! Seulement vous êtes disposé à vous divertir un peu ce matin ; voilà tout. Ne feriez-vous pas bien de réserver cette anecdote pour servir d’introduction – à trois pièces de théâtre retrouvées, ou quelque titre équivalent ?
L’AUTEUR. – Vous avez bien raison ; l’habitude est une étrange chose, mon fils. J’avais oublié à qui je parlais. Oui, à des pièces de théâtre destinées à être lues dans le cabinet, et non à être représentées…
LE CAPITAINE. – Fort bien : et de cette manière vous êtes sûr d’être joué ; car les directeurs aiment prodigieusement à forcer les gens à s’enrôler sous leurs bannières, tandis que des milliers de volontaires s’offrent pour les servir.
L’AUTEUR. – J’en suis une preuve vivante, car, bon gré mal gré, on a fait de moi un poète dramatique, comme un autre Laberius. Je crois que ma muse serait terrifiée au point d’être forcée à monter sur le théâtre, quand même je n’écrirais qu’un sermon.
LE CAPITAINE. – Vraiment, dans ce cas-là, je craindrais que certaines gens n’en fissent une farce ; ainsi donc, si vous vouliez changer de style, je vous conseillerais de composer un volume de drames comme lord Byron.
L’ACTEUR. – Non ; Sa Seigneurie est d’une autre trempe que moi. Je ne veux pas jouter contre lui, si je puis m’en dispenser. Mais voilà mon ami Allan qui vient de composer une pièce telle que j’en pourrais écrire une moi-même, dans un jour d’inspiration, et avec une des plumes surfines et brevetées de Bramah. Je ne puis rien faire de bon sans tous ces accessoires.
LE CAPITAINE. – Voulez-vous parler d’Allan Ramsay ?
L’AUTEUR. – Non, ni de Barbara Allan, mais d’Allan Cunningham, qui vient de publier sa tragédie de sir Marmaduke-Maxwell, dans laquelle on trouve les fêtes mêlées aux massacres, une scène d’amour auprès d’une scène de sang, et des passages qui ne mènent à rien, mais qui, après tout, sont fort bien. Il n’y a pas une lueur de vraisemblance dans le plan ; mais il y a tant de force dans certains passages, et partout une telle veine de génie poétique, que je désirerais en pouvoir mettre autant dans mes Restes de cuisine, si j’étais tenté de les publier. Dans une édition soignée, on lirait avec admiration les beautés d’Allan ; dans l’état où il se présente, on ne remarquera peut-être que ses défauts ; ou, ce qui est encore pire, on ne fera même aucune attention à lui. Mais ne vous en chagrinez pas, brave Allan, vous n’en êtes pas moins l’ornement de l’Écosse. Il a fait aussi quelques pièces lyriques que vous feriez bien de lire, capitaine. La pièce intitulée ’Tis hame, and ’tis hame6, ne le cède point à celles de Burns.
LE CAPITAINE. – Je suivrai votre conseil. Le club de Kennaquhair est devenu difficile depuis que Catalani est venue visiter l’abbaye. Mon pauvre Gelé a été reçu pauvrement et froidement ; et les Rives de Bonnie Doon sont tombées à plat. – Tempora mutentur.
L’AUTEUR. – Le temps ne peut rester stationnaire ; il est soumis au changement ainsi que nous autres mortels. Qu’importe ? – Au bout du compte, un homme vaut un homme.
Mais l’heure de nous séparer approche.
LE CAPITAINE. – Vous êtes donc déterminé à suivre votre système ? Ne craignez-vous pas qu’on n’attribue cette succession rapide d’ouvrages à un motif sordide ? On pensera que vous ne travaillez que par l’appât du gain.
L’AUTEUR. – En supposant qu’outre les autres motifs qui peuvent m’engager à me produire plus fréquemment devant le public, je calcule aussi les grands avantages qui sont le prix des succès en littérature ; – cet émolument est la taxe volontaire que le public paie pour un certain genre d’amusement littéraire ; elle n’est extorquée à personne, et n’est payée, je pense, que par ceux qui peuvent l’acquitter, et qui reçoivent une jouissance proportionnée au prix qu’ils donnent. Si le capital que ces ouvrages ont mis en circulation est considérable, n’a-t-il été utile qu’à moi seul ? Ne puis-je pas dire à cent personnes comme le brave Duncan, le fabricant de papier, le disait aux diables7 les plus mutins de l’imprimerie : – N’avez-vous pas partagé ? N’avez-vous pas eu vos quinze sous ? – Je pense, je l’avoue, que notre Athènes moderne me doit beaucoup pour avoir établi une manufacture aussi vaste ; et, quand on aura accordé à tous les citoyens le droit de voter dans les élections, je compte sur la protection de tous les ouvriers subalternes que la littérature fait vivre, pour obtenir une place dans le parlement.
LE CAPITAINE. – On croirait entendre parler un fabricant de calicot.
L’AUTEUR. – C’est encore de l’hypocrisie, mon cher fils. – Il y a de la chaux dans ce vin-là. – Tout est falsifié dans ce monde. Je le soutiendrai, en dépit d’Adam Smith et de ses sectateurs : un auteur qui réussit est un cultivateur industrieux, et ses ouvrages constituent une portion de la fortune publique, aussi effective que ceux qui sortent de toute autre manufacture. Si une nouvelle denrée, ayant par elle-même une valeur intrinsèque et commerciale, est le résultat de l’opération, pourquoi les ballots de livres d’un auteur seraient-ils regardés comme une portion moins profitable de la richesse publique, que les marchandises de tout autre manufacturier ? Je parle ainsi, eu égard à la quantité d’argent en circulation, et au degré d’industrie qu’un ouvrage aussi futile que celui-ci doit exciter et récompenser, avant que les volumes quittent la boutique de l’éditeur. C’est à moi qu’on doit cet avantage, et en cela je rends service au pays. Quant à mes émolumens, je les gagne par mon travail, et je ne dois compte qu’au ciel de l’usage que j’en fais. L’homme équitable pensera que tout n’est pas consacré à satisfaire un vil égoïsme ; et, sans que celui qui agit ainsi prétende s’en faire un grand mérite, il peut s’en trouver une partie
Qui, par le ciel guidée, aille trouver le pauvre.
LE CAPITAINE. – Néanmoins on regarde généralement comme une bassesse d’écrire par un motif d’intérêt.
L’ACTEUR. – C’en serait une si ce motif excluait tous les autres, s’il était le but principal d’une conception littéraire. J’oserais même avancer qu’aucun ouvrage d’imagination composé uniquement dans les vues d’en retirer un avantage pécuniaire n’a jamais réussi et ne réussira jamais. Ainsi l’avocat qui plaide, le soldat qui se bat, le médecin qui donne ses ordonnances, l’ecclésiastique, – si toutefois il en peut exister de semblables, – qui prêche sans avoir ni zèle pour sa profession, ni sentiment de sa dignité ; tous ces gens, en un mot, qui ne songent qu’à toucher leur salaire, leur paie ou leurs appointemens, s’abaissent au rang de sordides artisans. C’est pourquoi, à l’égard de deux des facultés savantes, au moins, leurs services sont considérés comme inappréciables, et ceux qu’elles rendent sont récompensés, non d’après une estimation exacte, mais par un honorarium, ou reconnaissance volontaire ; mais qu’un client ou un patient essaie d’oublier cette petite cérémonie de l’honorarium, qui est censée être une chose tout-à-fait hors de considération entre eux, et qu’il remarque la manière dont le savant docteur prendra la chose. Hypocrisie à part, il en est de même des émolumens littéraires. Aucun homme de sens, quel que soit son rang, ne doit regarder comme au-dessous de lui d’accepter ce qui est un juste dédommagement de son temps, ou une part raisonnable du capital qui doit son existence même à ses peines. Lorsque le czar Pierre travaillait aux tranchées, il recevait la paie d’un simple soldat ; et les gentilshommes, les hommes d’État et les hommes d’Église les plus distingués de leur temps n’ont pas dédaigné de régler des comptes avec leur libraire.
LE CAPITAINE. – (Il chante.)
S’ils ne l’ont jamais négligé,
Ce n’est donc pas une bassesse ;
Qui pourrait accuser d’une indigne faiblesse
Ou la noblesse ou le clergé ?
L’AUTEUR. – Vous avez raison ; mais aucun homme d’honneur, de génie ou d’esprit n’aura l’amour du gain pour principal objet, encore moins pour unique but de ses travaux. Quant à moi, je ne suis pas fâché de gagner au jeu sous la condition de plaire au public ; je le continuerais probablement pour l’unique plaisir de jouer, car j’éprouve aussi fortement que personne cet amour de la composition qui est peut-être le plus vif de tous les instincts, et qui entraîne l’auteur vers sa plume, le peintre vers sa palette, souvent sans aucune chance de gloire, sans perspective de récompense. Peut-être en ai-je trop dit ; il me serait sans doute possible, avec non moins de sincérité que bien des gens, de me disculper de l’accusation d’avoir l’ame bien avide ou mercenaire ; mais je ne suis pas assez hypocrite pour nier les motifs ordinaires d’après lesquels tout ce qui m’entoure agit sans cesse aux dépens de la tranquillité, du bonheur, de la santé et de la vie. Je n’affecte pas le désintéressement de cette association ingénieuse d’individus dont parle Goldsmith, qui vendaient leur journal à six sous l’exemplaire, uniquement pour leur propre amusement.
LE CAPITAINE. – Je n’ai plus qu’une observation à faire. – Le monde dit que vous vous épuisez.
L’AUTEUR. – Le monde a raison ; et qu’importe ? Lorsqu’il ne dansera plus, je ne jouerai plus de ma cornemuse, et je ne manquerai pas de gens assez obligeans pour me faire apercevoir que mon temps est passé.
LE CAPITAINE. – Et que deviendrons-nous alors, nous qui sommes votre malheureuse famille ? Nous tomberons dans le mépris et l’oubli.
L’AUTEUR. – Comme tant de pauvres diables chargés déjà d’une nombreuse famille, je ne puis m’empêcher de travailler à l’accroître. – C’est ma vocation, Hall8. – Il faut que ceux d’entre vous qui méritent l’oubli, vous tous peut-être, vous vous y résigniez. Du reste, vous avez été lus dans votre temps, et l’on n’en pourrait dire autant de quelques-uns de vos contemporains qui ont eu moins de bonheur et plus de mérite. Ils ne sauraient disconvenir que vous n’ayez eu la palme. Quant à moi, je mériterai toujours au moins le tribut involontaire que Johnson a payé à Churchill en comparant son génie à un arbre qui ne produit que des pommes sauvages, et qui pourtant est prolifique et porte une grande quantité de fruits. C’est toujours quelque chose que d’avoir occupé l’attention publique pendant sept ans. Si je n’avais écrit que Waverley, je n’aurais été depuis long-temps, comme on a coutume de le dire, que l’ingénieux auteur d’un roman fort estimé dans le temps. Je crois en effet que la réputation de Waverley est soutenue, en grande partie, par les éloges de ceux qui peuvent être portés à préférer cet ouvrage aux suivans.
LE CAPITAINE. – Vous voulez donc sacrifier la gloire future à la popularité du moment ?
L’AUTEUR. – Meliora spero. Horace lui-même ne s’attendait pas à revivre dans tous ses ouvrages, et moi j’espère vivre dans quelques-uns des miens ; non omnis moriar. C’est une consolation de penser que les meilleurs auteurs de tous les pays ont été les plus volumineux ; et il est souvent arrivé que ceux qui ont été le mieux accueillis de leur temps ont aussi continué de plaire à la postérité. Je n’ai pas assez mauvaise idée de la génération présente pour penser qu’une réprobation future soit la conséquence nécessaire de la faveur dont elle m’honore.
LE CAPITAINE. – Si chacun agissait d’après de pareils principes, le public serait inondé.
L’AUTEUR. – Encore une fois, mon cher fils, point d’hypocrisie. Vous parlez comme si le public était obligé de lire les livres uniquement parce qu’ils sont imprimés. Vos amis les libraires vous sauraient gré de faire goûter cet avis. Le plus grand mal que puissent causer ces inondations, c’est qu’elles renchérissent les chiffons. La multiplicité des ouvrages qu’on publie ne fait aucun mal au siècle présent, et peut être fort avantageuse à celui qui doit succéder au nôtre.
LE CAPITAINE. – Je ne vois pas comment cela peut se faire.
L’AUTEUR. – Les plaintes qui s’élevèrent dans le temps d’Élisabeth et de Jacques, sur la fertilité alarmante de la presse, retentirent aussi haut que celles que nous entendons ; et pourtant, regardez le rivage sur lequel s’est répandue l’inondation de ce siècle, il ressemble aux rives enchantées de la Reine des Fées9.
Il est couvert d’or et de pierreries ;
Rubis, saphirs, brillent sur les prairies ;
Le sable même est mêlé de trésors.
Croyez-moi, dans les ouvrages même les plus négligés du siècle actuel, le siècle à venir pourra découvrir des mines précieuses.
LE CAPITAINE. – Il est certains ouvrages qui mettront en défaut tous les alchimistes.
L’AUTEUR. – Ils seront en petit nombre ; car les écrivains qui n’ont absolument aucun mérite, à moins qu’ils ne publient leurs ouvrages à leurs frais, comme sir Richard Blackmore10, perdront tout moyen d’ennuyer le public, par la difficulté de trouver des libraires qui se chargent de les publier.
LE CAPITAINE. – Vous êtes incorrigible. N’y a-t-il aucunes bornes à votre audace ?
L’AUTEUR. – Il y a les bornes sacrées et éternelles de l’honneur et de la vertu. Je suis comme dans la chambre enchantée de Britomarte11.
Elle porte autour d’elle un regard interdit,
Et sur la même porte elle aperçoit écrit :
DU COURAGE ! En tous lieux cet avis salutaire,
Mille fois répété, lui paraît un mystère ;
Quand sur une autre porte, en un coin écarté,
Ces mots frappent ses yeux : MAIS SANS TÉMÉRITÉ.
LE CAPITAINE. – Hé bien ! il vous faut courir le risque de continuer d’après vos propres principes.
L’AUTEUR. – Et vous, agissez d’après les vôtres, et tâchez de ne pas rester ici à perdre votre temps pendant que l’heure du dîner s’écoule. – Je vais ajouter cet ouvrage à votre patrimoine, valeat quantùm.
Ici finit notre dialogue, car un petit Apollon de la Canongate, au visage noirci, vint demander l’épreuve de la part de M. Mac Corkindale ; et j’entendis M. C.12 gronder M. F. dans un autre détour du labyrinthe que j’ai déjà décrit, pour avoir laissé pénétrer quelqu’un dans les penetralia de leur temple.
Je vous laisse à penser ce qu’il vous plaira de l’importance de ce dialogue, et je ne puis m’empêcher de croire que je préviendrai les vœux de notre père commun en plaçant cette lettre au commencement de l’ouvrage auquel elle a rapport.
Je suis, révérend et cher monsieur, votre sincère et affectionné serviteur,
CUTHBERT CLUTTERBUCK.
Kennaquhair, Ier avril 1822.
CHAPITRE PREMIER.
« L’Anglais et l’écossais à la fin sont d’accord.
« Voyez partir Saunders13 pour passer la frontière.
« Comme il y va briller ! Métamorphose entière.
« Son vil habit de bure en drap d’or est changé.
« Son sabre, de fer seul jusqu’à présent chargé,
« Du plus noble métal maintenant étincelle.
« Sa toque même a pris une forme nouvelle ;
« C’est un casque éclatant, surmonté d’un cimier.
« Où trouva-t-on jamais un plus galant guerrier ?
« Sa mère aurait, je crois, peine à le reconnaître. »
Le Réformateur.
Les longues hostilités qui avaient, pendant des siècles, divisé la partie méridionale de la Grande-Bretagne et celle qui est située plus au nord, s’étaient heureusement terminées par l’avénement du pacifique Jacques Ier au trône d’Angleterre. Mais quoique les couronnes réunies d’Angleterre et d’Écosse fussent portées par le même monarque, il fallut laisser écouler un laps de temps considérable, et plus d’une génération, avant qu’on vît disparaître les préjugés nationaux invétérés qui avaient régné si long-temps entre les deux royaumes voisins, et que les habitans des deux pays séparés par la Tweed pussent s’habituer à se regarder comme amis et comme frères.
Ces préjugés devaient avoir, comme de raison, plus de violence pendant le règne de Jacques. Les Anglais l’accusaient de partialité pour ses anciens sujets ; et les Écossais, non moins injustes, lui reprochaient d’avoir oublié le pays qui l’avait vu naître, et de négliger ces anciens amis dont la fidélité lui avait été si utile.
Le caractère du roi, pacifique jusqu’à la timidité, l’engageait continuellement à se placer comme médiateur entre les factions opposées dont les querelles troublaient la cour. Mais, en dépit de toutes ses précautions, on voit dans l’histoire que mainte fois la haine mutuelle des deux nations, si récemment réunies après avoir été ennemies pendant mille ans, éclata avec une fureur qui menaçait de produire une convulsion générale. Le même esprit régnait dans les classes les plus élevées comme dans la plus basse, il occasionait des débats dans le conseil et dans le parlement, donnait lieu à des factions à la cour, à des duels entre les nobles, et faisait naître des dissensions et des querelles parmi le peuple.
À l’époque où cette animosité était portée au plus haut degré, il existait dans la cité de Londres un ouvrier ingénieux, mais fantasque et tenant fortement à ses idées. Il se nommait David Ramsay, et était fort adonné aux études abstraites. Soit que son talent dans sa profession lui eût servi de protection, comme le prétendaient les courtisans, ou que sa naissance dans la bonne ville de Dalkeith, près d’Édimbourg, lui eût valu cet avantage, comme ses voisins le disaient tout bas, il occupait dans la maison de Jacques Ier l’office de fabricant de montres et d’horloges de Sa Majesté : il ne dédaignait pourtant pas en même temps de tenir une boutique à Temple-Bar, à quelques pas de l’église de Saint-Dunstan.
La boutique d’un marchand de Londres, à cette époque, était, comme on peut bien le supposer, quelque chose de fort différent de celles qu’on voit aujourd’hui dans ce même quartier. Les marchandises en vente dans des caisses n’étaient défendues de l’injure du temps que par un auvent couvert en grosse toile ; ce qui ressemblait aux étaux et aux échoppes qu’on établit momentanément dans les foires de village pour les colporteurs, plutôt qu’au magasin d’un commerçant recommandable ; mais la plupart des marchands d’un ordre élevé, et David Ramsay était de ce nombre, avaient un petit appartement dans lequel on entrait par le fond de la boutique, et qui était à l’échoppe qui le précédait ce qu’était la caverne de Robinson Crusoé à la tente qu’il avait élevée devant l’entrée. C’était là que maître Ramsay avait coutume de se retirer pour travailler à ses calculs mathématiques ; car il avait l’ambition de vouloir perfectionner son art, d’y faire des découvertes ; et, de même que Napier et d’autres mathématiciens de ce temps, il poussait quelquefois ses recherches jusqu’à la science abstraite.
Quand il était ainsi occupé, il abandonnait le poste extérieur de son établissement commercial à deux robustes apprentis à voix de Stentor, qui ne cessaient de crier : – Que désirez-vous ? que désirez-vous ? – sans manquer de joindre à ces paroles un pompeux éloge des objets qu’ils avaient à vendre. Cet usage de s’adresser aux passans pour les inviter à acheter ne subsiste plus aujourd’hui, à ce que nous croyons, que dans Montmouth-Street (si même il en existe encore dans ce dépôt de vieux habits, sous la garde des restes épars des tribus d’Israël) ; mais à l’époque dont nous parlons il était adopté par les Juifs et par les gentils, et remplaçait le charlatanisme de ces avis insérés dans les journaux, par lesquels les marchands sollicitent le public en général, et leurs amis en particulier, d’accorder leur attention à l’excellence sans égale des marchandises qu’ils vendent et qu’ils offrent à si bas prix, qu’on pourrait croire qu’ils ont en vue l’avantage du public, plutôt que leur intérêt particulier.
Ceux qui proclamaient de vive voix l’excellence de leurs marchandises avaient un avantage sur ceux qui font aujourd’hui servir les journaux au même but : ils pouvaient, en bien des cas, adapter leurs discours à l’air, à la mise et aux goûts apparens des passans. C’était, comme nous l’avons dit, ce qui, de notre mémoire, se pratiquait dans Montmouth-Street. Nous nous rappelons qu’on nous y a fait remarquer à nous-même quelques défauts de continuité dans la partie inférieure de nos vêtemens, et qu’on a pris de là occasion de nous exhorter à nous équiper plus convenablement. – Mais ceci est une digression.
Ce mode d’invitation directe et personnelle aux passans devenait pourtant une tentation dangereuse pour les jeunes égrillards chargés du rôle de solliciteurs en l’absence du personnage principalement intéressé à la vente. Se fiant sur leur nombre et sur leur union civique, les apprentis de Londres se permettaient des libertés avec les passans, et se laissaient souvent aller à exercer leur esprit aux dépens de ceux dont ils n’avaient pas l’espoir de faire des acheteurs par leur éloquence. Si quelque mécontent voulait se venger par quelque acte de violence, les habitans de toutes les échoppes accouraient en masse au secours de leur camarade ; et, pour me servir de deux vers d’une vieille chanson que le docteur Johnson avait coutume de fredonner :
Et l’on voyait, grands et petits,
Accourir tous les apprentis.
Des querelles sérieuses s’élevaient souvent en pareille occasion, surtout quand les Templiers14, ou les autres jeunes gens tenant à l’aristocratie, étaient insultés ou croyaient l’être. L’acier était alors fréquemment opposé au bâton des citoyens ; et la mort enlevait quelquefois des victimes de part et d’autre. L’action de la police était dans ce temps lente et sans efficacité, et l’alderman de l’arrondissement n’avait d’autre ressource que d’appeler à haute voix les habitans pour étouffer la dispute sous le nombre, comme on sépare sur le théâtre les Capulets et les Montaigus15.
À l’époque où telle était la coutume générale des plus respectables marchands, comme des plus petits boutiquiers de Londres, David Ramsay, dans la soirée à laquelle nous prions nos lecteurs d’accorder leur attention, s’étant retiré pour se livrer en particulier à des travaux d’une nature plus abstraite, avait abandonné l’administration de sa boutique extérieure, ou échoppe, aux susdits apprentis, malins, actifs, vigoureux, et doués d’excellens poumons, qui se nommaient Jenkin Vincent et Frank Tunstall.
Vincent devait son éducation à l’excellente fondation de l’hôpital de Christ-Church. Il avait donc été élevé à Londres, comme il y était né ; et il était doué de cette dextérité, de cette adresse et de cette audace qui caractérisent la jeunesse d’une capitale. Il avait alors environ vingt ans, était de petite taille, mais fortement constitué, et il s’était fait remarquer par ses hauts faits les jours de congé, à la balle au pied et à d’autres exercices gymnastiques. À peine avait-il son égal dans le maniement du sabre, quoiqu’il ne s’y fût encore exercé qu’avec un simple bâton. Il connaissait tous les passages, toutes les allées borgnes et toutes les cours des environs, mieux qu’il ne savait son catéchisme. Il ne déployait pas moins d’activité dans les affaires de son maître que dans les aventures que lui attirait son caractère malin et pétulant ; et il arrangeait si bien les choses, que le crédit qu’il acquérait par le premier moyen le tirait d’affaire, ou du moins lui servait d’excuse, lorsque quelque incartade le mettait dans l’embarras. Il est juste d’ajouter qu’il ne s’était encore compromis dans aucune affaire déshonorante. Il était certains de ses écarts pour lesquels son maître, David Ramsay, le rappelait à l’ordre ; mais il en était d’autres sur lesquels il fermait les yeux, supposant qu’il en était de même que de l’échappement d’une montre, qui dispose de l’excédant de cette force mécanique dont l’impulsion met le tout en mouvement.
La physionomie de Jin Vin, abréviation familière sous laquelle il était connu dans le voisinage, répondait à l’esquisse que nous venons de tracer de son caractère. Sa tête, sur laquelle sa toque d’apprenti était ordinairement posée de côté, d’un air de négligence, était couverte de cheveux épais, noirs comme du jais, et bouclés naturellement, qui auraient atteint une grande longueur si l’usage modeste du poste qu’il occupait, et auquel son maître exigeait strictement qu’il se conformât, ne l’eût forcé à les tenir courts. Ce n’était pas sans regret, et il regardait d’un œil d’envie les cheveux flottans et frisés que les courtisans et les étudians aristocratiques du Temple, ses voisins, commençaient à porter, en signe de noblesse et de supériorité. Ses yeux profonds étaient noirs, vifs, pleins de feu, de malice et d’intelligence, et avaient une expression de sarcasme, même quand il ne faisait que tenir le langage du métier, comme s’il eût cherché à tourner en ridicule ceux qui étaient disposés à écouter sérieusement ses lieux communs. Il avait pourtant assez d’adresse pour y ajouter de son cru quelques touches qui donnaient une sorte de drôlerie même à la routine ordinaire de la boutique, et sa vivacité, son empressement, son désir évident d’obliger, son intelligence et sa civilité, quand il croyait la civilité nécessaire, avait fait de lui le favori de toutes les pratiques de son maître. Ses traits étaient loin d’être réguliers, car il avait le nez épaté, la bouche un peu trop fendue, et le teint plus brun qu’on ne l’estimait alors convenable à la beauté, même dans un homme ; mais aussi, quoiqu’il eût toujours respiré l’air d’une cité populeuse, son teint brillait des couleurs de la santé ; son nez retroussé donnait un air d’esprit et de raillerie à tout ce qu’il disait, et ses lèvres vermeilles et bien formées laissaient voir, quand il riait, un double rang de dents aussi blanches que des perles. Tel était l’apprenti en chef de David Ramsay, fabricant de montres et d’horloges de Sa Majesté très-sacrée Jacques Ier.
Le compagnon de Jenkin n’occupait que le second rang, quoiqu’il pût avoir le premier du côté des années. Du reste, il était d’un caractère plus rassis et plus tranquille. Frank Tunstall descendait d’une de ces fières et anciennes familles qui réclamaient le titre d’irréprochable, parce qu’au milieu de toutes les chances des longues et sanglantes guerres des deux Roses, elles étaient, avec une loyauté toujours pure, restées fidèles dès l’origine à la maison de Lancastre. Le plus mince rejeton d’un tel arbre attachait de l’importance à la souche dont il sortait, et l’on supposait que Tunstall nourrissait en secret quelques germes de cet orgueil de famille qui avait arraché des larmes à sa mère, veuve et presque indigente, quand elle se vit forcée de le lancer dans une carrière bien inférieure, d’après ses préjugés, à celle qu’avaient suivie ses ancêtres.
Cependant, malgré ce préjugé aristocratique, David Ramsay trouvait le jeune homme bien né plus docile, plus régulier, plus attentif à ses devoirs, que son camarade plus actif et plus alerte. Il n’était pas moins satisfait de l’attention particulière que Tunstall semblait disposé à donner aux principes abstraits des sciences relatives au métier qu’il était obligé d’apprendre, et dont les bornes s’étendaient chaque jour en proportion de l’accroissement de la science des mathématiques. Vincent était incomparablement au-dessus de son compagnon derrière le comptoir, dans tout ce qui concernait la pratique et la dextérité nécessaire pour travailler dans les branches purement mécaniques de son art ; et il le surpassait encore davantage dans tout ce qui avait rapport aux affaires commerciales de la boutique. Cependant leur maître avait coutume de dire que si Vincent était le plus habile pour l’exécution, Tunstall connaissait mieux les principes d’après lesquels on devait exécuter, et il reprochait quelquefois à celui-ci de connaître trop bien en quoi consistait l’excellence de la théorie pour se contenter jamais de la médiocrité en pratique.
Tunstall était aussi timide que studieux, et quoiqu’il fût parfaitement poli et obligeant, il semblait toujours ne pas se sentir à sa place quand il remplissait ses fonctions dans la boutique. Grand et bien fait, il avait les cheveux blonds, les traits réguliers, les yeux bleus et bien-fendus, le nez à la grecque, et une physionomie qui annonçait la bonne humeur et l’intelligence. Mais il y joignait une gravité qui ne paraissait pas convenir à son âge, et qui allait presque jusqu’à la tristesse. Il vivait au mieux avec son compagnon, et était toujours prêt à lui prêter main forte quand il le voyait engagé dans quelqu’une de ces escarmouches qui, comme nous l’avons déjà fait observer, troublaient à cette époque la paix de la cité de Londres. Mais quoiqu’il fût reconnu comme jouant mieux que personne du bâton à deux bouts, arme ordinaire des comtés du nord, et quoiqu’il eût reçu de la nature autant de vigueur que d’agilité, son intervention en de semblables querelles semblait toujours un objet de nécessité ; et comme il ne prenait jamais volontairement part aux disputes ni aux jeux des jeunes gens du voisinage, il occupait dans leur esprit une place moins distinguée que son brave et infatigable ami Jin Vin. Bien plus, sans l’intérêt que Vincent prenait à son camarade, et sans son intercession, il aurait couru quelques risques d’être entièrement exclu de la société des jeunes gens qui suivaient le même état, et qui l’appelaient par dérision le Cavaliero Cuddy et le noble Tunstall.
D’une autre part, ce jeune homme lui-même, privé de l’air vif dans lequel il avait été élevé, et ne pouvant prendre l’exercice auquel il avait été habitué autrefois lorsqu’il habitait la maison qui l’avait vu naître, perdait peu à peu la fraîcheur de son teint, et, sans montrer aucun symptôme direct de maladie, devenait chaque jour plus maigre et plus pâle. On pouvait remarquer en lui les apparences d’une santé languissante ; mais il ne faisait entendre aucune plainte, il n’avait aucune des habitudes des valétudinaires, si ce n’est une disposition à éviter la société, et à donner à l’étude le temps dont il pouvait disposer, plutôt que de partager les amusemens de ses compagnons. On ne le voyait même nullement enclin à fréquenter les théâtres, qui étaient alors le rendez-vous général des gens de sa condition, et où ils se battaient avec des pommes à demi mordues et des noix cassées, en faisant retentir la seconde galerie de leurs clameurs.
Tels étaient les deux jeunes gens qui reconnaissaient pour maître David Ramsay, et contre lesquels celui-ci s’impatientait du matin au soir, quand leur caractère se trouvait en opposition avec le sien ou arrêtait le cours tranquille et les profits de son commerce.