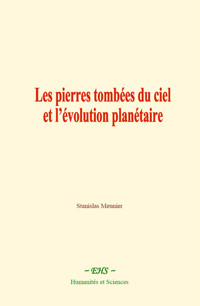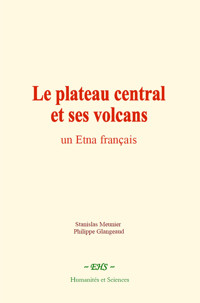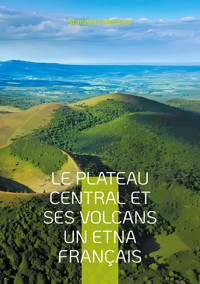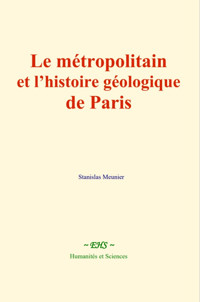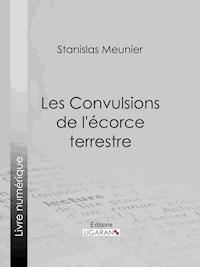
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
Extrait : "Tout le monde a employé l'expression de tremblement de terre, remplacée souvent par celle de séisme, mais tout le monde ne s'est pas préoccupé de la définir. Or, il paraît que rien n'est plus nécessaire ici que d'introduire de la précision dans nos discours, de pseudo-tremblements de terre existant à côté des vrais."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
D’après le tableau de Joseph de Nittis, témoin du phénomène.
SOMMAIRE.– Faits qui démontrent l’existence de la croûte terrestre. – La chaleur souterraine. – Comment on a découvert sa distribution. – Le degré géothermique. – Épaisseur de la croûte. – La substance du noyau terrestre. – Effet de la pression sur l’écoulement des solides. – Destinée réservée à la croûte. – Son origine et son mode de formation. – La photosphère du Soleil et ses enseignements au sujet du commencement de la Terre. – L’analyse spectrale du Soleil et la Géologie. – Les roches cosmiques : leur origine et leur imitation expérimentale. – La théorie cosmogonique de Laplace. – L’évolution planétaire. – La condensation des océans. – Apparition de la vie sur la Terre. – L’avenir du noyau terrestre. – État actuel de la Lune. – Les petites planètes. – Les météorites ou pierres tombées du Ciel. – La fin de la Terre.
Les expressions de croûte terrestre et d’écorce terrestre sont depuis longtemps entrées dans le langage courant. Elles consacrent la notion que notre planète consiste en un sphéroïde de substances fluides enveloppé d’un revêtement solide. Or, cette notion a seulement pour elle d’innombrables et puissantes vraisemblances : aussi ne peut-on pas dire qu’elle soit inattaquable et un certain nombre de personnes ont-elles adopté l’opinion que notre planète est à l’état solide jusqu’au centre.
Cependant il semble bien qu’on ne soit pas libre d’admettre l’une ou l’autre hypothèse indifféremment. Les arguments en faveur de l’existence d’une écorce du globe sont de deux catégories principales, bien nettement différentes et également sérieuses l’une et l’autre.
La première concerne l’étude de la distribution des températures souterraines et se base sur une extrapolation de résultats incontestables ; l’autre a trait à la faculté avec laquelle la conception de l’écorce terrestre se prête à l’interprétation d’une foule de phénomènes dont l’existence est, sans ce postulatum, infiniment plus compliquée et surtout moins homogène avec la théorie générale de la Terre.
Reprenons chacun de ces deux ordres d’arguments.
Tout le monde sait qu’un très mince épiderme du sol, épais seulement d’une douzaine de mètres sous nos latitudes, présente des vicissitudes de température évidemment attribuables aux conditions météorologiques, c’est-à-dire à la variation, en chaque point, de la température venant du Soleil. À partir de la limite inférieure de cette région, on se trouve en présence, à mesure qu’on s’enfonce davantage en profondeur, de couches successives dont chacune jouit d’un état thermométrique permanent et qui ne dépend que de sa distance verticale à la surface de sol.
Il est remarquable qu’on ait apporté autant de persévérance à une étude qui se traduit par la possession actuelle de millions de résultats, alors que tant de circonstances latérales devaient faire craindre qu’on n’arrivât jamais à l’expression de la vérité. L’ouverture des puits et des galeries de mines, indispensables à l’établissement des thermomètres, constitue par elle seule une cause de perturbation intense des conditions souterraines qu’il s’agit de préciser. Mais ici, plus que dans beaucoup d’autres cas, s’est révélée, avec une force exceptionnelle, la toute-puissance du nombre des observations, pour faire ressortir une moyenne tendant progressivement vers une limite qu’on doit accepter comme le résultat désiré.
D’ailleurs, au point de vue où nous sommes placés en ce moment, une haute précision ne serait aucunement indispensable : il suffit de constater avec une certaine approximation la valeur cherchée, en lui laissant une grande latitude de variation possible.
En éliminant un certain nombre de cas où manifestement sont intervenues des causes d’accélération ou de ralentissement du degré géothermique, comme au voisinage d’éruptions peu anciennes ou de grands glaciers actuels, on est arrivé à accepter que chaque approfondissement de 30 mètres donne lieu à une augmentation de 1 degré centigrade dans la température d’un puits. Et de même, le résultat, vérifié pour certaines profondeurs avec une précision qu’on peut dire absolue, par l’examen de sondages artésiens (Grenelle) d’où les causes de perturbation sont pratiquement éliminées, n’a pu être obtenu que jusqu’à une profondeur qui ne dépasse guère 1 kilomètre.
Les objections n’ont pas manqué contre les auteurs qui admettent, dans les régions inconnues, la continuation des progrès de l’échauffement observé seulement jusqu’à la très faible profondeur de 1 000 mètres. Mais ces objections peuvent être mises de côté, au moins provisoirement, car elles ne portent que sur la valeur des chiffres et non sur le fait même de l’accroissement de chaleur vers le centre. Nous avons, en effet, des témoignages innombrables de l’intensité calorifique des zones inaccessibles, par l’incandescence des produits volcaniques, par la tension des vapeurs qui s’échappent des fissures du sol, et surtout par la preuve que les eaux, dans leur domaine souterrain, jouissent d’une activité chimique que leur arrivée au jour suffit à leur faire perdre, comme le démontre l’activité des dépôts d’incrustations minérales variées, qui signale le siège de leurs affleurements.
La progression d’accroissement de la température avec la profondeur est-elle arithmétique ou géométrique, ou même pourvue d’un taux différent ? Nous ne le savons pas ; mais ces diverses hypothèses conduisent à des résultats qui, tout différents qu’ils soient les uns des autres, concluent cependant tous au même résultat général : la preuve de l’existence d’une croûte.
En admettant la raison de progression la plus généralement admise et que nous venons de rappeler, on arrive à attribuer une température constante de 2 000 degrés à la profondeur de 60 kilomètres environ. C’est là un point qui mérite attention.
Il résulte, en effet, des travaux des physiciens qu’à 2 000 degrés aucune des substances connues ne peut conserver son état solide : elle est liquéfiée, sinon volatilisée, en tout cas, fluidifiée. Dès lors, l’état solide, tel que nous le connaissons à la surface, ne peut persister en profondeur plus loin que ce niveau de 60 kilomètres, représentant exactement, comme on le voit (fig. 1.), le centième du rayon planétaire.
Ainsi donc, on peut admettre que la masse solide de la terre enfermée dans la double tunique fluide constituée par la superposition de l’atmosphère à l’océan, est elle-même réduite à une tunique de 60 kilomètres de puissance.
Ce fait a une telle importance pour la suite de nos études qu’il est indispensable de nous y arrêter un moment. Il convient de le préciser par une notion sur la région enveloppée par l’écorce terrestre et qui est formée de matériaux qu’on peut désigner sous le nom de substance nucléaire.
Il est très nécessaire d’avoir à son égard des enseignements permettant d’établir une sorte de base quant à l’économie de la croûte et surtout quant à son équilibre.
On a fait remarquer que sous 60 kilomètres de roches dont la densité est supérieure à 3, on a déjà une pression de 2 000 atmosphères et que par conséquent l’état de la matière à ce niveau est très difficile à concevoir. La haute température s’oppose au maintien de l’état solide, mais la pression ne laisse pas supposer non plus la persistance de la fluidité vraie. En pénétrant plus bas et en se rapprochant du centre, on rencontrerait des zones à l’égard desquelles on a prétendu déterminer des données, grâce à des indications séismographiques sur lesquelles nous reviendrons plus loin. Leur compacité, conclue de leur pouvoir conducteur pour des ondes dynamiques, ressemblerait à celle de l’acier forgé avec lequel elles n’auraient du reste que ce genre de ressemblance.
Tresca a montré que la glace, le plomb, et même le fer fondu peuvent à la température ordinaire, mais sous une pression suffisante, subir un déplacement moléculaire qui en permet l’écoulement comme cela a lieu dans le cas des liquides. Le fer solide peut, par une pression suffisante, être contraint à pénétrer à l’intérieur des cavités et à en prendre la forme. En examinant la section polie des métaux ainsi « écoulés », on a reconnu que les particules cristallines qui les composent sont disposées avec un agencement fluidal dépendant de l’espace dans lequel le refoulement a été opéré.
Il est cependant un point ayant pour nous une signification capitale et sur lequel il semble qu’on ne puisse hésiter : c’est que la matière nucléaire, quelles que soient sa densité, sa compacité et son élasticité, a conservé, – de la mécanique de substances fluides, – la faculté de se contracter par refroidissement avec une intensité bien supérieure à celle des solides. Nous aurons ainsi dans la contraction spontanée de cette matière interne un moteur puissant pour expliquer les déplacements observés dans la croûte, et il faut remarquer qu’aucune théorie actuellement connue de la mécanique souterraine ne saurait être acceptée, si on refusait au noyau de partager avec les fluides, malgré son état non défini, cette propriété caractéristique.
Nous aurons maintes fois, dans le cours de nos études, à revenir sur ce point qui nous sera utile pour prévoir la destinée de la croûte elle-même. Pour le moment, bornons-nous à ajouter que l’on a émis l’opinion que le noyau à compacité comparable à celle des métaux, serait séparé de la croûte rocheuse proprement dite par une assise relativement peu épaisse douée d’une vraie fluidité et que M. Milne a désignée sous le nom de Géite, c’est-à-dire de matière terrestre par excellence.
Ce sont là des suppositions qui attendent le contrôle d’une observation à laquelle jusqu’à présent il ne paraît guère possible de procéder.
Il ne suffit pas d’avoir justifié la supposition de la croûte terrestre, il faut nécessairement, étant donné le but que nous poursuivons, chercher à nous faire une idée de son origine et même de son mode de formation. À cet égard, nous ne sommes certainement pas aussi désarmés qu’on pourrait se le figurer a priori.
En effet, et conformément aux méthodes de la Géologie comparée, nous pouvons appliquer au sujet les procédés d’observation astronomique. Cela suppose que nous donnons un acquiescement complet à la théorie cosmogonique de Laplace, et que nous regardons la Terre comme étant un lambeau détaché de la matière nébuleuse initiale, devenue depuis lors, par contractions successives, la substance même du Soleil. Il se trouve que notre astre central, emporté comme tous les astres dans la série des étapes de l’évolution sidérale, en est justement aujourd’hui à ce stade particulier caractérisé par la production de la croûte solide entre l’atmosphère extérieure et un sphéroïde qui va devenir, en conséquence, le noyau du globe.
On sent bien que si le Soleil en est seulement aujourd’hui à cette période de formation que la Terre a traversée depuis si longtemps, c’est simplement à cause de son colossal volume comparé à celui de notre planète. La formule classique du refroidissement doit s’appliquer aux mondes en formation comme aux parcelles étudiées dans leurs laboratoires par les physiciens : on sait que le volume intervient très directement dans la vitesse du phénomène.
Or, les observations innombrables dont le Soleil a été l’objet, ont montré que la photosphère, c’est-à-dire la région de l’astre qui émet la lumière, constitue comme une mince pellicule interposée entre l’atmosphère gigantesque, dans la composition de laquelle dominent les gaz légers (hydrogène, etc.) et la masse interne jouissant sans aucun doute de l’état physique d’une partie au moins du noyau terrestre. Cette coque lumineuse est évidemment d’âge très récent comparativement à l’antiquité du Soleil et elle résulte du seul refroidissement, en conséquence duquel une certaine région a perdu progressivement son état gazeux du début, pour prendre l’état solide.
Cette circonstance, qu’on ne peut mettre en doute, est elle-même de nature à arrêter l’attention, car c’est un problème remarquable que la destinée de particules solides dans un milieu voué jusqu’alors à l’exclusive fluidité. Une foule de phénomènes se déclarent alors qui n’ont pas eu d’analogues et des lois, jusque-là tenues en réserve, exercent tout à coup leur empire. Telles sont les lois si formelles de la cristallographie qui vont, sans délai, présider à l’agencement mutuel des particules solides.
Aussi ces premières productions doivent-elles mériter de la part du géologue une étude toute particulière, comme constituant la charpente primitive de tout l’édifice astronomique.
Il y a déjà longtemps que l’analyse spectrale du Soleil nous a renseignés quant à la composition chimique de la photosphère. Le fer, le magnésium, le silicium, l’hydrogène y dominent, et Alfred Cornu a fait cette remarque que la substance irradiante de notre astre central a les plus grandes analogies avec l’étoffe rocheuse dont sont faites les météorites ou pierres tombées du ciel.
Remarque féconde, car elle conduit à étudier, à un point de vue nouveau, toute une famille de roches terrestres gisant à de grandes profondeurs et qu’on a été amené à considérer comme dérivant, – au travers d’actions complexes, qui les ont d’ailleurs plus ou moins modifiées, – de l’assise primitive de la Terre dont l’étude nous occupe en ce moment.
C’est en rapprochant les conditions où se trouvent ces roches, que Daubrée a qualifiées de « cosmiques », d’une part, dans les météorites, d’autre part, dans la photosphère du Soleil, et enfin dans les roches terrestres, – dunite, péridotite, pyroxénite, dolérite à fer natif, – que j’ai eu le bonheur de parvenir à la synthèse des silicates magnésiens, en même temps qu’à celle des alliages de fer et de nickel métalliques par un mode opératoire remplissant les conditions géologiques du gisement.
Répudiant les reproductions (parce qu’elles sont nécessairement incomplètes), par la voie purement sèche, c’est-à-dire par la fusion des éléments mélangés dans un creuset convenablement chauffé, – j’ai préparé le pyroxène, le péridot, la kamacite et la tænite par d’exclusives réactions entre des gaz ou des vapeurs mélangés. On peut dire que l’expérience consiste à faire une imitation de l’atmosphère solaire et à y déterminer une précipitation qui rappelle, malgré la haute température nécessaire, la formation du givre, par la brusque cristallisation de la vapeur d’eau atmosphérique.
Pratiquement, si l’on veut préparer les silicates magnésiens, on fait arriver dans un tube de porcelaine (fig. 2), chauffé au rouge, de la vapeur de chlorure de silicium, en même temps que de la vapeur de magnésium métallique et de la vapeur d’eau. Ces trois corps réagissant mutuellement, donnent naissance, à cause de sa stabilité, au bisilicate de magnésie, connu sous le nom de pyroxène.
« Ce produit, ont écrit MM. Fouqué et Michel Lévy, est identique au pyroxène magnésien ; il en présente les mâcles et les extinctions ». L’examen microscopique, d’ailleurs, n’y révèle pas ordinairement de vacuoles renfermant des gaz ; mais l’analyse chimique en extrait du chlore et de l’hydrogène, ce qui est une reproduction du fait offert par les minéraux météoritiques et aussi par les roches terrestres. C’est une raison déterminante pour reconnaître que des expériences, par voie de fusion ignée, ne sauraient éclairer complètement l’origine des minéraux.
Le procédé de synthèse efficace, comme on voit, pour la partie pierreuse des roches qui nous occupent et qu’on peut appeler initiales, s’est appliqué tout aussi bien à leur partie métallique : non seulement les alliages des météorites ont été imités jusque dans leurs détails et dans leur association mutuelle ; mais on a pu de même reproduire les fers carburés des dolérites d’Ovifak, au Groënland, qui sont, à n’en pas douter, des spécimens de la coque primitive de notre Terre.
Aussi, dans le laboratoire, éclairés par le gisement des roches terrestres, par la composition des pierres tombées du ciel et par le mécanisme actuellement à l’œuvre dans le Soleil et que Faye a analysé d’une manière si magistrale, parvenons-nous à formuler des conclusions très formelles et à proclamer que l’état gazeux n’a pas conduit au premier état solide par l’intermédiaire d’une fusion transitoire, mais qu’il s’est constitué brusquement. Et c’est ainsi que s’explique, par exemple, l’état fragmentaire, – cataclastique, comme on l’a dit, – des pierres météoritiques, état fragmentaire tout à fait comparable à celui du givre d’eau précipité rapidement.
Les observations de Faye sur la structure du Soleil permettent de concevoir comment la petite membrane cristalline des débuts sera progressivement remplacée par une écorce comparable à celle de la Terre. Tout d’abord, on peut remarquer que c’est l’installation de l’état solide à la surface de notre astre central qui a donné au Soleil sa faculté lumineuse dont les effets ont pour nous des conséquences si indispensables. Dans son état antérieur de globe très chaud, le Soleil ne rayonnait pas plus que la flamme de l’hydrogène pur, qui est, comme tout le monde le sait, essentiellement peu éclairante. Mais, de même que celle-ci brille d’un grand éclat si l’on y projette quelque poussière solide, – noir de fumée, limaille de platine, poudre de craie, – de même, le globe solaire est devenu brillant par la production dans sa masse de petits grains givreux de pyroxène ou de fer métallique. L’augmentation d’éclat est donc une conséquence du refroidissement. L’installation de la photosphère ne se fait pas d’ailleurs sans une sorte de lutte qui, comme Faye l’a magistralement exposé, introduit dans la physique solaire plusieurs de ses traits les plus caractéristiques. En effet, cette énorme masse gazeuse, tournant, comme on le sait d’après Galilée, autour de l’un de ses diamètres, des vitesses très inégales se répartissent à sa surface, depuis l’équateur, où elles ont leur maximum, jusqu’aux pôles. Il en résulte une série de courants parallèles à l’équateur et qui ressemblent aux filets voisins dans un cours d’eau. Avec une rapidité convenable de ceux-ci, on les voit se composer et engendrer des mouvements tournants, d’où résultent des tourbillons qui peuvent, sous forme d’entonnoirs, aller atteindre le fond du cours d’eau. Sur le Soleil, il s’en fait tout autant, mais à l’échelle de cet astre colossal, et le résultat est singulier ; en effet, les grains cristallins constitutifs de la photosphère étant entraînés par le tourbillon dans les régions basses, c’est-à-dire internes du globe solaire, leur réchauffement les détruit, leur rend l’état gazeux et leur retire leur éclat. Et il se produit ces taches qui n’intéressent que la région équatoriale, à rotation rapide, celle où les tourbillons peuvent se développer.
Et comme Faye se plaisait à le constater, une sorte de sanction de cette manière de voir résulte de l’observation, maintenant facile, de la suite du phénomène. Les gaz développés par la destruction des grains solides dans la tache, amenés brusquement dans les profondeurs, s’y réchauffent, s’y dilatent et en reçoivent une force ascensionnelle considérable. Aussi les voit-on venir faire éruption sur le bord même de la tache où ils sont abîmés et jaillir dans l’atmosphère sous la forme des protubérances ou flammes roses, dont Janssen a rendu l’observation possible, même en dehors des époques d’éclipses.
Cette période d’établissement des taches et des éruptions consécutives des protubérances devra durer un temps prodigieux ; mais à la faveur du refroidissement toujours continué, la croûte s’épaissira, se consolidera et perdra peu à peu son éclat, de manière à constituer un écran continu entre l’atmosphère et la substance du noyau.
Ces étapes dont le Soleil commence la série, se sont depuis longtemps écoulées pour la Terre, et dès maintenant l’écorce initiale est entièrement masquée par des revêtements extérieurs d’origine toute différente et qui l’ont successivement épaissie. Ce sont les matières abandonnées, les unes par l’atmosphère primitive en conséquence de son refroidissement et qui sont de simples produits de condensation concernant les substances les moins volatiles parmi celles qui s’étaient épandues autour du noyau de matières plus rafraîchies ; les autres proviennent de précipitations chimiques consécutives à des réactions réalisées entre des substances précédemment séparées.
Pendant qu’a lieu cette augmentation d’épaisseur sur la face externe de la pellicule primitive, il s’en fait une autre parfaitement symétrique sur la face interne de celle-ci, aux dépens des matières nucléaires successivement envahies par le refroidissement inéluctable, et acquérant ainsi l’état solide, soit par un mécanisme identique à celui des premiers temps et que nous décrivions tout à l’heure, soit par un processus différent et dépendant du mode de formation par la fusion en vase clos, en présence de substances élastiques.
En tout cas, c’est ainsi que la croûte est parvenue peu à peu à l’épaisseur que nous lui avons reconnue par des observations de thermométrie souterraine, et l’on voit que le niveau des débuts n’en constitue qu’une bien petite partie.
Bientôt, elle a été assez difficile à traverser par la chaleur interne (vu sa faible conductibilité), pour que sa face extérieure ait été amenée à une température favorable à la condensation de l’eau précédemment en vapeur et plus anciennement encore sans doute, à l’état de dissolution. Alors, la zone des roches solides s’est recouverte de la coque aqueuse constituant l’Océan et qui d’abord a été saturée des principes solubles dont l’atmosphère des premiers temps devait être surchargée.
Une épuration, dont on conçoit les progrès, a amené la séparation des océans qui, au début, ont pu recouvrir uniformément l’écorce, mais qui ensuite (et c’est un des sujets principaux de nos études futures) se sont concentrés dans des bassins laissant émerger au-dessus des eaux les régions insulaires et continentales.
Dès lors, les éléments dont la croûte s’est enrichie sont devenus surtout des productions de la voie humide (ou aqueuse) dont les éléments ont été empruntés aux assises précédemment formées, inaugurant ainsi un régime, qui dure encore aujourd’hui et pour longtemps, de destructions incessantes et de rénovations toujours recommencées.
Les entailles si nombreuses de la croûte terrestre nous permettent de retrouver les détails de ces vastes travaux : et c’est, au propre, le but principal de la Géologie. On sait déjà comment leur examen procure un spectacle dont la Science de la Terre a le monopole et qui suffirait pour en faire la plus captivante de toutes les formes de l’activité intellectuelle. Il s’agit de la brusque apparition, au milieu de formations dont la production ne suppose que l’intervention des agents de la physique et de la chimie, d’horizons où se signale la collaboration de la vie. Les masses contemporaines de cet immense évènement méritent une attention spéciale et bientôt on y découvre de véritables roches telles que la houille, dont aucune autre cause que la force biologique n’est capable de nous procurer des spécimens. Et l’on ne peut manquer de voir, dans cette éclosion des produits physiologiques, une espèce de pendant de l’apparition de l’état solide que nous mentionnions il n’y a qu’un instant. La ressemblance est intime entre les organismes provenant d’un arrangement spécial de la matière devenue le foyer et comme le support d’une entité dynamique particulière – la vie – et les cristaux que nous avons vus provenir aussi de matériaux antérieurs et constituer un point d’application de cette autre entité dynamique qui cause les architectures cristallines.
Mais, arrivée à ce degré de développement, la croûte terrestre s’est déjà signalée depuis longtemps à notre attention par d’autres particularités très fécondes en conséquences. Sa qualité d’écran ou de cloison séparative entre deux genres de milieux essentiellement différents, ne va pas sans une très notable perméabilité qui lui permet de favoriser des circulations dans les sens les plus opposés. De l’intérieur vers l’extérieur, elle livrera passage à un flux de chaleur qui, pour être peu sensible, n’en est pas moins réel et amène le refroidissement progressif de la substance nucléaire. De l’extérieur vers l’intérieur, elle livre passage, à mesure que sa température s’atténue, aux fluides de la surface et spécialement à l’eau qui en imprègne, qui en mouille les régions superficielles sur une épaisseur qui va constamment en grandissant.
Nous ne saurions, sans sortir du cadre du présent volume, analyser tous les phénomènes internes dont la croûte est le théâtre en conséquence des dispositions qui viennent d’être esquissées et nous sommes contraints de renvoyer le lecteur à la Géologie générale. Nous nous bornons donc à résumer en deux mots les traits les plus essentiellement caractéristiques de l’écorce rocheuse de notre globe. Continuant la structure concentrique déjà manifestée par la superposition de l’atmosphère à l’océan et de l’océan à la croûte, elle offre à nos regards des éléments régulièrement étalés : la primitive écorce recouverte des sédiments extérieurs et recouvrant les placages internes. En outre, son épaisseur de 60 kilomètres se répartit en deux zones également concentriques, dont la plus superficielle a appelé dans ses pores et par capillarité une quantité chaque jour plus grande d’humidité fournie par les amas aqueux de l’extérieur, pendant que la plus profonde est encore trop chaude pour que cette pénétration ait pu s’y produire jusqu’à présent.
On va voir combien il importe d’avoir ces faits présents à l’esprit pour comprendre le mécanisme des phénomènes qui font l’objet principal de ce livre. Mais sans supposer aucun changement dans l’allure actuelle des phénomènes dont la croûte est le produit, nous ne pouvons manquer de concevoir que la substance nucléaire ne saurait conserver éternellement l’état physique actuel, résultant de sa haute température et de la compression qu’elle s’inflige à elle-même en tendant, par une chute inévitable, vers son propre centre de gravité.
Le refroidissement étant centripète et s’étant déclaré par la surface du globe, l’épaississement interne de la croûte devra se continuer tant qu’il y aura de la matière à solidifier. Mais on ne peut échapper à cette conclusion que la matière nucléaire, éprouvant un refroidissement considérable, elle va subir une diminution correspondante de volume. On ne voit pas comment le résultat ultime ne serait pas une coque vide, à la manière des anciens boulets fondus qui présentent une chambre centrale – avec cette particularité que la chambre sera une fraction bien autrement considérable du volume total de la planète.
Dès aujourd’hui, nous devons admettre que certains corps célestes sont parvenus à l’état que nous avons en vue, et rien ne nous empêche de le supposer, par exemple pour la Lune. Les observations montrent qu’elle a possédé des eaux superficielles et une atmosphère, puisque les phénomènes volcaniques dont elle conserve de si nombreux et si éloquents témoignages, ne sont pas compréhensibles sans ces conditions. Et nous savons aussi, par la coïncidence exacte des moments calculés d’occultation d’étoiles avec l’observation de ces éclipses, qu’aucune réfraction n’est infligée à la lumière sur les bords du disque lunaire. Il est donc démontré que la Lune a absorbé par capillarité tous les fluides qui, jadis, enveloppaient sa masse solide.
Nous savons même davantage, puisque les astronomes ont depuis longtemps signalé, dans notre satellite, des signes incontestables de craquellement et il nous faut en conclure que le noyau doit être entièrement solidifié par refroidissement. Comme il est matériellement impossible d’admettre que le volume de ce solide soit comparable au volume de la matière primitive, dilatée par la prodigieuse chaleur des débuts, il faut de toute nécessité que la Lune consiste en une masse creuse dont la paroi peut être relativement très mince.
Les choses sont alors admirablement disposées pour que se réalise plus tard le morcellement progressif et spontané qui paraît avoir donné naissance aux dépens d’une ancienne planète extra-Martienne, aux centaines de débris circulant de concert, sous la forme d’essaims d’astéroïdes, dont le recensement n’est pas terminé ; ou encore (avec un second satellite dont la Terre a joui jadis, en même temps que la Lune, garantie provisoirement de la pulvérisation par son plus gros volume), aux innombrables météorites qui tombent sur notre sol à des époques que ne règle aucune périodicité.
Pour le dire en passant, ces dispositions merveilleuses font, de la croûte des astres, un agent de transmission de substance et d’énergie entre les corps célestes qui ont terminé le cycle de leur évolution et ceux qui sont encore livrés à l’activité géologique. C’est une sorte d’analogie, à l’échelle cosmique, des phénomènes nutritifs auxquels les manifestations biologiques doivent leur continuation à travers les âges, les générations successives se transmettant, avec leur substance abandonnée au moment de la mort, une contribution matérielle et dynamique.
Pour ce qui concerne la croûte terrestre, il n’y a pas à faire de doute que son avenir, d’ailleurs incompréhensiblement lointain, ne cadre avec les vues précédentes. Le calcul a démontré à Durocher que, dès maintenant, elle a absorbé plusieurs fois le volume d’eau qui reste liquide dans l’ensemble de tous les océans et que ceux-ci seront bien loin de pouvoir suffire à l’imprégnation des matériaux qui restent à refroidir et à solidifier, seulement au taux des roches actuellement les moins hydratées, comme le granit et les marbres.
Nous ne nous dissimulons pas que l’histoire de la croûte terrestre, réduite aux considérations précédentes, est bien loin d’être complète ; mais ce qui lui manque, c’est précisément ce que nous avons le projet de soumettre à une étude attentive ; c’est-à-dire le contrecoup qu’elle doit éprouver des modifications infligées au noyau par son refroidissement ininterrompu. On va voir que la théorie de toutes les convulsions de la zone rocheuse sur laquelle nous sommes condamnés à fonder nos établissements, nécessairement si précaires, repose avant tout sur les conditions auxquelles nous faisons allusion.
SOMMAIRE.– Nécessité de préciser le sujet. – Tassement des pays à mines de houille. – Glissement désastreux de Brux, en Bohême. – Les effondrements du Jura, du Valais et des environs de Paris. – L’éboulement du Rossberg. – La ruine du Grand-Sable à La Réunion. – Catastrophe de Glaris. – La « montagne qui marche ». – Secousses produites par les coups de grisou, par le choc des vagues, par le passage des trains de chemin de fer. – Le soulèvement du Val-Fleury.
Tout le monde a employé l’expression de tremblement de terre, remplacée souvent par celle de séisme, mais tout le monde ne s’est pas préoccupé de la définir. Or, il paraît que rien n’est plus nécessaire ici que d’introduire de la précision dans nos discours, de pseudo-tremblements de terre existant à côté des vrais.
Dans beaucoup de cas, ces pseudo-tremblements sont faciles à reconnaître. Il faut cependant les décrire d’une manière concise, afin de les éliminer à coup sûr.
Ils se présentent, par exemple, dans les pays où le sous-sol est transpercé de galeries de mines.
J’ai eu l’occasion, pour ma part, d’étudier les effets des mouvements du sol dans le département du Pas-de-Calais, non loin des houillères de Courrières et de Lens. J’ai été frappé de l’analogie qu’ils présentent avec les traces de séismes proprement dits. Par exemple, les maisons crevassées ont exactement l’allure de celles observées dans les pays à tremblements classiques, et il est certain que la cause du crevassement est vraiment la même : le déplacement du sol. Ce qui variera seulement, c’est la cause du déplacement (fig. 3).
Ici, il n’y a aucun doute : la matière minérale extraite du sol a laissé un vide exerçant sur les roches un appel irrésistible. Le glissement résultant a mis en mouvement de proche en proche un volume plus ou moins grand et la surface du terrain a subi un affaissement correspondant.
La forme de ces sortes d’accidents peut varier indéfiniment, suivant les circonstances déterminantes. Parfois le résultat présente des caractères d’extrême gravité. C’est, en particulier, ce qui s’est produit à Brux, en Bohême, dans la nuit du 20 au 21 juillet 1895, où le mouvement du sol amena la destruction totale de 31 maisons, des dégâts plus ou moins graves dans 60 autres constructions et la misère de 2 000 habitants privés de tout abri. Il s’était produit dans les galeries des mines de lignite ouvertes dans le sous-sol de la ville, un glissement du sable constituant une couche de 3 à 10 mètres d’épaisseur sur 450 mètres d’étendue horizontale et représentant 50 000 mètres cubes. Il en résulta un affaissement du sol où s’ouvrirent des crevasses comme sous l’effet d’un vrai tremblement de terre.
Les cas ne manquent pas où des dispositions naturelles n’ayant rien à voir avec celles qui engendrent les vrais séismes, donnent lieu à des déplacements plus ou moins brusques de la surface du sol. L’un des plus simples se trouve réalisé dans un certain nombre de régions essentiellement calcaires, et, par exemple, dans une partie du Jura avoisinant Lons-le-Saunier, qui a été spécialement étudiée par Fournet.
Il arrive que les eaux d’infiltration dissolvent en profondeur des masses rocheuses de diverses catégories, comme le gypse, le sel gemme, etc. Parfois les vides ainsi produits tendent à se combler par des tassements qui peuvent produire à la surface des effets plus ou moins comparables à ceux des tremblements de terre (fig. 4). Par exemple, on ressentit en 1855, pendant plus d’un mois, des mouvements du sol dans la vallée de Viège, en Valais : des fentes s’ouvrirent dans les rochers et il se produisit des éboulements dont plusieurs écrasèrent des habitations. L’existence de grandes cavités souterraines est rendue incontestable par la présence, dans la région, de plus de vingt sources tellement chargées de sulfate de chaux qu’on évalue à l’énorme quantité de 4 000 mètres cubes de gypse qu’elles rejettent sur le sol au cours de chaque année. Sans doute beaucoup d’autres tremblements de terre de pays semblablement constitués doivent se rattacher à cet énorme travail d’érosion chimique.
On constate dans les Alpes des points où l’anhydrite s’est transformée en gypse par son hydratation. Or, celle-ci ne peut s’accomplir sans provoquer dans la masse intéressée une énorme augmentation de volume et cette augmentation a nécessairement des contrecoups dans les régions voisines.
Cliché Aug. Robin.
Dans le gypse des environs de Paris, à Thorigny, on voit de larges entonnoirs d’effondrement tout à fait caractéristiques. À Livry-Sévigné, il y a également de toutes parts des affaissements qui ont amené la ruine d’ateliers et d’usines.
On aura une idée de l’intensité des soustractions souterraines par le volume de roches fontigéniques accumulées à la surface. À Kapouran (Java) toute la chaux est fabriquée par la cuisson du tuf apporté par les sources.
La circulation des eaux a très fréquemment des conséquences comparables à celles des travaux industriels. Des érosions superficielles parvenues à de certaines dimensions par la soustraction de matériaux condensés ailleurs sous forme de tuf ou d’alluvion, donne lieu plus ou moins brusquement, sous la pesanteur des masses voisines convenablement disposées, à des accidents parfois graves, et spécialement à des glissements, souvent lents mais irrésistibles, dont il est utile de rappeler quelques exemples.
Le 2 septembre 1806, la montagne de Rossberg, qui domine le village de Goldau, entre les lacs pittoresques de Zug, d’Egeri et de Lowetz, et à proximité du Righi, fut le théâtre d’un glissement dont Alexandre Dumas a fait le récit très exact dans ses Impressions de voyage en Suisse. Un gigantesque massif rocheux, de 4 kilomètres de longueur sur 320 mètres de largeur et 32 mètres d’épaisseur, descendit selon le plongement des couches et, en conséquence du délayage déterminé par les pluies d’assises argileuses sous-jacentes à des bancs de poudingues (Nagelfluhe). L’énergie du frottement fut telle que l’eau imprégnant le sol fut volatilisée et qu’il y eut des explosions très bruyantes. On dit que des oiseaux furent tués en l’air. Tout le village fut enseveli avec les habitants. En 1874, on découvrit encore un squelette.
De semblables accidents se sont renouvelés à beaucoup de reprises. Le 26 novembre 1875, le Piton des Neiges et le Gros-Morne, dans le cirque de Salazie, à la Réunion, écrasèrent, par le même mécanisme, le village de Grand-Sable et ses habitants, sous un éboulement de 5 kilomètres de longueur tombant d’une altitude de 3 000 mètres.
À Glaris (Suisse), le Plattenberg a provoqué à plusieurs reprises des catastrophes pareilles.
Le 21 février 1896, le sol où est ouverte, dans le Gard, la mine de houille de la Grand-Combe, se mit à glisser en masse, mais avec une lenteur qui contraste avec l’allure des phénomènes précédents. On entendit des bruits souterrains. Le « puits du Gouffre » fut le premier détruit. Des rochers énormes se détachèrent de la montagne et roulèrent dans la plaine, broyant tout sur leur passage. L’affaissement du sol a été de plus de 40 mètres, et, à mesure que le « Gouffre » descendait, le lit du Gard s’élevait jusqu’à 2m, 50.
Les coups de grisou, dans les mines de houille, déterminent parfois à la surface du sol des éboulements dont les effets sont très comparables à ceux des séismes. Aussi a-t-on pensé qu’on pourrait appliquer à leur étude et surtout à leur prévision les méthodes en usage parmi les séismologues. C’est ce qu’avait pensé Beguyer de Chancourtois « Le perfectionnement des observations sismologiques, dit-il, et l’extrême sûreté des procédés que M. d’Abbadie, promoteur de ces études, et M. Bouquet de la Grye emploient pour constater les petits mouvements de l’écorce terrestre, m’ont fait entrevoir la possibilité de tirer de ce genre d’observations un moyen pratique de prévoir, dans une certaine mesure, les dégagements de grisou. Je pense que des appareils séismographiques installés à portée des exploitations houillères, annonçant les recrudescences d’activité dans ces mouvements intérieurs des terrains, pourraient fournir des avertissements d’après lesquels on redoublerait de surveillance et de précautions. »
À Dunkerque, Yvon Villarceau a reconnu que le sol tremble à 1 kil. 1/2 du rivage, sous le choc des vagues, les jours de tempête.
Le capitaine Denmann a constaté que les vibrations produites par le passage d’un train de marchandises étaient perçues, par des séismographes placés à 400 mètres de distance horizontale. De même, le professeur Paul, cherchant pour l’observatoire de Washington, qu’il s’agissait alors de construire, un emplacement qui fût à l’abri des trépidations locales, s’aperçut qu’en observant l’image d’une étoile dans un bain de mercure, on pouvait reconnaître à 1 600 mètres l’arrivée d’un train de chemin de fer, avant d’en entendre le bruit. L’ancien directeur de l’observatoire de Greenwich, près de Londres, le célèbre astronome Airy, avait reconnu que la présence dans le parc de l’établissement du public venu en foule les soirs fériés, empêchait, par les secousses imprimées au sol, toute observation d’étoile.
C’est de faits de ce genre que Chancourtois concluait très judicieusement que l’étude, rationnellement faite, des trépidations artificielles du sol pourrait aider à la découverte des lois qui régissent la propagation des mouvements séismiques proprement dits. On verra que ces recherches ont été faites depuis.
On peut, dans une série différente, noter en passant la surcharge artificielle de terrains fluents. Dans ce genre, un accident survenu, lors de la construction du viaduc du Val-Fleury, à Meudon, pendant la construction du chemin de fer de Versailles (rive gauche), mérite une mention.
Par une inadvertance difficile à comprendre, on établit la lourde masse du pont sur la nappe d’argile plastique si connue, exploitée dans cette région méridionale des environs de Paris. Par l’effet du poids colossal ainsi appliqué en un point circonscrit, l’argile s’est lentement écoulée dans les directions centrifuges et à une certaine distance du centre de compression, elle s’est soulevée en un bourrelet plus ou moins irrégulier. Celui-ci atteignit bientôt un relief assez considérable pour renverser les constructions qu’il portait.
Si des ruines recouvrirent le sol, les caractères principaux du séisme manquèrent cependant.
SOMMAIRE.– Un exemple de grand tremblement de terre : Messine 1908. – Les indications du séismographe et du maréographe. – La destruction et l’écrasement. – La terreur chez l’homme et chez les animaux, d’après Sénèque, Humboldt, le docteur Fazio.
Les pseudoséismes étant écartés par nos observations précédentes, nous devons nous préoccuper de résumer les caractères des véritables tremblements de terre. Ici nous n’avons qu’à faire appel à nos plus récents souvenirs pour nous trouver en présence de toutes les circonstances dont le récit nous a angoissés, lors des catastrophes de Messine (28 décembre 1908), et peu avant de San-Francisco (18 avril 1906), du Japon (27 octobre 1891), de Charleston (31 août 1886).
Pour nous en tenir aux faits les plus généraux et afin de préparer l’analyse des diverses particularités séismiques, constatons tout d’abord que le tremblement de terre se déclare toujours sans aucun signe précurseur. On a parfois noté l’état tragique du temps : la tempête, le cyclone même, ou bien un calme analogue à celui qui précède l’orage. Mais il y a indépendance absolue du phénomène souterrain et de la météorologie, puisque celle-ci s’est tout aussi souvent montrée clémente et même charmante : le tremblement de terre de 1887, auquel nous avons personnellement assisté à Nice, s’est déchaîné par un temps idéal : ciel bleu, mer calme, campagne parfumée de fleurs.
Ce qui caractérise avant tout le tremblement de terre, c’est sa soudaineté : il naît presque en même temps que le bruit formidable ; c’est la courte durée de ses chocs ; c’est la dimension incomparable des désastres dont il est la cause.
Rappelons donc que le 28 décembre 1908, à 5 h. 21’ 15’’ du matin, alors que la grande majorité de la population dormait encore, le sol se mit à trembler à Messine, à Reggio et dans leurs environs. Ce fut, au début, un frémissement peu sensible qui augmenta pendant 10 secondes, puis diminua un temps égal, pour cesser tout à fait. Après un repos de deux minutes et sans transition, c’est la fin du monde qui arrive : secousses violentes, fracas formidable d’écroulement, clameurs désespérées et ténèbres profondes, – stupeur dirait-on de la nature elle-même. La ruine est consommée ; la cité, tout à l’heure splendide et florissante, est détruite et sa population écrasée.
Le séismographe de l’Observatoire de Messine, retrouvé sous les décombres donna l’heure, le nombre et l’intensité des secousses. Sa relation fut complétée par celle du marégraphe qui nous a renseignés sur les mouvements de la mer. D’après cet instrument enregistreur, l’amplitude des oscillations marines n’aurait pas dépassé 22 centimètres. Cependant il y a bien eu un raz de marée. Le phénomène marin a commencé par un retrait du flot qui s’est précipité ensuite avec violence sur le rivage. Le ferry-boat faisant le service entre Messine et Reggio toucha le fond, puis fut lancé avec force sur le ponton d’embarquement qui fut pulvérisé avec lui.
Sur le quai de Messine, le marché au poisson, qui était à 2 mètres au-dessus de la mer, est resté submergé, sans doute parce qu’une partie du rivage, formée de terrain récent, a glissé sur la pente des couches sous-jacentes.
Le caractère le plus évident du séisme est donc la quasi-instantanéité de la ruine qu’il a déterminée. Mais on sait que la secousse meurtrière n’est pas nécessairement isolée. À Messine, des oscillations de toutes les intensités se sont succédé à des intervalles essentiellement irréguliers durant plusieurs mois. Nombre de ces secousses ont été presque aussi violentes que la première, et si elles ont causé peu de dégâts et fait peu de victimes, c’est simplement parce qu’il ne restait plus que peu de mal à faire.
L’étude des lieux ébranlés conduit à des constatations du plus haut intérêt, puisqu’elle montre une sorte de symétrie : autour de la région sinistrée et qui, seule d’abord, a fixé l’attention, on rencontre des zones grossièrement concentriques établissant par des degrés successifs le passage aux pays qui n’ont point souffert. Ces zones, plus ou moins nombreuses, suivant les cas et limitées les unes aux autres d’une manière plus ou moins arbitraire, montrent des ruines de moins en moins graves et, en s’éloignant toujours du point le plus éprouvé, des localités où la population en fut quitte pour la peur, c’est-à-dire éprouva la sensation séismique, inoubliable et incomparable par la détresse où elle jette l’âme, privée tout à coup du support sur lequel, d’instinct, elle est habituée à compter.
La signification de ces zones transitoires entre les localités les plus ravagées et les régions indemnes se précise, quand on constate qu’elles n’ont point été secouées exactement en même temps, tandis que, si l’on dessine sur la carte les lignes d’égal dommage ou les lignes d’agitation simultanée, on fait deux fois le même dessin ; d’où il ressort une importance spéciale pour le point le plus éprouvé et le premier atteint. Ce point-là était certainement le plus rapproché du foyer inconnu où a pris naissance l’énergie séismique : c’est son épicentre et la forme sphérique des ondes mécaniques qui en sont émanées, en même temps que la loi d’atténuation en raison inverse du carré de la distance, expliquent tous ses caractères, comparés à ceux des régions voisines.
La terreur produite par le tremblement de terre est sans analogue et elle a inspiré souvent les poètes et les écrivains :
« Il n’y a point, dit Sénèque de calamité à laquelle on ne puisse se dérober ; jamais la foudre n’a consumé des peuples entiers ; la peste dépeuple les villes, mais ne les détruit pas : le fléau dont nous parlons est le plus étendu, le plus inévitable, le plus infatigable, le plus général de tous les fléaux. Ce n’est point à des maisons, à des villes qu’il s’attaque : ce sont des nations, des régions entières qu’il détruit ; tantôt il les couvre de leurs débris, tantôt il les ensevelit dans des abîmes profonds, sans la moindre trace qui fasse juger de ce qui n’est plus, de ce qui a du moins existé ; le sol étendu sur les villes les plus puissantes, fait disparaître jusqu’aux moindres vestiges de leur état précédent ».
Et Humboldt :
« Dès notre enfance, nous étions habitués au contraste de la mobilité de l’eau avec l’immobilité de la terre. Tous les témoignages de nos sens avaient fortifié cette sécurité. Le sol vient-il à trembler, ce moment suffit à détruire l’expérience de toute la vie. C’est une puissance inconnue qui se révèle tout à coup ; le calme de la nature n’était qu’une illusion et nous nous sentons rejetés violemment dans un chaos de forces destructives. Alors chaque bruit, chaque souffle d’air excite notre attention : on se défie surtout du sol sur lequel on marche. »
De telles impressions ont été jusqu’à amener la perte de la raison. Le Dr Eugène Fazio qui, à propos de la catastrophe de Casamiccioala (28 juillet 1883), a étudié les effets physico-pathologiques du tremblement de terre sur l’homme, note que, dans la matinée du 29, la douleur des survivants ne se manifestait ni par des sanglots, ni par des larmes…, ils étaient hébétés et apathiques. La stupéfaction atténuait tout sentiment : interrogés, ils ne donnaient que des réponses vagues et qui souvent ne correspondaient pas à la question ; la mémoire était oblitérée, et c’est avec peine qu’ils pouvaient réunir leurs pensées. Il y eut de véritables cas de folie, mais ce qui dominait, c’était l’état d’hyperesthésie générale…
L’épouvante frappe même les animaux. Les ânes, les chevaux, animaux habitués à être conduits par l’homme, lorsqu’ils peuvent briser leurs licous, viennent se réfugier auprès de lui. Les chiens hurlent, les porcs poussent des cris déchirants. « Les crocodiles de l’Orénoque, d’ordinaire aussi muets que nos petits lézards, fuient le lit ébranlé du fleuve et courent en rugissant vers la forêt »
SOMMAIRE.– Premiers appareils employés pour étudier les tremblements de terre. – Séismographe à mercure. – Séismographe à pendule. – Pendule de Milne. – Séismogrammes. – Troponomètres. – Microséismographes. – Troposéismomètre et orthoséismomètre. – Tremblements de terre à grande distance notés par les appareils. – Études expérimentales des oscillations de la verticale. – Les marées de la croûte terrestre. – Statistique des séismes.
Chacun des détails dont l’ensemble compose le phénomène séismique mérite d’être décrit à part ; il comprend des variétés dont la mention est du plus vif intérêt pour parvenir à la conclusion finale.
Nous allons les passer en revue, sans nous attacher à y établir une classification rationnelle : la plus pratiquement commode sera évidemment la meilleure.
On conçoit d’ailleurs que les documents ne peuvent être recueillis d’une manière sérieuse et profitable que par l’application de bonnes méthodes d’observation. Mais l’observation de phénomènes aussi effrayants est assez malaisée, et il faut s’attendre à voir de grosses erreurs dans l’appréciation des durées et des intensités. D’après Milne le plus ancien de ces instruments fut inventé en Chine cent trente-six ans avant notre ère, par Chôko. Comme on le voit dans la figure 5, il consiste en un vaisseau sphéroïdal en cuivre de 8 pieds de diamètre. Sur son pourtour se présentent huit têtes de dragons fabuleux, dont chacune tient en sa gueule une petite bille. Si une secousse se produit, la bille située dans la direction de l’ébranlement vient se loger dans la bouche de la grenouille accroupie au-dessous du dragon, qui la rejette et fournit orienté un témoignage du phénomène.
D’après John Milne.
Séismographes. – Dans les temps modernes on a inventé les séismographes et les séismomètres vraiment scientifiques.
Grâce à eux, plusieurs physiciens ont constaté dès le XVIIe siècle, et surtout au XVIIIe, des mouvements très petits et d’origine inconnue, réalisés par des pendules de longueurs considérables. Ainsi, en 1753, le baron de Graute qui, dans une grotte des environs de Louviers en Normandie, y observait un pendule de onze pieds de longueur, remarqua un mouvement continuel de forme elliptique et l’attribua à l’existence dans le sol de mouvements trop faibles pour être perçus par les moyens ordinaires.
Le Gentil, astronome français, qui faisait en 1767 des observations à Manille, renouvela les remarques de de Graute. Et l’on constata que le grand tremblement de terre, si célèbre, qui agita la Calabre en 1783, influença des pendules placés à Naples (d’après Salsano) et même à Milan (d’après l’astronome Oriani).
Il est curieux de constater qu’en 1813 et 1814, un astronome milanais, Angelo Cesaris attribua les petits mouvements du fil à plomb d’un quadrant mural, non pas à une action séismique, mais aux multiples influences éprouvées par les murailles de l’édifice où il travaillait, de la part des agents atmosphériques variations thermométriques, hygrométriques et autres).
Deux fois en sa vie, en 1805 et en 1832, le géodésiste Delcros observa, d’abord dans les Vosges et ensuite à Narbonne, de forts mouvements oscillatoires sur la bulle d’air de son niveau, sans qu’il eût senti d’ailleurs la moindre secousse dans le sol.
Vers 1837, d’Abbadie a multiplié au Brésil, en Abyssinie et en France des observations qu’il publia plus tard sur les déplacements de la bulle des niveaux. Plantamour a repris ensuite le même sujet avec des résultats identiques : il a même cru trouver une périodicité dans ces microscopiques déplacements du sol.
Voici les principes d’après lesquels ont été construits les principaux appareils destinés à l’étude rationnelle des déplacements du sol.
Le séismographe à mercure est fondé sur l’inertie qui cause le retard du niveau du mercure dans un baromètre qu’on élève et qu’on abaisse brusquement. Des index permettent de suivre le mouvement apparent du liquide, et si le tube est convenablement infléchi, on peut avoir des indications pour divers plans orientés de façon quelconque.
Parmi les formes les plus simples, on peut mentionner l’emploi d’un baromètre à siphon construit de façon que le mercure vienne exactement araser la petite branche du tube. Dans ces conditions, l’amplitude des trépidations a pour mesure le poids du mercure qui s’est extravasé de cette petite branche et qu’on a recueilli dans un récipient convenablement disposé.
Mais les formes les plus courantes de séismographes sont fondées sur l’inertie mise en œuvre par l’emploi de pendules. Si un pendule est composé d’un poids considérable suspendu à un fil fin (fig. 6), on comprend facilement que les impulsions imprimées à son point de suspension ne se transmettent pas aisément à sa masse. Celle-ci pourra être considérée comme sensiblement immobile au milieu des objets voisins qui seront agités. Aussi il suffira de lui ajouter une pointe traçante sous laquelle se déplacera, par l’action d’un mouvement d’horlogerie une bande de papier propre à recevoir le trait, pour que la trajectoire d’un point de la surface du sol soit exactement dessinée. On obtient ainsi un séismogramme dont la figure 7 donne un exemple qui doit d’ailleurs être ramené, par un calcul très simple, à la dimension réelle du déplacement dont il est la représentation.
Cette courbe, il est vrai, ne représente pas la loi du mouvement du sol : il eût fallu, pour qu’il en fût ainsi, que le style fût demeuré immobile dans l’espace. Il n’en est rien, car l’axe de suspension du pendule remuant avec le sol, il est clair que le pendule ne tarde pas à osciller. La courbe recueillie représente donc un mouvement relatif résultant de la superposition du mouvement du sol et du mouvement acquis par le pendule.
Par des artifices ingénieux, on a pu construire aussi des pendules horizontaux (fig. 8), doués de la même faculté d’enregistrement. On en emploie simultanément plusieurs, dirigés en différents plans, et l’on obtient alors le déplacement dans l’espace du point considéré de la surface du sol.
Le professeur Sekiya, de Tokio, a représenté la trajectoire dont il s’agit par un fil de cuivre convenablement tordu, et il a mis le résultat de ce travail sous les yeux des visiteurs de notre Exposition Universelle, en 1878.
On a perfectionné de maintes façons la construction des séismographes. Ainsi, on les fait opérer photographiquement, en y réfléchissant à l’aide d’un miroir un rayon de lumière qui va tomber sur un papier sensible se déroulant d’une façon continue et automatique.
Mouvements microséismiques. – On verra dans une autre partie du présent ouvrage que l’étude des volcans a bénéficié de l’emploi, proposé d’abord par de Rossi, du microphone à l’examen des bruits souterrains. Une application du même genre a été faite à la séismologie. Dans les régions fréquemment agitées, on a installé des instruments très délicats, connus sous les noms de troponomètres et de micro-séismographes, qui déjà ont rendu d’importants services.