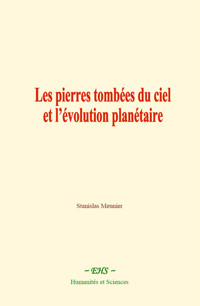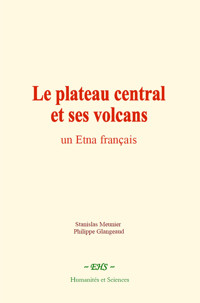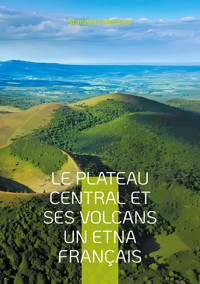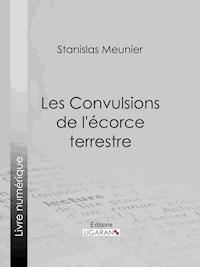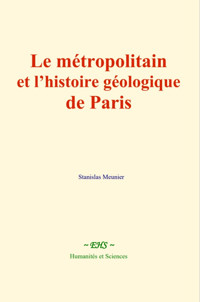
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
La région que recouvre le « pavé de Paris » a été soumise dès l’origine de la cité, de la part de ses habitants, à des remaniements incessants, et certaines portions en ont été artificiellement supprimées d’une façon complète. Telles sont les assises désignées sous le nom de marnes de Saint-Ouen qui ont été enlevées à la surface de la plaine Monceau, afin de mettre à peu près au même niveau toutes les voies du quartier. La même soustraction s’opéra aux dépens d’une partie de la montagne Sainte-Geneviève lorsque furent percés le boulevard Saint-Michel et la rue Monge et aux dépens de la Butte des Moulins, quand on ouvrit l’avenue de l’Opéra. Dans ces différents cas, la science eut à faire des découvertes intéressantes…
Pourtant, c’étaient là des travaux très locaux. Le tracé du Métropolitain y vient ajouter un ensemble très vaste. On ne s’étonnera pas, d’après ce qui précède, que des notions bien plus importantes en soient immédiatement résultées.
Dans toutes les formations géologiques intéressées, des échantillons ont été prélevés avec le plus grand soin et déposés dans les collections du Jardin des Plantes où elles sont tenues à la disposition des naturalistes qui désirent les étudier. M. Auguste Dollot, correspondant du Muséum, à qui sont dues la plupart de ces récoltes précieuses, leur a donné une valeur plus grande en en présentant les particularités principales sous la forme de grandes coupes qui nous donnent maintenant d’un seul coup d’œil une représentation scrupuleusement exacte de la structure souterraine de Paris. Grâce à ces belles recherches, nos descendants auront un témoignage palpable et un souvenir permanent de toute une région destinée à disparaître totalement, puisqu’elle doit sans aucun doute être remplacée en tous ses points par des substructions artificielles.
La situation géographique de Paris est telle que les travaux du Métropolitain conduisent, malgré leur profondeur relativement si faible, à des considérations d’un intérêt général...
À PROPOS DE L'AUTEUR
Stanislas Étienne Meunier, né le 18 juillet 1843 à Paris, mort le 23 avril 1925 à Paris1, est un géologue, minéralogiste et journaliste scientifique français.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le métropolitain et l’histoire géologique de Paris.
Les travaux du métropolitain et l’histoire géologique de Paris
La science et l’industrie ont une origine commune : l’homme utilisa immédiatement sa première connaissance des choses pour la satisfaction de ses besoins matériels et, par un instinct tout aussi irrésistible que la nécessité de se nourrir, chercha à s’en fournir à lui-même une explication.
A peine distincts l’un de l’autre à leurs débuts, ces deux rameaux industriel et scientifique de l’activité humaine sont destinés fatalement à réagir mutuellement l’un sur l’autre. L’industrie demande à la science un guide sûr dont l’intervention se traduit invariablement par une augmentation de bénéfices et, réciproquement, la science reçoit de l’industrie des matériaux de travail et jusqu’à des sujets de recherches qui contribuent efficacement à l’extension de ses progrès.
Il n’y a guère d’industrie chimique qui n’ait procuré, dans ses résidus, des matières imprévues dont les laboratoires ont tiré parti pour le développement de la science pure. L’iode, le brome, ont été retirés des déchets des salines et des salpêtrières ; une série de métaux rares se sont trouvés inopinément concentrés dans les produits latéraux de l’extraction du platine, du plomb et d’une foule d’autres corps.
En retour, la chimie de laboratoire met à la disposition du praticien des notions convertibles en procédés nouveaux : l’industrie de la soude, comme celle de l’aluminium, comme celle des becs à incandescence, et mille autres ne sont que des prolongements de la science.
Dans les industries fondées sur les propriétés physiques des corps, on sait avec quelle fréquence des incidents d’atelier mettent le théoricien sur la voie des découvertes les plus hautes. La liste serait bien longue des observations fortuites faites chez les constructeurs et qui sont devenues l’origine de découvertes nouvelles, soit en électricité, soit en optique, soit en toute autre branche de la physique. Et il est presque oiseux de rappeler qu’à l’inverse, des résultats de laboratoire qui semblaient devoir à tout jamais rester renfermés dans les limites de la science abstraite, se sont transformés en résultats industriels, depuis le noircissement à la lumière du chlorure d’argent constaté par Charles, jusqu’au déplacement, observé par Œrstedt, de la boussole par le courant électrique et la phosphorescence déterminée au travers de corps opaques par M. Rœntgen, au moyen des rayons cathodiques : de là nous sont venues la photographie, la télégraphie, la radioscopie.
En histoire naturelle, on peut affirmer que la géologie est née des travaux empiriques des premiers mineurs et que, réciproquement, tous les grands progrès si immédiatement tangibles, de l’exploitation minérale, ont été procurés par les découvertes de la géologie pure.
On doit même, à ce sujet, remarquer qu’il s’est fait progressivement comme une manière de renversement dans l’importance relative de la science et de l’industrie, en ce qui concerne leurs rapports mutuels depuis l’origine des choses. Au début, tous les initiateurs de la géologie sont des mineurs : Werner, Agricola, et tant d’autres, cherchent à codifier, à exprimer en corps de doctrine et à résumer sous forme de lois, les faits que l’exploitation a mis accidentellement sous leurs yeux ; les premiers traités de géologie sont des manuels de praticiens. Aujourd’hui, on peut dire que les directeurs des grandes entreprises minérales sont avant tout des géologues.
Qu’il s’agisse d’ouvrir une mine de houille, ou de creuser un tunnel au travers d’une montagne ou de forer un puits artésien, c’est au géologue que l’industriel commence par s’adresser et, s’il est avisé, il relire de sa consultation des résultats immédiats : les exemples des houillères découvertes dans le Boulonnais par Désandrouin, du percement du Saint-Gothard par Stappf, du forage du puits de Grenelle par Mulot, sont restés célèbres dans ce genre.
Je sais bien qu’il peut, ici comme partout, y avoir des mécomptes tels que ceux qui se sont produits dans le tunnel de Meudon près de Paris et dans l’immense percée du Simplon : on peut rencontrer, au cours des travaux les mieux préparés, des circonstances imprévues. C’est que nous ne sommes qu’au début de nos études, et que des quantités de traits de la structure du globe nous ont jusqu’ici échappé. En outre, les lois naturelles sont infiniment compliquées et la disposition instinctive qui nous porte à les simplifier, pour leur donner une forme quasi géométrique, est une cause fréquente d’erreurs. Et c’est pour cela que, malgré ces insuccès d’ailleurs exceptionnels, la géologie continuera de guider l’industrie dans les grands travaux dont le sol est le théâtre, et que, de leur côté, ces travaux continueront à augmenter le nombre des notions scientifiques acquises.
Or, voilà précisément le double résultat qui vient d’être réalisé au cours de la construction du chemin de fer métropolitain, cette dernière transformation, et la plus remarquable, depuis longtemps, de la Ville de Paris.
La région que recouvre le « pavé de Paris » a été soumise dès l’origine de la cité, de la part de ses habitants, à des remaniements incessants, et certaines portions en ont été artificiellement supprimées d’une façon complète. Telles sont les assises désignées sous le nom de marnes de Saint-Ouen qui ont été enlevées à la surface de la plaine Monceau, afin de mettre à peu près au même niveau toutes les voies du quartier. La même soustraction s’opéra aux dépens d’une partie de la montagne Sainte-Geneviève lorsque furent percés le boulevard Saint-Michel et la rue Monge et aux dépens de la Butte des Moulins, quand on ouvrit l’avenue de l’Opéra. Dans-ces différents cas, la science eut à faire des découvertes intéressantes. On peut voir au Muséum les restes d’un animal fossile, le Pernatherium, trouvé justement dans les couches dont l’ablation précéda la construction de l’église Saint-Augustin.
Pourtant, c’étaient là des travaux très locaux. Le tracé du Métropolitain y vient ajouter un ensemble très vaste. On ne s’étonnera pas, d’après ce qui précède, que des notions bien plus importantes en soient immédiatement résultées.
Dans toutes les formations géologiques intéressées, des échantillons ont été prélevés avec le plus grand soin et déposés dans les collections du Jardin des Plantes où elles sont tenues à la disposition des naturalistes qui désirent les étudier. M. Auguste Dollot, correspondant du Muséum, à qui sont dues la plupart de ces récoltes précieuses, leur a donné une valeur plus grande en en présentant les particularités principales sous la forme de grandes coupes qui nous donnent maintenant d’un seul coup d’œil une représentation scrupuleusement exacte de la structure souterraine de Paris. Grâce à ces belles recherches, nos descendants auront un témoignage palpable et un souvenir permanent de toute une région destinée à disparaître totalement, puisqu’elle doit sans aucun doute être remplacée en tous ses points par des substructions artificielles.
La situation géographique de Paris est telle que les travaux du Métropolitain conduisent, malgré leur profondeur relativement si faible, à des considérations d’un intérêt général.
Remarquons avant tout, en nous reportant par la pensée à l’époque où la grande ville a commencé à se développer et à prendre de l’importance, qu’il était décisif pour elle de posséder, dans son propre sous-sol, tous les matériaux indispensables à la construction et à l’embellissement d’une cité.
A cet égard, les choses sont naturellement arrangées dans notre région d’une manière si profitable qu’on pourrait les croire agencées à plaisir. A côté l’une de l’autre, et dans des situations facilement accessibles, se trouvent de volumineuses accumulations d’une argile propre à faire les tuiles et les briques, les tuyaux de conduite et les tuyaux de cheminées ; de pierre à bâtir de toutes les variétés fournissant, suivant les cas, des moellons ou des pierres de taille, avec toutes les qualités diverses que les entrepreneurs les plus exigeants peuvent désirer ; de sables souvent purs comme du cristal de roche en poussière, parfois chargé de fer ou d’argile, ou d’autres substances, en tous cas tout à fait convenables pour la préparation des mortiers ; de pierres meulières aussi légères que résistantes, procurant des constructions d’une solidité à toute épreuve, comme en témoignerait au besoin le mur des fortifications ; enfin de pierre à plâtre qui constitue la merveille dans la série et qui contient le secret même de l’ancienne réputation de Paris.
Avec le plâtre en effet, Paris a toujours disposé, non-seulement d’une matière conjonctive d’un emploi commode et d’une solidité parfaite, mais encore d’un revêtement qui fait disparaître toutes les irrégularités des matériaux mis en œuvre et permet d’embellir économiquement les constructions. Le plâtre de Paris est si universellement estimé qu’on l’exporte jusqu’aux États-Unis.
Avant le perfectionnement des moyens de transport qui permettent de charrier sur tout le territoire des matériaux provenant de Lorraine ou de Bourgogne, des environs de Caen ou des environs de Grenoble, on se figure ce que devait être une ville comme Paris, disposant de tous les éléments architectoniques, en face de localités comme Londres, qui devait se contenter des briques fabriquées avec ses argiles, ou comme Clermont-Ferrand, bâti de blocs de lave, impossibles à tailler, difficiles à réunir, ou comme Brest, fait de granit rebelle. On s’imagine comment l’attrait des constructions de la capitale, alors si correctes par comparaison, devait s’ajouter à ses autres causes de succès.
Et c’est dans le même ordre d’idées, qui nous ramène d’ailleurs aux points de vue mêmes d’où nous sommes partis, qu’il faut ajouter que si Paris a reçu de la géologie de son sol des avantages si grands qu’une portion de sa prospérité peut légitimement lui être rapportée, — Paris, en échange, a été le berceau, et toujours à cause de son sol, d’un très grand nombre de progrès purement scientifiques.
C’est à Paris, par exemple, que Guettard, le propre maître de l’immortel Lavoisier, a réalisé le premier cette idée si riche en applications, de représenter sur la carte géographique la constitution du sol en chaque point. Dès sa première tentative, il a ainsi mis en évidence que Paris réside en un véritable centre géologique, en un point autour duquel les éléments terrestres sont nettement coordonnés, et tellement que, bien plus tard, Élie de Beaumont et Dufrenoy seront autorisés à faire de la capitale l’un des « pôles géologiques » de la France entière.
C’est à Paris, et en raison même des caractères des terrains qui le supportent, que Cuvier a fondé la paléontologie : nos lecteurs savent l’histoire des carrières de Montmartre. C’est encore à Paris que le collaborateur de Cuvier, Alexandre Brongniart, a trouvé la localisation, à des niveaux géologiques parfaitement déterminés, de corps fossiles spéciaux. A Paris également est née la paléontologie végétale, grâce aux travaux d’Adolphe Brongniart ; et c’est à Paris enfin que fut formulée, par Constant Prévost, la doctrine féconde entre toutes, dite des causes actuelles.
C’est plus qu’il n’en faut pour montrer que la région de Paris se signale à l’attention des curieux de la philosophie naturelle par des titres aussi sérieux que variés, et la remarque doit rendre tout spécialement dignes de considération les études dont sa constitution géologique peut être l’objet.
I.
Avant tout, les travaux du Métropolitain témoignent de l’activité extrême avec laquelle nos pères ont remanié le sol de Paris. Il n’y a guère de points de la surface qui ne soit complètement fouillé, creusé et remblayé et parfois sur une échelle considérable.
Tout l’ancien Paris est sorti des catacombes à l’état de moellons et de pierres de taille ; les parcs de Montsouris et des Buttes-Chaumont sont de vieilles carrières qu’on a eu la bonne idée de transformer en élégants jardins, au lieu de les combler pour y construire des maisons. Enfin les quartiers les plus corrects sont établis sur des points naguère bouleversés par les exploitations et où toute la surface du terrain a été artificiellement rapportée.
Grâce au Métropolitain, on peut admirer l’ampleur avec laquelle la pierre à plâtre a été extraite tout le long des boulevards extérieurs du Nord de Paris. Sur les boulevards Rochechouart, Barbes et de la Chapelle, jusqu’à la place de la Nation, le tracé de la voie ferrée a traversé les vestiges de carrières dont les dimensions sont parfois énormes. Par exemple, sous le boulevard de la Chapelle, c’est sur une longueur de plus de 300 mètres que les couches ont été entaillées le long d’escarpements de 12 mètres de hauteur, au travers de lits de gypse marneux intéressants par comparaison avec les variétés exploitées aujourd’hui. Au boulevard Barbes, les remblais sont également gigantesques, et on retrouve, au-dessous d’eux, le profil très bien conservé des escarpements abandonnés par les anciens ouvriers. Dans la rue de Meaux, non loin de l’hôpital Saint-Louis, on a recoupé, à une dizaine de mètres sous le pavé, des galeries d’exploitation soigneusement remblayées à une époque inconnue mais selon la méthode encore en usage. C’est le pendant exact des galeries retrouvées au Sud de Paris le long du boulevard Saint-Jacques, mais qui sont percées dans le calcaire grossier ou pierre à bâtir et se rattachent directement au réseau des catacombes.
A quelle époque remontent les débuts de ces ouvrages ? C’est ce qu’il n’est pas facile de préciser ; on sait seulement que beaucoup d’entre eux se sont continués jusqu’au XVIIIè siècle et même jusqu’au commencement du XIXè siècle.
A côté des vieux travaux d’exploitation minérale, les tracés du chemin de fer métropolitain ont rencontré des remblais destinés à faire disparaître des inégalités du terrain et à favoriser ainsi l’extension progressive de la cité.
Par exemple, place de la République, et dans les régions circonvoisines, on rencontre immédiatement sous le pavé, et avec plusieurs mètres d’épaisseur, les remblais dont furent comblés les fossés qui bordaient la ville au temps de Charles V, tout le long du boulevard Saint-Martin. L’ancienneté de ces travaux est, comme on voit, tout à fait relative et, au point de vue géologique, on serait porté à croire qu’elle ne compte pas. Cependant, elle suffit pour que des phénomènes chimiques aient réalisé la production d’effets variés et spécialement la genèse de minéraux bien imprévus.
Les eaux infiltrées dans la terre, chargée des impuretés résiduelles de la surface, sont venues agir, lentement mais sans relâche, sur la substance des remblais : ceux-ci étaient surtout composés de débris de vieux plâtras provenant des démolitions. On sait que le plâtre est du sulfate de chaux, c’est-à-dire une matière contenant du soufre. Sous l’influence des corps organiques en dissolution ou en suspension dans les suintements aqueux, vraisemblablement sous l’action de microbes multipliés dans ce milieu fétide, les plâtras se sont décomposés et ils ont donné naissance à des corps sulfurés très divers, reconnaissables à l’odeur de bain de Barèges qui s’en dégage. En même temps, et ceci est encore plus remarquable, ils ont mis en liberté une notable quantité de soufre parfaitement pur, qui a cristallisé de toutes parts et qui brillait comme du diamant aux lueurs des lampes des ouvriers.
Ces plâtras, dont l’accumulation s’étend sur une vaste surface et jusque dans la rue Meslay, sont si sulfurifères qu’ils rappellent les tufs de la solfatare de Pouzzoles.
La réaction d’où le soufre résulte et qui avait déjà été signalée par le créateur de la cristallographie, l’illustre abbé Haüy, sur cette même place du Château-d’eau, comme on l’appelait alors, explique la production, dans le sol de Paris, de filets d’eaux sulfureuses dont, malgré leur origine plutôt répugnante, vu le rôle qu’y jouent les eaux vannes et même les exsudations des fosses d’aisance, les propriétés thérapeutiques ont été offertes aux malades d’humeur sédentaire, comme équivalant dans leur efficacité (ce qui est d’ailleurs bien possible) à celles d’Enghien ou même à celles d’Aix en Savoie.