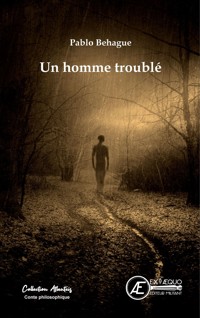Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ex Aequo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le jour où Paul prend la route pour Darlon, petit village isolé des Vosges du Nord, il ne s’attend pas à y retrouver Margot, une connaissance de lycée, et encore moins à être plongé dans une sombre histoire aux relents d’ésotérisme.
À l’origine, il venait pour travailler sur les archives médiévales de l’abbaye, mais Darlon cache une liste ancestrale de mystérieuses disparitions liées à un énigmatique symbole. Darlon, c’est aussi l’atmosphère oppressante d’une forêt qui possède ses secrets ; forêt que peuplent champignons vénéneux, digitales et belladones...Quant à cette odeur de sapin pourri, elle ne semble jamais complètement s’estomper, comme s’il existait quelque part une porte menant à l’enfer. Une aventure dont personne ne sortira indemne.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né en 1991, Pablo Behague vit dans les Vosges. Fasciné par la nature, il a été botaniste pendant longtemps avant de devenir professeur d’Histoire. Son univers fantastique est constitué d’une réalité trompeuse, enchantée et sombre, dans laquelle les détails troublants de l’existence sont autant de passages secrets vers l’angoisse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pablo Behague
Les disparus de Darlon
Roman
Pablo Behague
Les disparus de Darlon
Roman
ISBN : 979-10-388-0609-2
Collection Atlantéïs
ISSN : 2265-2728
Dépôt légal : mars 2023
© couverture Ex Æquo
© 2023 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays. Toute modification interdite.
Préface
Les vieux massifs montagneux ont tous leurs légendes, les Vosges ne font pas exception. Pablo Behague tire ses décors d’une vallée aussi étrange que chimérique, celle de la Sarre Noire et le vallon de la Dame en Blanc, voisine de La forêt muette ou la toile sombre de Si loin de Caïn, de Pierre Pelot. Les noirceurs du récit imposent ce parallèle.
La forêt était omniprésente depuis qu’il avait quitté Saint-Quirin…La civilisation n’avait pas le même poids ; elle paraissait dépassée, submergée, noyée dans la nature ténébreuse, perdue et vulnérable comme un petit animal blessé dans un environnement qui lui est profondément hostile. Dès le second paragraphe, le lecteur change d’univers pour l’obscurité des futaies de résineux. Les fragrances bucoliques s’altèrent en une puanteur prégnante, celle des aiguilles de sapins qui pourrissent… La profondeur abyssale d’un humus moisi et corrompu. Les villageois de Darlon portent toutes les peines d’un monde qui se recroqueville sous les frondaisons. Cette forêt maudite constitue une forme de cercueil dont on ne ressort pas, ou en tout cas, pas indemne.
C’est dans cette atmosphère asphyxiante, vénéneuse, que surviennent les disparitions maléfiques.
Sur la trame d’un amour naissant — car, sans bonheur… pas d’horreur — l’imaginaire puissant et l’écriture immersive de Pablo Behague tissent un récit en apparence simple, mais « diablement » efficace, élevant ce roman au rang d’incontournable de la collection Atlantéïs.
Soyez les bienvenus à Darlon !
Thierry Dufrenne.
Chapitre 1L’odeur des sapins et celle des capucines
Paul Roudier était sur le point de se ranger sur le bas-côté pour regarder la carte quand il vit enfin un panneau indiquant le nom du village qu’il cherchait : Darlon. Il s’engagea à gauche sur la route forestière et se mit à progresser à flanc de montagne, avant de replonger vers une vallée au tracé sinueux. La forêt était omniprésente depuis qu’il avait quitté Saint-Quirin, et il ne savait même plus dire à quand remontait le dernier bâtiment qu’il avait croisé. Il était habitué à ces paysages puisqu’il avait lui-même grandi dans les Vosges, à quelques vallées d’ici. Cependant, il devait admettre que le coin où il avait passé son enfance n’était pas aussi perdu que celui dans lequel il progressait désormais.
La différence n’était pas seulement liée à l’isolement du lieu. C’était étrange comme la forêt lui semblait oppressante ici, presque hostile, comme si elle lui en voulait d’être parti pendant si longtemps. Théoriquement, maintenant qu’il avait atteint la vallée de la Sarre Noire et qu’il longeait la rivière en direction de sa source, il devrait être en train de prendre de l’altitude, de monter… Alors pourquoi avait-il cet affreux sentiment de sombrer dans des profondeurs froides ? N’était-ce qu’une impression ou bien les arbres en bord de route avaient-ils réellement des formes de plus en plus étranges au fur et à mesure qu’il progressait le long du cours d’eau ?
Il chassa ces idées malsaines de ses pensées et, pour se convaincre qu’elles appartenaient bien à la sphère de l’émotion qu’il détestait tant, augmenta le son de l’autoradio. Malheureusement, même la chaîne d’information austère qu’il écoutait d’une oreille depuis qu’il avait quitté Metz ne passait plus ici. On était vraiment au bout du monde, mais peut-être cela lui ferait-il du bien de s’isoler un peu, finalement… Cela faisait trop longtemps qu’il vivait en ville, et retrouver enfin l’odeur des sapins ne pourrait que lui être bénéfique. Pour s’en persuader, Paul baissa son carreau et huma l’air tel un marin retrouvant la mer après une saison d’attente. L’odeur qui lui vint au nez l’incita cependant à remonter prestement la fenêtre. Étaient-ce encore une fois ses émotions qui lui jouaient des tours ? Le parfum de l’extérieur était bien celui des sapins… mais différent de celui dont il se souvenait. En fait, cela lui évoquait des aiguilles de conifères, certes, mais pourrissantes, comme si les arbres ici étaient malades et propageaient dans l’air une odeur fétide semblable à celle qui pourrait émaner de l’enfer…
Bon sang, mais pourquoi avait-il toutes ces métaphores grotesques en tête ? Il était vraiment temps qu’il s’arrête, et heureusement, un petit panneau sur le bord de la route venait de lui indiquer que Darlon n’était plus qu’à trois kilomètres. De plus, il apercevait enfin un bâtiment ; et quel bâtiment ! À gauche, en effet, de l’autre côté de la Sarre Noire par rapport à la route, se dressait à flanc de colline une immense demeure qu’il supposa être le manoir des Langlois, les descendants de la dynastie nobiliaire locale. Il était constitué d’une grande et large façade grise aux fenêtres nombreuses, cernée de deux tourelles s’élevant comme des crayons en direction des nuages. Les toits étaient en ardoise, mais certaines tuiles avaient été peintes et donnaient un côté baroque à l’architecture. Paul aimait beaucoup le style de la demeure, mais pour une raison qui lui échappait, l’endroit avait quelque chose de repoussant, comme ces forêts étranges dans lesquelles il roulait depuis maintenant près de dix minutes. Objectivement, c’était un édifice splendide, et le parc qui l’entourait ne faisait qu’ajouter encore à l’aspect féerique du lieu… Pourtant, Paul était sûr que si une fée veillait sur ce château et sur ce jardin, ce ne pouvait être que Carabosse. Qui d’autre laisserait un arbre à moitié mort se dresser au milieu de la pelouse, qui plus est un arbre dont la forme faisait penser à la silhouette d’une créature monstrueuse aux longs doigts crochus ?
Il détourna les yeux et se demanda une nouvelle fois pourquoi son imagination, d’habitude si maigre, se mettait à faire des siennes ainsi. Peut-être le retour dans les Vosges lui rappelait-il son enfance ; un temps où son esprit se laissait encore distraire par des histoires idiotes de fantômes et de croque-mitaines.
Le deuxième bâtiment qu’il perçut était celui qui l’intéressait le plus. Il était l’objet même de sa venue : l’abbaye d’Auvreyles. Elle se dressait au loin, au sommet d’un mont abrupt et boisé de l’autre côté de la rivière. L’édifice paraissait semblable à ce qu’il avait vu sur les photos, mais la distance qui l’en séparait l’empêchait de tout bien distinguer pour le moment. À droite, il devinait les arches en pierre du cloître. À gauche de celui-ci, c’était l’église abbatiale qui s’élevait, avec un toit en briques orange qui contrastait étonnamment avec le vert profond des conifères alentour. D’après ce qu’il en savait, le bâtiment était quasiment à l’abandon depuis trente ans ; seul un moine archiviste y vivait en permanence. Son état n’était pas déplorable pour autant et il avait hâte de s’y rendre. Pour cela, il faudrait néanmoins attendre le lendemain, car la lumière du jour commençait déjà à décliner sur la vallée.
Enfin, il sortit de la forêt et passa le panneau qui indiquait l’entrée de Darlon. Les arbres autour de lui avaient cédé la place à des prairies embroussaillées et humides, et le long du ruisseau, des reines-des-prés se disputaient la berge avec d’immenses chardons en fleur. Quelques vaches rustiques paissaient çà et là ; spectacle qu’il n’avait plus l’habitude de voir depuis qu’il vivait à Lille. Presque toutes s’arrêtèrent de brouter quand il passa à leur hauteur, comme si un véhicule ici était déjà en soi quelque chose de surprenant. Au-dessus de leurs têtes, une bande de corneilles tournait en poussant des cris plaintifs.
La première maison qu’il atteignit n’était probablement pas habitée au vu de son état délabré. Pourtant, quand il passa devant les fenêtres poussiéreuses, il lui sembla apercevoir du coin de l’œil une silhouette se mouvoir à l’intérieur. Peu à peu, les demeures se firent plus denses et finalement, il distingua devant lui la pancarte en bois qui indiquait sa chambre d’hôte. Elle se balançait dans le vent au-dessus d’une vieille porte donnant sur une maison en pierre. De l’autre côté de la route, juste à côté du petit parking en schiste où il se gara, une roue en bois de moulin ancestral tournait au gré du courant de la Sarre Noire. Il sortit du véhicule, s’étira le dos, et contempla quelques instants le soleil qui brillait sur l’eau, au milieu de petites fleurs blanches qui affleuraient à la surface.
Après s’être étiré, il traversa la route et toqua. Personne ne lui répondit. Lors de sa deuxième tentative, néanmoins, la porte de la maison voisine s’ouvrit et une vieille femme sortit dans la rue. Elle le dévisagea et s’avança vers lui d’un pas claudicant en s’essuyant les mains sur son tablier.
― C’est Anita que vous cherchez ?
― Oui, c’est bien cela. J’ai loué une chambre d’hôte chez elle et…
― L’est pas là. Partie boire sa goutte au Tilleul.
La vieille parlait sèchement et le regardait d’un air méfiant, les yeux plissés, tout en continuant d’avancer d’une démarche qui faisait penser à celle d’un zombie.
― Le… Le Tilleul, vous dites ?
― C’est le bar du coin. Là qu’on trouve tous les poivrots. Anita n’est pas de ceux-là, mais elle boit toujours sa goutte à 18 heures.
― Je vois. Merci, madame, je vais aller voir.
Il tenta d’esquisser un sourire, puis regagna sa voiture sans oser se retourner. Cette femme était pour le moins intimidante… Et pourquoi avait-elle des taches rouges sur les mains et le tablier ?
― Dieu vous bénisse, mon bon monsieur, entendit-il dans son dos.
Il ne répondit pas, monta dans sa voiture et repartit sous les yeux inquisiteurs de la vieille dame.
*
Le bar du Tilleul se situait sur la place du village, même si le mot n’avait pas ici la même signification qu’à Lille. Pour toute place, il n’y avait en fait qu’un minuscule espace pavé sur le bord de la route, avec une fontaine et trois bancs qui l’entouraient. Le bistrot était en pierre, comme tous les bâtiments du coin d’ailleurs, et une enseigne Meteor clignotait au-dessus de la porte, juste à côté d’un panneau rouge sur lequel était indiqué « le Tilleul ». Adossé au porche, un homme d’une trentaine d’années fumait d’un air désinvolte et des éclats de voix parvenaient de l’intérieur. Paul s’avança, salua d’un hochement de tête le fumeur, puis pénétra dans l’établissement.
L’endroit était chaleureux, très boisé, et baigné d’une lumière tamisée qui mettait en valeur l’étagère à bouteilles derrière le bar. Le comptoir était long, mais la plupart des clients y étaient accoudés dans le fond de la pièce, juste après l’angle qu’il formait, lançant des dés sur une table de jeu à tapis vert. Le patron — un gros bonhomme barbu — les regardait en essuyant des verres à bière d’un geste machinal.
― Bonjour, m’sieur. Qu’est-ce que je vous sers ? demanda-t-il finalement en s’apercevant de sa présence.
― Oh euh… À vrai dire je cherche juste quelqu’un, mais je ne serais pas contre un café quand même.
Il s’accouda au comptoir pendant que le barman s’emparait d’une tasse. Tandis que le liquide noir se mettait à couler sur la porcelaine en émettant un bruit doux, son regard se perdit sur l’étagère à bouteilles, et plus précisément sur un flacon vert qui contenait vraisemblablement un whisky pur malt d’une marque qu’il ne connaissait pas. Il était en train de se demander pourquoi il avait machinalement demandé un café alors qu’il avait plutôt besoin d’un remontant quand soudain, une odeur stoppa net ses pensées. C’était une odeur qu’il connaissait, car elle lui rappelait ses années de lycée et plus précisément une après-midi de mai durant laquelle il avait séché les cours. C’était l’odeur des fleurs de capucine et quand une main se posa sur son épaule, il n’eut pas besoin de réfléchir pour savoir qui se tiendrait derrière lui quand il se retournerait.
― Paul ? Paul Roudier ? Ah, mais je rêve !
Bien sûr, c’était elle. Margot se tenait devant lui et elle n’avait que peu changé. Certes, son visage avait un peu mûri, et ses cernes n’étaient pas là quand elle avait dix-sept ans. Mais ses grands yeux bleus, qui balayaient le bar de droite à gauche derrière ses lunettes rondes, avaient toujours la même lueur espiègle et enfantine. Ses cheveux bruns, entrecoupés de rubans de couleur et d’atébas, tombaient devant sa face lunaire ; dont l’expression était toujours aussi énigmatique, comme celle de quelqu’un de continuellement étonné par le monde. Son nez retroussé et ses petites fossettes lui donnaient l’aspect d’un gnome, et même le rouge à lèvres qu’elle s’était maladroitement déposé sur les lèvres ne parvenait pas à lui donner un aspect banal. Margot n’était pas belle. Elle n’avait jamais été belle. Mais qu’il le veuille ou non, c’était bel et bien la première fille dont il était tombé amoureux, quoiqu’il ne le lui ait jamais dit à l’époque. Comment aurait-il pu lui avouer cela sans devenir à son tour la risée de tout le lycée ? C’est que Margot avait toujours eu la réputation d’être quelqu’un de bizarre. Non seulement son look dénotait profondément avec les stéréotypes de beauté, mais son comportement n’arrangeait rien… Elle passait son temps à lire seule dans son coin, des livres bizarres sur les sorcières et les fantômes, ou alors à ramasser des plantes qu’elle faisait sécher dans ses cahiers. Est-ce qu’elle était toujours aussi étrange aujourd’hui ? En tout cas, elle avait toujours son collier en perles de bois, et même la chemise à carreaux qu’elle portait au-dessus de son t-shirt noir disait quelque chose à Paul.
― Salut, Margot, parvint-il finalement à articuler.
Elle tenait un verre de whisky dans la main droite et à sa manière de sourire, il devina que ce ne devait pas être le premier.
― Un whisky pour mon copain ! lança-t-elle au barman.
Paul essaya de protester, mais elle se mit à rire bruyamment et posa sa main sur sa bouche.
― Ce n’est pas tous les jours qu’on retrouve le seul garçon qui nous plaisait au lycée.
Paul sourit. Margot avait toujours eu cette propension à dire haut et fort des choses très gênantes, et ce sur un ton on ne peut plus naturel, comme si cela n’avait de toute façon aucune importance. Elle s’assit sur le tabouret à côté de lui et finit son verre cul sec.
― Et un pour moi aussi Didier, s’te plaît ! Tu rajoutes à l’ardoise, OK ?
L’homme opina du chef et remplit les verres avant d’aller rejoindre les lanceurs de dés.
― Qu’est-ce que tu fais là ? demanda finalement Margot en se tournant vers Paul.
De sa bouche émanait l’odeur du whisky, mais elle ne suffisait pas à surpasser complètement celle des capucines, qui était celle du parfum qu’elle portait déjà au lycée.
― Je fais une thèse sur le fonctionnement économique des abbayes bénédictines au XIIIe siècle, du coup je viens passer quelque temps ici pour étudier les archives dont ils disposent à celle d’Auvreyles. Si j’en crois monsieur Gaston, les fonds documentaires sont énormes et… Je crois que je m’emporte. Et toi, alors ?
― Je suis journaliste. Je bosse pour une gazette locale, l’Écho des sapins, je ne sais pas si tu connais… Enfin, du coup je ne pense pas avoir besoin de te dire pourquoi je suis là !
Paul eut beau réfléchir, mais justement non, il ne parvenait pas à expliquer pourquoi une journaliste viendrait se perdre dans un trou comme ça, à moins de vouloir rédiger des articles sur la décrépitude des campagnes vosgiennes.
― Euh… non, je t’avoue que je ne sais pas ce qui peut t’amener à Darlon.
― Quoi ? Tu n’as pas entendu parler de l’affaire des disparus ?
Devant le regard déconcerté de Paul, Margot se remit à rire.
― Tu fais toujours la même tête quand tu es perdu, c’est drôle ! Il y a eu cinq disparitions non élucidées à Darlon, en à peine quatre mois… Dans un village de seulement quelques centaines d’habitants, tu te rends compte ? Alors j’ai été envoyée ici pour couvrir l’événement… Je ponds un petit article de temps en temps sur le sujet, que j’envoie à mes patrons, et hop, le tour est joué. Les autres journalistes ne viennent presque jamais se perdre ici… ils se contentent généralement de modifier un peu mes articles. Ça ne me dérange pas, au moins comme ça je suis tranquille ! Je recueille des témoignages, tout ça, tout ça… Et comme le meilleur moyen de parler aux gens, c’est de les croiser autour d’un verre, ben je passe mes journées au bar. C’est une excuse comme une autre, non ?
Elle se mit à rigoler une nouvelle fois, ce qui releva ses fossettes, puis but une grande gorgée de whisky en entortillant une de ses tresses.
― Je crois qu’on a affaire à un cas de sorcellerie, finit-elle par dire d’une voix tout à fait sérieuse en reposant son verre. Tout fait penser à une affaire hors du commun, en tout cas… Le premier à avoir disparu, Jérôme Pick, était allé pêcher sur les bords du ruisseau de la Dame en Blanc, un petit affluent de la Sarre Noire. Sa femme n’a retrouvé que sa canne à pêche, prise dans des roseaux au milieu de la rivière, et son panier un peu plus loin sur la berge. Juste à côté, il y avait le fameux signe, tracé sur l’écorce d’un hêtre…
― Un signe ?
― Ouais. On a trouvé le même à proximité de tous les lieux de disparition, toujours fraîchement taillé sur un arbre. Et personne ne sait ce qu’il signifie, si ce n’est que ça fait évidemment penser à un rite satanique… Cela représente une croix à l’envers, comme un crucifix renversé, mais par-dessus il y a un arc de cercle et juste en dessous trois petits triangles qui suivent le contour de l’arc… Attends, je vais te montrer.
Margot s’empara d’un dessous de verre qui traînait sur le comptoir, et, avec un crayon qu’elle sortit de sa poche de chemise, se mit à dessiner. Quand elle eut fini, elle poussa le carton vers Paul, mais le signe ne lui disait rien.
― Et donc, on a retrouvé ce symbole à chaque fois que quelqu’un a disparu ?
― Oui. Après monsieur Pick, ça a été une vieille dame, madame Loudin. C’était un soir d’orage, et son mari m’a dit qu’elle voulait se dépêcher d’aller chercher le linge qu’elle avait oublié sur une corde au bout du jardin. Elle serait sortie dans la nuit pluvieuse, aurait traversé sa pelouse, puis son potager. Son mari, qui l’observait depuis la fenêtre de la cuisine, l’aurait alors vue passer derrière un grand drap blanc… Et c’est la dernière fois qu’il l’a vue.
― Tu crois à ça ?
― J’y crois, oui. Mais ce n’est pas tout… Quand nous avons discuté, son mari m’a confié que le grand drap blanc était subitement tombé au sol, en même temps qu’un éclair illuminait son jardin, comme si quelqu’un avait subitement enlevé les pinces de la corde. Il m’a dit tout cela en sanglotant, car avant que la lumière de l’éclair ne cesse, il lui semble avoir aperçu une silhouette derrière le drap tombé. Ce n’était pas celle de sa femme, ça, il me l’a juré sur sa vie.
Paul but une gorgée de whisky et grimaça. Il trouvait ce genre d’histoire complètement absurde.
― Et je suppose qu’on a retrouvé ton fameux signe tracé sur le drap ? demanda-t-il avec une pointe d’ironie en reposant son verre.
― Pas sur le drap, non. Sur le tronc d’un aulne en bordure de la Sarre Noire, juste derrière leur jardin. Une enquêtrice avec qui j’ai eu l’occasion de discuter m’a dit que, là où devait se tenir le drap blanc, les traces de pas de madame Loudin disparaissent, comme si elle s’était volatilisée…
― Et il n’y avait pas d’autres empreintes ?
― Apparemment non… Une bière Didier, s’il te plaît !
Margot finit son verre cul sec et le poussa vers le barman, qui dodelina de la tête en allant chercher une pinte.
― Je t’embête avec mes histoires ? demanda-t-elle soudain en se plongeant dans les yeux de Paul.
― Pas du tout, répondit-il, même s’il eut l’impression de mentir un peu.
Ses histoires ne l’ennuyaient pas, mais il devait admettre qu’il n’était plus habitué à ces élucubrations lugubres. Il détestait quand les faits ne bénéficiaient pas d’explication rationnelle. Paul finit son whisky et commanda lui-même une pinte, pendant que Margot se remettait à parler. Sous son nez, la mousse de sa bière formait une espèce de moustache qui pétillait.
― Donc… La troisième personne qui a disparu est monsieur Jacob. Il participait à l’habituelle randonnée mensuelle quand, traînant en fin de groupe, il s’est visiblement volatilisé. Lorsque les autres marcheurs s’en sont aperçus, ils sont revenus sur leurs pas, mais n’ont rien trouvé d’autre que son bâton de marche au milieu du chemin… juste à côté, bien sûr, d’un arbre sur lequel était tracé le signe. Je crois que c’était un frêne cette fois.
― Est-ce que c’est toujours dans le même secteur que les gens disparaissent ? intervint Paul.
― Bravo Sherlock ! s’exclama Margot en riant, faisant détourner le regard des joueurs de dés. Les disparitions ont toutes lieu à peu près au même endroit, c’est vrai… mais c’est assez vaste. Elles surviennent toujours côté nord de la Sarre Noire, vers le vallon de la Dame en Blanc, dans les forêts qui séparent le manoir de l’abbaye. Ou en lisière, pour le cas de madame Loudin. Et d’ailleurs aussi pour le cas du petit Clément ; c’est la quatrième disparition.
― Un enfant ? s’indigna Paul, un peu plus fort qu’il ne l’aurait voulu.
― Ouais… Douze ans. Son père est le garde forestier communal. Cette fin d’après-midi-là, la famille était allée pique-niquer à l’aire de jeu en lisière de forêt, celle juste après le petit pont. Clément faisait de la balançoire avec d’autres enfants. À un moment donné, le père Hallier, qui mangeait avec les parents de Clément, a appelé les gamins pour leur proposer des biscuits… Tout le monde est venu, mais soudain, on s’est aperçu que Clément manquait. Le père de Tom m’a dit avoir vu la balançoire bouger, comme si quelqu’un y était encore assis la seconde précédente. Pourtant il n’y avait plus personne, et nul n’a depuis revu le petit Clément. En fouillant la forêt derrière l’aire de jeux, la police a évidemment trouvé le signe… Sur un chêne.
Paul eut un frisson. Il n’avait jamais supporté les disparitions d’enfants.
― Et le dernier cas, c’était il y a deux semaines, reprit Margot en continuant de le fixer de ses grands yeux énigmatiques. Une adolescente cette fois, du nom de Johanna. Elle était revenue de Nancy — où elle faisait ses études — pour revoir ses parents qui habitent Saint-Quirin. Malheureusement pour elle, elle a eu l’idée de proposer une randonnée à son copain, qui était là pour le week-end. Il a suffi qu’il aille pisser pour qu’il ne la retrouve plus. Et bien sûr, le signe qu’il a découvert tracé sur un érable semblait tout frais. C’était comme si, selon ses dires, « quelqu’un l’avait gravé au couteau la seconde précédente ». Voilà, je crois que tu sais tout. Les flics continuent leurs recherches, et ce ne serait pas étonnant que tu les croises en train de battre la forêt prochainement. Mais je crois qu’ils n’ont aucune piste sérieuse… Et je dois admettre que moi-même, qui mène ma petite enquête, je n’ai pas foule d’idées non plus…
― Un vrai mystère… constata Paul en espérant par cette phrase évasive mettre enfin un terme à cette discussion morbide.
Mais au moment où Margot finissait son verre d’un geste théâtral, un des hommes au comptoir, visiblement là depuis longtemps, intervint.
― Un mystère ? Pas pour tout le monde, mon p’tit monsieur. Je vous entends causer d’puis tout à l’heure, et j’crois que m’dame Margot a bien résumé les choses. Mais pour sûr, si on m’demande mon avis, j’ai bien quelques soupçons ! Et je ne suis pas le seul à savoir qui est derrière tout ça.
― Qu’est-ce que tu racontes encore, Mich ? intervint un de ses copains en l’attrapant par l’épaule. T’es encore rond comme une queue de pelle, on dirait !
― Arrête… répondit Mich en se dégageant. On peut faire semblant de rien, mais je sais que toi aussi tu soupçonnes le comte !
― Le comte ? Ouais, il est suspect, en effet.
― Ce type a toujours vécu à l’écart, comme d’ailleurs toute la famille Langlois. Et il a toujours détesté tout le monde. C’est comme si… comme si son argent lui donnait plus de valeur que nous on en a. J’crois qu’y serait capable de tuer. Il a toujours détesté les gueux comme nous.
L’ami de Mich haussa les épaules au moment où Paul se décidait à donner son avis.
― C’est une tendance assez répandue que d’incriminer les riches dans le cadre d’affaires inexpliquées. On a vu cela lors de l’épisode du Gévaudan, par exemple, et même lorsque la prétendue « Bête des Vosges » massacrait des troupeaux. Si mes souvenirs sont exacts, on a accusé un riche Allemand de la plaine… Accusations sans fondement, évidemment.
Mich émit un rire dédaigneux.
― Dis donc l’intello, quand on aura besoin de ta science, on te sonnera ! Moi je dis ce que je pense, mais après tout c’est qu’un avis. J’espère juste que les flics n’oublieront pas de fouiller de son côté simplement sous prétexte que Monsieur est comte, qu’il a du sang noble dans les veines…
― Ouais, intervint le barman, qui les écoutait d’une oreille attentive depuis tout à l’heure en buvant un café. Mais il faut admettre qu’il n’a pas une vie facile… Entre sa femme dépressive, la petite Esther qui n’est plus capable d’aligner un mot et la cadette, Julia…
― Qu’est-ce qu’elle a ? s’enquit Margot.
― Personne ne sait exactement. On raconte juste qu’elle est tombée subitement très malade ; une maladie génétique ou un truc comme ça. Ce n’est qu’une rumeur, mais il paraît qu’elle ne ressemble plus du tout à une gamine maintenant, plutôt à une sorte de monstre ou un zombie…
Didier — le barman — finit son café et se mordit le bout des lèvres ; le monde recelait des choses terribles, auxquelles il valait mieux ne pas penser. Tout le monde semblait partager son désarroi, sauf peut-être Margot dont le visage demeurait interrogatif et insondable.
― Si moi j’avais un nom à donner, ce serait plutôt celui de la vieille Louise, déclara le dernier des joueurs de dés ; un homme aux yeux globuleux qui était resté un peu en retrait depuis tout à l’heure. Ce n’est pas bizarre de vivre seule à son âge, dans un chalet complètement perdu ? Paraît qu’elle n’a pas moins de dix chats dans son taudis… Vous vous rendez compte ? Dix !
― T’as raison, Gérard, reprit Mich. Ce genre de mégère, je crois qu’au Moyen Âge elle aurait déjà fini sur un bûcher, si vous voyez ce que je veux dire…
― Si je peux me permettre, ne put s’empêcher de corriger Paul, les procès de sorcellerie ont plutôt eu lieu à l’époque moderne qu’au Moyen Âge, si c’est à cela que vous faites référence…
― Il va fermer son clapet, celui-là ? s’énerva presque Mich. Je raconte ce que je veux, et comme je le veux, est-ce que c’est clair ?
Paul baissa la tête, gêné, tandis que Margot se mettait à pouffer dans sa manche.
― Bon et m’dame Margot elle peut rigoler, mais est-ce qu’elle a quelque chose à nous proposer ? reprit Mich, plaisantant cette fois-ci. C’est son métier de journaliste, nan, d’enquêter ?
― Je n’ai pas d’avis particulier, répondit Margot en ravalant son rire. Mais l’étrangeté des faits me fait penser à quelque chose de paranormal. Je ne suis pas sûre qu’un humain soit derrière tout ça…
Cette fois-ci, ce fut au tour de Paul de pouffer, mais s’apercevant qu’il était le seul, il reprit rapidement son sérieux.
― Vous pouvez vous moquer, m’sieur, lui dit Mich, mais j’crois que c’est parce que vous ne quittez pas assez souvent votre grande ville. Vous m’avez tout l’air d’un Parisien, je me trompe ?
― Un Lillois.
― Mouais. Pareil. Vous êtes un citadin. Allez donc vous balader seul la nuit dans les grandes forêts qui nous entourent, peut-être que ça remettrait en cause certaines de vos certitudes sur la marche du monde. Je ne dis pas que j’crois aux fantômes, mais je dis juste que ces forêts abritent quelque chose — une force, une magie — qu’aucune science ne saurait expliquer.
Paul hocha la tête. Il ne voulait pas entrer dans un débat d’ivrognes sur l’existence ou non du surnaturel. Il finit son verre cul sec et demanda au barman de lui en resservir un pour couper court à la discussion. Il avait très envie de boire ce soir, ce qui n’était pourtant pas dans ses habitudes… Contrairement à Margot, de toute évidence, qui ajoutait d’ailleurs un nouveau trait à son ardoise.
― Je dois dire que, pour ma part, j’ai toujours trouvé la vieille Mona Bellard étrange… reprit Didier en tirant les bières.
― Oh, c’est vrai qu’elle est bizarre, elle aussi, ajouta l’ami de Mich. Mais je crois que c’est juste une vieillarde qui perd un peu la boule… Elle va fêter ses cent ans dans quelques jours.
― Mona, c’est la dame à l’air sévère qui habite à côté de chez Anita ? demanda Margot.
― C’est ça.
― Je crois que je l’ai rencontrée alors, intervint Paul. Elle est venue vers moi pendant que je toquais chez Anita.
― Ah, c’est donc vous mon locataire ? s’éleva une nouvelle voix en provenance du fond du bar.
Ne voyant personne, Paul s’avança jusqu’au coude du comptoir. Là, il put distinguer une vieille dame chétive installée à une petite table, un journal ouvert devant elle. Celle-ci lui sourit et le jaugea un instant par-dessus ses lunettes.
― Je suis Anita. Vous êtes donc Paul ?
Il acquiesça et elle lui serra la main.
― Je pense que vous vous trompez sur le compte de Mona, lança-t-elle ensuite en se levant et en jetant son journal sur le comptoir à côté des hommes. C’est une dame non seulement très gentille derrière les apparences, mais aussi très saine d’esprit. Je crois seulement qu’elle sait des choses que l’on ne serait même pas capable d’imaginer. Elle a dû vivre des moments très douloureux par le passé, à une époque où tu n’étais même pas né, mon pauvre Didier…
― À son âge, elle a forcément connu la guerre, intervint Paul.
― Oui, effectivement. Mais je ne crois pas que ce soit là l’épisode qui l’ait le plus traumatisée… Il y a autre chose, à mon avis, mais cela demeurera sans doute pour toujours un mystère.
Après un temps de silence théâtral, Anita s’empara de son manteau et l’enfila.
― Merci pour la goutte et le café, Didier. Monsieur Paul, comme j’ai cru comprendre que Margot était votre amie d’enfance, je ne veux pas gâcher vos retrouvailles… Voilà les clés de la maison, et celles de la chambre. C’est la première porte sur la droite après l’escalier.
― Vous êtes sûre que ça ne vous dérange pas ? s’inquiéta Paul, un peu gêné.
― Pas du tout. J’ai connu l’amour aussi, vous savez…
― Ah, mais Margot et moi ne sommes pas…
― Tenez, voilà les clés.
Il prit le trousseau et resta un instant hébété en voyant Anita lui faire un clin d’œil et partir sans un mot de plus. Margot, quant à elle, s’était remise à pouffer dans la manche de sa chemise.
Son rire n’avait pas changé, lui non plus ; il était le même que celui qui était le sien ce jour où, en un printemps 2002 qui lui paraissait à la fois si lointain et si proche, ils avaient séché les cours pour aller se promener sur le bord de la rivière. Elle ne buvait pas encore de whisky à l’époque, mais déjà une bière ; une 8.6 en aluminium qu’elle lui avait tendue comme un breuvage sacré. Il avait pris une lampée — davantage pour lui faire plaisir qu’autre chose — pendant qu’elle allumait un joint et le portait à ses lèvres. Le temps était venteux, et soulevait régulièrement ses tresses autour de sa nuque. Elle avait l’odeur des capucines ; un parfum qui se mélangeait avec celui de l’herbe tondue dans laquelle ils étaient assis. Quand il n’était plus resté qu’un mégot, elle l’avait caché dans une petite boîte en fer décorée de fleurs, qu’elle avait finalement rangée dans son sac. Ensuite — Paul s’en rappelait comme si c’était hier —, elle avait sorti le cahier dans lequel elle séchait ses plantes et les lui avait toutes montrées les unes après les autres. Alors qu’elle ne parlait jamais au lycée, seule contre un mur à lire ses bouquins, cette fois-là elle l’avait fait pendant des heures. Elle lui avait raconté l’histoire des différentes espèces, appris des anecdotes sur leurs propriétés ou leurs usages ancestraux. Elle lui avait narré aussi les légendes qui les entouraient et expliqué les raisons qui lui faisaient tant les aimer… Mais soudain, elle s’était arrêtée de parler et s’était mordu la lèvre inférieure.
― Je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça… désolée, avait-elle murmuré.
La lumière s’était éteinte dans ses yeux et elle avait baissé la tête. D’un coup, elle avait cessé d’être Margot — une Margot que Paul venait en fait seulement de découvrir — pour redevenir le bouc émissaire du lycée, la fille moche et bizarre dont tout le monde se moquait. Il n’avait pas été capable de dire quoi que ce soit de réconfortant. Il n’avait jamais été très doué pour ce genre de choses. Son sourire n’avait vraisemblablement pas suffi, car Margot avait rangé précipitamment ses affaires, s’était levée en marmonnant quelque chose et avait fui sans se retourner ; comme toujours elle l’avait fait et comme le font sans doute toutes les adolescentes dans son genre.
Elle n’avait laissé derrière elle qu’un livre de Lovecraft oublié dans l’herbe et l’odeur des capucines, qui avait continué de flotter un peu dans l’air avant de s’estomper.
Plus tard, il avait dû expliquer à ses copains pourquoi Jason Tutin l’avait vu traîner avec la folle du bahut ; Margot la dingo. En réalité, lui-même ne savait pas pourquoi, cette fois-là, il l’avait suivie, puis rattrapée dans la rue pour lui demander où elle allait. Il ne savait pas non plus pourquoi, quand elle lui avait chuchoté d’une voix méfiante qu’elle allait juste bouquiner, il lui avait demandé s’il pouvait venir avec elle. Jamais il n’avait su la véritable raison de tout cela ; ou du moins jamais il n’avait osé se l’admettre. Et lorsque ses amis avaient insisté et s’étaient mis à le chambrer, il avait réagi comme socialement il devait réagir en une telle occasion ; comme son instinct de meute lui indiquait qu’il fallait le faire. Il avait ri, bien sûr, avait pris tout cela à la légère, et avait répondu, goguenard : « J’avais juste envie de me marrer un peu ». Pourtant, derrière les apparences, son cœur ne riait pas, et il était même tombé en miettes quand, lorsqu’il s’était retourné, il avait aperçu Margot appuyée contre le mur, qui avait dû tout entendre depuis le début. Elle avait un livre ouvert devant le visage, mais l’immobilité de ses yeux la trahissait, de même d’ailleurs que leur humidité, et Paul avait bien compris en cet instant qu’elle ne lisait pas. Quand sa bande était partie, il avait voulu aller lui parler, et avait même ouvert son sac pour s’emparer du livre de Lovecraft. Mais il n’en avait pas eu le temps, car Margot avait précipitamment rangé ses affaires, et fui une nouvelle fois sans se retourner.
Jamais il ne lui avait rendu son livre. Et plus jamais d’ailleurs il ne lui avait reparlé. Il n’avait plus osé. Pourtant, cette après-midi-là n’avait cessé de le hanter. Elle avait le goût de ces moments cruciaux de la vie ; ceux durant lesquels les agissements peuvent tout faire basculer d’un côté ou de l’autre, ceux durant lesquels la route semble se diviser en plusieurs chemins dont on sait pertinemment qu’ils ne se rejoindront jamais. Le chemin qu’il avait emprunté ce jour-là n’était probablement pas le bon, et il s’en était toujours voulu pour son manque de courage. Mais que pouvait-on demander de plus à un adolescent, qui plus est un adolescent entouré de sa bande de potes ? Il n’y avait pas de deuxième chance, la vie s’était écrite ainsi et Margot avait disparu de son existence après le lycée, le détestant sans doute comme elle devait détester tous ceux qui l’avaient humiliée. Il ne lui était plus resté d’elle que son livre de Lovecraft et l’odeur des capucines.
Une odeur qui se mélangeait désormais à celle du whisky.
― Paul ?
Il sortit de ses pensées.
Elle était là, devant lui, et le regardait en souriant de manière énigmatique, comme autrefois elle l’avait regardé en lui parlant des plantes de son cahier. Ses cernes avaient grossi et son visage trahissait une vie déjà bien remplie. Mais ses yeux étaient étrangement doux et il avait beau les sonder, il ne parvenait pas à y percevoir la haine qu’elle aurait dû éprouver à son égard.
― Tu collectionnes toujours les plantes séchées ? demanda-t-il subitement.
Margot recommença à rire et sortit de sa sacoche un gros livre sur lequel était écrit à la main : « herbier de Margot ». Elle l’ouvrit et, en buvant sa bière par lampées, se mit à parler.
Finalement, il arrivait parfois que certains chemins finissent par se rejoindre.
Chapitre 2Le journal du moine Grandier
Lorsque le réveil de Paul sonna le lendemain matin, il lui fallut un certain temps pour comprendre où il se trouvait. La chambre dans laquelle il était allongé — tapissée de fleurs et encombrée de bibelots, baignée par un soleil qui se reflétait dans une gigantesque armoire à glace — ne lui disait absolument rien. En se redressant, il se souvint qu’il n’était plus à Lille, mais dans les Vosges désormais, au sein d’un petit village perdu du nom de Darlon où il devait enquêter sur l’économie d’une abbaye bénédictine au XIIIe siècle. Il ne se rappelait plus très bien la fin de soirée dans le bar, même s’il était persuadé d’être rentré à la chambre d’hôte à pied.
Après s’être habillé et s’être vaguement coiffé devant le miroir, il descendit. Anita lui avait laissé un mot sur la table pour l’inviter à faire comme chez lui. Il déjeuna donc en vitesse, lava la vaisselle, puis sortit de la maison. Le soleil était radieux dehors et, malgré son mal de tête — qui n’était évidemment pas sans lien avec le whisky inconnu qu’il avait ingurgité la veille —, le parcours qu’il entreprit pour rejoindre sa voiture fut plutôt agréable. En contemplant les paysages montagneux et boisés qui l’entouraient, Paul ne put toutefois s’empêcher d’être parcouru du même sentiment que la veille ; ce malaise étrange et incompréhensible. Son esprit cartésien ne parvenait pas à saisir pourquoi le monde ici paraissait différent d’ailleurs ; plus vieux, plus mûr, presque même pourrissant. C’était beau, certes, mais il y avait quelque chose de troublant dans la forme des arbres ; comme si ces derniers se tordaient d’une façon désespérée pour fuir la terre sur laquelle ils poussaient. Même le bruit de l’eau, qu’il entendait couler sur les rochers à sa gauche, avait quelque chose de mystérieux, tel un chuchotement maudit prononcé par les arcanes de la Terre.
Il allait ouvrir la portière de sa voiture quand quelqu’un cria son nom. En tournant la tête, il vit Margot lui faire des signes de la main depuis la fenêtre du bar du Tilleul. Tenait-elle déjà un verre de bière ou alors rêvait-il ? Derrière elle, en tout cas, il reconnaissait le dénommé Mich de la veille, ainsi que son ami aux yeux globuleux, Gérard. Ces gens-là ne prenaient visiblement jamais de vacances. Il salua Margot, puis monta dans son véhicule.
Par une route particulièrement étroite, il quitta le village, traversa une prairie fleurie et enjamba la Sarre Noire par un pont en pierre dont la paroi s’effondrait par endroits. Peu après, il atteignit la lisière forestière et s’engagea sur une voie en lacets qui montait de manière abrupte. Combien de boucles passa-t-il ? Il ne s’amusait pas à les compter. Au fur et à mesure qu’il prenait de l’altitude, le paysage en direction du sud s’étalait dans la profondeur et finalement, il atteignit un point où il fut capable de percevoir l’horizon ; là où le ciel et les monts verts se mélangeaient dans une nuée informe que l’œil humain ne parvenait plus à distinguer.
Les lacets cédèrent la place à une route un peu moins sinueuse et escarpée, qui progressait au cœur d’une forêt ancestrale de sapins moussue. Par sa fenêtre ouverte, Paul entendait sur sa gauche — du fond du ravin ombragé qu’il longeait désormais —, un bruit de cascade. Ce n’est que quand le son s’estompa qu’il retrouva enfin l’air libre. Sa voiture surgit en effet au sein d’une étendue ouverte tapissée de rochers et d’herbes, qui se prolongeait en pente douce jusqu’à l’abbaye. Celle-ci se dressait désormais devant lui et, malgré son état de délabrement indéniable, elle l’impressionna, car il ne l’avait jusqu’à présent observée de près que sur des photographies. Afin de la contempler, il se gara à une centaine de mètres de ses murs. De toute façon, il ne pouvait pas aller plus loin, car la route s’arrêtait net comme si l’on avait mal recollé une carte, et que les deux morceaux ne se rejoignaient pas de manière cohérente.
Une fois sorti de son véhicule, Paul fut immédiatement marqué par le lourd silence des lieux. Pas un chant d’oiseau, pas une once de vent. L’endroit était totalement mort, vide, comme le fantôme d’un monde disparu ; ce qui était le cas d’une certaine manière puisque l’abbaye était désormais presque déserte. Les bâtiments étaient beaux, d’une architecture romane soignée qui témoignait d’un travail de précision et de moyens considérables au moment de la construction, au XIe siècle. Néanmoins, plus aucun moine ne vivait ici, à part père Gaston, et les grosses pierres étaient désormais colonisées par des fougères. Certains murs étaient à terre, d’autres sur le point de l’être, et le tas de cailloux qui s’étalait à gauche de l’église abbatiale semblait bien être les vestiges d’une aile désormais disparue.
Il s’avança en s’étirant, gravit une butte d’herbe, puis passa sous une arche pour atteindre l’intérieur du cloître. Là où autrefois devait se tenir un resplendissant jardin n’existait plus à présent qu’une friche où dominaient des fleurs d’un bleu profond ; Margot aurait probablement pu dire leur nom si elle avait été là. Au milieu se trouvait une statue, qui représentait un moine à l’expression meurtrie tenant une croix par-dessus son épaule. L’une des branches était néanmoins cassée, ce qui faisait davantage ressembler le personnage à un fanatique brandissant une hache qu’à celle d’un homme pieux. Après l’avoir dévisagé quelques instants en se demandant s’il s’agissait du fondateur du lieu, Paul se dirigea vers l’église abbatiale — dont le clocher plongeait dans l’ombre une partie de la friche —, et y pénétra par une lourde porte en bois sous les voûtes de pierre.
La nef était plus vaste qu’elle n’y paraissait de l’extérieur : il y avait au moins une vingtaine de rangées de bancs et presque autant de tableaux accrochés sur les murs latéraux. En revanche, Paul fut surpris par l’obscurité des lieux. De grands vitraux ornaient tous les versants de l’édifice, mais ils ne suffisaient nullement à offrir un éclairage digne de ce nom. Heureusement, quelques cierges brillaient çà et là entre les allées, sans doute allumés par le moine Gaston, et apportaient un peu de chaleur bienvenue. Paul marcha jusqu’au transept et admira l’immense Christ en bronze qui se tenait au milieu du chœur. La poussière qui flottait devant les fenêtres — qui tapissait aussi le dallage et les pages de la bible ouverte sur l’estrade — prouvait que la messe ne se tenait plus ici depuis fort longtemps. Les tubes de l’orgue dans le fond de la salle étaient d’ailleurs tous tordus, ou cassés, et il aurait été bien étonnant que l’instrument puisse encore produire un son convenable.
En longeant le chœur, il tomba sur un étroit escalier en colimaçon qui menait à une crypte illuminée. Là, une excavation dans les fondations du bâtiment accueillait des santons en terre cuite, juste sous une chandelle. Au centre se trouvaient les éléments habituels d’une crèche : Marie et Joseph aux côtés d’un âne et d’une vache, abrités par un petit abri en bois. Autour, cependant, Paul fut étonné de constater que les personnages ne présentaient aucune cohérence, et que la plupart n’avaient même aucun rapport avec un quelconque épisode biblique. Il y avait beaucoup de figurines de moines, mais aussi des bûcherons, des paysans munis de fourches, un homme en tenue de chevalier, et même un individu portant une collerette typique du XVIe siècle… Paul, qui avait l’œil de l’historien, ne put s’empêcher d’émettre un rire dédaigneux en pensant aux nombreux anachronismes que revêtait la scène. Celle-ci était purement grotesque, et pas seulement en raison de ses aberrations chronologiques. La qualité artistique des figurines était en effet plus que douteuse : les personnages étaient affaissés, difformes, comme s’ils avaient été cuits encore en train de dégouliner. Leur texture était semblable à celle de bougies fondantes.
Paul préféra se détourner de ce spectacle affligeant et remonta dans la nef. Monsieur Gaston n’était visiblement toujours pas là. En parcourant nonchalamment les tableaux du chemin de Croix, il découvrit un autre escalier, qui celui-ci menait à une grosse porte en bois. Il s’apprêtait à descendre les marches quand une voix grave s’éleva dans son dos.
― Je vous déconseille d’aller voir ce qui se trouve là-dedans.
Paul sursauta et fit volte-face. D’abord, il ne vit personne. Puis, en balayant l’église du regard, il distingua la silhouette encapuchonnée d’un homme entre deux allées de chaises, à côté d’une colonne.
― Bonjour, je suis le moine Gaston, le dernier résident de ces lieux, indiqua celui-ci en s’avançant vers lui et en tendant des doigts fripés. N’essayez plus jamais de passer cette porte, je vous en serai reconnaissant. C’est mieux pour vous aussi, croyez-moi. Je suppose que vous êtes Paul ?
Il acquiesça et l’individu, après lui avoir serré la main, enleva sa capuche. Il présentait un visage particulièrement ridé, mais des yeux d’un bleu pétillant qui le faisaient paraître presque jeune. Une tonsure ornait sa tête.
― Avez-vous fait bon voyage, jeune homme ?
― Parfaitement, je vous en remercie… Mais vous êtes vraiment isolé, ici !
― À qui le dites-vous ! Bien… Je suppose que vous avez hâte de commencer vos recherches. Je vais vous montrer ce qu’il reste de notre bibliothèque, reprit le moine en se mettant à grimper sur le chœur. Suivez-moi. J’y ai disposé une table et un fauteuil qui devraient vous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Je suppose que vous connaissez déjà l’histoire de notre établissement ?
― Plus ou moins, oui, répondit Paul en descendant à la suite de monsieur Gaston un escalier en pierre à l’arrière de l’estrade. Mais je suppose que j’ai encore beaucoup à apprendre. Pour mon sujet, je m’intéresse particulièrement aux aspects économiques et… Waouh !
Paul n’avait pu s’empêcher de lâcher une exclamation de surprise en découvrant la pièce dévoilée par père Gaston en bas des marches. C’était une belle salle au plafond voûté, où se tenaient de grandes armoires débordantes d’ouvrages anciens et de classeurs.
― J’essaye de maintenir tout cela en ordre, baragouina le moine comme s’il s’excusait. Les premières étagères contiennent les livres. Celles dans le fond contiennent les archives proprement dites. Je crois que c’est plutôt cette partie-là qui vous intéressera. Les documents sont normalement classés par année, mais bien sûr, il y a toujours des éléments mal rangés… Voilà les clés de la bibliothèque, venez travailler quand vous voulez. Mon bureau est situé juste à côté, et j’y suis souvent.
Après lui avoir remis le trousseau, père Gaston lui tapota l’épaule en souriant — ce qu’il n’avait pas fait jusqu’à présent — puis remonta les marches d’une allure lente.
Paul attendit que le bruit de ses pas s’estompe, avant de s’avancer entre les étagères de livres à la recherche de documents du XIIIe siècle.
*
Quelle heure était-il maintenant ? Il n’en avait aucune idée, car la bibliothèque souterraine ne disposait d’aucune fenêtre. Le gargouillement de son ventre lui laissait néanmoins supposer qu’il était passé midi, et largement. Son carnet de notes était déjà rempli d’informations, rédigées d’une écriture illisible, qu’il avait glanées dans des livres de comptes de l’époque. Il était sur le point de s’arrêter pour aller manger quand soudain, feuilletant un petit cahier qui semblait être le journal d’un des moines de l’abbaye au XIIIe siècle — un certain Grandier —, il s’arrêta de respirer.
Le signe.
Sur une des pages était dessiné à l’encre noire, sous le texte qui correspondait à la date du 12 juin 1293, le même symbole que celui qu’avait dessiné la veille Margot sur le dessous de verre : une croix renversée surmontée d’un arc de cercle et de trois petits triangles. Comment était-ce possible ? Le texte, évidemment, était en latin, et avant de savoir de quoi il retournait, il lui fallait d’abord se concentrer sur la traduction. Oubliant pour l’heure complètement sa faim, excité comme un enfant devant une carte au trésor, il avança son dossier, rouvrit son dictionnaire et se remit au travail de plus belle.
Quand il eut fini de traduire une dizaine de pages, il s’interrompit et, après s’être passé les mains sur le visage pour s’assurer qu’il ne rêvait pas, entreprit de tout relire depuis le début.
An 1293, 12e jour du mois de juin.
Un nouveau frère a disparu : mon ami Jauvin. C’est le troisième en un mois. La tristesse que j’éprouve face à ce terrible drame n’a d’égale que mon incompréhension. Je ne sais que penser face à cette macabre série, et je crois que nous sommes tous, ici au monastère d’Auvreyles, dans le même cas. Mon ami était parti cueillir des cerises avec frère Aubiner quand ce dernier l’a perdu de vue. Évidemment, cela ne peut que me rappeler la fois où moi-même, il y a trois semaines de cela, j’ai perdu frère Amaury alors que nous allions chercher de l’eau à la rivière. Je l’ai appelé longtemps, au point d’en perdre la voix. Dieu m’en est témoin. Mais frère Amaury n’a jamais été retrouvé. Et pour ma part… Je ne peux m’enlever de la tête le souvenir terrible de cette forme bossue, se précipitant entre les buissons de ronces, des lambeaux de vêtements informes pendant derrière son dos comme des ailes de démon repliées. J’ai voulu appeler l’individu, ou le monstre que sais-je, mais n’y suis pas parvenu. Les mots sont restés bloqués dans ma gorge, et mes jambes se sont soudainement figées, me faisant basculer dans un buisson de bourdaine. Peut-être était-ce l’œuvre du démon ? Peut-être le Malin protégeait-il sa créature ?
Invoquer le diable à tout bout de champ n’est pas dans mes habitudes, ceux qui ont lu les pages qui précèdent le savent. Je suis adepte de la rationalité, de l’enquête objective avant tout, afin de ne pas mêler inutilement le divin à des choses que la raison peut appréhender. Même quand frère Amaury a disparu, je n’ai pas crié au Malin, contrairement à frère Danton qui n’a pas hésité à lancer des accusations sur une vieille femme vivant à Darlon, réputée sorcière, alors même que je lui répétais qu’elle ne correspondait pas le moins du monde à ce que j’avais aperçu. « Tu n’as qu’un œil, Grandier, cela ne te fait peut-être percevoir que la moitié de ce que moi je perçois », a-t-il même osé me lancer avec son ton méprisant habituel. Je suis borgne, c’est vrai, mais le bandeau qui me cache l’œil ne m’empêche nullement de réfléchir, et sans doute même mieux que cet ignare. Quoi qu’il en soit, je devais admettre, déjà à ce moment-là, que le signe que nous avions trouvé en fouillant la forêt était pour le moins troublant. Le voici redessiné, en espérant que Dieu voudra bien pardonner le blasphème qu’il constitue.