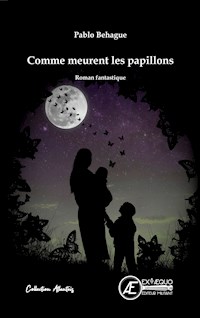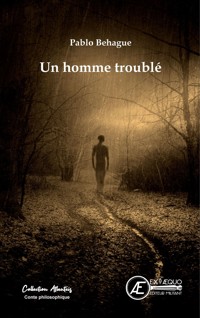
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ex Aequo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Passionné de philosophie, Tom est un élève brillant et promis à un avenir radieux. Néanmoins, sa vie bascule lorsqu’il comprend que l’homme est condamné à vivre dans l’illusion perpétuelle, et par conséquent dans la solitude la plus extrême. Car comment nous connaître nous-mêmes, quand nos cerveaux ne produisent qu’ombres et mensonges ? Incapable de se défaire de ses tourments existentiels, l’adolescent se lance dans une longue quête obsessionnelle afin d’exhumer son véritable moi. Son périple fou le mènera aux quatre coins du monde et dans ses arcanes les plus obscurs
A travers le témoignage de son ancien professeur et des bribes de son journal intime, ce conte fantastico-philosophique nous questionne sur la réalité et le mystérieux concept de chose en soi. Il nous amène aussi à réfléchir à la notion d’identité individuelle et à nous perdre dans ses contradictions
Que se trouve-t-il donc sous le masque des apparences ? Qui se cache derrière ce reflet qui vous contemple dans le miroir ? Existe-t-il seulement… quelqu’un… pour lire ces lignes ?
À PROPOS DE L’AUTEUR
Né en 1991, Pablo Behague vit dans les Vosges. Passionné de philosophie, mais aussi fasciné par la nature et ses mystères depuis son enfance, il a exercé le métier de botaniste pendant longtemps avant de devenir professeur d’Histoire. Ses textes développent une conception pessimiste de l’existence, et amènent les lecteurs à se questionner sur la place de l’homme dans un univers qui le dépasse et lui est profondément hostile.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pablo Behague
Un homme troublé
Conte philosophique
ISBN : 979-10-388-0771-6
Collection Atlantéïs
ISSN : 2265-2728
Dépôt légal : octobre 2023
© couverture Ex Æquo
© 2023 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays. Toute modification interdite.
Au cours de ma longue carrière de professeur de philosophie, j’ai été confronté à de nombreux élèves brillants et intéressants, mais aucun qui se rapprochait autant du génie que Tom Gallien. Il est indéniablement l’adolescent qui m’a le plus marqué ; et pour cause, j’ai passé une grande partie de ma retraite à enquêter nuit et jour sur son cas et sur ses étonnantes aventures, qui sont d’ailleurs l’objet même du texte que je rédige en cet instant. Je l’ai commencé en vous indiquant que Tom était un génie, mais comme il en est souvent ainsi chez les esprits complexes et tortueux — c’est-à-dire chez les bons philosophes —, son génie se confondait et se mélangeait étroitement avec la folie. Fallait-il le considérer en surdoué ou en aliéné ? En prodige ou en dément ? Le commun des mortels, cela va de soi, l’a rangé dans la seconde catégorie sans hésiter. Néanmoins, quelqu’un qui comme moi se passionne pour les réflexions métaphysiques et les tortures de la pensée ne peut qu’être admiratif quant à la profondeur de ses recherches, leur détermination et leur constance. Je ne peux que tirer mon chapeau également, en songeant à tous les sacrifices qu’il a consentis durant sa vie, afin de mettre en conformité son existence avec ses doutes, et se vouer corps et âme à sa quête ultime.
En fait, je dirais que Tom avait passé toute son adolescence sur la ligne de crête qui sépare les deux versants de la montagne cérébrale : l’adret du génie et l’ubac de la folie. Il aurait très bien pu basculer dans le gouffre de la facilité ; celui de la respectabilité sociale et de la gloire terrestre, en réussissant haut la main ses études et en se rangeant dans un métier intellectuel prestigieux et chèrement payé. Ainsi, il aurait pu devenir professeur d’université, écrivain, journaliste, chercheur en anthropologie, sociologue… Sans doute cette voie constituait-elle celle du génie pour la plupart des gens, car c’était celle où brillait le soleil et où ses contemporains auraient eu le loisir de le côtoyer. Mais vous l’avez deviné, notre ami a préféré un chemin moins conventionnel et moins bien balisé ; un sentier plein d’embûches que la plupart de ses congénères situent sur le versant ombrageux de la folie. Or, s’il s’est engagé sur cette voie regrettable, c’est en grande partie à cause de moi. Certes, peut-être aurait-il fini par l’emprunter de toute façon, avec ou sans mon aide, mais c’est bien la leçon que j’ai donnée à sa classe le jeudi 13 janvier 2005 qui a provoqué le déclic mental.
Tom était un élève extraordinaire, dont les devoirs témoignaient d’une culture générale, et surtout d’une profondeur de raisonnement que je n’avais jusqu’alors jamais connue chez aucun de ses semblables. La philosophie le passionnait, et il avait lu un grand nombre des auteurs classiques, qu’il citait au sein de ses copies en dépassant leurs réflexions et en offrant des notes d’esprit critique tout à fait bienvenues. Mais Tom n’était en aucune façon un philosophe de bureau, se contentant de méditer langoureusement assis dans un fauteuil douillet, empêtré dans un confort amollissant toute effervescence depuis le cœur jusqu’aux fibres du cerveau. Tom était ce que l’on peut appeler un « philosophe écorché vif » ; le genre d’esprit torturé, sans cesse aux aguets, que tous les stimuli du monde extérieur troublent en permanence pour remettre en cause la pensée. Toujours concentré durant mes explications, il posait un nombre incalculable de questions, qui souvent menaient la démonstration si loin qu’elles déstabilisaient ses camarades, et même moi tant elles me semblaient incongrues dans la bouche d’un lycéen. Les échanges que nous avions étaient ô combien intéressants, mais ils avaient tendance à perdre les autres jeunes, voilà pourquoi je lui proposais en général de me retrouver à la fin de l’heure pour poursuivre le débat ; ce qu’il faisait systématiquement.
Que sa main se lève en classe était donc chose habituelle, raison pour laquelle je n’ai pas pris soin de peser mes mots lorsqu’il m’a interrogé en ce fameux 13 janvier 2005. Ce jour-là, je donnais une leçon sur la différence fondamentale qui existe entre le monde réel et le monde perçu ; c’est-à-dire sur l’idée de « représentation du monde » si chère à des auteurs comme Kant ou Schopenhauer, par exemple. C’était un cours que j’aimais tout particulièrement, car ce concept d’illusion me paraissait — et me paraît d’ailleurs toujours — totalement fondé, et irréfutable au sens le plus strict du terme. Ayant été formé au cœur de l’école kantienne, ce présupposé initial de la perception, qui offre au sujet, par l’intermédiaire des sens et de l’entendement, des représentations, me semblait être le seul élément indiscutable au sein du chaos de l’existence ; le seul point de départ possible, donc, pour la réflexion philosophique. Bien sûr, mon cours étant destiné à des terminales, je présentais ce concept de façon très caricaturale et très ludique. Par le biais d’exemples faciles à appréhender, j’essayais simplement de prouver à mes élèves que le réel et ce que nous devinons du monde sont deux choses distinctes, et probablement même très différentes ; si ce n’est contradictoires.
Ainsi, leur demandais-je, pourquoi les chiens s’agitent-ils parfois, alors que l’homme demeure quant à lui impassible ? En raison des ultrasons qu’ils sont capables d’entendre, bien sûr, tandis que les êtres humains en sont eux incapables. Est-ce à dire que les ultrasons ne sont pas réels ? Impossible de trancher, mais ils le sont apparemment dans la perception du chien. Et que penser encore de l’arc-en-ciel ? L’ultraviolet est invisible dans le champ visuel de l’homme, pourtant la science atteste l’existence de cette couleur. Nos sens nous offrent donc du monde une image tronquée, fausse, trompeuse… Nous observons des explosions d’étoiles à des années-lumière de notre planète, et parfois nous voyons les astres briller alors qu’ils ont péri depuis longtemps. Notre vision n’est ainsi pas conforme à la réalité de l’instant présent, mais à une réalité morte, déchue, qui elle-même n’a peut-être jamais existé, car nous n’en avons perçu qu’une infime portion par nos sens ridicules. À ce stade de ma démonstration, je présentais aux élèves une illusion d’optique, constituée de lignes parallèles apparaissant à toutes et tous comme courbées et convergentes.
« Ainsi, concluais-je, les scientifiques estiment aujourd’hui que nous n’avons du monde qu’une perception partielle, qui n’intègre au maximum que 10 % du réel. Cette perception elle-même, de surcroît, pourrait être une chimère. Infirmes dans l’univers, nous ne disposons que de cinq sens : la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher, le goût… Et ces derniers ne sont que de piètres portes d’entrée pour nos cerveaux, qui eux-mêmes déforment nos impressions pour restituer quelque chose de plus ou moins cohérent. Les groseilles nous apparaissent rouges parce qu’on nous a toujours appris qu’elles étaient rouges… Mais qui me dit que mon rouge n’est pas différent du tien, Léa ? Ou du tien, Mathieu ? Néanmoins, le problème de la perception ne s’arrête pas, tant s’en faut, à une histoire de couleur ni à ce que nous qualifions de visuel. Tout en réalité n’est que représentation, même le temps et l’espace ainsi que l’a montré Kant. Jusqu’à nos pensées sur la nature du monde sont une illusion, un phénomène de l’expérience sensible… Autrement dit, nous n’avons de ce qui nous entoure qu’une vision biaisée, fausse très probablement, mais qui nous mène en bateau depuis notre naissance. »
C’est à ce moment-là que Tom est intervenu, alors que je m’apprêtais à commenter la fameuse citation de Descartes sur les sens trompeurs. Depuis le début de ma démonstration, je le voyais froncer les sourcils et se gratter le menton par intermittence, et ne pouvais m’empêcher de me demander au cœur de quels tréfonds cérébraux ses réflexions le conduisaient.
— Monsieur… Ce que vous expliquez est probant, et même irréfutable. Mais cela n’implique-t-il pas, pour chaque individu sur cette Terre, la solitude la plus extrême ? Car alors, nous ne connaissons finalement personne, ni nos amis, ni notre famille, ni nos professeurs… Nous n’avons d’eux qu’une représentation fallacieuse, qui ne correspond à aucune réalité, et qui nous rend donc fondamentalement isolés du reste du monde pour l’ensemble de notre vie.
— Indéniablement, Tom, et c’est bien là le grand drame de l’existence. Peut-être nos proches sont-ils en réalité des monstres hideux, des ombres sans consistance, des formes inconcevables pour le cerveau humain, des êtres abjects et tortionnaires déguisés sous le drap de nos illusions… Mais en fait, j’irai même plus loin… Non seulement tu ne peux jamais connaître les autres, mais tu ne peux pas non plus te connaître toi-même.
À ce moment précis, j’ai vu son visage se figer dans une expression de révélation maudite ; ses sourcils se froncer encore davantage, sa gorge se contracter, ses yeux se mettre à pétiller d’une étrange lueur.
— Que voulez-vous dire ?
— Eh bien, au sein de la représentation du monde, même de nous-mêmes nous ne pouvons avoir la moindre certitude. Nous ne percevons de notre apparence, de notre personnalité, de notre esprit… que ce que nos sens et notre cerveau nous autorisent à percevoir. Mais peux-tu me dire, Tom, ce qui se dissimule derrière ton visage, ou plutôt derrière ce masque que tu contemples chaque matin dans le miroir ?
— Mon… âme ? a-t-il bafouillé, et c’était la première fois que je le voyais agir de la sorte, et s’exprimer avec autant de décontenance.
— Bien sûr, si on considère le concept d’âme fondé, alors il se cache sous ton enveloppe corporelle une âme. Mais même cette âme — si tant est qu’elle existe — ne t’est perçue que par le biais des représentations que t’offrent tes sens, et tes connexions neuronales, qui construisent de toi-même une image grossière ; une image qui, du moins, te permet de supporter la vie sur cette Terre, et de te concevoir dans les normes de la géométrie telle qu’elle nous est comprise. Car l’esprit humain a besoin de rigueur, alors il classe les traits et les formes, range les éléments dans le grand tableau de la matière, tire d’une réalité confuse une vision ordonnée de la vie… Mais il est probable que, derrière l’apparente clarté du monde qui nous entoure, et de ce que nous sommes, se déploie en fait un vaste chaos. Aussi paradoxal que cela puisse te sembler, nous sommes fondamentalement étrangers à nous-mêmes, et le demeurerons à jamais.
Pendant un instant, j’ai cru qu’il allait rétorquer quelque chose, mais au lieu de cela il a baissé la tête et s’est renfrogné, s’enfermant dans la contemplation de son cahier. Son visage était l’objet d’étranges tics, et jamais jusqu’alors je ne l’avais senti aussi perturbé, ni aussi concentré sur un problème philosophique. En raison de son état, j’étais persuadé qu’il s’attarderait à la fin du cours pour me bombarder de questions. À ma grande surprise, néanmoins, il s’est immédiatement précipité en dehors de la classe quand la cloche a retenti.
Depuis ce jour, Tom n’a plus été le même. Lui qui participait tant durant mes séances s’est soudain muré dans le silence, se contentant de regarder en permanence par la fenêtre avec des yeux cernés et rougis qui trahissaient de longues nuits sans sommeil. Parfois, il gribouillait d’étonnants schémas tentaculaires, ou des mots mystérieux, et murmurait entre ses dents de vagues formules dont je n’ai jamais pu discerner le sens. À une occasion, tandis que je passais entre les rangs, j’ai cependant été capable de lire d’énigmatiques questions sur une de ses pages : « Sous le néant, peut-il exister autre chose que le néant ? », « Lorsque l’étranger cesse de l’être, devient-il pour autant un ami ? », « De qui ou de quoi sommes-nous les esclaves ? », « Qui suis-je sous mon masque de cire ? Comment le faire fondre ? »
Bien entendu, le changement d’attitude de Tom n’était pas propre à ma matière. Ses résultats scolaires se sont mis à plonger d’un coup, et il devint rare qu’il ne rende pas purement et simplement copie blanche à ses évaluations. En fait, c’était comme si tout ce qui l’avait intéressé jusque-là avait brusquement perdu son intérêt ; comme si la vie ne valait plus la peine d’être vécue sans être capable d’apporter une réponse à cette interrogation cruciale : qui sommes-nous derrière les apparences ? « Peut-on concevoir la vie dans la peau d’un alien ? », avait-il griffonné un autre jour, dans la marge de son cahier. Mes collègues déploraient sa désinvolture et blâmaient une brutale crise d’adolescence ; moi seul comprenais la profondeur du choc qui l’animait. Monsieur Huibert, son enseignant en français, m’a ainsi expliqué que Tom avait refusé un travail de groupe. Il arguait qu’entretenir des relations sociales avec d’autres êtres humains n’avait aucun sens, dans la mesure où il ne pourrait jamais les appréhender que comme des ombres chinoises sur un mur granuleux. Évidemment, mon confrère n’avait pas cerné la subtilité de cette insolente métaphore, mais tandis qu’il me racontait cette anecdote en levant les yeux au ciel, le sentiment de culpabilité qui me rongeait depuis quelques mois a atteint son paroxysme.
J’étais de toute évidence responsable de son état, mais me rassurais en me convainquant qu’un esprit comme le sien aurait de toute façon fini par se poser cette question un jour ou l’autre. Néanmoins, même si je n’avais qu’accéléré le processus, sans doute était-ce à moi de venir en aide à ce jeune homme que j’avais conduit dans les affres de la torture philosophique. Mais quelle solution pouvais-je lui proposer ? Le problème qui le hantait était évidemment insoluble, et quiconque s’y confrontait se trouvait de facto condamné, et voyait son innocence s’émietter dans la tempête du nihilisme et de l’absurde existentiel. Je réfléchissais depuis quelques semaines à la meilleure manière d’aborder le sujet quand, me devançant dans ma démarche, Tom est resté à la fin d’une heure de cours pour discuter. Il se tortillait d’un pied à l’autre face à mon bureau, et sa voix, lorsqu’il s’est adressé à moi, était étonnamment rauque, sans doute en raison d’un temps de sommeil pour le moins limité.
— Bonjour, Monsieur. J’ai beaucoup pensé au cours que vous nous avez donné il y a quelques mois, à propos du monde qui ne nous serait pas appréhendable autrement que par nos sens trompeurs… À propos de la vie, des autres, et surtout de nous-mêmes, qui ne seraient finalement que représentations ; effets d’optiques en quelque sorte, et donc mensonges. Je voulais savoir si vous aviez des ouvrages à me conseiller sur le sujet, car il m’intéresse beaucoup.
Je n’ai pu m’empêcher d’esquisser un sourire en coin, car derrière sa façon timide et presque désinvolte de présenter sa requête, je savais pertinemment qu’il n’était non pas intéressé par le sujet, mais obsédé