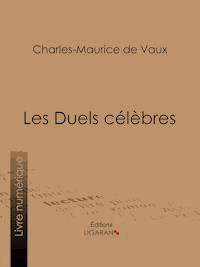
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le duel de femmes est chose rare en France, aujourd'hui surtout que la race des Richelieu a disparu. En faisant bien des recherches, nous avons fini par en découvrir un dans la Gironde. Deux de ces vierges folles, que le Gil-Blas désigne sous le nom charmant de tendresses, ou d'horizontales, se disputaient le cœur et la bourse d'un jeune propriétaire de Bordeaux, le comte de G…é."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À AURÉLIEN SCHOLL
Comme un témoignage de reconnaissance et de sincère affection de l’auteur.
AU BARON DE VAUX
Votre lettre m’arrive à l’instant et me rend positivement rêveur.
Après avoir dressé le répertoire de votre temps, de façon à ce que les romanciers de l’avenir ne puissent rien faire sans avoir consulté vos Hommes d’épée, vos Tireurs de pistolet et vos Hommes de cheval, vous voulez aujourd’hui, mon cher ami, faire une sorte de panorama des combats singuliers de toutes les époques.
Écrire le livre des querelles, raconter les duels d’hier et les duels d’aujourd’hui. Que de fantômes vous allez évoquer ! Que de spectres vont sortir de l’ombre !
Le passé appartient à l’historien, et, de ce côté, il n’y a pas de réclamations à craindre. Mais comment toucher aux cendres encore chaudes des querelles contemporaines ? Des combattants d’il y a quinze ans, l’un s’est battu pour une maîtresse aujourd’hui mariée, l’autre pour une femme morte et oubliée, un troisième pour une opinion politique qu’il a changée depuis pour une opinion toute neuve.
Tel s’est brouillé avec ses témoins qui, après lui avoir donné un satisfecit, seront peut-être bien aises de le lui retirer. Tel autre est devenu l’ami intime de son ancien adversaire.
Des quatre témoins, dans beaucoup d’affaires, un seul a survécu. Qu’il proteste contre un détail peut-être important d’un de vos récits, où irez-vous chercher des preuves ? Comment le réfuter avec autorité ?
J’admire votre audace et je puis bien me risquer à faire la préface, puisque vous faites le livre.
Vous pourriez y ajouter comme appendice le projet d’un boulevardier prudent et sagace qui, par opposition aux salles d’escrime dont Paris se hérisse, veut ouvrir une salle d’excuses dans laquelle on enseignera les soixante manières de se rétracter, et où les prévôts apprendront à leurs élèves comment on livre les assauts de politesse !
Le duel est une coutume particulière au monde moderne ; on n’en trouve pas de traces dans l’antiquité. Le combat des Horaces et des Curiaces est le premier duel connu. César et Tacite nous apprennent que les Germains décidaient par l’épée leurs querelles particulières ; et lorsque la conquête eut mieux fait connaître leurs mœurs, on voit le fait confirmé par les lois qu’ils rendirent.
En 501, Gondebaud le Bourguignon ordonne, pour remédier à l’obstination et à l’avarice, que toutes les contestations doivent se décider par l’épée ; et Frothius le Danois, digne descendant des héros de l’Edda, dit expressément qu’il est plus noble de résoudre une difficulté par la force que par la parole.
La féodalité reçut cet usage des Barbares ; mais elle le modifia, le régla par des lois, en fit une institution sociale, une solennité à laquelle les pouvoirs temporel et religieux prêtaient l’éclat de leur présence.
Othon II, par son décret de Vérone, en étendit l’obligation aux femmes, mais en leur accordant la faculté de se faire représenter par des champions. Les Danois allèrent plus loin encore, car leurs femmes et leurs filles étaient obligées de défendre leur honneur en personne.
En Angleterre, le combat singulier était à peu près inconnuavant la conquête normande. Les différents se terminaient par une compensation pécuniaire. Mais le conquérant introduisit la coutume de ses fiers Normands : il commença par provoquer Harold en combat singulier, et la seule restriction qu’il impose dans ses lois au combat judiciaire, c’est qu’aucun prêtre ne pourra se battre sans l’autorisation de son évêque.
L’un des plus anciens combats judiciaires que l’on trouve dans les annales anglaises est celui que le comte d’Eu, accusé par Godefroy Baynard de conspiration contre Guillaume le Roux, livra à son accusateur dans la plaine de Salisbury. Vaincu en présence de toute la cour, il fut cruellement mutilé par ordre du roi : on lui arracha les yeux, son écuyer même fut fouetté et pendu.
On raconte l’histoire plus romanesque d’un comte de Modène qui, pour avoir imité la continence de Joseph, fut persécuté par Marie d’Aragon, femme de l’empereur Othon. Il eut beau protester de son innocence, tout ce qu’il put obtenir, ce fut un combat en champ clos ; il fut vaincu et aussitôt décapité.
La comtesse de Modène ramassa la tête sanglante de son mari, et la déposa aux pieds de l’empereur en lui demandant vengeance. – « De qui ? dit l’empereur. – De vous-même, qui avez sanctionné une iniquité ; car je suis prête à prouver l’innocence de mon mari par l’épreuve du feu. »
Une barre de fer rouge placée au milieu d’un brasier ardent décida l’affaire ; la comtesse, la saisissant sans crainte, réclama de nouveau à Othon sa propre tête pour avoir fait périr un innocent.
La chronique ajoute que l’empereur, après avoir mûrement réfléchi, imagina comme moyen de conciliation de faire brûler sa femme, ce qui fut exécuté à Modène, en l’an du Seigneur 998.
Dans ces âges barbares, il n’y avait d’autre état pour la noblesse que le cloître ou l’épée, que chacun regardait comme sa seule sauvegarde.
Les tribunaux n’existaient que pour les femmes, les gens de robe, les bourgeois et les vilains. La force triomphait partout.
Cependant, le remède allait sortir de l’excès du mal. Une nouvelle carrière s’ouvrit sur un terrain que la loi semble impuissante à saisir, celui de l’honneur individuel. L’honneur, sentiment vague, irritable, impossible à définir, que l’État lui-même encourageait chez ses nobles et dont il remettait la défense à leur seule valeur. Ce qu’on appelle aujourd’hui « l’honneur » n’est, en réalité, qu’une transformation de l’antique chevalerie. Les aventures, qui ne manquaient pas d’abord au chevalier errant, protecteur des faibles et des opprimés, ont disparu devant l’organisation d’une bonne police ; mais, en mourant d’inanition, la chevalerie nous a laissé un code fantaisiste qui s’est plus ou moins modifié. Les lois de l’honneur, les motifs pour lesquels on doit se trouver offensé, la manière d’obtenir une réparation, la marche à suivre, les privilèges de l’offensé les devoirs des seconds et autres points de la matière furent exposés dans d’innombrables volumes et discutés avec toute la subtilité du Moyen Âge.
Les écrivains spéciaux ne reconnaissent pas moins de trente-deux espèces de démentis !
L’Italie fut l’arène où ce nouveau genre de combat singulier, le duel moderne, se déploya avec le plus de fureur ; c’est aussi l’Italie qui produisit les traités les plus estimés sur le sujet, les meilleurs armuriers pour les armes usitées dans les combats de cette nature, et les plus célèbres maîtres d’escrime. De là, cette coutume se répandit avec fureur en France, en Espagne, en Allemagne. En Angleterre, elle ne parut prendre racine qu’au temps des Stuarts.
C’est la France qui fournit les plus riches matériaux à l’histoire du duel.
Quand Charles IX institua une cour d’honneur, la France était devenue un champ de tuerie.
Les guerres d’Italie et de la Ligue, jointes au relâchement des liens moraux et religieux, avaient amené un tel état social que, pendant les vingt années du règne de Henri IV, et malgré tous ses édits, il ne périt pas moins de quatre mille personnes en duel, et quatorze mille délinquants obtinrent leur grâce. Chiffre effrayant, si l’on songe au petit nombre de gentilshommes qui avaient alors le droit de porter des armes.
Le mal n’en resta pas là, car lorsque l’on n’obtenait pas satisfaction loyalement, il n’était pas moins honorable de la prendre d’une autre manière. Montaigne dit : « Mettez trois Français dans le désert de Libye, ils n’y resteront pas un mois sans se battre. »
Brantôme fait l’éloge d’un digne gentilhomme de la Franche-Comté qui tua son ennemi d’un coup d’épée sous le porche d’une église, et de deux autres qui se battirent dans une église, devant l’autel, pour décider lequel des deux devait être encensé le premier.
Le fils aîné du duc de Guise tua le comte de Saint-Pol dans les rues de Reims, et deux ans après, il était gouverneur de la Provence.
Si le roi récompensait, les dames françaises adoraient ces nouveaux gladiateurs.
Lord Herbert dit dans un passage de ses lettres :
« Toutes choses étant prêtes pour le bal, et moi me trouvant près de la reine Anne, attendant que les danses commençassent, quelqu’un frappa à la porte plus fort, à ce qu’il me sembla, qu’il ne convient à un homme bien élevé. Quand ce visiteur entra, j’entendis circuler une rumeur parmi les dames. On se disait : C’est monsieur Balagny ! Puis je vis les dames, l’une après l’autre, l’inviter à s’asseoir près d’elles et, lorsqu’il s’arrêtait quelques minutes, une autre arrivait bientôt qui réclamait : “Vous l’avez gardéassez longtemps ; à mon tour, maintenant. ” Ce qui m’étonnait surtout, c’est que cet homme n’était pas beau ; ses cheveux presque gris, un pourpoint de gros drap et des culottes d’étoffe commune. En prenant des renseignements sur ce personnage, j’appris que c’était un des hommes les plus braves du monde et qu’il avait tué huit ou neuf personnes en duel, et que c’était pour cela qu’il était si recherché des dames. »
La folie était générale. Ignace de Loyola défiait en combat singulier tout Maure qui oserait nier la divinité de Jésus-Christ. Le cardinal de Retz se battait deux fois pendant la Fronde, et le cardinal d’Este présidait un duel à Ferrare.
Ce n’étaient pas seulement l’offenseur et l’offensé qui se battaient ; leurs seconds, leurs troisièmes, leurs quatrièmes témoins mettaient aussi l’épée à la main, sans jamais avoir eu l’ombre d’une querelle, sans même se connaître.
Pour juger de l’esprit qui présidait à ces rencontres sanglantes, on n’a qu’à voir le ton plaisant et léger sur lequel en parle Brantôme. Il nous entretient avec délices de ce « très beau combat » livré entre Quélus et d’Entragues avec leurs seconds, ces derniers se battant « par envie de mener les mains ». Il est fier de dire au lecteur que, sur six combattants, quatre périrent, et c’est sans aucun étonnement qu’il raconte que d’Entragues dut la victoire à une dague dont il s’était armé, contre les conventions du combat.
C’était là l’âge d’or de l’honneur et de la chevalerie. Qu’est-ce donc que ce temps si regretté et quels fruits a-t-il produits ? Lorsque Bayard, sans peur et sans reproche, tuait au nom de la courtoisie, de l’honneur et de la religion don Alonzo di Soto Maïor, Machiavel écrivait le Prince, les Borgia empoisonnaient, volaient et se livraient à l’inceste ; les Sforza à Milan, et les Médicis à Florence suivaient leur exemple infâme ; un pape mourait empoisonné par une hostie, un autre pontife bénissait le massacre de la Saint-Barthélemy, Philippe II versait des flots de sang, la cour de Henri VIII était le repaire de la lâcheté, de l’apostasie et des massacres judiciaires. En fait, l’immoralité, la licence, l’athéisme pratique trônaient souverainement par toute l’Europe, à cette époque des preux chevaliers qui, par leur conduite et leurs mœurs journalières, insultaient à cet honneur dont le nom était sans cesse sur leurs lèvres.
Que penser de la loyauté d’un sieur Malcoolm, qui, après avoir dépêché son adversaire, vint à l’aide de son second en disant à la victime de ce guet-apens : « J’ai tué mon homme, c’est vrai, mais si nous restions seul à seul, vous pourriez me tuer à votre tour !… Ne soyez donc pas surpris si je prends mes précautions ! »
Que dire de la générosité d’un neveu du maréchal de Saint-André qui, s’étant pris de querelle dans une partie de chasse avec un ancien officier nommé Matas, se vit bientôt désarmé par lui. Matas ramassa l’épée et la rendit courtoisement à son adversaire. Celui-ci la reprit en s’inclinant puis, saisissant son moment, il assassina par-derrière son trop confiant ennemi. Et savez-vous qui fut blâmé ? Matas, qui avait eu le tort de vouloir « donner une leçon de courtoisie à cet honorable jeune homme ! »
Lord Singuhar avait perdu un œil en s’exerçant avec un certain Turner, professeur d’escrime. Quatre ans après, il était présenté à Henri IV, et celui-ci demanda si l’homme qui lui avait fait cette blessure était encore en vie.
Le lord crut qu’il était de son honneur de retourner en Angleterre, d’y prendre à sa solde une bande d’assassins et de faire assassiner le malheureux maître d’armes à qui il avait pardonné.
À Milan, il ne se passait pas un jour où l’on ne trouvât sur la voie publique des cadavres abandonnés. Des gens y venaient de tous les coins de l’Europe pour y cultiver le noble art de l’escrime, et surtout pour y apprendre des feintes et des bottes secrètes.
Le baron de Mittaud, voulant venger la mort de son frère, assassiné par Duprat, le Parangon de France, provoqua ce dernier en duel. Le baron, s’étant muni sous ses habits d’une cuirasse couleur de chair, perça tranquillement son adversaire d’outre en outre.
Tels étaient les duels, tels étaient les héros et les hommes d’honneur de cette époque trop vantée. Aussi ne doit-on pas s’étonner si, avec la marche de la civilisation, le législateur songea partout à réprimer ces excès.
Le duel fut prohibé en Portugal sous peine de la confiscation des biens et de la déportation en Afrique. En Suède, il fut puni de mort. Des édits très sévères furent rendus par François Ier, Charles IX et Henri IV, mais ils restèrent sans effet. La sévérité de Louis XIII ne produisit que peu de résultats, bien qu’il ait fait un grand exemple en faisant exécuter un Montmorency sur la place de Grève.
Louis XIV rétablit la cour d’honneur et menaça de la peine de mort, avec forfaiture de rang, d’honneur et d’état, tous ceux qui oseraient se compromettre dans un duel.
Cette rigueur excessive manqua encore son objet. Le duel seréveilla bientôt avec une licence caractéristique de l’époque. Lauzun, Saint-Évremont et le duc de Richelieu donnèrent l’exemple, que suivirent les femmes elles-mêmes. La marquise de Nesle et la comtesse de Polignac se battirent au pistolet pour l’honneur de la possession d’un Richelieu. Le plus fameux des duellistes féminins fut une cantatrice de l’Opéra, la Maussin, qui, formée par le baron de Sévane, l’un de ses amants et célèbre maître d’escrime de ce temps-là, tua trois hommes en combat singulier et s’enfuit à Bruxelles, où elle devint la maîtresse de l’électeur de Bavière.
Ne connaissant pas votre ouvrage, mon cher de Vaux, au moment où je retrace à grands traits l’histoire du duel, je m’arrête pour ne pas empiéter sur vos récits.
Dans la plupart des États européens, les lois relatives au duel ont subi des modifications qui, en les rendant moins sévères, ont produit d’heureux effets.
Dans la pratique, il n’est pas probable que la loi ait jamais prévenu un seul duel ; ce qu’elle a obtenu, c’est de forcer les duellistes à se battre loyalement. C’est, à mon avis, un résultat que l’opinion publique et les sentiments d’honneur contemporain, qui est un honneur raisonné, eussent parfaitement obtenu sans les législateurs.
À MONSIEUR LE BARON DE VAUX
Le point d’honneur, mon cher de Vaux, est presque toujours cause des duels qui ont lieu, car, à tort ou à raison, l’amour-propre fait dépendre la bravoure de ce mot, qui se montre cependant souvent faux et rarement vrai.
La plupart du temps, c’est le faux point d’honneur qui met en présence deux galants hommes ; notre susceptibilité pointilleuse, notre orgueilleuse prévention nous portent toujours à croire que notre honneur est effleuré par une négation, par un défi, par un regard ou un propos.
Rien n’est plus extravagant, rien n’est plus dangereux que cette fausse opinion que l’on a du Point d’honneur. Elle abuse et surprend tout le monde, et il n’y a pas à dire, nous nous y soumettons tous. La crainte seule d’un mépris bien ou mal fondé nous trouble et nous porte à croire de suite que nous sommes offensés. Voilà comment le faux honneur se substitue à la place du véritable, qu’il établit des décrets à la pointe de l’épée ; que chacun se soumet à ses dangereuses maximes par la force du préjugé, et que l’on prend l’opinion énoncée pour la loi, l’erreur pour la vérité, la fierté pour la grandeur d’âme, la brutalité pour la douceur, l’injustice pour l’équité et la sottise pour la raison.
C’est du faux point d’honneur dont sont nourris tous ces Rodomonts et ces don Quichottes qu’on rencontre à chaque pas dans la vie. Trop orgueilleux pour s’humaniser, ils regardent leurs concitoyens avec une telle impertinence qu’ils semblent vouloir mettre flamberge au vent pour un oui ou pour un non.
Qu’y a-t-il de plus commun que de rencontrer des gens vraiment perdus de réputation, qui veulent se battre pour soutenir et conserver l’honneur, ce bien précieux qu’ils n’ont plus ? Si on leur reproche l’injure, le mensonge, la mauvaise foi, ils vous provoquent de suite en duel. Cependant, qui mérite d’être vraiment puni, ou du plaignant, qui est en droit de reprocher, ou de l’homme sans honneur qui, ne pouvant plus rougir de rien, s’offense de la vérité et ose se battre contre elle ? Il en est d’autres encore qui, ne voulant pas revenir sur une parole dite mal à propos, se font un point d’honneur de ne pas se dédire ; et parce qu’ils ne veulent ni s’excuser ni avouer qu’ils ont dit une bêtise, ils se battent et se font tuer.
Ce n’est pas ainsi que se comprend l’honneur, car l’honneur, a dit un savant, n’est point variable ; il ne dépend ni des temps, ni des lieux, ni des préjugés ; il ne peut passer ni renaître ; il a sa source éternelle dans le cœur de l’homme et dans la règle de ses devoirs.
Autrefois, il existait, dans l’armée prussienne, des Tribunaux d’honneur, chargés d’entendre toutes les affaires qui pouvaient amener une rencontre entre deux officiers. La mission de ces tribunaux était surtout de prévenir les duels.
Je voudrais bien qu’une institution de ce genre existât chez nous, car il est plus que probable que presque tous les duels dont parlent chaque jour les journaux n’auraient pas lieu.
Oui, mon vieux camarade, presque toujours, c’est un faux point d’honneur qui est la véritable cause de la rencontre.
Mais si l’on m’injurie, me dites-vous, si l’on attaque ma réputation, mon honneur, devrai-je me battre ? « Oui », évidemment, car votre défense devient aussi légitime que forcée, et, dans ce cas, c’est un point d’honneur vrai, légitime, naturel et raisonnable. On se doit le soin de défendre son honneur, sa réputation. Ce serait même une chose indigne d’un homme de ne pas relever la chose.
Le point d’honneur donc commande la défense et répudie l’agression.
À vous,
Marquis DE CASTELLANE-NORANTE.
Versailles, le 5 juin 1883.
HIER ET AUJOURD’HUI
Le livre que j’offre aujourd’hui au public n’est point le livre rêvé par Sthal ; ce n’est point non plus une chronique scandaleuse, c’est le récit des principaux duels qui ont eu lieu pendant ces vingt dernières années, et qui n’ont pu trouver place dans l’excellent ouvrage d’Émile Colombey : l’Histoire anecdotique du duel. J’ai laissé de côté les duels burlesques et comiques, pour ne raconter que ceux qui ont un caractère sérieux ou une fin dramatique. J’ai puisé, aux sources les plus sûres, tous les documents qui composent cette espèce d’Encyclopédie du duel. Si, par impossible, ces sources m’avaient fourni quelquefois des renseignements erronés, je serais prêt, cela va sans dire, à rectifier les erreurs que j’aurais commises involontairement. Quoique la plupart des duels que je rapporteappartiennent à l’histoire, j’ai omis, à dessein, tout ce qui pouvait blesser des contemporains.
Je n’ai eu qu’un but en écrivant ce livre : celui de montrer qu’il existe encore, en France, des idées chevaleresques et du courage.
Ce n’est donc pas un réquisitoire contre le duel que je présente, car je suis de l’avis de M. Guizot, qui disait au maréchal Clauzel, lors de la discussion du projet Dupin : « Sans les duels, pas de salons ; il n’y a que des cabarets. »
On a beaucoup parlé pour, contre et sur le duel, mais je crois et j’espère qu’on n’arrivera jamais à faire une loi sur le duel. On l’a tenté bien des fois, depuis le Code de 1810 ; aucun projet n’a abouti.
Proposer d’édicter une loi sur le duel à l’heure présente équivaut à peu près à la proposition de rétablir la Censure. Il semblait admis, en effet, que sur ces deux points, du moins, la liberté absolue était conquise.
Après avoir été l’objet d’autant de lois, d’édits et de décrets que la presse, le duel a survécu comme elle à toutes les législations ; comme elle, il était entré, avant la malencontreuse intervention de M. Griffe, dans cette phase qui, si elle n’est pas la liberté complète et consentie, est, du moins, la tolérance absolue imposée par la force des choses.
Le duel et la presse, d’ailleurs, sont tous deux de même nature ; insaisissables tous deux et échappant aux réglementations les mieux combinées, ils représentent l’un et l’autre cette puissance indéfinissable et vague qui s’appelle : l’opinion.
Un coup de poing qui vous démolit la mâchoire fait-il plus de mal qu’un gant qui vous effleure le visage ? Cela est indiscutable, et cependant celui qui aura reçu un coup de poing se contentera très volontiers d’une réparation par les tribunaux, tandis qu’un geste seul, qui n’aura eu aucun résultat matériel, demandera du sang.
« Quel coup de poing ! » s’écrie Talleyrand en recevant un léger soufflet de Maubreuil, et, par ce mot prononcé avec une présence d’esprit admirable, le grand seigneur, si vraiment Français en dépit de sa corruption, venait de supprimer l’outrage par le seul fait qu’il aggravait le délit.
Que voulez-vous que les tribunaux fassent contre cette loi sociale, qui est en dehors de toutes les lois du Code ?
L’idée de faire une loi contre les duellistes n’est pas nouvelle. Depuis 1815, presque toutes les Assemblées s’y sont essayées ; il y a eu deux projets de loi sur le duel mis à l’étude sous la Restauration, trois sous le gouvernement de Juillet, un sous la République de 1848. Celui-ci sera donc le septième, et il serait téméraire d’affirmer qu’il sera le dernier.
D’où sont venues jusqu’à ce jour les difficultés exceptionnelles qui ont empêché de rédiger ce chapitre de législation pénale ? De deux causes, l’une qui tient aux difficultés particulières du sujet au point de vue juridique ; l’autre, qui résulte de ce produit des mœurs et de l’opinion qu’on appelle le préjugé.
Au point de vue juridique, la question du duel a soumis à de singulières épreuves la science des criminalistes et la doctrine des tribunaux. Rien n’est en effet plus difficile à commenter que le silence de la loi. Or, depuis 1789, aucune loi criminelle n’a parlé du duel : ni le Code pénal de 1791, ni le Code des délits et des peines de l’an IV, ni le Code pénal de 1810 ; et l’on en est encore à se demander si le législateur moderne a voulu punir le duel. Merlin déclarait que non. Ce jurisconsulte si ferme et si sagace, qui avait assisté de près à toute l’œuvre législative de la Révolution et de l’Empire, qui en avait été l’un des interprètes les plus autorisés comme procureur général à la cour de cassation, Merlin n’hésitait pas à soutenir que ni le duel ni ses suites les plus meurtrières n’étaient atteints par la loi pénale. « Le silence de la loiéquivalait, disait-il, à une prohibition expresse depunir les duellistes qui avaient loyalement observé dansle combat, quelle qu’en fût l’issue, les règles qu’ilss’étaient réciproquement imposées par leur convention préalable. » Telle était la réponse qu’il faisait, en 1812, à un procureur général qui le consultait sur des poursuites à engager contre un duelliste qui avait tué son adversaire.
Jusqu’en 1837, l’opinion de Merlin fut partagée par la cour de cassation et par presque toutes les cours d’appel. Le petit nombre de cours dissidentes qui croyaient devoir renvoyer en cour d’assises les champions et les témoins de duels malheureux, voyaient leurs arrêts impitoyablement cassés par la cour suprême. (Arrêts de 1819, 1821, 1822, 1827, et deux arrêts de chambres réunies, décembre 1824 et août 1828.)
En 1837, tout changea de face. La cour de cassation, entraînée par des conclusions pressantes de son procureur général, M. Dupin, – et aussi, il faut le reconnaître, par un mouvement assez vif de l’opinion, – déclara pour la première fois, par arrêt du 15 décembre 183 y, que les peines du Code pénal étaient applicables aux meurtres et blessures résultant d’un duel. Depuis lors, la jurisprudence n’a plus varié.
La doctrine judiciaire actuelle, pour appliquer au duel des lois qui n’en font pas mention, a été ainsi amenée à ériger en une sorte d’article de foi juridique le propos humoristique qu’on a attribué au conseiller d’État Treilhard. Un jour qu’on lui demandait pourquoi le Code pénal (dont il était un des principaux rédacteurs) n’avait pas parlé du duel : « Nous n’avons pas voulu, dit-il, faire au duel l’honneur de lenommer. » – Boutade spirituelle si elle n’était que l’expédient d’un législateur embarrassé ; mais singulière réponse, on en conviendra, venant d’un criminaliste qui est bien obligé de faire aux plus laides actions l’honneur de les nommer, s’il n’aime mieux leur faire l’honneur plus grand encore de les absoudre par son silence ; – réponse non moins étrange si elle est celle d’un moraliste ; car refuser de faire aucune différence entre les coups portés en duel et les violences brutales et déloyales que le Code qualifie assassinat, coups et blessures volontaires, c’est méconnaître la réalité des choses et l’impression instinctive de la conscience.
Or, ce souffle puissant, qui est la conscience publique, ne confondra jamais le duel avec l’assassinat. Les échafauds élevés par le cardinal de Richelieu pour y faire tomber lestêtes des duellistes n’empêchèrent pas les duels entre gentilshommes. La religion même, qui dompte tant de passions, est impuissante pour rendre l’homme insensible à l’injure.
Deux ou trois juges pourront punir un maréchal Bugeaud pour avoir mis une balle dans la tête d’un insolent, mais la conscience publique absoudra ce vétéran jaloux de son honneur.
Quoi qu’il en soit, nous vivons depuis 1837 sur cette idée d’assimilation légale entre le coup d’épée sur le terrain et le coup de couteau au coin d’un bois. L’assimilation étant fausse en elle-même, il n’est pas surprenant qu’elle n’ait jamais été observée ni par le ministère public, ni par les juges, ni surtout par les jurés. Elle ne l’est pas davantage par MM. les députés, qui, de temps à autre, envoient ou reçoivent des cartels avec une conscience aussi peu troublée que s’il s’agissait de simples communications parlementaires.
Le duel, à mon idée, n’est pas justiciable de la loi pénale. Dites tout ce que vous voudrez contre le duel : qu’il est un reste de barbarie, qu’il est contraire à la notion du juste et de l’injuste, qu’il tend à faire résider le droit dans la force, vous n’arriverez jamais à établir la légitimité d’une mesure assimilant le duel à un délit.
Comment la loi pénale, sans cesser d’être juste et aussi d’être conséquente avec elle-même, atteindrait-elle un cas qui, le plus souvent, trouve sinon sa justification, au moins son excuse dans la loi même, impuissante à dénouer pacifiquement les situations que l’épée tranche. La loi n’a pas à venger, mais elle devrait réparer. Est-ce que la loi sur la diffamation, qui n’admet pas la preuve, répare quelque chose ? Est-ce qu’il est possible de la concevoir et de la faire réparatrice ? L’admission de la preuve à l’audience entraînerait des abus monstrueux, créerait une prime au chantage et mettrait le repos et l’honneur des plus honnêtes gens à la merci du premier malfaiteur venu. Où sera donc la réparation pour le diffamé, si le duel est non seulement condamné, mais flétri par la loi ?





























