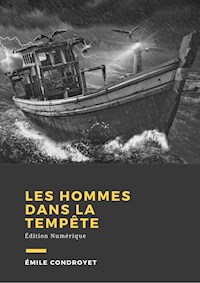
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Librofilio
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Le phare est seul comme le génie.
Le phare possède l'harmonie d'une architecture parfaite et la rigueur d'un chiffre.
Le phare dissipe l'équivoque mortelle des nuits en mer : il est l'étincelle d'intelligence précise qui brille dans le désordre de la nature.
Le phare est donc devenu symbole. Mais quoique la clarté n'engendre pas le mystère, le phare sue toujours le mystère, parce qu'il est le témoin muet de la tempête et de la mort, et qu'il est né lui-même de la mort. Le même éclat qui trahit salutairement l'écueil, veille pour les âmes de plusieurs bordées de fantômes. La lumière protège la vie en évoquant le trépas.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Emile Condroyer, né en 1897 et mort en 1950 est un journaliste, notamment au Petit Parisien, et romancier français. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la mer et la pêche. En 1933, il reçoit le prix Albert-Londres, qui récompense depuis cette année-là les meilleurs grands reporters francophones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Émile Condroyer
Les hommes dans la tempête
A M. FERNAND CROUTON
Bâtisseur de phares
ENFERS
Premières lueurs
Le phare est seul comme le génie.
Le phare possède l'harmonie d'une architecture parfaite et la rigueur d'un chiffre.
Le phare dissipe l'équivoque mortelle des nuits en mer : il est l'étincelle d'intelligence précise qui brille dans le désordre de la nature.
Le phare est donc devenu symbole. Mais quoique la clarté n'engendre pas le mystère, le phare sue toujours le mystère, parce qu'il est le témoin muet de la tempête et de la mort, et qu'il est né lui-même de la mort. Le même éclat qui trahit salutairement l'écueil, veille pour les âmes de plusieurs bordées de fantômes. La lumière protège la vie en évoquant le trépas.
L'antiquité alluma des feux. Ils se tordaient au vent de la nuit sur les caps. « Tel aux yeux des nautoniers que les vents entraînent malgré eux loin des rives amies, apparaît l'éclat d'un feu qui brûle dans un lieu solitaire au sommet d'une montagne... » Homère déjà chantait les phares.
Puis on bâtit des tours. Les feux brûlèrent sur la plate-forme comme une flamme au poing.
Ils brûlèrent ainsi pendant des siècles. Le dix-huitième les remplaça par des lampes à huile. Elles fumaient. Des réflecteurs sphériques renvoyaient mal leur douteuse lueur. L'ingénieur bordelais Teulère les remplaça par des réflecteurs paraboliques. En donnant à l'appareil un mouvement de rotation, il donna, avant Bourdelles, une personnalité au phare.
Mais Fresnel apparut avec ses lentilles et ses anneaux de cristal. Le phare changea d'aspect et presque d'âme. La lampe changea de physionomie. Elle perdit ses mèches concentriques et son huile au bénéfice du manchon et du gaz. Et même de l'arc et de l'ampoule électriques.
A cent quatre-vingts kilomètres de la pointe de Penmarch, la clarté métallique d'Eckmühl chavire maintenant dans la nuit de l'Océan.
Il fallut cependant consolider les tours pour porter les machines nouvelles, les hausser pour rendre leur lumière plus tutélaire. Il fallut en faire un abri pour la flamme et pour les hommes qui retrouvaient le vieil esprit des vestales. Les tours devinrent forteresses. Là aussi, Vauban mit sa marque. Enfin, elles s'élancèrent nues, pures, presque votives et, se multipliant, tracèrent à la mer ses frontières.
Cela ne pouvait suffire. Il fallait porter la lumière sur la mer même, révéler ces miettes de continent que l'Océan a conquises et dont il aggrave sa puissance.
Et l'on fit sortir des phares de la mer. Ce qui n'avait été jusqu'alors qu'intelligence et habileté devint héroïsme et épopée. Sept ans ici, neuf ans là, dix-huit ans ailleurs, un travail infernal, la lutte contre la vague, la patience de l'homme plus acharnée que l'acharnement de la tempête, parfois le sang sur la pierre, la mort : chaque phare en mer est à ce prix.
Accoudé à la galerie de granit de la tour du Créach, je regardais descendre le soir sur Ouessant. A cette épave de terre sans un arbre, sans un buisson, quelques points grisâtres se mouvant lentement accordaient un peu de vie : c'étaient ces moutons qui, réunis par une accouple, errent jour et nuit à travers l'île dont ils tondent à leur guise l'herbe salée.
La mer olivâtre et gonflée sous un ciel plein de nuées accusait, en la cernant de son écume, la forme en pince de tourteau qu'elle a donnée à Ouessant. Le vent froid emportait la rumeur des brisants dont la blême multitude s'étendait au delà de l'archipel de Molène, vers le continent qui n'était plus qu'une brume plombée.
Au pied même du phare peint de noir et de blanc comme pour un deuil perpétuel, la mer menait une charge monstrueuse et inlassable contre des rocs si formidables, si tourmentés, si acérés, si corrodés que, jusqu'à la sauvage pointe de Pern, ils semblaient une horde de géants apocalyptiques.
Très loin, vers l'ouest, parut le scintillement minuscule d'un de ces trente mille navires qui, chaque année, doublent l'île de l'épouvante. Il était rigoureusement quatre heures quarante-cinq minutes. Depuis un quart d'heure très précis le soleil avait dû se coucher.
Alors s'allumèrent les phares.
Le grondement des dynamos monta sous moi, du fond de cette tour sonore et creuse autant qu'un puits où, contre la paroi, l'escalier déroule son mince ruban hélicoïdal. Dans la cage de verre, au-dessus de ma tête, les charbons des arcs électriques commencèrent de grésiller. Et les optiques éblouissants comme deux énormes et féeriques diamants se mirent à tourner lentement sur leur disque de cuivre.
Des étoiles rouges ou blanches, surgies tout d'un coup, mettaient une note d'humanité dans cette désolation crépusculaire de l'île et de la mer. On en voyait sur tous les points de l'horizon. Elles clignotaient. Mais la nuit, peu à peu, révéla le tournoiement de leurs faisceaux, ce geste régulier d'un bras de lumière qui veut obstinément écarter l'ombre.
Le gardien-chef, désignant comme du centre d'un panorama toutes ces lueurs lointaines ou proches qui veillaient dans la nuit massive de l'Océan, faisait les présentations.
« Ici, les deux éclats rouges du Stiff, les cinq éclats blancs du Four, le feu de la Grande Vinotière, l'occultation de Kéréon, l'éclat de Kermorvan, celui de Saint-Mathieu, les trois occultations du Toulinguet... Plus près, oui, c'est l'éclat rouge des Pierres-Noires, et tout au fond le reflet blanc d'Eckmühl à Penmarch... »
Il les connaissait comme des camarades : « Là-bas, au sud, ce feu blanc ? Tévennec. Presque dans son alignement, le secteur rouge de la Vieille devant le Raz. Plus à droite, les quatre lueurs blanches du phare de Sein ; plus à droite encore, les trois d'ArMen. Et là, tout près, les trois éclats rouges de la Jument.... Dans tout cela il y a sept isolés, sept « enfers » quoi. Ici ? Oh ! ici, c'est un « paradis ».
Le goût populaire pour les classifications imagées a ainsi baptisé les phares : «paradis » ceux qui se dressent sur le littoral ou sur les larges îles, « purgatoires » ceux qui n'ont qu' un îlot comme base, « enfers » les autres, les isolés plantés dans la houle contre le fond brumeux des horizons marins.
Ceux-là ont acquis une manière d'âme héroïque. Aux yeux des marins, ils sont l'amical signal avancé de la terre. Aux yeux des terriens, ils sont l'âpre thébaïde de quelques hommes qui mènent volontairement une vie monacale où la tempête chante les offices. Et de l'abnégation même de ces hommes dont la présence garantit la sécurité de tant d'autres, le phare en mer se trouve auréolé.
La littérature, puisant une excuse dans son existence même, ne se donne pas des gants pour interpréter la vie de ces gardiens de phares. Forte des droits de l'imagination, elle réorganise tout à sa manière. Pourquoi ce romancier construit-il un phare sur une roche où il a été démontré depuis un quart de siècle qu'on n'y peut même pas sceller une balise ? Pourquoi y évoquer une histoire de pédérastie alors que jamais rien de semblable n'a été connu depuis qu'il existe des phares en mer et que les conditions mêmes de vie dans un phare, la psychologie des gardiens, sont la plus sûre protection contre ce vice littéraire ? Pourquoi Mme Rachilde rattache-t-elle à la Marine une administration qui n'a jamais relevé jusqu'à ces mois derniers que des Travaux Publics ? Pourquoi donne-t-elle à une histoire extravagante de vieillard lubrique le décor du phare d'Ar-Men, seul de son espèce au monde, alors que chaque notation révèle qu'elle ne sait à peu près rien de sa construction, de son agencement, de la vie qu'on y mène ? Je le regrette d'autant plus que ce sont là deux auteurs que j'aime.
Lorsque l'œuvre n'est pas purement imaginative, pourquoi ne pas respecter un peu plus la réalité. Ainsi éviterait-on des erreurs trop grossières. La sélection, l'interprétation sont à la base de tout art. Mais je ne pense pas qu'on y doive rattacher la méprise.
Seul peut-être, dans toute la littérature, qu'elle soit de qualité ou feuilletonnesque, le roman que M. Anatole Le Braz a écrit d'après un fait-divers légèrement modifié, possède le mérite de traiter d'une chose que l'auteur connaît bien.
Voilà un mérite que l'on trouvera contestable à une époque où l'on peut, au nom de la littérature, écrire sur la guerre, même si on ne l'a point vécue. Je n'en garde pas moins la conviction que, sortie de la fantaisie, de l'anticipation poétique ou de la psychologie, la littérature ne peut toucher à certains domaines trop précisément limités, trop fermés, trop exacts, sans s'être donné la peine de posséder là-dessus quelque opinion personnelle que seule l'observation directe peut fournir. Hors cela, on ne peut qu'aligner des mensonges et grossir la foule des poncifs.
Le tragique quotidien de l'existence des gardiens de phares en mer n'a pas besoin d'être ainsi pimenté. Tel est le sort, il est vrai de toutes les existences solitaires, — trappistes, morutiers, — d'enfiévrer l'imagination. En l'occurrence, la lente chute des heures dans un isolement forcené ne comporte-t-elle pas à elle seule suffisamment de grandeur ? La réalité est simple, terriblement simple.
Pour la bien connaître, c'est au large du Finistère qu'il faut venir la voir. Parmi les quelques sept cent cinquante feux qui jalonnent les côtes de France et de Corse, il convient de choisir ces « enfers » qui tressaillent sous le dernier ressac de l'Atlantique et se dressent en cierges funéraires sur cet immense cimetière de navires qui va d'Ouessant à la chaussée de Sein.
La Jument d'Ouessant
De la baie de Lampaul à l'îlot de Béniguet, tout le monde connaît le patron Créach, l'homonyme du phare.
C'est un petit homme sec, pas très causant, à l'œil qui porte loin et juste. Il est chargé par les Ponts et Chaussées de ravitailler les « isolés » d'Ouessant, tous les dix jours. Tous les dix jours, si la mer le permet ; on sait ce que parler veut dire.
Un matin, le patron Créach jugea que la mer était belle. Les vagues n'avaient que trois mètres de creux. A l'étale de flot, il prit donc la barre de sa vedette grise et mit le cap sur la Jument.
Plaqué contre la ciel diffus, à deux milles dans le sud, le phare, âpre comme un donjon, se dressait seul sur l'horizon haché. Le plus avancé de tous les « enfers », dans l'Atlantique, à une vingtaine de kilomètres du « continent », ainsi que disent les Ouessantins, il marquait l'entrée de cette zone où parmi les mufles noirs des rocs et le labyrinthe des écueils sous-marins, la mer bouillonne, crève, tourne et galope. Lorsque la vedette montait sur le dos d'une lame verte, on l'apercevait depuis sa coupole jusqu'à sa base qui était toujours environnée d'une blancheur de vapeur fusante.
Pour poser la sérénité de cette lampe à quarante-deux mètres au-dessus de l'exaspération continuelle de l'Océan, il a fallu sept ans d'un travail qui touchait au miracle. Il a fallu étudier la roche que chaque houle rinçait, en découvrir les fissures, la décaper à l'acide, la forer pour la hérisser de barres de scellement. Un courant de quatorze kilomètres à l'heure s'ajoutait au ressac de la mer du large. Pendant l'année 1904, on ne put accoster que quatorze fois et travailler au total cinquante-deux heures.
Puis il fallut mater la roche sous un cube cyclopéen de granit et de béton que des « épingles » de bronze rendent d'une cohésion primitive, et là-dessus ériger peu à peu la tour, sans se lasser ni se démoraliser si la tempête emportait en une nuit l'ouvrage de dix mois, si les fondations se lézardaient sous le bélier des vagues, si une lame de fond submergeant l'équipe des travailleurs agrippés sur ce chantier exigu se retirait en laissant un vide parmi eux...
Héroïsme des bâtisseurs de phares qu'on n'a jamais loués avec l'ampleur que méritent leur simplicité, leur courage quotidien et leur modestie !
Mais le voici enfin avec la hautaine impassibilité de l'intelligence dans l'aveugle déchaînement des forces.
Le patron Créach, penché sur la barre n'avait d'yeux que pour le cône blanc du coffre d'amarrage dansant à soixante brasses du phare. D'un coup précis qui contrastait avec le désordre de la mer, il lança la vedette à frôler le caisson qu'un homme crocha à la gaffe et mit en laisse avec un filin. Alors, assuré de pouvoir en cas d'urgence se haler hors de ces parages où les récifs qui ne découvrent jamais marbrent la mer de taches violacées, le patron Créach manœuvra à s'approcher du phare dans la partie où sa base offrait un abri relatif contre la houle.
La manœuvre n'avait l'air de rien ! Pourtant, à chaque seconde, sans cette poigne velue refermée sur la barre, la vedette risquait d'aller éclater comme une coquille contre le mur si farouche avec ses goémons noirs, ses chevelures d'algues vert acide et, plus haut, son granit nu, raclé, rongé, où la rouille d'un anneau avait longuement pleuré.
Par à-coups, dans un bouillonnement, l'embarcation s'élevait et retombait le long de la muraille dont une vague plus creuse déchaussait soudain le soubassement mystérieux. On installa un deuxième amarrage afin qu'elle pût se maintenir à une bonne dizaine de mètres de lui.
Quillé sur sa plate-forme, le phare nous dominait de sa sombre masse octogonale surmontée d'une espèce de tourelle crénelée comme un burg, où claquaient les cordes du mât à signaux. Le câble rouillé d'un vieux treuil grinçait au vent.
A dix mètres au-dessus de nous apparurent les trois gardiens vêtus d'une cotte bleue. Ils se tenaient sur l'espace ménagé entre le pied du phare proprement dit et le bord du cube de maçonnerie qui le porte. Ironie des mots : cet « espace » n'était pas plus large qu'un sentier de douanier, sans rambarde, ni garde-fou.
D'un geste de gaucho, le plus petit gardien tenta de lancer une corde jusqu'à la vedette. Au quatrième coup, l'extrémité alourdie par un morceau de bois tomba sur le plat-bord. Un homme de la vedette tira là-dessus, amena ainsi un filin plus épais dont les gardiens, sur la plate-forme, nouèrent l'autre bout au cartahu. L'un d'eux cria quelque chose que le vent emporta. Alors, sans quitter la barre afin que le bateau ne se mît pas à rouler comme saoul, le patron Créach commanda la manœuvre. Les hommes halant le filin firent descendre vers eux une sorte de sac cylindrique suspendu à un câble qui, partant d'un treuil scellé à la base du phare, montait pour tourner tout là-haut, près de la lanterne, dans la poulie d'une potence.
Pour si rudimentaire qu'il paraisse, il n'est pas de meilleur moyen d'accéder au phare. Le tout est de se bien tenir et de ne point s'énerver. Dès que le sac en toile à voile, bourré de cordes et d'étoupe, tomba sur le pont de la vedette, je m'assis sur lui comme sur un pouf étroit, et je me cramponnai solidement au grelin ainsi qu'on fait, sur les chevaux de bois, à la tige dont ils sont verticalement traversés.
Le patron Créach, qui parlait peu, parla à ce moment-là.
« Vas-y donc, cria-t-il, le nez levé vers la plate-forme. »
Et à moi :
« Parez à pas vous lâcher surtout... L'eau est froide. »
Les gardiens actionnèrent le treuil. Le bruit clair du cliquet s'égrena entre deux jappements de vagues. Tout au sommet du phare, dans le ciel morne, la poulie piaulait. Et je me sentis enlever, jambes pendantes, dans un doux balancement qui semblait être le résultat combiné de la houle, du vent et de quelque puissance magnétique du phare.
En dessous, la mer brisait, s'enfonçait, s'ébrouait, sautait à mes talons fuyants. Je n'avais plus de liaison avec la vedette que par le cordage que les hommes laissaient peu à peu filer avec précaution afin qu'une risée ne vînt pas aplatir le sac et sa cargaison contre le mur du phare.
Les gardiens tournaient toujours le treuil. Allais-je monter ainsi jusqu'à la poulie de la lanterne comme une araignée à son fil. Parfois le sac était pris de tournis. Alors, à quarante pieds dans les airs, un seul regard superposait le bras de la potence sur le ciel, la vedette se dandinant avec son fin patron qui ne me perdait pas de l'œil, la ligne brune d'Ouessant, l'horizon vide, la nier glauque, et tout contre le nez, le mur râpeux, énorme. Une troublante simultanéité d'images.
Parfois le sac retombait brusquement et s'arrêtait soudain pour remonter avec lenteur. Une mouche endormie... Ah ! desserrer un peu la main pour connaître l'émotion et aussi pour la délasser de cette crispation qui me laissait imprimé dans la paume le dessin des brins de chanvre ! Desserrer un peu... Mais inutile, le sac descend. Il descend vite même... Holà, holà ! Il va couler comme une goutte sur un carreau le long du mur à pic de la plate-forme visqueuse, barbouillée de bave.
Brusquement, un décalage. Un crochet de fer agrippa et attira le câble que je serrais à en avoir les muscles de l'avant-bras ankylosés. Les deux gardiens cessèrent de manœuvrer le treuil ; le troisième ralentit l'arrivée du sac sur le rebord de granit.
« Aujourd'hui, ça va tout seul, dit-il... Il fait beau. »
Tous trois eurent un mince sourire un peu triste. Ils se remirent en silence à renvoyer le câble pêcher dans la vedette des caisses de conserves.
Alors je me glissai vers la porte, en rasant les murs de la tour parce que le moindre faux-pas m'eût fait piquer une tête et que sur cette margelle où les gardiens se promènent parfois pour se dégourdir, des cormorans auraient malaisément tenu leurs colloques.
Vers la fin de l'après-midi, un vent glacé commença de poncer la mer brune où traînaient les reflets d'étain poli d'un soleil déclinant derrière un bourrelet de nuages gris. Sur l'horizon s'amenuisait la fumée d'un cargo. Des voiles noires couraient vers l'île de Molène.
Troboul, l'auxiliaire, rêvassait mains aux poches, sur la plate-forme. Le dos contre le mur, la casquette enfoncée sur des yeux qui semblaient toujours bouffis de sommeil, le col de son chandail bleu remonté par dessus le veston jusqu'aux oreilles, il regardait la mer.





























