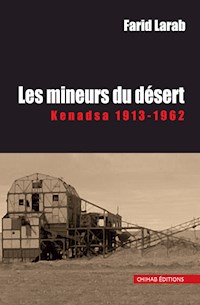
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Chihab
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Parti sur les traces des mineurs kenadsi, Farid Larab nous propose dans cet ouvrage ponctué de souvenirs et d’analyses, des témoignages recueillis auprès d’eux et des personnes ayant vécu la période de l’exploitation charbonnière. Par leurs différentes déclarations, l’auteur a mis à nu une situation professionnelle des plus démunie, et livré des informations relevant du domaine politique (pratique coloniales), organisationnel ainsi que des faits essentiels marquant la colonisation de Colomb-Béchar, à savoir les importantes explorations de la région effectuées à la fin du XIXe siècle et la résistance de la population autochtone.
L’auteur en parfait guide et ce, grâce aux archives et divers documents réunis, invite le lecteur à découvrir l’itinéraire d’une vie empreinte de souffrance, de risques auxquels ces anciens mineurs étaient exposés durant leur carrière professionnelle mais par dessus tout, d’une prise de conscience, ayant débouché sur des grèves et luttes. Puisant dans la mémoire de toute une génération, cet ouvrage constitue une contribution considérable apportée à l’Histoire.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Farid Larab est titulaire d’une licence en bibliothéconomie et sciences documentaires à l’université d’Alger. II y travaille en tant que cadre archiviste à l’entreprise nationale des Travaux aux puits de Hassi Messaoud.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
LES MINEURS DU DESERT KENADSA 1913-1962
FARID LARAB
LES MINEURS DU DESERT KENADSA 1913-1962
CHIHAB EDITIONS
© Éditions Chihab, 2013.
ISBN : 978-9947-39-035-1
Dépôt légal : 3913/2013
Tél. : 021 97 54 53 / Fax : 021 97 51 91
www.chihab.com
E-mail : [email protected]
À ma femme et à mon fils Amar
à la mémoire de mes grands-parents et à celle de Hachimi Larab, tombé au champ d’honneur.
Remerciements
Je remercie en particulier Monsieur Djerbal Daho tant pour ses précieuses appréciations que pour son aide quant à la publication de mon manuscrit.
Tout comme je remercie Ouhachi Tahar (enseignent à l’Université de Tizi-Ouzou), Guerbi Boudrina (retraité des Travaux publics de la Wilaya de Béchar), Khennache Rabah (cadre administratif auprès de la wilaya de Béchar), Bouhazma (fonctionnaire auprès du CIAJ de Béchar ) et Mademoiselle Chominot Marie (historienne, docteur à l’université Paris VIII).
Sans oublier tout le personnel du service des Archives de la wilaya de Béchar et ce, pour leur assistance et soutien.
Avant-propos
Au cours de mon court séjour à Béchar, j’ai été fasciné tant par la beauté de son relief géographique que par ses sites touristiques. Les montagnes, les ergs, les oueds et les vallées forment un paysage mosaïque et exceptionnel au sein de cette région désertique. Des sites témoignant du passage de l’homme à travers l’histoire se distinguent nettement presque à travers toutes les localités. Ce riche patrimoine est composé de gravures rupestres, de ksour, de palmeraies, de tombes géantes et entre autres la fameuse mine de charbon de Kenadsa.
La rudesse du climat et le facteur de l’isolement rendent parfois la vie aux Sahraouis très pénible. Car la région est caractérisée par un climat désertique et continental : très chaud en été, jusqu’à 45° et très froid en hiver avec 2° à 3°, auquel s’ajoutent des vents de sable parfois très violents. Ce désagrément climatique offre en revanche aux autochtones une force de méditation, qu’ils expriment par un véritable sentiment d’hospitalité et de chaleur humaine. Le Béchari aime partager avec le visiteur les secrets et la beauté de sa région. Une randonnée chez lui, finit toujours, comme l’exige la tradition, par une invitation somptueuse autour d’un bon couscous et d’un délicieux verre de thé.
A vingt kilomètres au sud-ouest de Béchar, de la vaste étendue de sable, jaillit Kenadsa. Réputé depuis l’ère coloniale pour son gisement et son activité minière, Kenadsa demeure de nos jours, une escale obligatoire pour les visiteurs. Des traces d’un métier disparu, tels les lavoirs, les galeries (sièges d’exploitations), la station thermique et les gigantesques montagnes de résidus de charbon, ne sont que des restes d’une activité minière, qui s’est exercée durant la colonisation française de l’Algérie.
Ce legs permettra certes à la région de relancer le secteur du tourisme et de créer des richesses. Néanmoins, celui-ci présente quelques inconvénients d’ordre sanitaire et écologique. En effet, ces immenses montagnes noires de résidus de charbon que les Bécharis appellent communément le coke portent sérieusement préjudice à la santé publique et particulièrement à l’équilibre de la biodiversité. Ce coke est constitué de déchets provenant du lavoir (triage du charbon) ainsi que des fonds des galeries (couche superficielle couvrant le charbon). Telles sont les décharges qui ont modifié le paysage de Kenadsa et de Béchar-Djedid. Et nul ne pourra traverser ces deux localités sans être interpellé par ces « reliefs » de montagnes noires qui sont le résultat d’un demi-siècle de déversement.
Ce « désastre » écologique commence, de nos jours, à préoccuper sérieusement les autorités locales et la société civile de la région, car les spécialistes ont recensé plusieurs cas de maladies dermatologiques et respiratoires. Des tentatives, qui ont été opérées par des associations écologiques locales en vue d’endiguer ce phénomène n’ont, à ce jour, donné aucune satisfaction.
Ce site historique, tel un musée à ciel ouvert, occupant une vaste superficie au sein de ces deux localités de la région de Béchar, n’a été l’objet jusqu’à nos jours, d’aucune étude et réflexion. Une politique de réhabilitation de ces vestiges et leur classement parmi le patrimoine matériel et immatériel de l’Algérie mérite sérieusement d’être engagée.
Cet espace qui est totalement délaissé et qui dissimule des secrets relevant du domaine de l’histoire contemporaine, offre au chercheur un travail très fastidieux. Car, à ma connaissance, il existe très peu d’ouvrages traitant ce sujet. L’absence de sources bibliographiques, à savoir les ouvrages et autres publications, nous a amenés à nous investir beaucoup plus sur le terrain.
Notre investigation consiste à recueillir au préalable des témoignages auprès des anciens mineurs et des personnes ayant vécu la période de l’exploitation charbonnière.
Cela nous a conduits ensuite à nous rapprocher du service des Archives de la wilaya de Béchar pour cerner et sélectionner les documents traitant de notre sujet de réflexion.
Les visites effectuées au niveau du « Musée » de Kenadsa nous ont permis à la fois de vérifier les propos de nos témoins mineurs et de recueillir des données concernant notamment le volet technique du métier de mineur, à savoir la conception et la répartition des puits, les techniques d’extraction de charbon et l’équipement utilisé, et autres. Nous insistons fortement sur l’absence de publications concernant l’histoire des anciens mineurs de Kenadsa et pour cela nous nous permettons de qualifier le présent travail de recherche d’inédit.
Pour nous permettre de réunir des données et surtout pour insérer notre sujet dans son contexte historique, il nous reste donc, que les archives et les témoignages oraux comme unique source d’informations. En premier lieu, nous avons procédé de manière séquentielle au dépouillement des archives se trouvant au niveau du service des Archives de la wilaya de Béchar. Malgré l’inexistence d’instruments de recherche et le désordre des boites d’archives sur les rayonnages, nous avons pu quand même recenser suffisamment de références et d’indications.
La présentation de manière brute des données (données non encore traitées) nous a obligés à faire appel à d’autres types de documents dans l’intention de coordonner nos idées et de cadrer le sujet. Ainsi, grâce aux monographies (découvertes par hasard dans ce même service), nous avons pu retracer l’enchaînement des événements et établir notre préalable méthodologie. D’autres sources, qui demeurent de nos jours, des supports incontournables pour tout historien, à savoir les témoignages oraux ont été minutieusement exploités.
Les différentes déclarations des anciens mineurs nous ont servis pour illustrer la situation socioprofessionnelle des mineurs et décrire leur métier.
Quoique, durant les entrevues, ces anciens mineurs ont livré quelques informations relevant du domaine politique (pratiques coloniales) et organisationnel (gestion des Houillères du Sud-Oranais de Kenadsa), que nous avons complétées et avons trouvé concordance (recoupement) au cours de notre consultation des archives et de dépouillement de plusieurs titres de journaux.
Notre recherche repose donc sur des procès-verbaux de réunions et d’élections syndicales, un compte-rendu détaillé du Conseil d’administration des Houillères du Sud-Oranais, des procès-verbaux de rencontres entre les mineurs et la sécurité sociale, un rapport détaillé sur la gestion financière des HSO, élaboré par un commissaire aux comptes français et nous avons consulté quelques statuts et textes de réglementation.
Une copie d’un film documentaire évoquant la présence « positive » de la France à Colomb-Béchar (CB), nous a été remise par un fonctionnaire du Centre d’information et d’animation aux jeunes (CIAJ) de cette même wilaya. Un énorme obstacle est à signaler quant au décryptage et à l’analyse des données car le support audiovisuel ne porte aucune mention ou générique. Ces deux indications pourraient en effet nous renseigner sur l’auteur du court-métrage ainsi que sur la date de sa réalisation. C’est grâce à la visualisation répétée de la bande et à notre forte concentration sur quelques dates d’institutionnalisation de sociétés et d’infrastructures que nous avons pu situer le film dans le temps.
Un ensemble de publications ont également contribué à l’enrichissement de nos idées. Cette documentation nous a servis de repères et nous a donnés des indications sur l’histoire et les origines du nationalisme algérien et sur le mode de fonctionnement du syndicat.
Au cours de notre recherche, notre attention s’est portée essentiellement sur la reconstitution des événements vécus par les mineurs, voire les conditions de travail et précisément leur lutte ouvrière et syndicale.
On ne peut évoquer la mine de Kenadsa, sans toutefois mettre en exergue les faits essentiels marquant la colonisation de Colomb-Béchar, à savoir les importantes explorations de la région qui ont été effectuées juste à la fin du 19e siècle, la résistance de la population autochtone face à la présence des troupes françaises, le recours par l’armée française à la force (artillerie militaire) et à la douceur (désenclavement de la région par la voie ferrée étroite) en vue de pacifier la population autochtone, les ambitions économiques françaises et l’extension du chemin de fer pour conquérir l’Afrique noire et enfin les raisons ayant incité la société des Chemins de fer algériens d’autrefois à exploiter le gisement minier de la région de Kenadsa.
Concernant l’exploration de la région, nous avons constaté qu’aucune publication n’a évoqué le ksar d’Igli, qui fut bel et bien le premier jalon de l’extension et de l’occupation militaire de Colomb-Béchar. La construction d’une Redoute (forteresse), à proximité de ce ksar, engendrant désormais l’installation en 1901, du premier poste militaire, n’était qu’un indice révélant réellement la forte concentration des études géographiques et ethnologiques qu’avaient effectuées les explorateurs français sur Igli et sa population autochtone.
Aujourd’hui, les artisans de ce grand patrimoine historique, la mine de Kenadsa, ont farouchement envie de transmettre à leurs enfants les secrets de leur métier ; un métier qui ne s’exerce plus de nos jours en Algérie. Hélas, la maladie de la silicose qui les ronge quotidiennement et l’inexistence de structures d’accompagnement (associations et autres) n’ont fait qu’enfoncer ces « Gueules noires » dans les ténèbres de l’anonymat.
Aucun effort n’a été engagé pour réhabiliter ce valeureux héritage, excepté une statue érigée juste à l’entrée de Kenadsa représentant un mineur poussant un chariot rempli de roche fossile et un musée édifié au centre de cette même localité. Ce musée abrite des objets et des photos retraçant l’histoire et la genèse de la mine.
Si le musée existe, le grand mérite revient à un certain Limanci Mohamed. Le souci de rendre hommage aux anciens mineurs a incité ce fonctionnaire de l’Assemblée populaire communale (APC) de Kenadsa à initier une campagne de collecte de documents et d’objets susceptibles d’apporter des témoignages sur l’activité minière. Une fois réuni, le modeste legs est acheminé vers l’APC. Les objets et les documents récoltés sont ainsi déposés sur une grande table.
Propulsé par ses ambitions, ce bénévole a tenté de mener une action de grande envergure ; celle-ci consiste à ramener ne serait-ce que l’essentiel du passif (ensemble de documents d’archives et d’objets utilisés durant l’extraction de charbon) de l’entreprise minière se trouvant au siège de la daïra de Kenadsa. Après concertation avec les responsables locaux concernés, une partie de ce passif a été transféré vers une autre salle plus spacieuse. Un espace plus spacieux en guise de musée, réparti en stands est donc consacré pour conserver les documents transférés. Un personnel non spécialisé est détaché de l’APC pour veiller à la gestion de cet espace culturel.
Selon Limanci Mohamed, l’important tarde à venir et celui-ci au fil des années est devenu utopique. Cet important est le statut pour le musée que cet administratif souhaite être élaboré ne serait-ce que pour accomplir totalement sa mission.
« Le musée donne réellement des frissons aux visiteurs ; il leur fait revivre un moment à la fois sensationnel et attractif. En visitant les différents stands, rares sont ceux qui maîtrisent leur émotion. Cet important legs ne mérite-t-il pas plus de considération ? » S’interroge Limanci Mohamed.
– Quelles seront les sensations si nous adaptons à titre d’exemple l’expérience des anciens mineurs de France ?
En effet, le grand engouement porté à l’activité minière en France, s’est caractérisé par la mise en place de quatorze musées. Le visiteur aura le plaisir de découvrir des photos et des objets que les mineurs eux-mêmes ont ramenés aux musées. (Musée Villard de Loire et Cagnac de Turn).
Par ailleurs, d’autres mineurs ont investi carrément des sites dans l’intention de préserver ces lieux et leur authenticité et d’éviter d’éventuelles détériorations. Cette action se traduit par l’aménagement en équipement approprié de l’ensemble des vestiges et cela pour permettre aux visiteurs d’y accéder facilement. (Musée Ales de Gard, Lewarde du Nord-Pas-de-Calais).
Des souvenirs amers et douloureux sont ancrés dans la mémoire des anciens mineurs de Kenadsa. La pénibilité de l’activité minière et les risques auxquels ils étaient exposés durant leurs carrières professionnelles ont sérieusement irrité leurs consciences. Les procès-verbaux de réunions syndicales que nous avons étudiés et les témoignages recueillis illustrent fortement la situation désastreuse vécue par cette frange de la société.
Ces anciens mineurs se comptent aujourd’hui sur les doigts d’une main et chaque fois qu’un mineur s’éteint c’est toute une partie de la mémoire collective qui s’évapore.
– Ces artisans et acteurs de l’histoire de la mine de Kenadsa ne méritent-ils pas plus de soins et de considérations ?
– Sortir de l’anonymat cette poignée d’anciens mineurs ne serait-ce que par leurs témoignages ne contribue t-il pas à l’écriture de l’histoire et à la sauvegarde de ce précieux héritage ?
– L’hommage et le mérite ne reviennent-ils pas à ces mineurs qui ont sacrifié toute une partie de leur vie aux fonds des galeries ?
C’est dans cette optique que nous voulons orienter notre recherche. Notre investigation bute également sur la levée du voile concernant la condition socioprofessionnelle des mineurs qui ont exercé pendant presque un demi-siècle, une activité la plus fastidieuse dans une conjoncture très particulière, voire sous l’occupation militaire française de l’Algérie.
Introduction
Sur un vaste territoire déshérité, situé au sud-ouest de l’Algérie, cohabitait une population d’origine arabe et berbère. Les oueds et les routes de caravanes étaient des espaces attractifs pour cette population sahraouie.
Les nomades issus des tribus arabes, nommées Doui Menea et Ouled Djerir ont préféré se fixer en dressant des tentes à la lisière de la palmeraie du oued Guir, où ils s’adonnaient à l’agriculture et au pâturage.
Les jardiniers berbérophones d’Ouakda quant à eux se sont installés sur les routes des caravanes avoisinant le long d’un oued. Les Chleuhs d’Igli en revanche, sont établis dans une vallée où ils ont édifié également leur ksar à proximité du point de passage des caravaniers. Les Noirs et d’autres Berbères peuplaient aussi des ksour répartis à travers toute la région (Taghit, Beni Abbes, Abadla, Mougheul, Boukais…).
L’agriculture vivrière, l’entretien des palmeraies et le commerce caravanier demeuraient pour la majorité de ces autochtones l’unique source de vie. Or, pour d’autres très pauvres, ces activités n’étaient que des objets d’attraction vers des convoitises et des conflits tribaux.
L’enclavement de la population dans cette région très pauvre a favorisé l’émergence de pillards et de détrousseurs parmi la population aborigène. Une insécurité régnait sur tout le territoire de la région. Les attaques et les convoitises de biens sont devenues ainsi monnaie courante.
La caravane de chameaux transportant de l’Afrique noire de l’or et des plumes d’autruches était la cible préférée des pilleurs. Des guets-apens se dressaient au niveau des points d’eaux, où les caravaniers faisaient escale pour se reposer et se rafraîchir.
Par ailleurs, sur un passage obligé de la caravane, avoisinant le ksar d’Igli, d’autres épreuves de vandalisme surprennent les commerçants. Parfois, ces itinérants traversaient une période « d’accalmie », où leurs marchandises ne subissaient point d’actes de vandalisme de la part des pillards. La caravane est appelée en revanche, à s’acquitter d’un « impôt » qui lui permettra de franchir en toute sécurité la zone des Glaoua.
Si ce n’était, fort heureusement, l’intervention de la zaouïa de Kenadsa, la situation pourra autrement dégénérer. La zaouïa, contrairement aux pillards, tirait de manière légale d’importants profits de l’activité commerciale. Grâce à la location de ses chameaux et à l’escorte qu’elle assure aux commerçants, celle-ci permet en plus des dons qu’elle recevait de fructifier encore d’avantage ses recettes.
Ce train de vie commence peu à peu à prendre, dès les premières incursions de la région une autre tournure. La zaouïa qui fut dans cette région la force « suprême » est dans le collimateur du pouvoir colonial, et ce, au même titre que le commerce caravanier. Ce pouvoir a fait payer à la zaouïa qui, ne cessait de veiller jalousement à l’enseignement coranique, scientifique, culturel…, un lourd tribut en brûlant un nombre inestimable de ses manuscrits. Le colonisateur souhaitait ainsi briser la forte relation liant les autochtones à sa confrérie religieuse. Pour appauvrir la population, il n’y a plus meilleurs, selon lui, que de perturber l’activité commerciale pour pouvoir ensuite en s’accaparer totalement.
Une fois l’exploration de tout le territoire était achevée (1854-1870), l’armée française peinait à asseoir sa stratégie lui permettant d’occuper militairement cette région du sud-ouest de l’Algérie. Il a fallu des années et des années (1870-1903) pour neutraliser les tribus rebelles et affaiblir la résistance de Bouamama pour que la région soit livrée enfin aux mains du colonisateur.
Après l’installation de plusieurs postes militaires qui ont servi de garde-fous au général Lyautey, l’administration coloniale, a décidé dès 1903 d’ériger celui (le poste) du ksar de Béchar en « cercle » auquel toutes les localités de la région furent rattachées. Ce ksar a reçu à partir de cette année le nom de « Colomb-Béchar ». Colomb tire son origine du premier officier français Colomb ayant exploré pour la première fois la région du sud-ouest de l’Algérie. Quant à Béchar, les étymologistes donnent diverses versions sur l’origine de ce toponyme.
Après l’occupation militaire, une autre nouvelle page vient de s’ouvrir avec l’arrivée du rail en 1904 à Colomb-Béchar. Le dromadaire qui fut jadis l’unique moyen d’échanges commerciaux, est désormais face à un redoutable concurrent, à savoir le chemin de fer. En fait, pour les commençants, le transport de leurs marchandises via le rail s’effectuait de manière plus rapide et surtout plus sûre. Au-delà de Béchar, l’activité continuait à s’exercer comme à l’accoutumée à dos de chameaux, et ce, sous la menace continuelle des détrousseurs. Car le tronçon joignant Béchar à l’Afrique noire, en passant par Igli n’était pas pour l’heure modernisé. La France souhaitait avec ferveur en desservir, au point que ce projet – tant attendu de l’œuvre de la « conquête moderne française » –, si nous reprenons les propos des Français, a fait à maintes reprises objet de débat dans le Parlement.
L’approvisionnement des trains en charbon posait problème parfois à la société des Chemins de fer algériens (CFA) à cause des ruptures de stock et de la flambée des prix du produit. Ce désagrément incite parfois la compagnie à suspendre de manière momentanée le trafic ferroviaire. L’exploitation du charbon qui sommeillait dans les entrailles du sol de Kenadsa demeurait une nécessité majeure pour parer à ce désagrément. Dès l’année 1917, les CFA commencent, déjà, en leur qualité d’exploitant de gisement à alimenter ses locomotives à vapeur avec du charbon de Kenadsa. Jusque-là, le charbon n’était pas destiné à la commercialisation ; il couvrait uniquement les besoins des trains. Cet intérêt ne s’est manifesté qu’au début des années quarante, d’où la mise en place en 1943 d’un organisme approprié à l’activité minière, à savoir la Régie de charbonnage de Kenadsa. En 1947, les Houillers du Sud-Oranais (HSO) qui étaient créées dans le cadre de la nationalisation des mines ont succédé à cette entreprise patronale (Régie de charbonnage).
Comme nous l’avons déjà signalé, la commercialisation du charbon n’a démarré qu’au début des années quarante. Le rythme de la production s’intensifiait jour après jours, et le taux de recrutement au sein de la mine ne cessait d’augmenter. Des ouvriers – dont le nombre a atteint les 4000 – originaires tout d’abord de Kenadsa, des tribus nomades, de Kabylie, de Maroc et d’Europe constituaient ainsi l’effectif de l’entreprise minière. Des infrastructures dont une salle de soin, des classes d’enseignement, une cité européenne, des corons, des baraquements… étaient mis en place pour accompagner le rythme de ce petit monde. D’autres infrastructures de grandes envergures, à savoir une agence d’Air France, une base du Mer-Niger et une compagnie transsaharienne étaient également implantées à Colomb-Béchar au lendemain de l’exploitation du bassin minier de Kenadsa. Le rail demeurait ainsi dans la région le fer de lance d’importantes mutations socioéconomiques.
Contrairement aux pays du Machreq, la colonisation au Maghreb avait la particularité de créer des colonies de peuplements. Le développement du capitalisme colonialiste a engendré une aisance économique que rare parmi les colonisés tiraient profit. Cette inégalité de répartition de « richesses » n’a pas tardé a provoqué chez les colonisés une certaine prise de conscience. L’avènement du capitalisme colonialiste qui a engendré des conséquences néfastes sur la situation socioéconomique des colonisés a en effet suscité des contestations parmi cette écrasante tranche de la société. La zone minière de Kenadsa dont toutes ces conditions étaient bel et bien réunies, peut-elle réellement rester à l’écart des contestations ? Si les responsables de la mine percevaient l’affluence des ouvriers vers les chantiers comme synonyme de croissance de production, les syndicalistes, par contre, en voyaient un catalyseur de luttes ouvrières pour condamner l’exploitation des ouvriers.
Et si l’Etat français a lâché du lest en s’engageant de manière très timide à satisfaire quelques revendications des colonisés en vue de garantir la paix, il n’en demeure pas moins que cette posture réussisse toujours à passer comme une lettre à la poste surtout face à la montée au créneau des partisans hostiles au pouvoir colonial. En s’opposant justement à l’ordre colonial établi (régime de Vichy de 1940 notamment), un nombre inestimable parmi les militants nationalistes et communistes étaient jetés en prisons. Ceux déportés à Djenien Bouzerg ont, après leur libération, rejoint la mine de charbon. Quelques temps après leurs recrutements, ces ex-détenus dont la plus part étaient des communistes français ont réussi à mobiliser les ouvriers en jetant les premières bases du mouvement syndical.
La forte concentration au sein de cette zone minière d’un militantisme nationaliste radical avait obligé l’armée française à asseoir un plan d’action, voire une stratégie militaire. Ce plan militaire que finançait secrètement la trésorerie des HSO a rendu celle-ci incapable d’honorer ne serait-ce que les droits élémentaires de ses employés.
L’aveu de la direction des mines de son incapacité quant à la prise en charge des droits socioprofessionnels des mineurs a suscité parmi les syndicalistes de l’entreprise diverses interrogations.
Chapitre I : Igli, premier jalon de l’extension coloniale
Les reconnaissances qui ont été menées durant la fin du 19e siècle par l’armée française sur la région du sud-ouest de l’Algérie ont renseigné les exploiteurs que la vallée de Zousfana, en particulier Igli, demeure incontestablement la porte menant vers l’occupation totale de la région de Béchar. La position géographique privilégiée du ksar d’Igli à laquelle s’ajoute le caractère ethnologique et religieux des Ksouriens n’était qu’un véritable champ d’investigation pour les explorateurs français.
Convaincu par ces caractéristiques particulières, l’explorateur a procédé en premier lieu à la construction d’une redoute et ce, à proximité du ksar des Glaoua, d’où ils guettaient le moindre mouvement des habitants d’Igli ainsi que le déplacement de la population riveraine.
Les études de reconnaissance ont duré des années entières sans que l’armée mette les pieds sur le sol du territoire d’Igli. Il aura fallu attendre l’année 1901, pour que le rêve colonial se concrétise et ce, par l’installation du premier poste militaire historique à Igli. Historique, car ce dernier était le premier poste à avoir existé dans la région du sud-ouest algérien.
1. La position géographique privilégiée d’Igli
Les premières expéditions militaires ont donc commencé par la construction d’une forteresse sur une colline étroite dite : « Taouria », située à proximité du versement de l’oued Zouzfana sur le Guir. L’emplacement stratégique de la redoute avait permis à l’armée coloniale de commander, au nord-ouest, chaque déplacement de la population vers le Guir (Abadla) ainsi que tout défilé sur les pistes menant vers le Tafilalt (royaume du Maroc). Quant à la région du Sud, son contrôle s’étend jusqu’à Figuig en passant par les routes de : Béni Abbes, des oasis de la Saoura et celle de Touat1. (Voir carte géographique no 1 en annexe).
En 1901, pour des raisons d’ordre sanitaire (rudesse climatique), la redoute fut transférée à proximité du ksar d’Igli.
L’édification de la redoute dans une zone stratégique n’a point empêché les Rezzou et les Djeouch des tribus de lancer des attaques contre les patrouilles et les caravanes de l’armée française. « Chabet et Kerkour, deux points de passage dont les noms résonnent comme une sonnerie à l’oreille des chefs de convois militaires, patrouilles et conducteurs de caravanes, région où il faut redoubler de vigilance et de précaution si l’on veut éviter les surprises… la fin de l’étape qui permettra d’abandonner ces parages peu sûrs2. »
Le déplacement « programmé » de la forteresse vers Igli a permis en fin de compte, au convoiteur de cerner davantage les caractéristiques géographiques et ethnologiques de la vallée d’Igli. Cette particularité dont donc jouit cette région avait offert à l’explorateur un champ d’investigation très propice pour mener de manière rigoureuse sa politique de pacification au sein de la population.
La situation géographique privilégiée du ksar d’Igli offre en effet, à ses habitants Ksouriens un avantage leur permettant de contrôler et de dominer toute la région avoisinante. Ceci leur permettra en outre, de contrôler la population bédouine et riveraine lors de leur passage.
2. Le ksar d’Igli
Le ksar d’Igli est construit sur le Djebel Kebir, d’environ 35 mètres de hauteur. Tel un petit plateau, cette colline se caractérise par une masse de roches qui s’étale sur les flancs, rendant l’accès très difficile au ksar. Sur cette plate-forme, les habitants d’Igli ont édifié leurs habitations, qu’ils ont construites de manière ordinaire, en toub et en simples briques de terre d’argile séchées au soleil.
Les bâtisses sont haussées de terrasses qui leur servent d’abris contre les nuits chaudes de l’été. Des ruelles sous forme de labyrinthes, et qui sillonnent toutes les habitations se distinguent très nettement au niveau du ksar.
Ces multiples ruelles servaient d’issues de secours pour les Ksouriens en cas d’éventuelles attaques inopinées. Toutes ces voies donnent vers une artère principale, où les habitants ont naguère édifié une placette, dite : la djemââ. Aménagée en banquettes de pierres, cette djemââ qui se situe au centre du ksar servait de lieu où les notables tenaient des assises en vue de discuter démocratiquement et librement des affaires du pays.
Cette fameuse artère principale coupant le ksar d’Igli en deux distinctes zones, donne accès sur deux importantes portes. L’une dite : « Bab Dahraouia », orientée au nord, conduit vers la palmeraie, Taouria, les pistes du Guir et celles de Tafilalt. Tandis que l’autre porte connue sous le nom de : « Bab Gueblia », dirigée au sud mène directement vers l’emplacement des caravanes, les campements des Doui Menea ainsi que les pistes de Béni Abbes.
La souveraineté dont jouissait jadis la djemââ, avait au lendemain de l’occupation militaire subi d’importantes mutations. Le colonisateur a procédé au fil du temps à la « dissolution » définitive de cette organisation ancestrale (djemââ) et un bureau arabe a désormais pris le relai.
Un caïd est affecté à cette « administration » pour assurer soi-disant le « rôle » de chef de tribu. Celui-ci n’est, en fin de compte, qu’un « serviteur » au profit du colonisateur par le fait qu’il a été choisi et imposé par l’administration militaire.
Le bureau jouait le rôle d’intermédiaire entre l’armée française et les habitants d’Igli. Cet espace est devenu donc un « centre de commande et de décisions » que les notables et les Ksouriens sollicitent en vue de soumettre à l’officier leurs différentes préoccupations.
Assisté par un interprète d’origine « indigène », cet officier français demeure le seul maître des décisions. Quant à l’interprète, sa mission se limite essentiellement à la traduction des propos émanant des citoyens ou ceux du caïd.
Contrairement aux populations riveraines bédouines – tribus nomades –, réputées pour leurs itinérances, les Glaoua se sont par contre sédentarisés au niveau du ksar construit à proximité des oasis et des oueds, où ils menaient un cadre de vie plus au moins organisé.





























