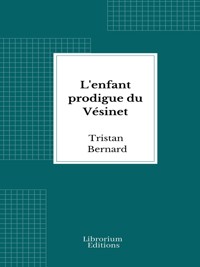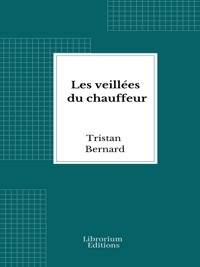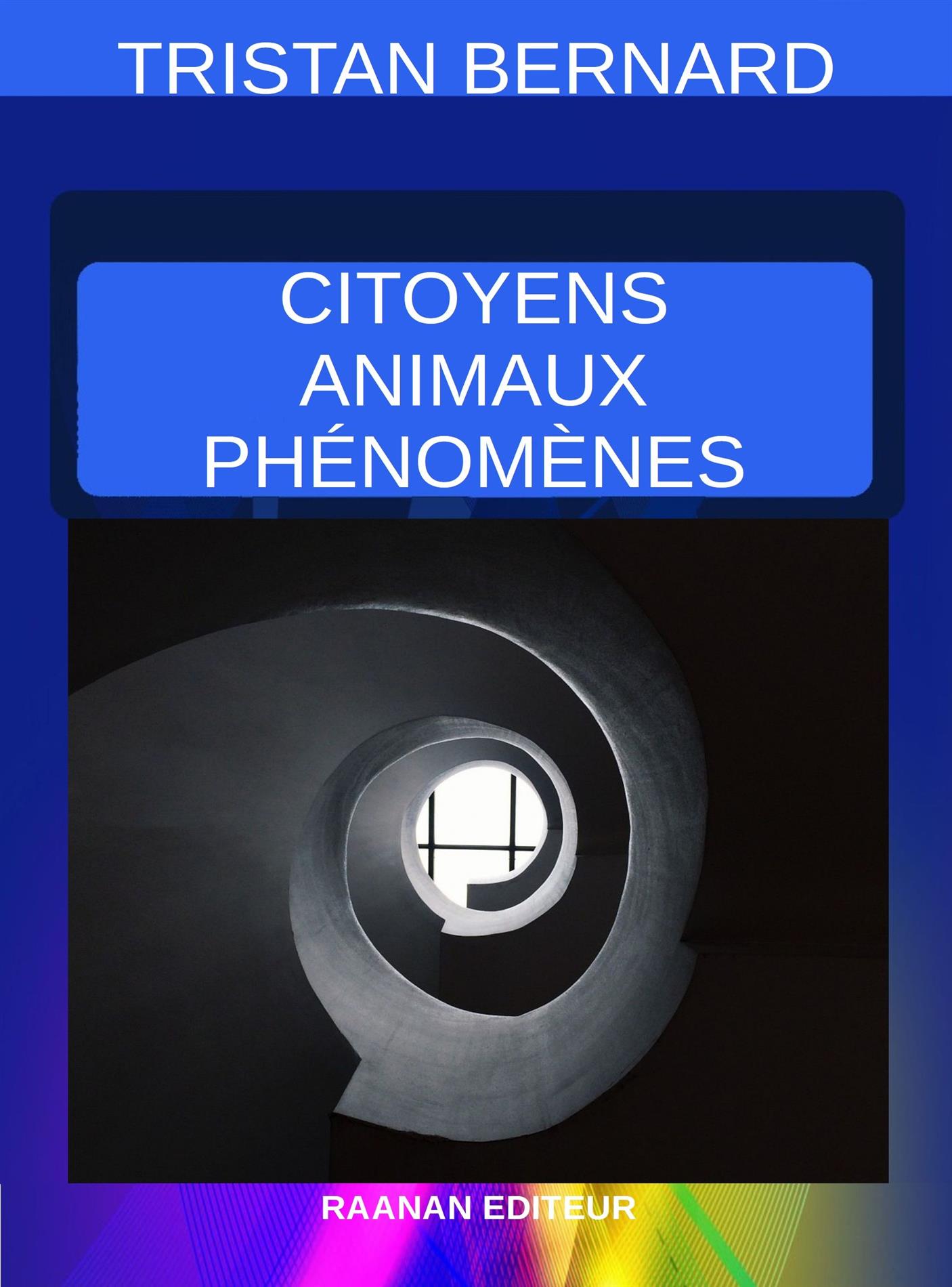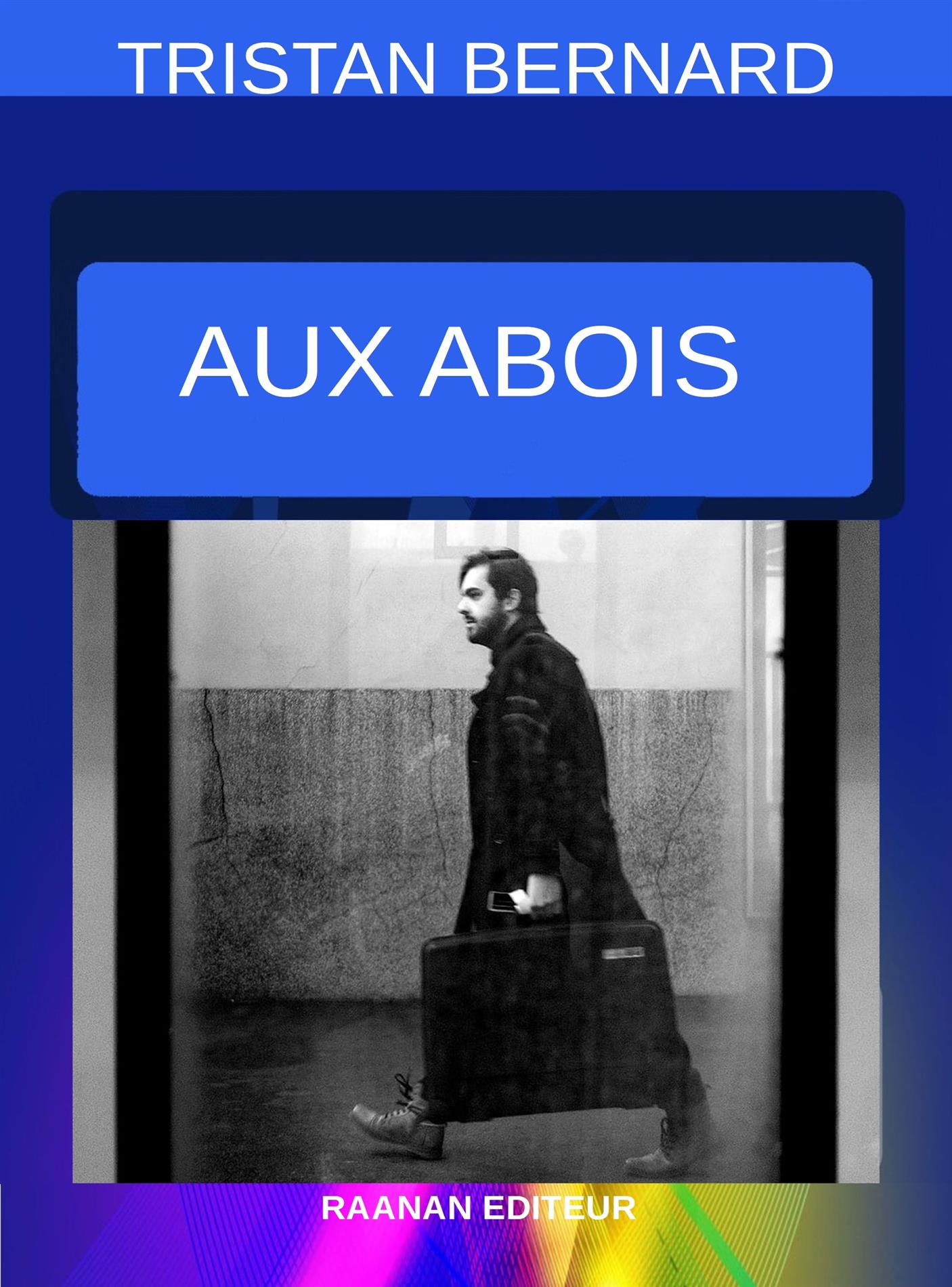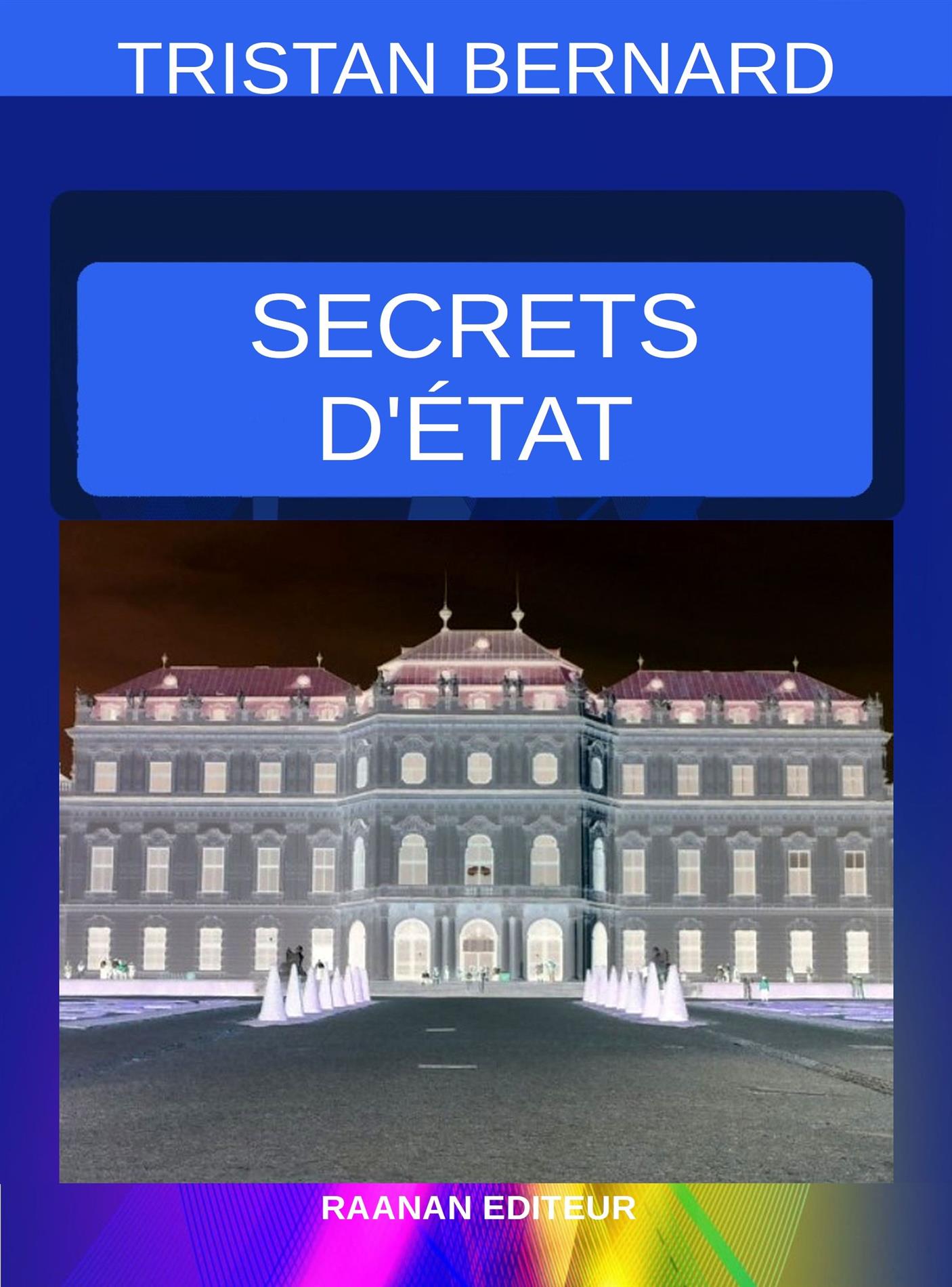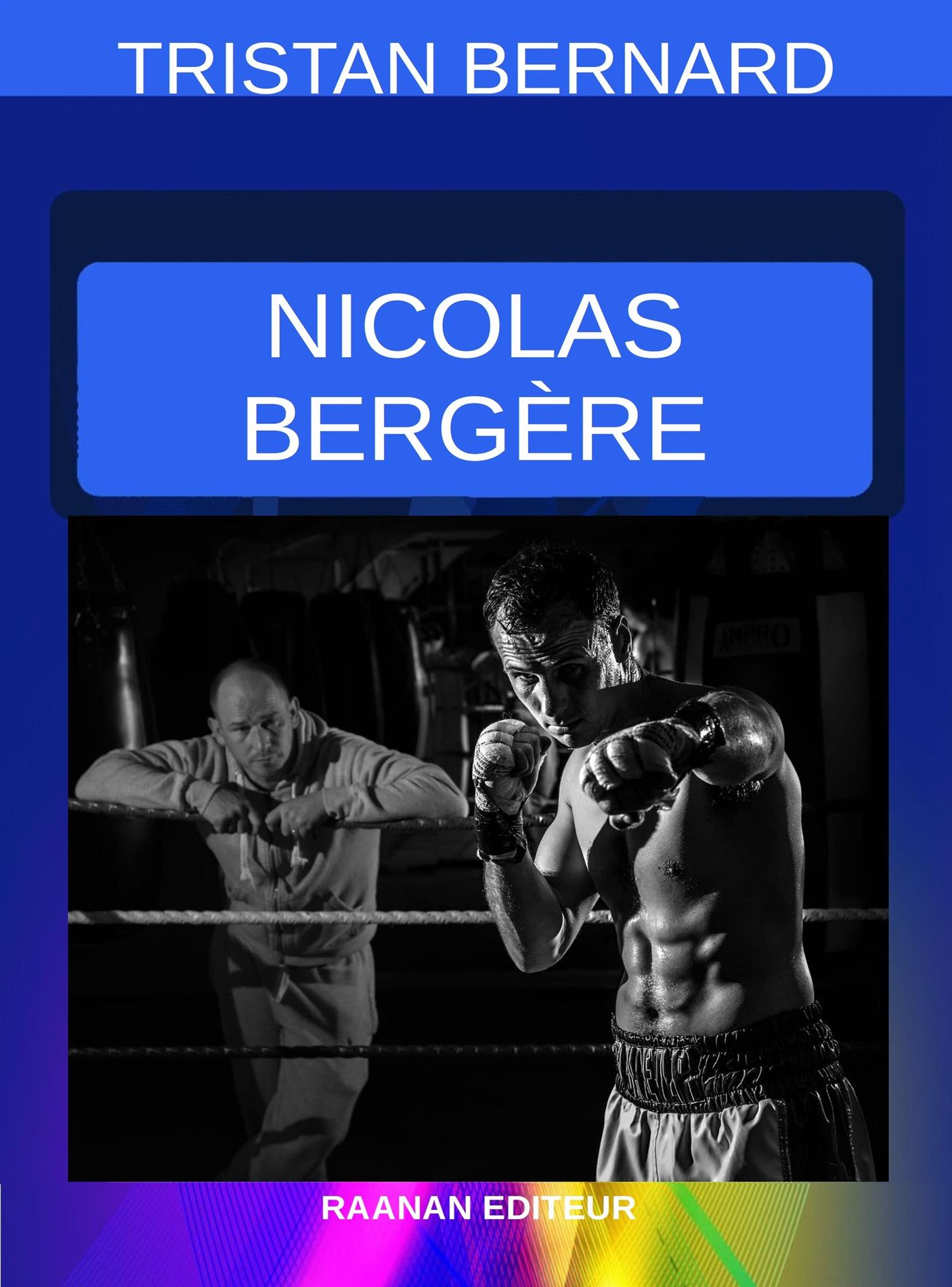1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Vers sept heures du matin, Émile, garçon de bureau, vêtu comme un simple mortel d’un pantalon et d’une chemise, promenait un balai électrique sur le tapis d’une vaste pièce.
Ce cabinet spacieux était celui de M. Maurice Langrevin, éditeur. Il était meublé confortablement, mais sans recherche. Des armoires étaient venues y prendre place, au hasard des événements. C’est ainsi que la grande bibliothèque en bois noir venait de la maison Borbat, éditeur d’ouvrages de droit, dont M. Langrevin avait un jour racheté le fonds. Une autre armoire vitrée, en noyer ciré, avait été trouvée, un jour de pluie, à l’Hôtel des Ventes… Un buste de Cicéron venait également de chez Borbat. Un groupe de trois coureurs en bronze, sans prétention au symbole, avait été offert par ses employés à M. Langrevin, à l’occasion du quarantième anniversaire de la fondation de la maison.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
TRISTAN BERNARD
Les moyens du bord
ROMAN
1927
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385740245
PREMIÈRE PARTIE
Vers sept heures du matin, Émile, garçon de bureau, vêtu comme un simple mortel d’un pantalon et d’une chemise, promenait un balai électrique sur le tapis d’une vaste pièce.
Ce cabinet spacieux était celui de M. Maurice Langrevin, éditeur. Il était meublé confortablement, mais sans recherche. Des armoires étaient venues y prendre place, au hasard des événements. C’est ainsi que la grande bibliothèque en bois noir venait de la maison Borbat, éditeur d’ouvrages de droit, dont M. Langrevin avait un jour racheté le fonds. Une autre armoire vitrée, en noyer ciré, avait été trouvée, un jour de pluie, à l’Hôtel des Ventes… Un buste de Cicéron venait également de chez Borbat. Un groupe de trois coureurs en bronze, sans prétention au symbole, avait été offert par ses employés à M. Langrevin, à l’occasion du quarantième anniversaire de la fondation de la maison.
Des diplômes encadrés rappelaient les succès de M. Langrevin dans des expositions européennes, et même dans des manifestations de propagande de par delà l’Atlantique.
Le balai mécanique ronflait autour d’un grand bureau, représentant isolé du style Empire. A l’autre bout de cette grande pièce, une table de faux Boulle faisait également bureau. C’était là que prenait place Marcel Langrevin, le fils du patron.
Pour l’instant, la grande maison semblait vide. Le laboureur Émile suivait comme des sillons les lés du tapis. Il sifflotait, la conscience calme, comme un bon travailleur matinal.
Un homme grisonnant, de belle taille, parut à la porte d’entrée. Il était déjà en longue blouse blanche et en casquette, c’est-à-dire en uniforme pratique de concierge que les nécessités du service obligent à prêter la main aux hommes de peine, à l’occasion.
— Monsieur le portier de la librairie, dit Émile, qu’est-ce qui nous vaut l’honneur de votre visite ?
— Sais-tu, dit le concierge, si on va fermer le jour de l’Ascension ?
— Ah ! mon vieux, il faudrait que tu demandes ça à M. Langrevin. Moi, ici, j’ai de l’influence sur le balai électrique et sur les plumeaux. Mais c’est pas dans mes attributions de commander si on ferme ou pas la librairie. Ces petites décisions de rien du tout, j’ai pas le temps de m’en mêler. Je laisse ça au papa Langrevin.
— Toutes les maisons d’édition ferment pour l’Ascension…
— C’est possible, mais le patron s’occupe pas de savoir ce que font les autres. Il fait d’abord comme il veut et ensuite à sa tête.
— Faut pas se plaindre de lui, dit le concierge. Il n’est pas mauvais pour le personnel…
— Non, pas pour le personnel…
Ils se turent l’un et l’autre. Ils n’en pensaient pas moins. Toute la maison avait remarqué avec quelle rigueur Maurice Langrevin traitait son fils Marcel, un garçon de vingt-deux ans, qui, évidemment, ne menait pas une existence de sédentaire.
— Y a pas à dire, il faut que M. Marcel marche droit, dit le garçon de bureau, répondant à une réflexion que le concierge n’avait pas formulée.
— Pour marcher droit, je ne peux pas dire que je l’ai vu marcher de travers, même quand il rentre à sept heures du matin.
— Il n’est pas encore là, aujourd’hui ?
— Non, dit le concierge, mais c’est son heure. Voilà trois jours qu’il est très régulier. Jamais plus tard que sept heures et demie.
— Encore heureux, dit le garçon, qu’ils habitent dans leur maison de commerce. Sans ça, je me demande comment qu’il serait à l’heure au bureau.
— Moi, je crois qu’il préférerait habiter ailleurs qu’avec son papa. Le patron se lève vers les huit heures. Des fois que M. Marcel serait pas rentré, ça ferait une affaire.
— C’est arrivé le mois dernier, dit le garçon de bureau. Tu parles que ça a bardé… Le patron est dur.
— Et comme n’y a plus là la pauvre maman pour tempérer l’orage !
— Et Monsieur est serré pour le pognon. Ce pauvre jeune homme, il me doit au moins mille francs de pourboires qu’il m’a promis depuis deux ans…
— A moi aussi. Oh ! c’est pas que j’y compte pour la semaine prochaine, mais c’est de l’argent que l’on reverra toujours.
— Et nous pouvons nous dire aussi qu’il est plus généreux comme ça, tant qu’il s’agit d’en promettre et qu’il n’y a pas tout de suite à raquer.
— … Ferme un peu, monsieur Cognard, le voilà qui s’amène.
Pour détourner les jeunes gens de l’enfer du jeu, il vaut mieux ne pas leur montrer un joueur qui regagne son logis après une nuit passée au poker ou au baccara. L’excitation de la partie, puis le grand air, lui donnent une animation, une mine de bonne santé, de nature à faire croire qu’il n’y a pas dans la vie d’occupation plus hygiénique.
Attendons, pour exhiber une image édifiante, de prendre ledit joueur après son déjeuner de midi, quand le manque de sommeil commence à se faire sentir. Alors nous verrons un être torpide, éreinté, diminué, et dont l’exemple n’a rien d’engageant.
Pour Marcel Langrevin, qui venait de passer une série de nuits incomplètes, la fatale dépression ne devait pas attendre l’heure de midi pour se manifester. A peine assis derrière sa table-bureau, il parut très affaissé aux yeux d’Émile, le garçon. (Le concierge s’était retiré discrètement.)
Pourtant il eut la force de faire des recommandations hâtives, qui purent être proférées en un langage très abrégé, car Émile paraissait déjà au courant de la question.
Il s’agissait pour le garçon de se rendre au plus tôt dans la chambre de Marcel, et de donner au lit du jeune homme l’air fatigué que doit avoir une couche, après le réveil d’un jeune homme vertueux.
— Monsieur ne se repose pas ? demanda Émile.
Marcel répondit par un signe vague. Il n’avait pas la force d’expliquer qu’il valait mieux pour lui de ne pas s’étendre sur son lit, où il serait pris par un sommeil tenace dont certainement huit hommes vigoureux, maniant des leviers et des crics, ne fussent jamais parvenus à le tirer.
Émile partit donc vers sa besogne de camouflage.
Marcel, resté seul, étendit péniblement le bras vers un appareil téléphonique. La préposée dut avoir l’impression, d’après la voix mourante de l’abonné, que le numéro demandé était celui d’un saint prêtre, que l’on réclamait pour une extrême onction.
Le jeune homme était déjà endormi, quand le Carnot 88-34 arriva à l’appareil et le fit sursauter.
— C’est toi, mon vieux ? dit Marcel… Je suis tellement crevé que je m’endormais au téléphone… Et je ne peux pas me coucher. Papa va arriver d’un instant à l’autre. Et il croit que j’ai passé la nuit dans mon lit…
— Mon pauvre vieux, dit Carnot… Moi, je vais me coucher. Je suis content que tu m’aies demandé. J’étais ennuyé de t’avoir quitté, après cette nuit…
— Crois-tu que j’ai eu une poisse ! dit Marcel.
— Au moins huit mille ? dit le camarade.
— Comment ? Huit mille ? Onze mille !
— Onze mille ?
— Qu’est-ce que tu dis de ça ? Je croyais que c’était neuf mille cinq. En recomptant ce que je dois, j’ai vu que c’était… ce que je viens de te dire… Je ne veux pas trop prononcer de chiffres au téléphone. On peut entrer d’ici une minute…, je ne quitte pas la porte de l’œil. Tu sais, maintenant, c’est fini, j’arrête les frais. Je ne joue plus…
— Alors, tu ne viendras pas ce soir ?
— Si… ce soir encore. Je ne veux pas rester sur une séance pareille. C’est un coup trop dur, et contre qui ? Hein ! Crois-tu qu’il joue mal, cet Espagnol !… c’est un peu ce qui m’a perdu. Je me disais : je vais l’avoir, je vais l’avoir… et il n’arrêtait pas de ramasser du jeu. Quelles rentrées de cartes !… C’est bien simple : il gagne exactement ce que j’ai perdu. Le reste de la table ne fait pas de différences.
— Mais comment vas-tu t’organiser pour régler ?
— Oh ! mon vieux ! pour ça, je ne m’en fais pas. Je veux bien que ce soit la première fois qu’on ait joué avec lui. Mais, avant de se mettre à table, on a dit expressément que l’on ne réglerait pas le soir même, en cas de grosses différences. J’aurais aussi bien pu gagner, je n’aurais pas songé un instant à demander le règlement immédiat… Tout de même, si je ne me refais pas, il faudra bien payer un jour… Oui, je me suis levé de bonne heure, j’ai un ouvrage pressé…
— Je comprends, dit Carnot, ton père vient d’entrer dans le bureau.
— Oui, oui… Au revoir, mon vieux.
Il y a maintenant, assis au bureau Empire, un homme pas très haut, mais de carrure large, armé d’une grosse barbe grise et de sourcils noirs touffus comme des moustaches. Marcel, sans mot dire, va jusqu’à lui, et, d’un geste rituel, lui met un baiser sur le front. Comme il se dirige de nouveau vers son poste, Langrevin l’arrête d’un mot…
— Je t’ai entendu dire que tu t’étais levé de bonne heure ? Tu t’es en effet levé de grand matin, car, à six heures, tu n’étais déjà plus dans ta chambre et ton lit était déjà refait.
Marcel n’est pas d’une humeur à goûter les reproches, ou l’ironie. Il « ressaute » comme un jeune taureau piqué…
Mais, comme c’est à son père qu’il répond, il ne hausse pas la voix. C’est sourdement qu’il répond :
— Si on n’entrait pas dans ma chambre, on ne ferait pas de constatation.
C’est au tour de M. Langrevin d’être touché. Lui n’a pas à se maîtriser. Offensé dans sa dictature, il réagit violemment, et tonne :
— Monsieur, j’entrerai dans votre chambre quand bon me semblera ! Et si ça ne vous plaît pas, vous irez habiter ailleurs ! Tu es majeur, je le sais. Mais ici, tu es sous mon toit. Je ne veux pas que tu découches. Tu as toute ta soirée pour voir des filles…
Marcel pense que son père n’a pas songé au poker, et cette idée le calme un peu. Mais une phrase de M. Langrevin va l’irriter à nouveau…
— J’en parlais hier encore avec ta sœur et Florentin…
Florentin, c’est le beau-frère de Marcel, M. Tury-Bargès, juge au tribunal de la Seine… Ce qui exaspère Marcel, c’est que, dans la famille, M. Tury-Bargès est l’exemple continuel, le modèle, et lui, Marcel, le repoussoir. On est devenu d’une austérité abominable, parce qu’on est désormais une famille de magistrats. On a acquis une sorte de noblesse de robe.
Les principes ? Non, le souci de la situation de M. Tury-Bargès. Marcel trouve que certains jeunes magistrats sont plus terribles que les anciens, qui étaient inflexibles par tradition plus que par ambition. Marcel n’accorde d’ailleurs à l’ancienne magistrature cette haute estime rétrospective que pour en accabler certains échantillons de la magistrature nouvelle et particulièrement son beau-frère…
M. Tury-Bargès a la réputation d’un juge indulgent. Mais Marcel ne croit pas à la sincérité de cette indulgence. Il prétend que c’est une attitude adoptée par certains, depuis l’invention des bons juges. Marcel, qui est généreux, ne se plaint pas de cette mode, qui profite au moins à quelques pauvres diables de délinquants. Mais quant à « couper » dans la bienveillance foncière de Tury-Bargès, Marcel laisse cela à des âmes plus naïves ou que ne préoccupe point l’exacte appréciation de la bonté.
Pratiquement, il vaut mieux avoir affaire à Tury-Bargès comme justiciable que comme parent ou allié. Il a le souci de la Justice, mais surtout celui de la bonne réputation des siens, condition nécessaire de son avancement…
Marcel, en d’autres circonstances, a constaté le manque de générosité de son beau-frère. Il n’aime pas non plus la façon dont il « cote » les gens… Le coefficient de fortune ou d’influence joue un rôle un peu trop capital dans ses évaluations…
Le plus triste, c’est que Cécile, la sœur de Marcel, s’est détachée de son frère en se rapprochant de Tury-Bargès. Marcel l’a connue généreuse… Comme ce n’est pas un mauvais garçon, il s’efforce de ne pas regretter le divorce qui s’est produit entre sa sœur et lui. En somme, il vaut mieux qu’elle s’accorde avec son magistrat, puisque c’est avec lui qu’elle doit passer sa vie…
— Et pourquoi, demande M. Maurice Langrevin, pourquoi me serais-je privé d’en parler à ton beau-frère ?
Mais Marcel n’accepte pas la discussion. Il balbutie quelques paroles vagues. A quoi bon « sortir » encore une fois ce qu’il pense de son beau-frère ? La dispute ne mènerait à rien. Il reproche à Tury-Bargès son « grimpage » continuel… Or, c’est précisément cet arrivisme, traité de noble ambition, qu’apprécie chez le gendre l’esprit commercial de M. Langrevin.
La discussion éteinte se rallume d’ailleurs tout de suite, à propos d’une lettre que Marcel était chargé d’écrire à un client. M. Langrevin a des idées à lui sur le style commercial. Son fils n’a jamais pu les saisir. Marcel a beau soigner son texte, c’est-à-dire en bannir toute élégance, M. Langrevin trouve toujours ses expressions déplacées. Il y a dans ce désaccord littéraire quelque chose de fatal et d’irrémédiable. Mais Marcel n’arrive pas à s’y résigner.
— Ce n’est pas ce que je t’avais dit d’écrire…
— Papa, dit Marcel énervé, j’ai pris note des phrases mêmes que tu as prononcées. Quand j’écris exactement ce que tu m’as dit, tu trouves que ce n’est pas bien, et, quand je change, j’ai toujours tort…
— C’est parce que tu ne te donnes aucune peine, répond M. Langrevin, qui, après tout, a peut-être raison. Marcel se dit un peu cela, et s’en exaspère davantage. M. Langrevin a pris la lettre et va la porter à un autre employé. Marcel ne se fait pas à cette humiliation.
Il reste seul devant sa table. Cette dispute avec son père l’a réveillé. Il n’a plus sommeil. Mais il a toujours un grand cafard. La perte de onze mille francs y est peut-être pour quelque chose.