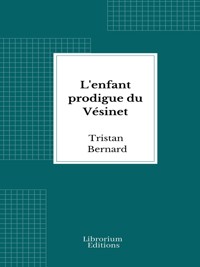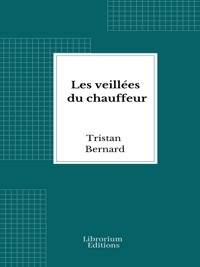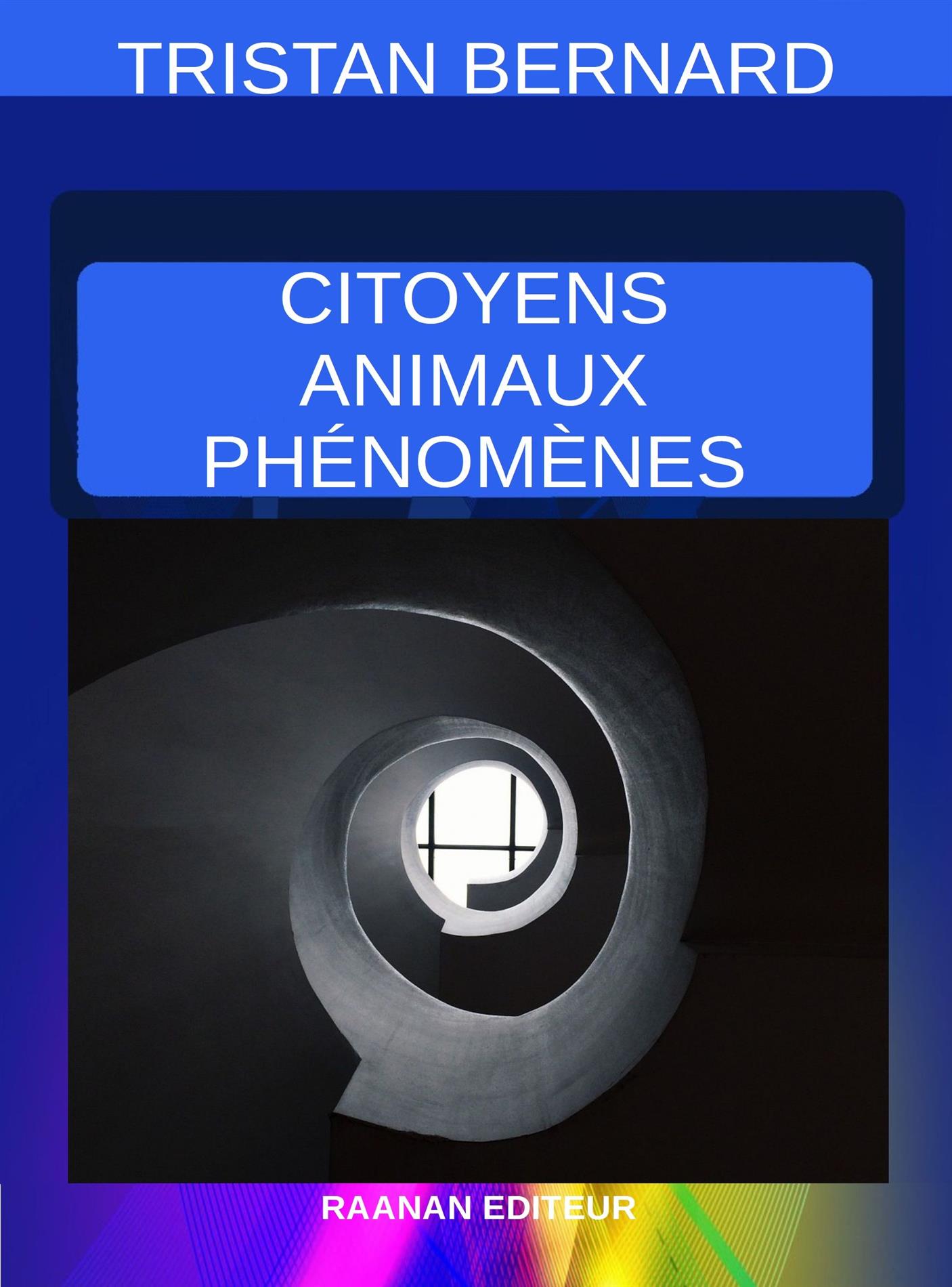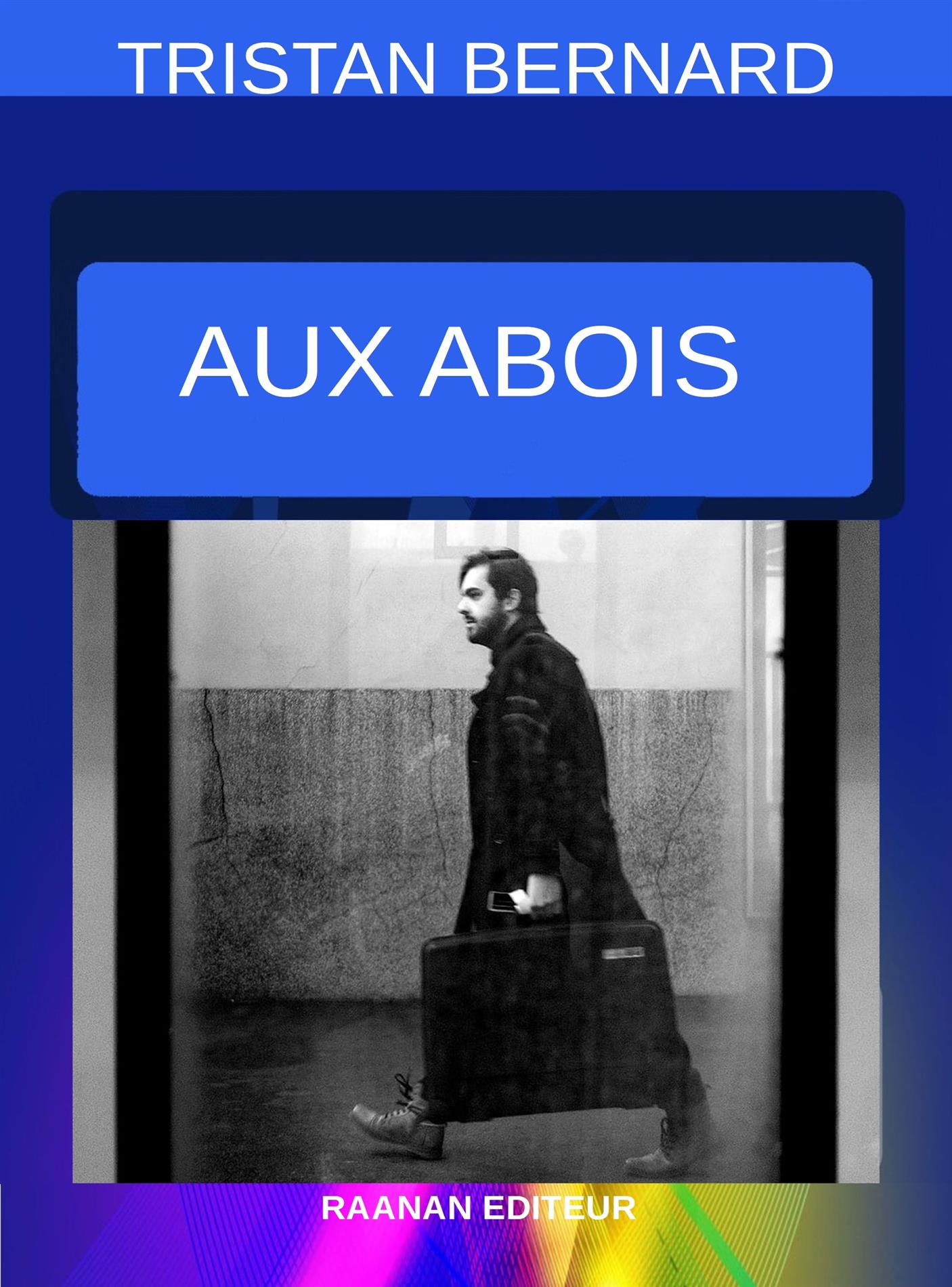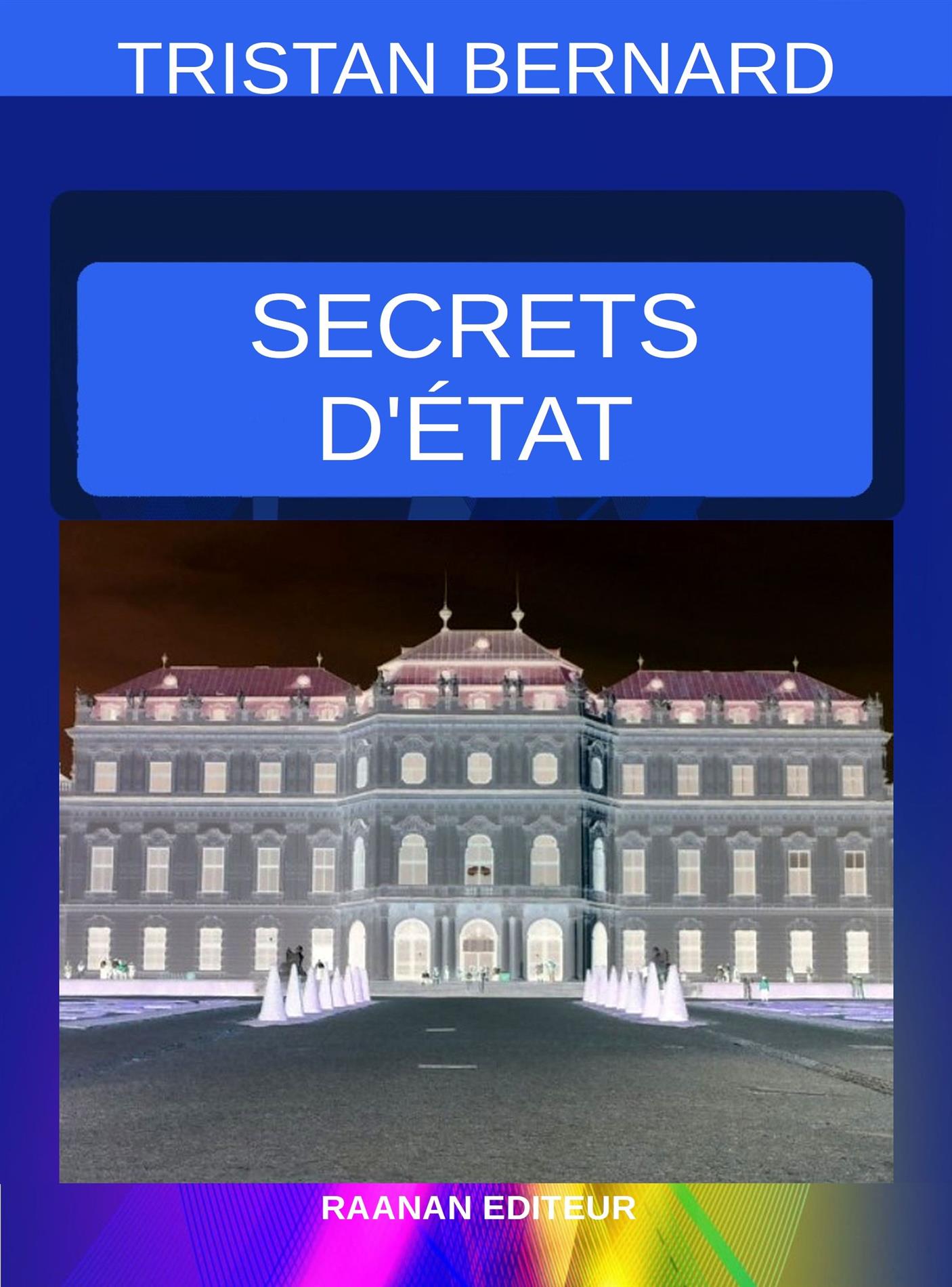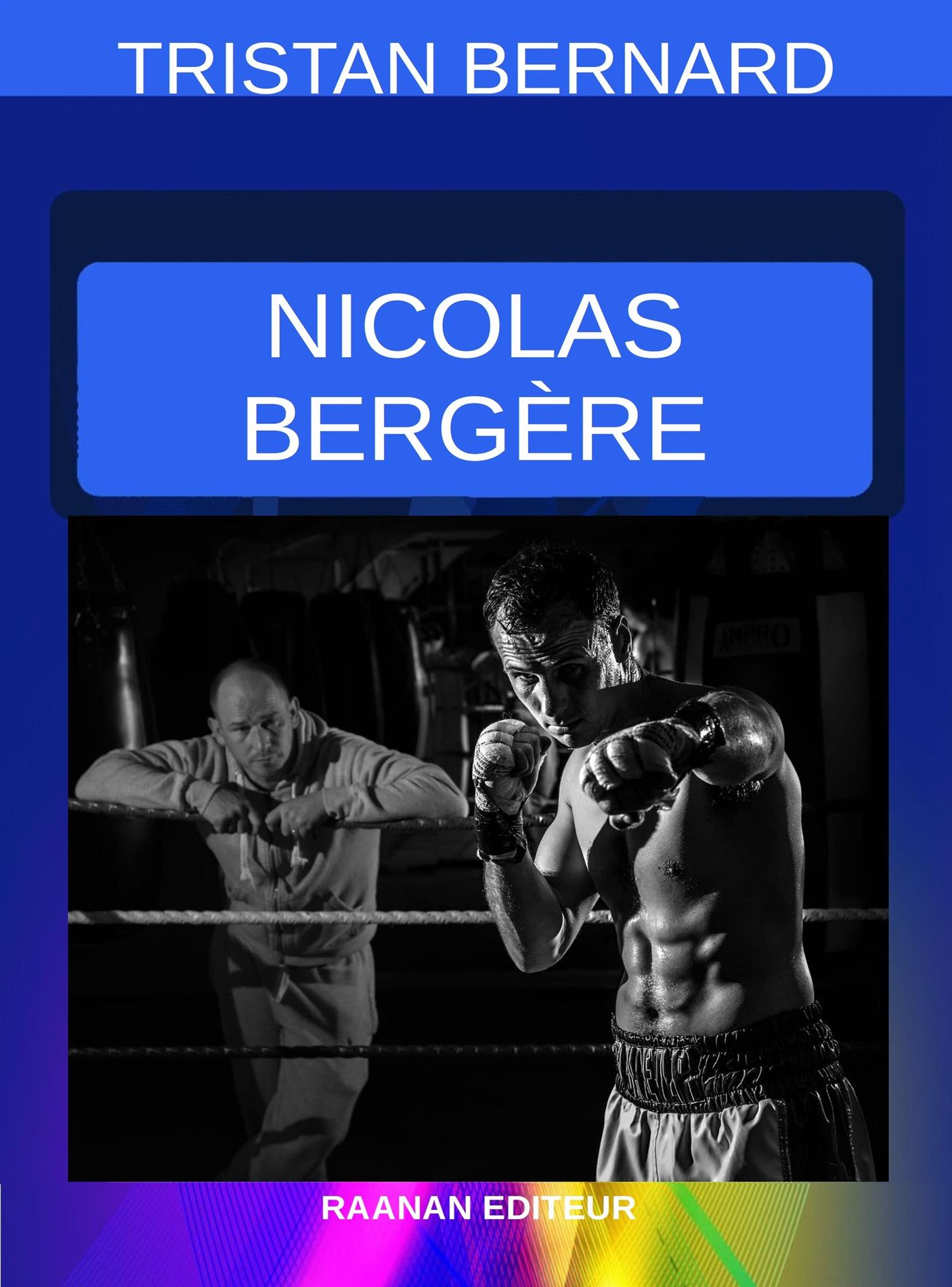1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Mathilde et ses mitaines est un roman de Tristan Bernard publié en 1912.
Extrait
| Il était un peu plus de minuit quand Firmin Remongel descendit du Métro à la station de « Couronnes, » et prit la rue mal éclairée qui le menait à son domicile.
Pourquoi était-il venu habiter à Belleville, lui qui faisait son droit de l’autre côté des ponts ?
C’est que Belleville n’était pas loin du faubourg du Temple. Or, c’était dans ce faubourg que le père de Firmin, fabricant de chapeaux de paille à Vesoul, avait l’habitude de descendre, depuis vingt-cinq ans, chaque fois qu’il venait à Paris. De sorte que, pour toute la famille Remongel, le faubourg du Temple était devenu une espèce de centre exploré, et à peu près sûr au milieu de ce vaste Paris mal connu et suspect. Il n’était pas prudent du tout de s’aventurer dans les autres quartiers.
Cette conception un peu spéciale de la géographie parisienne avait trompé le jeune Firmin. Il avait cru innocemment qu’en traversant le boulevard extérieur, pour aller louer à quelques centaines de mètres, il ne s’égarait pas trop loin de la zone tutélaire.
Décidé par la modicité du prix, bien qu’il ne fût pas avare, il avait loué une petite chambre très confortable dans une maison meublée, d’ailleurs fort convenablement habitée, mais qu’on ne pouvait atteindre qu’après avoir traversé deux ou trois rues inquiétantes, où l’on voyait se glisser, passé onze heures du soir, trop d’ombres précautionneuses. Une fois la maison choisie, et son adresse envoyée à sa famille, il n’osa donner congé, car il eût fallu s’avouer à lui-même qu’il n’était pas rassuré, et son courage traditionnel s’y refusait.
Il se fit la promesse tacite de ne pas rentrer trop tard le soir.
— Il vaut mieux, se dit-il avec sagesse, que je travaille à la maison plutôt que d’aller perdre mon temps dans les cafés...|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
SOMMMAIRE
PRÉFACE
CHAPITRE PREMIER
CHAPITRE II
CHAPITRE IlI
CHAPITRE IV
CHAPITRE V
CHAPITRE VI
CHAPITRE VII
CHAPITRE VIII
CHAPITRE IX
CHAPITRE X
CHAPITRE XI
TRISTAN BERNARD
MATHILDE ET SES MITAINES
ROMAN
Paris, 1912
Raanan Editeur
Livre 745| édition 1
PRÉFACE
Mon cher Tristan Bernard,
Il faut tout de même que j’explique à vos lecteurs pourquoi vous avez eu l’idée inattendue de me choisir comme préfacier.
Un livre de vous a-t-il besoin d’être présenté au public ? Et, si cette formalité est nécessaire, ai-je, pour l’accomplir, qualité et autorité ?
Que vont-ils penser, vos lecteurs, en voyant arriver ce couple paradoxal d’un filleul considérable comme vous, escorté, patronné, protégé par un parrain légèrement plus fluet ?
Cet été, pendant queMathilde et ses mitaines paraissait dans Le Journal, je me trouvais dansun cercle d’amis de lettres, et votre œuvre était l’objet de discussions passionnées.
Certains de ces confrères, qui sont des esprits d’habitude, et qui, une fois leur choix établi, tiennent à estimer, à admirer un écrivain pour des raisons immuables, vous reprochaient vivement d’avoir « changé de genre ».
« Comment ? Voilà qu’il « fait » maintenant du roman judiciaire !
« Voilà qu’il nous raconte des histoires de cadavres enterrés, d’épaules marquées au poignard, de passages souterrains, de déguisements... Mais est-ce que c’est la vie ? »
Je pris alors, cher Tristan Bernard, votre défense, et je leur répondis avec mon énergie ordinaire : « Mais oui, mes bons amis ! c’est la vie !... Ce n’est plus la vie plate, banale, la vie en palier ! C’est la vie accidentée ! Il n’y a rien dans les plus romanesques inventions des feuilletonnistes, que la vie n’ait réalisé à un moment donné, soitavant, soit après, soit qu’elle inspire les littérateurs, soit qu’elle lesimite !…
« L’auteur ne nous raconte pas toute l’existence d’un homme, puisque son roman se passe exactement en cinq jours. Mais il a choisi, comme c’était son droit, une semaine exceptionnelle… Et il s’est appliqué à raconter l’extraordinaire de la vie avec la même sincérité paisible qu’il avait mise, en d’autres occasions, à en représenter l’ordinaire, avec le même souci de vérité… »
Puis, cher Tristan, après vous avoir défendu, enhardi par l’orgueil d’avoir à plaider pour un client de votre valeur, votre avocat improvisé a pris l’offensive, a poussé contre vos détracteurs une vigoureuse attaque reconventionnelle.
Je leur reprochai de ne voir dans une œuvre que les poutres de la charpente et de ne pas considérer le prix des matériaux de construction.
Comment n’avaient-ils donc pas senti que votre ouvrage avait les mêmes qualités que vos livres précédents, une vérité d’évocation peu commune, une aptitude exceptionnelle à placer les personnages dans un décor vivant, de sorte que tous leurs gestes, même les plus anormaux, se justifient.
J’ai dit qu’il fallait vous savoir gré d’avoirmontré des policiers plausibles, des détectives qui sont des êtres humains, capables à la fois d’ingéniosité, de décision d’héroïsme, et de maladresse, d’hésitation, de timidité. Et les exploits de ces détectives vrais sont d’autant plus surprenants qu’ils restent vraisemblables…
Vous avez appris, mon cher ami, on vous a rapporté avec quelle ardeur j’avais pris votre défense, et vous m’avez fait l’honneur de désirer que mon plaidoyer parût en tête de ce volume. Mais je ne suis pas dupe de vos raisons : ce que vous vouliez, c’était surtout me faire plaisir… Vous y avez réussi : vous m’avez fait plaisir et, je dois le dire, un peu peur…
Bien affectueusement,
RENÉ BLUM,
CHAPITRE PREMIER
Il était un peu plus de minuit quand Firmin Remongel descendit du Métro à la station de « Couronnes, » et prit la rue mal éclairée qui le menait à son domicile.
Pourquoi était-il venu habiter à Belleville, lui qui faisait son droit de l’autre côté des ponts ?
C’est que Belleville n’était pas loin du faubourg du Temple. Or, c’était dans ce faubourg que le père de Firmin, fabricant de chapeaux de paille à Vesoul, avait l’habitude de descendre, depuis vingt-cinq ans, chaque fois qu’il venait à Paris. De sorte que, pour toute la famille Remongel, le faubourg du Temple était devenu une espèce de centre exploré, et à peu près sûr au milieu de ce vaste Paris mal connu et suspect. Il n’était pas prudent du tout de s’aventurer dans les autres quartiers.
Cette conception un peu spéciale de la géographie parisienne avait trompé le jeune Firmin. Il avait cru innocemment qu’en traversant le boulevard extérieur, pour aller louer à quelques centaines de mètres, il ne s’égarait pas trop loin de la zone tutélaire.
Décidé par la modicité du prix, bien qu’il ne fût pas avare, il avait loué une petite chambre très confortable dans une maison meublée, d’ailleurs fort convenablement habitée, mais qu’on ne pouvait atteindre qu’après avoir traversé deux ou trois rues inquiétantes, où l’on voyait se glisser, passé onze heures du soir, trop d’ombres précautionneuses. Une fois la maison choisie, et son adresse envoyée à sa famille, il n’osa donner congé, car il eût fallu s’avouer à lui-même qu’il n’était pas rassuré, et son courage traditionnel s’y refusait.
Il se fit la promesse tacite de ne pas rentrer trop tard le soir.
— Il vaut mieux, se dit-il avec sagesse, que je travaille à la maison plutôt que d’aller perdre mon temps dans les cafés.
Il devint donc, par peur de rentrer tard, l’étudiant austère et laborieux qui refuse systématiquement toutes les invitations.
Mais ce soir-là il n’avait pu couper à un dîner trimestriel d’une société d’étudiants francs-comtois.
Après le dîner, qui fut suivi d’un concert d’amateurs, les étudiants de Franche-Comté se dispersèrent. Un certain nombre d’entre eux cependant restèrent agglomérés et se dirigèrent vers des lieux de plaisir.
Firmin, exceptionnellement, eût accepté de les accompagner, quitte à ne rentrer chez lui qu’au petit jour…
Mais ses camarades jugèrent qu’ils avaient déjà trop détourné de son travail ce vertueux garçon. Firmin s’en alla seul et prit le Métro qui l’amenait à dix minutes de chez lui.
Pendant son trajet dans le Métro, il s’efforça de songer à son actuel sujet d’études. C’était les testaments… Alors il pensa à un autre chapitre du Code.
Malgré lui, il revenait toujours à un souvenir impressionnant de la nuit précédente.
Dans son premier sommeil il avait été réveillé par un cri qui venait de la rue.
C’était un cri assez effrayant, un de ces cris « vrais », qui ne ressemblent pas du tout à ceux qu’on entend au théâtre, ni à des cris d’enfant qui pleure. Ce n’était pas non plus le cri d’un malade qui veut se faire plaindre et que sa plainte même soulage. C’était certainement un cri arraché à la douleur, un cri d’être humain en détresse et qui n’a pas de recours.
Firmin s’était réveillé et avait couru à sa fenêtre, qui donnait sur un petit carrefour. Il avait vu fuir deux ombres qui lui semblèrent être deux hommes et qui disparurent tout de suite au tournant de la rue. Et cette fuite était aussi effrayante que le bruit entendu. Elle avait, comme lui, quelque chose d’éperdu et de soudain.
Était-ce une attaque nocturne ? Était-ce une bataille d’apaches ?
C’est souvent entre eux que les apaches ont des comptes à régler, et ils n’en veulent pas spécialement, c’est entendu, au passant attardé qui rentre à son domicile. Mais peut-être vaut-il mieux pour ce passant paisible ne pas traverser la place où ils ont décidé de trancher leurs différends. Ces jouteurs brutaux ne font pas de façons pour débarrasser la lice des gêneurs qui l’encombrent.
Firmin pensait vaguement à toutes ces choses, quand arriva bien rapidement la station de « Couronnes », où il devait descendre.
L’étudiant, d’un air dégagé, sans trop presser le pas, s’engagea dans son chemin.
Il était descendu, en même temps que lui, une dizaine de personnes… Peut-être un certain nombre d’entre elles auraient-elles le bon esprit de venir sur sa route. Il ralentit le pas et vit deux hommes, d’allure très comme il faut et, ma foi, de carrure assez respectable, prendre la rue où il allait entrer.
Mais sa satisfaction fut de courte durée, car presque tout de suite ces deux hommes s’arrêtèrent devant une porte, qui avait bien des chances d’être la leur…
L’étudiant continua seul son chemin. Après une centaine de pas, il devait tourner à droite, puis suivre une autre petite rue pendant une bonne centaine de pas. Ensuite il prendrait une rue montante et plus longue, la rue Pelpeau, qui l’amenait jusqu’au croisement où se trouvait sa maison meublée.
Il s’était déjà engagé dans la seconde rue sans rencontrer personne. Les petites boutiques fermées avaient l’aspect le plus honnête et le plus tranquille du monde. Mais elles étaient bien closes, bien aveugles et bien sourdes…
Toutes les fenêtres étaient obscures, à l’exception, cependant, d’une seule, là-bas, au quatrième étage…
Appelé par un cri d’alarme, cet inconnu qui veillait là-haut aurait-il le temps de descendre dans la rue, à supposer qu’il en eût le courage ?
... Firmin tourna dans la rue Pelpeau, celle qui montait jusqu’à son domicile. Elle était complètement déserte, et, somme toute, il n’en fut pas fâché. Car elle était assez mal éclairée, et toute ombre aperçue eût été en principe plus inquiétante que rassurante.
Allons ! la fâcheuse aventure ne serait peut-être pas pour ce soir-là ! Cependant il ne fallait pas le dire trop vite. Ce passage latéral, là-bas, qui sait s’il ne recélait pas de gens cachés ?
Firmin, qui avait traversé la rue, préféra passer de l’autre côté pour ne pas frôler de trop près le coin de ce passage.
Or, comme, de l’autre trottoir, il jetait un rapide coup d’œil dans ledit passage, il vit à une vingtaine de pas de lui un groupe en marche d’ombres silencieuses, dix à douze personnes, quinze peut-être, qui s’avançaient à pas rapides dans la direction de la rue Pelpeau.
À ce moment, Firmin avait encore à parcourir cent ou cent cinquante pas pour arriver jusqu’à sa porte… Il se dit que le concierge n’ouvrait pas tout de suite… Ce petit retard serait-il compensé par l’avance de vingt pas qu’il avait sur la petite troupe ? Il pressa l’allure. Puis il se mit carrément à courir, dès qu’au bout d’un instant, le groupe avant tourné la rue, il entendit à n’en pas douter que l’on courait derrière lui.
Il lui sembla, d’après le bruit, que deux ou peut-être trois hommes s’étaient détachés pour lui donner la chasse… Il perçut ensuite, proféré par une voix sourde et menaçante, comme un appel ou un ordre de s’arrêter…
À ce moment, quelques mètres à peine le séparaient de sa porte. Il s’y jeta d’un bond, écrasa trois doigts sur le bouton électrique pour ne pas risquer de presser à côté…
La porte ne s’ouvrait pas. Firmin se retourna, y appuya son dos de toutes ses forces… Il vit arriver à une trentaine de pas de lui trois hommes qui couraient…
« Bien ! se dit-il, la porte ne s’ouvrira pas… En quatre secondes, ils seront sur moi… » Il donnait des coups de pieds furieux dans le bois… Ce sera cette brute de concierge qui sera cause de ma mort… »
La porte, ce jour-là, ne s’ouvrit pas plus vite qu’à l’ordinaire. Mais, ce qui sauva Firmin, c’est que les poursuivants s’imaginèrent qu’elle allait s’ouvrir. Malgré eux, ils ralentirent donc leur course, et ne reprirent leur allure qu’à dix pas, au moment précis où la porte cédait enfin, si inopinément pour Firmin que, le dos appuyé contre elle, il faillit tomber en arrière. Mais l’instinct de la conservation lui fit retrouver son équilibre. Il disparut dans le couloir obscur et repoussa de toutes ses forces cette porte protectrice, qui se referma avec un bon bruit de tonnerre.
Firmin, dans son escalier sombre, qu’une veilleuse peuplait d’ombres gigantesques, montait les marches avec une lenteur heureuse. Puis, tout à coup, il lui vint cette idée folle : les apaches allaient sonner à leur tour, et cet imbécile de concierge, dans l’inconscience du sommeil, était capable de leur ouvrir… Firmin fut repris d’une nouvelle panique, vraiment cette fois moins justifiée. Il monta ses deux étages à perdre haleine… Sa clef affolée fouillait nerveusement les environs de la serrure… Enfin, elle rencontra le trou et entra dedans. Mais Firmin ne pouvait ouvrir, tant il poussait, et, quand il fut chez lui, il s’écorcha les doigts à retirer sa clef… Puis, la porte une fois refermée, ce furent des nouveaux tâtonnements de la clef maladroite pour donner dans la serrure le double tour protecteur.
Quel délice de se retrouver dans cette forteresse !
Firmin se félicita d’avoir loué au second étage. Au premier, il n’eût pas été tout à fait tranquille.
Maintenant, il s’agissait de regarder ce qui se passait dans la rue, mais, bien entendu, avec certaines précautions.
Firmin s’approcha doucement de la fenêtre, dont les volets étaient fermés. Il ouvrit la croisée le plus silencieusement possible, et regarda à travers les fentes des volets.
D’abord, il eut une déception ; il n’y avait personne dans le petit carrefour.
Maintenant qu’il était séparé du danger par deux étages et deux portes solides, il ne lui eût pas été désagréable de contempler ses poursuivants réduits à l’impuissance, comme on se repaît de la vue des bêtes fauves enfermées derrière de solides barreaux.
Décidément l’aventure était incomplète… Il allait se retirer, légèrement dépité, quand il entendit un bruit de voix étouffées… Puis soudain un cri, un cri déchirant comme celui de la veille… La voix qui criait était peut-être cette fois moins forte, moins intense, mais il y retrouvait cet accent de vraie douleur qui, la nuit précédente, l’avait si profondément remué.
Des ombres, un paquet d’ombres traversa la place. Il n’y avait, dans ce petit carrefour, qu’un pauvre bec de gaz, dont la lanterne, sans doute, avait une de ses vitres brisée, car le papillon de flamme se tordait, secoué par le vent, et ne fournissait aux alentours qu’une bien pauvre lueur.
Les ombres en fuite avaient tout à fait disparu et Firmin avait bien l’impression qu’il ne restait plus personne sur la place, quand il lui sembla percevoir dans la rue comme une espèce de murmure… Ce ne fut qu’au bout d’un instant que ce murmure se précisa et qu’on y reconnut comme une plainte, un gémissement faible.
Le vent se calmait peu à peu, et, avec lui, l’agitation de la petite flamme de gaz. Firmin crut voir sur le trottoir une tache d’ombre épaisse qui bougeait un peu. Il lui sembla bien que le gémissement venait de là.
Il y avait là quelqu’un, un être en détresse, Firmin en fut certain… Un besoin impérieux de venir en aide à cette victime s’empara soudain de ce poltron.
Il y avait sûrement un danger sérieux à descendre dans la rue, d’autant qu’en fouillant l’obscurité de ses yeux avides, Firmin crut apercevoir au coin d’une des rues une ombre qui guettait…
Et puis il fallait redescendre, redemander le cordon au concierge, qui n’y comprendrait rien : plus que le danger probable, la peur de réveiller son concierge arrêta d’abord Firmin… Puis il se dit que son devoir ne lui permettait pas de s’arrêter à cet empêchement futile. Il était fou de songer au sommeil de son concierge quand la vie d’un être humain était en jeu… Au dehors, le gémissement persistait. Firmin mit dans sa poche un poignard ancien qui lui servait de coupe-papier et ouvrit sans hésiter cette précieuse porte de sa chambre, que cinq minutes auparavant il avait été si heureux de refermer.
Il descendit l’escalier mécaniquement, sans penser à ce qu’il allait trouver en bas.
« Cordon ! Cordon ! Cordon !… » Il fallut tambouriner à la vitre de la loge. Firmin se demandait quelle dispute homérique il allait être obligé de soutenir contre son concierge… quand, très simplement, la porte s’ouvrit… Ce pauvre concierge était trop endormi pour être capable de la moindre colère.
Cette fois Firmin se garda bien de refermer la porte derrière lui : il valait mieux ne plus dépendre de cet obstiné dormeur.
Il traversa la rue et alla droit au trottoir où il avait aperçu l’ombre gémissante, tout en donnant un furtif coup d’œil au coin de rue où il avait cru voir en observation une autre ombre, plus valide ; mais il se rendit compte que c’était l’ombre inoffensive du réverbère. Il n’en eut pas trop de désappointement. Cette erreur ne diminuait pas la valeur de son acte courageux, puisque la menace de cette ombre, encore indécise, ne l’avait pas arrêté.
Cependant le petit tas sombre et gémissant n’était pas, lui, une illusion. Firmin mit un genou en terre, et distingua un petit corps de femme qui ne remua pas à son approche. Il en montait toujours un petit gémissement machinal, régulier comme la plainte d’un être qui souffre en dormant.
La plainte s’accrut à peine quand Firmin, avec précaution, déplaça le petit corps mystérieux… Puis l’étudiant resta perplexe. Évidemment il n’y en avait pas lourd à porter. Mais il savait qu’il n’est pas très aisé de transporter un être humain qui n’y met pas de complaisance. Il valait mieux essayer de l’éveiller… Firmin lui toucha doucement le bras, ce qui n’eut d’autre effet que d’accroître un peu ce ronron gémissant qui persistait toujours…
Avait-elle vraiment quelque blessure ? C’était bien elle sans doute dont il avait entendu le cri de douleur… Firmin se dit : « Essayons toujours de la porter dans ma chambre ». Certainement ce charitable projet n’était suivi d’aucune arrière-pensée. Mais Firmin eût-il songé à hospitaliser chez lui une victime masculine ?
Il passa donc très doucement un de ses bras sous les épaules, l’autre sous les jambes repliées de l’inconnue…
À ce moment elle joignit les bras autour du cou du jeune homme, comme un petit enfant que l’on emporte pendant son sommeil. Et, comme un enfant aussi qui veut se faire plaindre et câliner, elle se mit à gémir tendrement…
Elle n’était pas lourde, et Firmin eut tôt fait de regagner la porte, qu’il referma d’un coup de pied vigoureux… Puis il s’engagea dans son escalier.
Cette histoire lui plaisait confusément. Il ne savait pas où tout cela le conduirait. Mais il avait entre les bras un petit être souple, qu’il espérait joli et gracieux. Que cette petite femme fût ainsi qu’il la souhaitait, on s’arrangerait toujours.
Il n’avait eu qu’à pousser la porte de sa chambre qu’il avait laissée entr’ouverte. Il rejoignit son lit dans l’obscurité, y déposa son fardeau. Puis avec émotion, il se mit en devoir d’allumer sa lampe ; qu’allait-elle lui révéler ?
Il allait de temps en temps aux courses. Il lui était arrivé de toucher un gagnant et d’apprécier le charme palpitant de ce moment d’anxiété douce, où, devant le tableau d’affichage, on attend le résultat de la répartition du mutuel et le chiffre exact de ce que l’on a gagné… D’avoir remonté chez lui cette jeune femme, c’était déjà une aubaine dont il allait maintenant mesurer l’importance.
La lampe allumée, le résultat ne fut pas connu tout de suite : la petite femme roulée en boule, la tête dans les épaules, avait le nez enfoui dans l’oreiller. Il fallut dérouler ce petit corps en escargot, puis relever de noirs cheveux qui cachaient le visage. Firmin procédait hâtivement à cette investigation sans s’arrêter à ce qu’elle pouvait avoir d’indiscret.
Il aperçut une très gentille figure au front bas, aux sourcils têtus. La jeune femme ouvrit des yeux tout noirs et regarda Firmin. Elle l’eût indéfiniment regardé ainsi, s’il ne se fût décidé à l’interroger.
— Est-ce qu’on vous a frappée ? lui demanda-t-il.
La petite femme continua à le regarder sans rien dire. Il est probable qu’elle n’entendit pas la question immédiatement ou que le sens des paroles prononcées ne lui parvint pas tout de suite… Sans doute le mot : frappée, enfin enregistré, provoqua-t-il chez elle un souvenir pénible, car elle se reprit à gémir, sans autre explication.
— Où ça vous fait-il mal ? continua le patient Firmin.
Cette seconde question n’eut pour résultat que de provoquer un gémissement plus immédiat… Puis la jolie figure se contracta, comme un beau ciel d’été gâté par un soudain orage. Et ce fut une suite ininterrompue de sanglots, une petite débâcle de larmes, la désolation de la désolation.
Firmin regardait couler, avec un certain soulagement, ces pleurs plus enfantins, plus humains, moins mystérieux ; il n’y avait qu’à prendre un peu de patience : l’inconnue n’allait pas tarder à s’expliquer.
Cependant, comme ce déluge de larmes ne cessait pas, Firmin, en un geste qui ne laissait pas de lui être agréable à lui-même, caressa doucement la petite tête brune : ce qui eut pour effet d’augmenter encore la désolation de la malheureuse. Mon Dieu ! comme elle se jugeait à plaindre, et comme on avait raison de la consoler ! Firmin le comprit bien, et, tout en insistant encore sur ses tendres caresses, il approcha du visage de la jeune femme un visage compatissant. Il semblait né pour cette pieuse tâche : il était le frère de charité des jolies femmes en détresse.
Ses bons offices l’avaient déjà tant rapproché de cette malheureuse inconnue qu’il se crut autorisé à compléter sa tâche de consolateur en déposant un baiser chaste, un baiser de grand-père, sur cet aimable front têtu.
Mais cette marque d’affection provoqua chez la jeune femme un tel redoublement de pleurs que Firmin se releva un peu interdit.
N’avait-il pas été un peu indiscret dans son œuvre de consolation ?
L’inconnue le rassura bien vite. Pour la première fois elle bougea toute seule, avança une main, prit le jeune homme par le bras, l’attira tout près d’elle, et se mit à pleurer tout contre lui.
Et c’était très bien ainsi. Ils ne se disaient rien d’explicite. Il s’était établi entre eux une sorte d’affection simple, naturelle, primitive. Elle semblait soulagée comme un être humain qui trouve une consolation chez un autre être humain. Plus tard on se dirait peut-être des paroles qui préciseraient les événements et la situation. Pour le moment, ce n’était pas nécessaire.
La petite femme se calmait visiblement et ne poussait plus que de petits sanglots de même grosseur, par habitude, semblait-il.
Ils seraient restés longtemps ainsi, elle pelotonnée sur le lit, lui à moitié étendu auprès d’elle… Mais la position de Firmin n’était pas absolument confortable. À un moment donné, il se redressa, et justifia ce mouvement par une inquiète sollicitude :
— Où avez-vous été blessé ?
D’un geste de tâte, l’inconnue lui désigna son épaule, qui providentiellement n’était pas celle que Firmin avait appuyée sur le lit en y déposant son fardeau.
Le jeune homme se mit en devoir de lui écarter son corsage pour examiner la blessure.
Mais l’opération n’alla pas sans difficulté.
La petite femme ne cessait de pousser de petits cris, parce qu’elle souffrait et aussi parce qu’elle avait peur d’avoir mal, comme on crie chez le dentiste pour l’avertir qu’il travaille dans une région sensible, et de peur qu’il n’oublie d’opérer avec précaution.
Puis comme le timide Firmin, impressionné, n’osait plus toucher au corsage, elle se mit elle-même sur son séant et écarta l’étoffe. Elle avait sur l’épaule une estafilade qui saignait. Cette longue écorchure était coupée par une autre griffe plus courte et moins profonde : on avait voulu la marquer d’une espèce de croix.
— Ils n’avaient pas l’intention de vous tuer, dit Firmin.
L’inconnue repartit dans une nouvelle crise de larmes.
— C’est bon ! se hâta de dire Firmin, vous me raconterez tout cela.
Pour l’instant, il était tout à la satisfaction qu’elle fût ainsi revenue à elle et de l’avoir ainsi dans sa chambre.
— Et vous savez, lui dit-il, ils ne viendront pas vous chercher ici. Vous êtes chez moi, vous n’avez rien à craindre de personne.
Ayant prononcé ces nobles paroles, il s’arrêta un peu embarrassé.
La suite ?… Quelle serait la suite ?
Il se souvint très à propos qu’il avait quelque chose à faire, soigner la légère blessure pour l’empêcher de s’envenimer.
— Je vais faire bouillir de l’eau pour vous laver un peu votre épaule. J’ai par là des cristaux d’acide borique. Comme ça on sera sûr qu’il ne viendra pas de mal.
Il préparait une lampe à esprit-de-vin. Comme il se retournait de son côté, il vit qu’elle le regardait avec de gentils yeux…
Elle n’avait encore prononcé aucune parole… Il ne connaissait pas le son de sa voix. Très doucement, elle lui dit :
— Je m’appelle Rose.
Il fut ému, sans savoir pourquoi. Elle s’appelait Rose… Il inclina la tête, comme pour dire qu’il n’y voyait pas d’inconvénient.
Tout en préparant la lampe et en cherchant son acide borique, il essayait de tirer cette histoire au clair par le seul secours de son imagination.
Les explications qu’il trouvait s’enchaînaient assez bien.
Rose appartenait à une bande d’apaches. Il entrevoyait une dispute entre deux femmes ; l’amant de l’autre femme s’était vengé sur Rose… Pourquoi exactement ? On saurait cela plus tard.
Cependant, certains détails ne cadraient pas avec cette explication.
Il ne lui semblait pas que Rose eût le costume et les manières d’une maîtresse d’apache.
À vrai dire, Firmin ne savait pas si les maîtresses d’apaches avaient un uniforme de rigueur, et il eût été très embarrassé de dire en quoi consistait ce costume hypothétique. Il examina à la dérobée la robe d’étoffe foncée que portait Rose. Il lui sembla que cette robe était bien coupée et que les petites bottines de la jeune femme étaient assez élégantes.
Mais pourquoi une maîtresse d’apache ne serait-elle pas bien habillée, et même bien chaussée ? Encore que, et Firmin en avait fait l’observation, les chaussures bien faites se rencontrassent moins souvent que les toilettes passables chez les jeunes femmes des classes non dirigeantes.
Elle était en cheveux. Évidemment, elle était en cheveux. C’est ainsi que la légende nous représentait la fameuse Casque d’Or. Pourtant, il ne s’agissait là que d’un détail. Et d’ailleurs, plus encore que son costume, l’air de la petite femme dérangeait les premières suppositions de Firmin.
Quel âge pouvait-elle bien avoir ? Peut-être pas vingt ans, dix-huit ans à peine. La façon très tranquille dont elle était installée là, dans la chambre de ce garçon qu’elle ne connaissait pas, dénotait aussi bien des mœurs faciles que la plus audacieuse des ingénuités…
Firmin n’osait lui poser des questions. Il s’occupait avec diligence de sa lampe à alcool. Quand son eau fut bouillie, il prit la petite casserole et la mit à rafraîchir dans une cuvette d’eau froide. Puis il alla chercher dans un tiroir de l’ouate hydrophile qu’il avait toujours en réserve.
Rose, en vérité, était bien tombée avec ce garçon de précaution.
Ces préparatifs terminés, il dit timidement :
— Il faudra peut-être retirer votre corsage.
Rose se laissa dévêtir, sans que son aisance naturelle et paisible dénotât quoi que ce fût de trop facile ou de trop pudique. Sa façon d’être n’apprit donc rien encore au toujours perplexe Firmin…
Elle portait par-dessus son corset un petit cache-corset très blanc, orné de minces rubans de satin bleu.
Firmin n’était pas un novice, mais il ne possédait pas sur les dessous de la toilette des dames des notions bien précises. Il lui sembla pourtant que ce cache-corset assez simple, ces petits rubans bleus, ressemblaient plutôt à la tenue soignée d’une femme d’un certain monde qu’au luxe à la manque qu’eût arboré une demoiselle de Belleville de mœurs reprochables.
Rose, toujours sur le lit, s’était mise sur son séant. Elle étendit son mince bras au-dessus de la cuvette. Elle regardait maintenant Firmin avec un sourire où il lui sembla discerner quelque chose de provocant. Il en conçut un peu d’ennui. Il lui semblait que cet air audacieux redonnait un peu de force à sa première hypothèse à laquelle il avait été heureux de renoncer dans son besoin de romanesque.
Et voilà que Rose lui dit tout à coup :
— Vous auriez dû mettre votre acide borique dans l’eau chaude, car je crois qu’« il » fond plus difficilement dans l’eau froide.
Elle disait « il fond » et non « elle fond ». Elle savait que le mot « acide » était du masculin. Elle remontait du coup un grand nombre de degrés dans l’échelle sociale !
Il pensa qu’il valait mieux ne plus faire de suppositions. Elles étaient constamment contradictoires et le fatiguaient. Le mieux était d’attendre patiemment les révélations de Rose.
Il se mit à panser avec douceur la plaie légère ; bientôt elle ne saigna plus.
— Demain matin, dit-il, il faudra aller chez le pharmacien et lui demander quelque chose pour mettre là-dessus, un taffetas quelconque. C’est à peu près sec, mais il ne faut pas que ça touche l’étoffe du corsage.
— Oui ; mais en attendant demain matin, comme je n’ai pas de taffetas, il faut me prêter un mouchoir pour mettre sous mon corsage…
— Comment, pour remettre votre corsage ?
Il avait cru qu’elle resterait chez lui. Voilà qu’elle manifestait l’intention de se rhabiller et de s’en aller sans doute.
Cependant il osa dire :
— Il vaut mieux ne pas remettre votre corsage maintenant ; vous allez vous reposer sur mon lit.
Il lui sembla convenable d’ajouter :
— Moi j’ai un bon fauteuil pour dormir dans le cabinet à côté…
— Mais quelle heure est-il donc ? demanda Rose.
Firmin alla ouvrir une armoire. C’est là qu’il enfermait son réveille-matin pour se débarrasser de son tic-tac obsédant.
— Il est un peu plus de deux heures et demie.
— Deux heures et demie ! s’écria la petite femme en sautant à bas du lit. Deux heures et demie ! répéta-t-elle, effarée. Mon Dieu ! mon Dieu ! Et moi qui croyais qu’il n’était pas minuit ! Il faut que je m’en aille tout de suite, vous entendez ? tout de suite.
— Vous n’allez pas partir seule, dit absolument Firmin.
La petite femme le regarda de ses yeux où l’on ne voyait que du noir. Firmin y reconnut une sorte de gravité.
— Vous descendrez avec moi, dit-elle, et vous me conduirez à une voiture.
Sans façon, elle lui prit le bras. Elle était surtout mince, et, une fois debout, paraissait moins menue.
Dans l’escalier, il eut toutes les peines du monde à l’empêcher de descendre trop vite. Depuis qu’il lui avait dit l’heure, elle ne tenait plus en place.
Une fois dans la rue, bras dessus, bras dessous, ils s’engagèrent dans la rue Pelpeau, la rue montante qui, cette fois, descendait, puisqu’on la prenait dans la direction du boulevard.
Bientôt ils ne furent plus qu’à quelques pas du passage Lunoyer. C’était là que, deux heures auparavant, Firmin avait vu sortir cette petite troupe de dix à douze personnes, dont Rose faisait évidemment partie.
Comme ils arrivaient au coin de ce passage, au lieu de continuer à suivre la rue Pelpeau, Rose, à la grande surprise de son compagnon, s’engagea dans le passage.
Il ne put s’empêcher de marquer un instant d’arrêt.
— Où allons-nous ? demanda-t-il, en maîtrisant un léger tressaillement.
— J’ai quelque chose à prendre par là, dit-elle du ton le plus naturel.