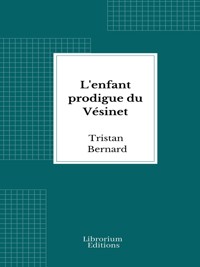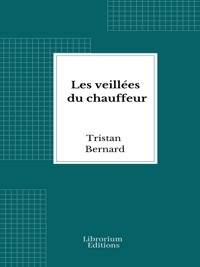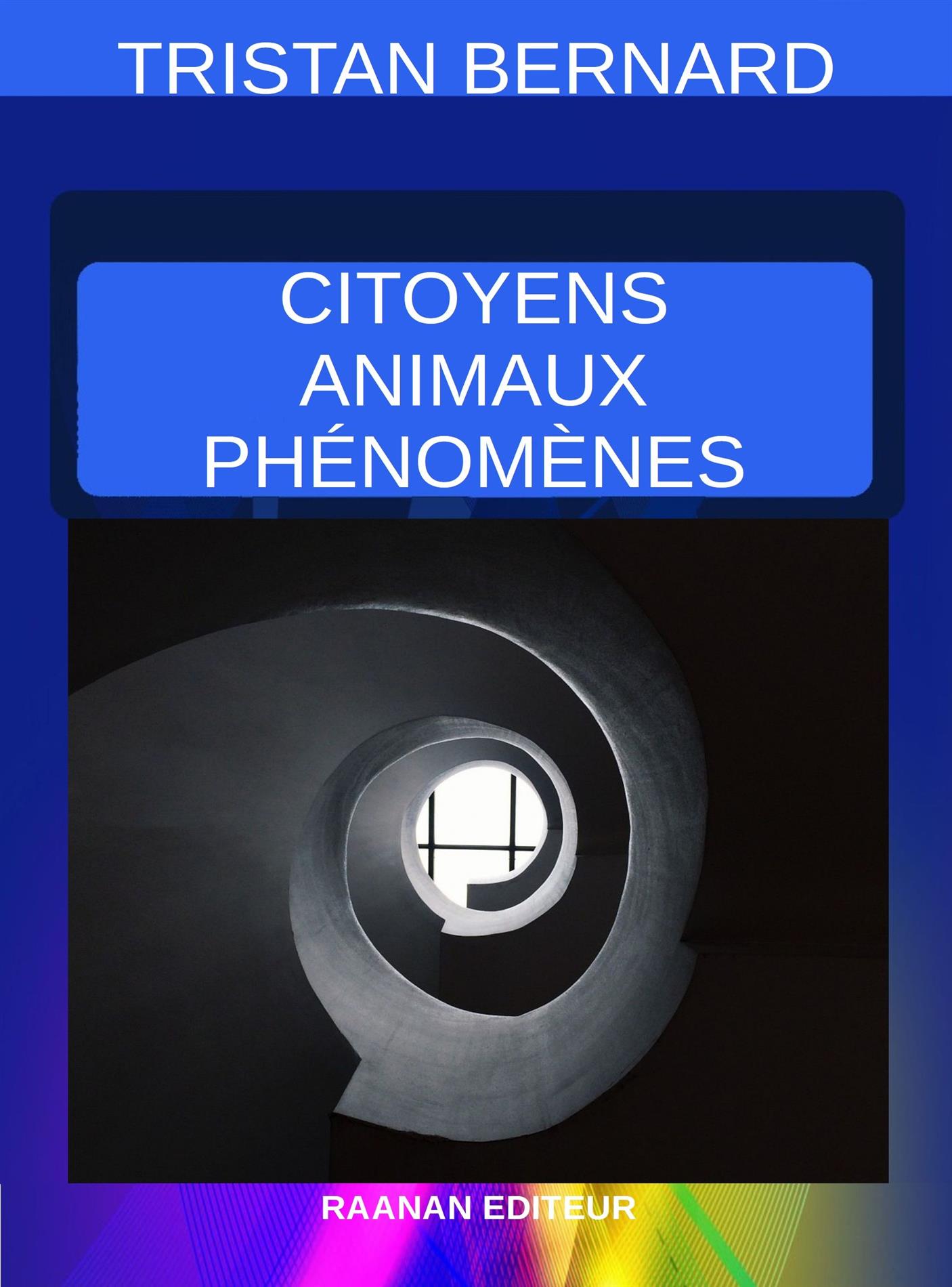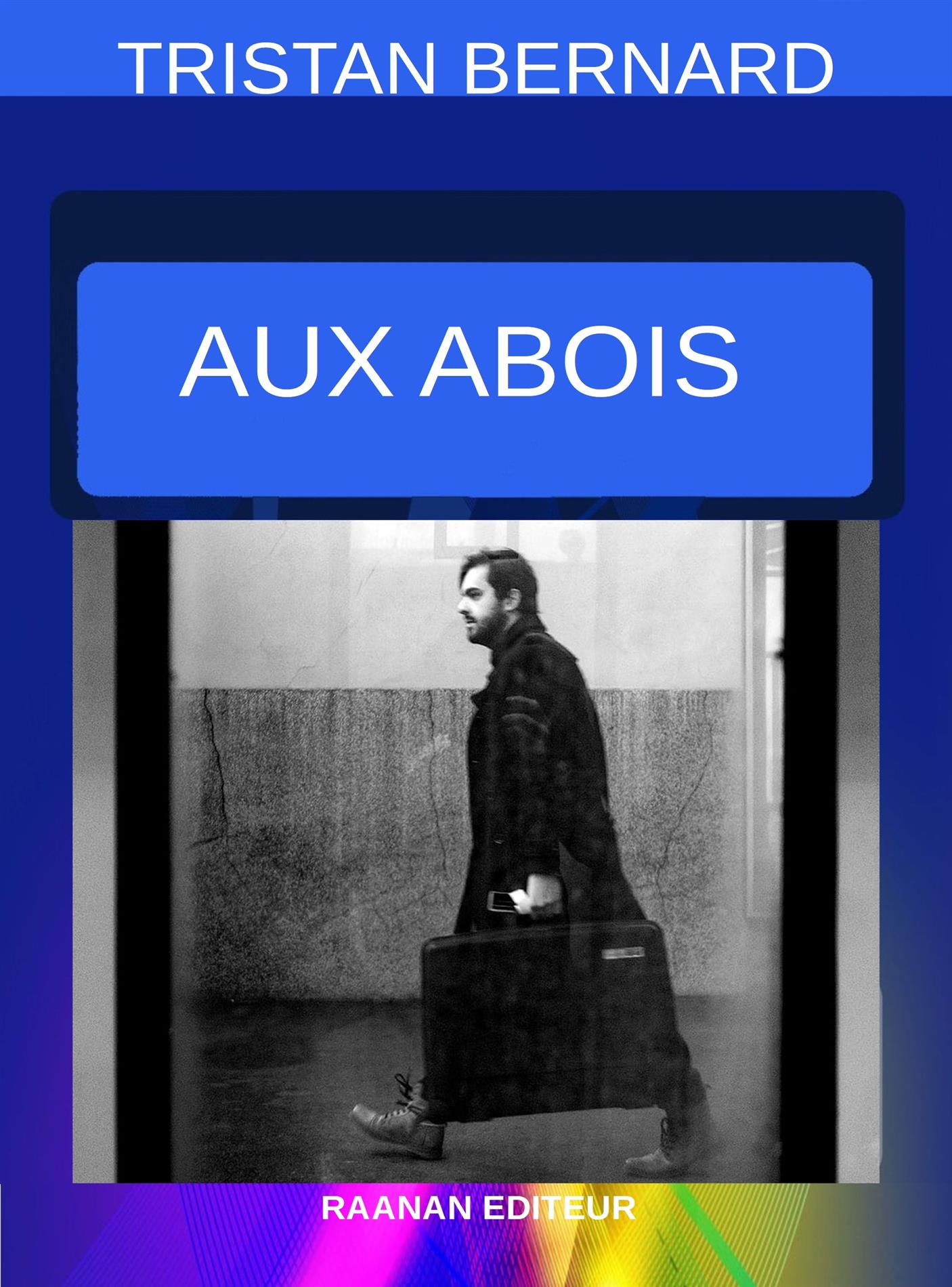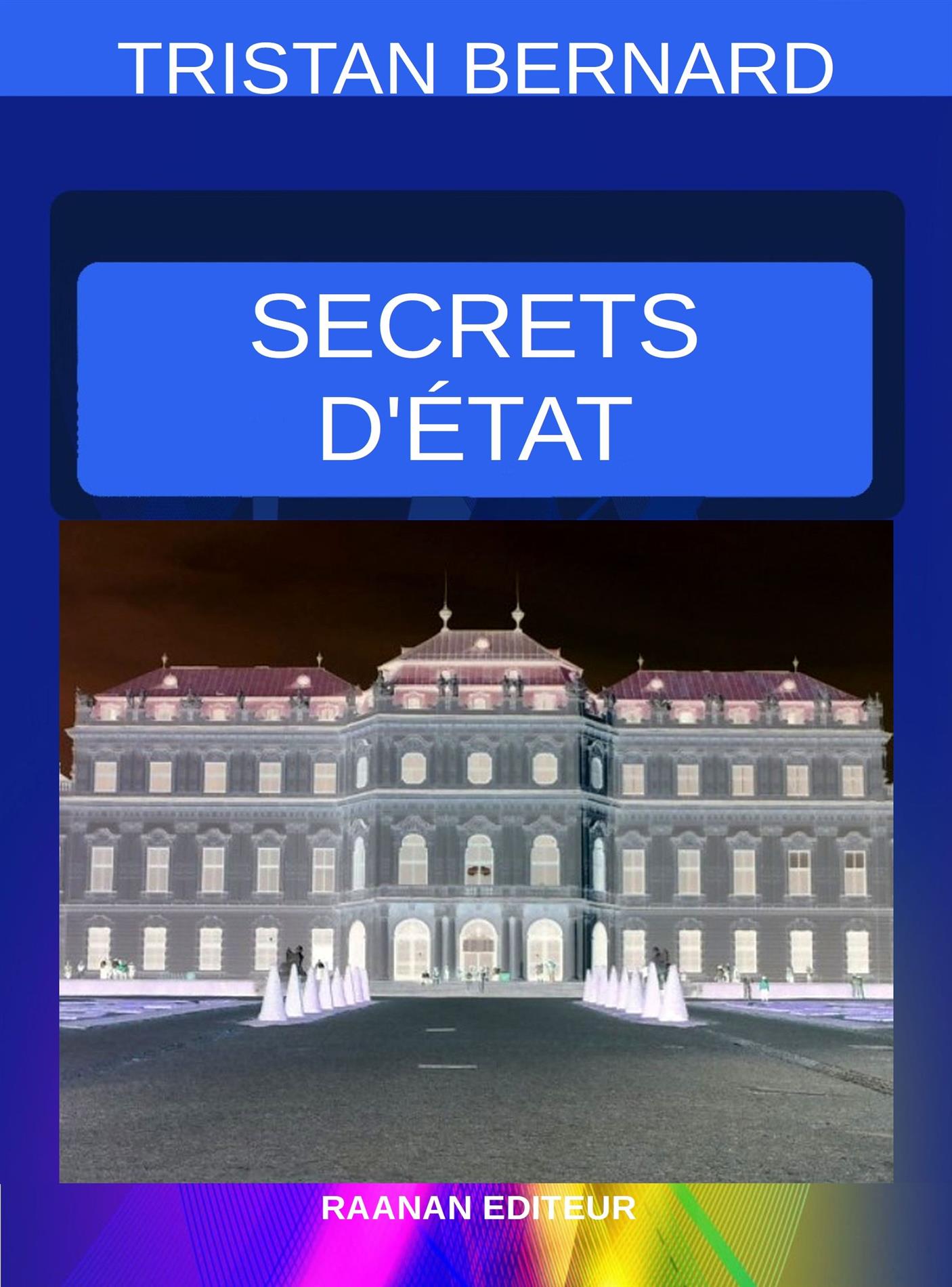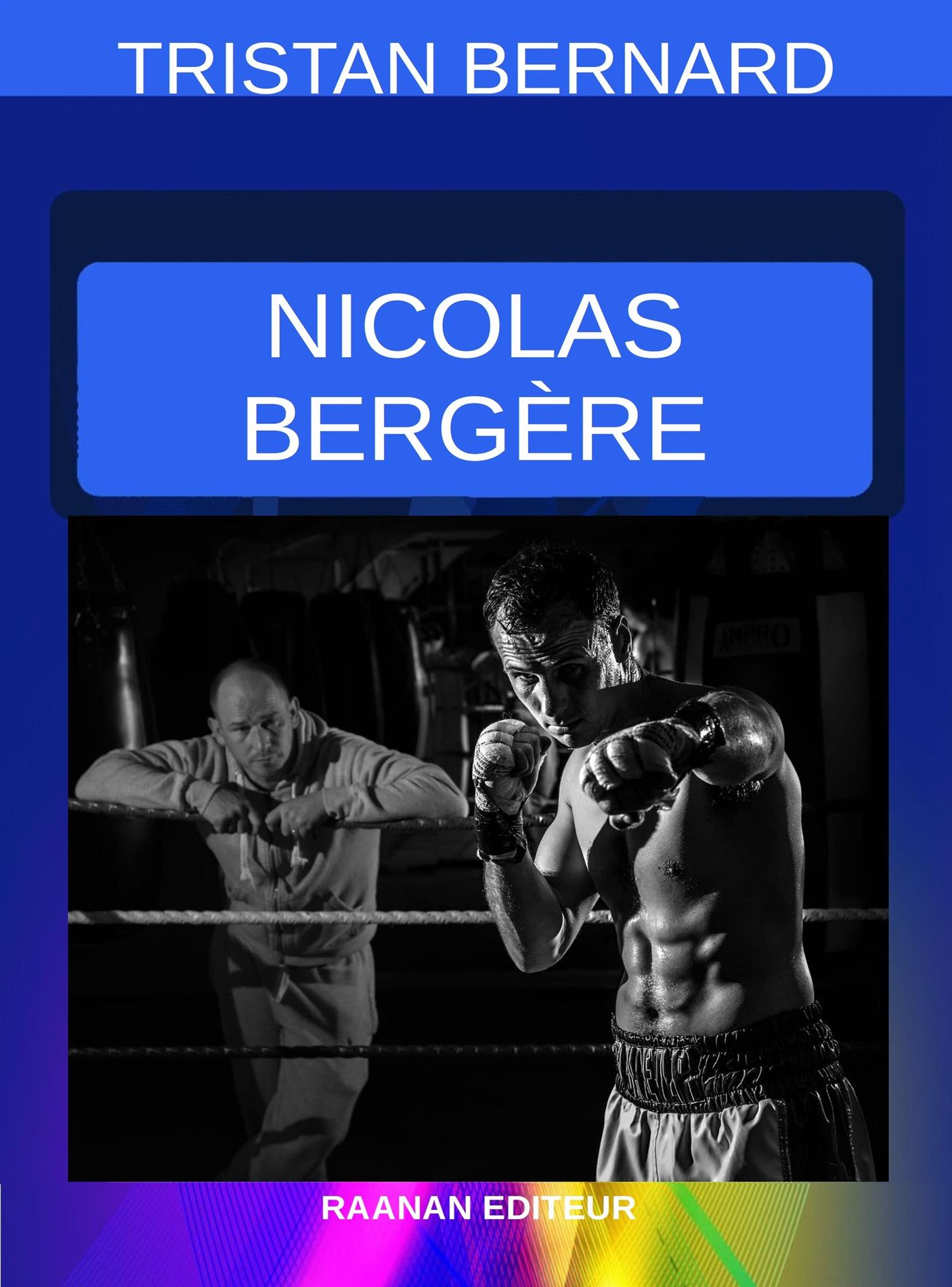1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Mémoires d’un jeune homme rangé est un roman de Tristan Bernard publié en 1899.
Extrait
I-DÉPART POUR LE BAL
| La jeunesse de Daniel Henry se passa alternativement à mépriser les prescriptions de la mode, et à tenter de vains efforts pour s’y conformer.
Il employa des années de sa vie à rêver la conquête de ces fantômes insaisissables : un chapeau élégant, un col de chemise bien dégagé, un veston bien coupé. Les haut-de-forme, si reluisants et séduisants tant qu’ils habitaient le magasin orné de glaces, contractaient au contact de la tête de Daniel Henry une sorte de maladie de vulgarité. Les collets de veston montaient jusqu’à la nuque, au mépris absolu des cols de chemise, dont ils ne laissaient plus rien voir.
Daniel avait été élevé par sa famille dans cette idée que les tailleurs fashionables et chers n’étaient pas plus adroits que certains tailleurs à bon marché qui habitaient dans les rues étroites du quartier Montorgueil.
— D’ailleurs, disait la mère du jeune Henry quand elle avait découvert un nouveau tailleur en chambre, c’est un homme qui travaille pour les premières maisons de Paris, et l’on peut avoir pour quatre-vingt-dix francs chez lui un vêtement qu’on paierait facilement le double ailleurs.
Daniel s’était commandé un habit de soirée à l’occasion de sa vingtième année. C’était son deuxième habit. Il s’était beaucoup développé en trois ans, et le premier était décidément trop étroit. Pendant plusieurs semaines, il avait vécu dans l’espérance de ce vêtement neuf, qui devait le mettre enfin au niveau social d’André Bardot et de Lucien Bayonne, deux jeunes gens qu’il devait rencontrer au bal des Voraud, et qui l’avaient toujours médusé par leur inaccessible élégance...|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
SOMMMAIRE
I DÉPART POUR LE BAL
II QUADRILLE DES LANCIERS
III COUP DE FOUDRE
IV DIMANCHE
V DANS LES AFFAIRES
VI PYLADE
VII INTERMÈDE
VIII GRANDE BANLIEUE
IX LE DOUBLE AVEU
X LA FÊTE COMMENCE
XI LE RETOUR
XII EN FAMILLE
XIII MAISON À LOUER
XIV ON S’INSTALLE
XV À CHEVAL
XVI UN POINT OBSCUR
XVII GRAVES RÉSOLUTIONS
XVIII DÉMARCHES OFFICIELLES
XIX FLEURS ET PRÉSENTS
XX UN AMI VÉRITABLE
XXI CONSEIL DE FAMILLE
XXII UNE DÉMARCHE
XXIII LA FIANCÉE
XXIV REPAS OFFICIEL
XXV ANDRÉ BARDOT
XXVI L’ENQUÊTE
XXVII SAGESSE NOCTURNE
XXVIII L’ATTACHEMENT
XXIX ÉPILOGUE
TRISTAN BERNARD
MÉMOIRES
D'UN
JEUNE HOMME RANGÉ
ROMAN
Paris, Fayard Editeur
1899
Raanan Editeur
Livre 740 | édition 1
À JULES RENARD
Mon cher Renard, c’est moins votre ami qui vous dédie ce livre, que votre lecteur. Je ne suis devenu votre ami qu’après vous avoir lu, et je n’ai fait votre connaissance que parce que je voulais vous connaître. J’ai été pour l’Écornifleur ce que j’avais été pour David Copperfield, un de ces frères obscurs que les écrivains tels que vous vont toucher à travers le monde. Je croyais alors que Dickens vous avait fortement impressionné. J’ai su depuis que vous le lisiez peu. Mais vous possédiez comme lui cette lanterne sourde, dont la clarté si pénétrante ne vous aveugle point, et qui vous permet de descendre en vous, et d’y retrouver sûrement de l’humanité générale et nouvelle. Ainsi vous éclairez, en vous et en nous, ces coins sauvages où nous sommes encore nous-mêmes, où les écrivains ne sont pas venus arracher les mauvaises herbes et les plantes vivaces pour y poser leurs jolis pots de fleur.
C’est une grande joie dans votre nombreuse famille, anonyme et dispersée, quand un volume récent, une page inédite, lui apporte de vos nouvelles et que le cousin Jules Renard nous envoie de son vin naturel, de ses œufs frais, ou quelque volaille bien vivante. C’est une bonne gloire pour vous que ce concert de gratitudes qui vous vient vous ne savez d’où. Comme cette clientèle naturelle est plus précieuse et plus difficile à conquérir que certaines élites parquées, où il suffit pour se faire comprendre, d’employer un dialecte spécial dont les mots ont acquis, grâce à des sortes de clés, un sens profond d’avance ! À vos frères inconnus vous parlez un langage connu, et je vous admire, cher Jules Renard, de savoir leur transmettre votre pensée tout entière, par votre style classique, fidèle messager.
T. B.
I DÉPART POUR LE BAL
La jeunesse de Daniel Henry se passa alternativement à mépriser les prescriptions de la mode, et à tenter de vains efforts pour s’y conformer.
Il employa des années de sa vie à rêver la conquête de ces fantômes insaisissables : un chapeau élégant, un col de chemise bien dégagé, un veston bien coupé. Les haut-de-forme, si reluisants et séduisants tant qu’ils habitaient le magasin orné de glaces, contractaient au contact de la tête de Daniel Henry une sorte de maladie de vulgarité. Les collets de veston montaient jusqu’à la nuque, au mépris absolu des cols de chemise, dont ils ne laissaient plus rien voir.
Daniel avait été élevé par sa famille dans cette idée que les tailleurs fashionables et chers n’étaient pas plus adroits que certains tailleurs à bon marché qui habitaient dans les rues étroites du quartier Montorgueil.
— D’ailleurs, disait la mère du jeune Henry quand elle avait découvert un nouveau tailleur en chambre, c’est un homme qui travaille pour les premières maisons de Paris, et l’on peut avoir pour quatre-vingt-dix francs chez lui un vêtement qu’on paierait facilement le double ailleurs.
Daniel s’était commandé un habit de soirée à l’occasion de sa vingtième année. C’était son deuxième habit. Il s’était beaucoup développé en trois ans, et le premier était décidément trop étroit. Pendant plusieurs semaines, il avait vécu dans l’espérance de ce vêtement neuf, qui devait le mettre enfin au niveau social d’André Bardot et de Lucien Bayonne, deux jeunes gens qu’il devait rencontrer au bal des Voraud, et qui l’avaient toujours médusé par leur inaccessible élégance.
Sur les conseils de sa mère, il avait commandé cet habit chez un petit tailleur de la rue d’Aboukir, qui travaillait d’après les modes anglaises. Ce petit homme à favoris gris, habillé d’une jaquette trop étroite et d’un pantalon trop large – deux laissés pour compte – avait apporté un portefeuille gonflé de gravures de mode, qui toutes représentaient des messieurs, très grands, très sveltes et pourvus de belles moustaches ou de barbes bien taillées. L’un d’eux, en habit de soirée, tendait le bras gauche, d’un geste oiseux, vers un monsieur en costume de chasse et, la tête tournée à droite, regardait froidement une jeune amazone.
Bien qu’il fût de taille médiocre et qu’il eût les épaules une idée tombantes, Daniel s’était assimilé dans son esprit à l’un de ces jeunes hommes, qui portait un monocle sous des cheveux légèrement ondulés et séparés par une raie.
Jamais les cheveux de Daniel Henry n’avaient voulu se séparer ainsi. Il n’avait jamais eu, comme le jeune homme de la gravure, une moustache blonde bien fournie. Ses joues étaient fertiles en poils noirs, mais sa moustache s’obstinait à ne pas pousser. Ses tempes aussi le désespéraient. Ses cheveux n’avaient pas à cet endroit le contour arrêté qui rendait si remarquable le front de tel ou tel élégant. Ils ne se terminaient pas par une bordure très nette. Ils se raréfiaient plutôt, pour ménager une transition entre la peau nue et le cuir chevelu.
Daniel, cependant, tout à la contemplation intérieure de cette merveilleuse vision du gentleman, de la gravure, s’identifiait à lui en pensée, oubliant l’insuffisance de sa moustache et la mauvaise conduite de ses cheveux du front.
Il alla pour l’essayage chez le tailleur. L’escalier montait tout droit jusqu’à l’entresol, à la loge du concierge, puis, après cette formalité, se livrait dans sa cage obscure à des combinaisons de paliers et de détours imprévus, de sorte que le tailleur habitait à un étage mal défini. Daniel arriva à sa porte après avoir dérangé deux personnes, un fabricant de descentes de lit et une ouvrière en fleurs de chapeaux, qui lui fournirent, en entrebâillant leur porte, deux rapides aperçus sur la flore artificielle et la faune honoraire de ce domaine citadin.
Daniel pénétra enfin dans une chambre assez bien éclairée, qui sentait l’oignon, et qu’un tuyau de poêle oblique traversait dans sa largeur. À côté de quelques gravures de modes, d’autres images exprimaient l’éloge suranné de M. Adolphe Thiers, soit qu’on le montrât en apothéose, sur son lit mortuaire, soit, vivant encore, au milieu du Parlement, et recevant vénérablement l’acclamation de Gambetta, qui saluait en lui le libérateur du territoire.
Le tailleur sortit de la chambre à côté. Daniel fut tout de suite impressionné par ses favoris gris et son pince-nez. Tout le monde, dans sa famille, ayant bonne vue, il n’avait jamais fréquenté de près des personnes ornées d’un binocle, qui restait pour lui une marque de supériorité sociale.
L’habit noir, rayé de petits traits de fil blanc et dépourvu de sa manche droite, ne ressemblait pas encore à l’habit de la gravure : Daniel, en se regardant dans la glace, remarqua que son dos n’avait jamais paru si rond.
Il en détourna les yeux de désespoir, et murmura d’une voix étranglée : « Le col un peu plus dégagé, n’est-ce pas ? »
Ce à quoi répondit à peine, d’un petit signe de tête approbatif, l’arrogant mangeur d’épingles.
En sortant de chez le tailleur, Daniel était un peu rembruni. Mais il se dit qu’il y avait bien loin d’un habit essayé à un habit fini, et que l’aspect général changerait notablement, le jour où il aurait un pantalon noir assorti à la place du pantalon marron, fatigué du genou, qu’il avait gardé pour l’essayage.
Le soir du bal chez les Voraud, on apporta l’habit de cérémonie. Daniel se hâta de l’endosser, et le trouva bien différent de ses rêves. Le collet cachait encore le col de chemise, qui, lui-même, était un peu bas (ce qui, entre le chemisier et le tailleur, rendait bien difficile l’attribution des responsabilités). De plus, les pans et la taille étaient trop courts. Daniel, sans mot dire, se regardait dans la glace. Après les éloges de sa mère et l’enthousiasme de sa tante Amélie, il n’eut plus d’opinion. Il n’osa d’ailleurs pas avouer qu’il se sentait un peu gêné aux entournures.
Quand il fut prêt des pieds à la tête, serré au cou dans un col un peu étroit, avec le nœud tout fait de sa cravate blanche et des bottines qu’il avait prises très larges (c’était le seul moyen de faire cesser la torture des chaussures), il alla se montrer dans la salle à manger, où son père et son oncle terminaient une partie d’impériale. Il était près de dix heures et demie. Il fallait arriver chez les Voraud vers les onze heures. Daniel attachait une importance énorme à son entrée. Il ne s’était jamais rendu un compte exact de la place qu’il occupait dans le monde. Tantôt il pensait être le centre des préoccupations de l’assistance, tantôt il se considérait comme un être obscur et injustement négligé. Mais il ne concevait pas qu’il y pût produire une sensation médiocre.
Son père l’examina avec une indifférence affectée, tira sa montre et dit :
— Il faut te mettre en chemin. Tu prendras le petit tram, rue de Maubeuge, avec une correspondance pour Batignolles-Clichy-Odéon, qui te déposera sur la place du Théâtre-Français.
— Pourquoi ça ? dit l’oncle Émile. Il a bien plus d’avantages à prendre Chaussée du Maine-Gare du Nord ? Qu’est-ce que tu veux qu’il attende pour la correspondance ? Chaussée du Maine le mène rue de Rivoli.
— Trouvera-t-il de la place dans Chaussée du Maine ? dit M. Henry qui tenait à son idée.
— Toujours à cette heure-ci, dit l’oncle Émile.
Daniel, qui était décidé à prendre une voiture, écoutait placidement cette discussion.
II QUADRILLE DES LANCIERS
Les Voraud donnaient un bal par saison. M. Voraud, avec sa barbe grise, ses gilets confortables et ses opinions bonapartistes ; Mme Voraud, avec ses cheveux dorés et son habitude des premières, effrayaient beaucoup Daniel Henry. Il n’était guère rassuré, non plus, par leur fille Berthe, qui semblait posséder, autant que ses parents, un sens profond de la vie.
Est-il possible que M. Voraud ait jamais pu être un petit enfant ? Quelle autorité dans son regard, dans ses gilets, dans son col blanc d’une blancheur et d’une raideur inconcevables, arrondi en avant comme une cuvette, et que remplit comme une mousse grise une barbe bien fournie !
Daniel pénètre dans l’antichambre et se demande s’il doit aller présenter ses compliments à la maîtresse de la maison.
Mais il n’a préparé que des phrases bien incomplètes, et puis Mme Voraud se trouve de l’autre côté du salon ; pour traverser ce parquet ciré, au milieu de ce cercle de dames, il faudrait à Daniel l’aplomb d’Axel Paulsen, le roi du Patin, habitué à donner des séances d’adresse sous les regards admiratifs d’une galerie d’amateurs.
Daniel préfère aller serrer la main au jeune Édouard, un neveu de la maison, qui peut avoir dans les douze ans. Car Daniel est un bon jeune homme, qui fait volontiers la causette avec les petits garçons dédaignés. Il demande au jeune Édouard dans quelle classe il est, quelles sont ses places dans les différentes branches, et si son professeur est un chic type.
Puis Daniel aperçut et considéra en silence les deux modèles qu’il s’était proposés, André Bardot et Lucien Bayonne, deux garçons de vingt-cinq ans, qui dansaient avec une aisance incomparable et qui parlaient aux femmes avec une surprenante facilité. Daniel, qui les connaissait depuis longtemps, ne trouvait d’ordinaire d’autre ressource que de leur parler sournoisement de ses études de droit ; car ils n’avaient pas fait leurs humanités.
Leurs habits de soirée étaient sans reproche ; ils dégageaient bien l’encolure. Bayonne avait un collet de velours et un gilet de cachemire blanc. Leurs devants de chemises, qu’on portait alors empesés, semblaient si raides que Daniel n’était pas loin d’y voir un sortilège. Dans le trajet de chez lui au bal, son plastron s’était déjà gondolé.
Alors, délibérément, il lâcha toute prétention au dandysme, et prit un air exagéré de rêveur, détaché des vaines préoccupations de costume, habillé proprement, mais sans élégance voulue.
On ne peut pas faire les deux choses à la fois : penser aux grands problèmes de la vie et de l’univers, et valser.
Il s’installa dans un coin de l’antichambre et attendit des personnes de connaissance. D’ailleurs, dès qu’il en voyait entrer une, il se hâtait de détourner les yeux, et paraissait absorbé dans l’admiration d’un tableau ou d’un objet d’art.
Pourtant il se permit de regarder les Capitan, car il n’avait aucune relation avec eux et n’était pas obligé d’aller leur dire bonjour. Mme Capitan, la femme du coulissier, était une beauté célèbre, une forte brune, aux yeux familiers et indulgents. Daniel avait toujours regardé ces yeux-là avec des yeux troublés, et ne pouvait concevoir qu’Eugène Capitan perdît son temps à aller dans le monde, au lieu de rester chez lui à se livrer aux plaisirs de l’amour, en compagnie d’une si admirable dame. Il avait beau se dire : « Ils viennent de s’embrasser tout à l’heure et c’est pour cela qu’ils sont en retard au bal », il n’admettait pas qu’on pût se rassasier de ces joies-là. Ce jeune homme chaste et extravagant n’admettait que les plaisirs éternels.
Un jeune sous-officier de dragons, préposé à la garde d’une Andromède anémique, s’approche inopinément de Daniel et lui demande :
— Voulez-vous faire un quatrième aux lanciers ?
Daniel accepte. C’est la seule danse où il se risque, une danse calme et compliquée.
Il met un certain orgueil à se reconnaître dans les figures. Pour lui, les lanciers sont à la valse ce qu’un jeu savant et méritoire est à un jeu de hasard.
Il se met en quête d’une danseuse et aperçoit une petite femme courte, à la peau rouge, et dont la tête est légèrement enfoncée dans les épaules. Elle n’a pas encore dansé de la soirée. Il l’invite pour prouver son bon cœur.
Puis commence ce jeu de révérences très graves et de passades méthodiques où revivent les élégances cérémonieuses des siècles passés, et qu’exécutent en cadence avec leurs danseuses les trois partenaires de Daniel, une sorte de gnome barbu à binocle, le maréchal des logis de dragons et un gros polytechnicien en sueur.
Le polytechnicien se trompe dans les figures, malgré sa force évidente en mathématiques. Daniel le redresse poliment. Lui-même exécute ces figures avec une nonchalance affectée, l’air du grand penseur dérangé dans ses hautes pensées, et qui est venu donner un coup de main au quadrille pour rendre service.
En entrant au bal, et en apercevant le buffet, Daniel s’était dit : Je vais étonner le monde par ma sobriété. (À ce moment-là, il n’avait encore ni faim ni soif. Et puis il se méfiait du café glacé et du champagne, à cause de ses intestins délicats.)
Le quadrille fini, il conduisit au buffet sa danseuse, persistant dans son rôle de généreux chevalier et lui offrant à l’envi toutes ces consommations gratuites, en se donnant ainsi une contenance pour s’en régaler lui-même. Mais le destin lui était néfaste. Précisément, à l’instant où il se trouve là, arrive Mme Voraud. Daniel se sent rougir, comme si elle devait penser, en le voyant, qu’il n’a pas quitté de toute la soirée la table aux consommations. Pour comble de malheur, il éprouve mille peines à donner la main à cette dame, car il se trouve tenir à la fois un sandwich et un verre de champagne. Il finit par lui tendre des doigts un peu mouillés et reste affligé, pendant une demi-heure, à l’idée que sans doute il lui a taché son gant.
III COUP DE FOUDRE
Daniel était venu à ce bal avec l’idée qu’une chose définitive allait se passer dans sa vie. Il ne se déplaçait d’ailleurs qu’à cette condition.
Ou bien il allait être prié de réciter des vers et les réciterait de telle façon qu’il enfiévrerait la foule.
Ou bien il rencontrerait l’âme sœur, l’élue à qui il appartiendrait pour la vie et qui lui vouerait un grand amour.
À vrai dire, cette femme-là n’était pas une inconnue. Elle était toujours déterminée, mais ce n’était pas toujours la même. Elle changeait selon les circonstances. Il y avait une sorte de roulement sur une liste de trois jeunes personnes.
Ces trois demoiselles étaient Berthe Voraud, une blonde svelte, d’un joli visage un peu boudeur ; Romana Stuttgard, une grande brune ; enfin, la petite Saül, maigre et un peu aigre. Daniel avait joué avec elle étant tout petit, et ça l’inquiétait un peu et le troublait de penser que cette petite fille était devenue une femme.
D’ailleurs il n’avait jamais dit un mot révélateur de ses pensées à aucune de ces trois élues, qui lui composaient une sorte de harem imaginaire. Aucune d’elles ne lui avait fourni la moindre marque d’inclination.
Chacune avait sa spécialité.
C’était avec Berthe Voraud qu’il faisait en Imagination un grand voyage dans les Alpes. Il la sauvait d’un précipice. C’était elle aussi qui l’appelait un soir à son lit de mort. Elle y guérissait ou elle y mourait, suivant les jours. Quand elle y mourait, ce n’était pas sans avoir avoué à Daniel un amour ardent. Il s’en allait ensuite tout seul dans la vie, avec un visage triste à jamais, dédaignant les femmes, toutes les femmes, avides de lui, que son air grave et sa fidélité à la morte attiraient sur son chemin.
La grande jeune fille brune était plus spécialement destinée à des aventures d’Italie, où Daniel, l’épée à la main, châtiait plusieurs cavaliers.
C’était pour lui l’occasion de songer à apprendre l’escrime.
Quant à la laide petite Saül, elle trouvait son emploi dans des épisodes beaucoup moins chastes.
Le mariage sanctifiait toujours ces rapprochements. Car l’idée d’arracher une jeune fille à sa famille terrifiait le fils Henry et les pires libertinages se passaient après la noce.
Ce soir-là, c’était Mlle Voraud qui tenait la corde et qui était vouée au rôle principal et unique, en raison de son actualité.
Daniel sentit en la voyant un grand besoin de la dominer. Elle lui était tellement supérieure ! Elle faisait les honneurs de la maison et parlait aux dames avec tant de naturel ! Elle disait à une dame : « Oh ! madame Hubert ! vous avez été trop charmante pour moi ! Vous êtes trop charmante ! On ne peut arriver à vous aimer assez. »
Cette simple phrase paraissait à Daniel dénoter une intelligence et une aisance infinies. C’était une de ces phrases comme il n’en trouverait jamais. Peut-être après tout aurait-il pu la trouver, mais il ne fût jamais parvenu à la faire sortir de ses lèvres. Comme elle était bien sortie et sans effort, de la petite bouche de Berthe Voraud ! Daniel, lui, ne parlait d’une façon assurée qu’à quelques compagnons d’âge et à sa mère. Quand il s’adressait à d’autres personnes, le son de sa voix l’étonnait.
L’après-midi, il avait eu une conversation imaginaire avec Berthe Voraud. Alors, les phrases venaient toutes seules.
C’était lui qui devait aborder Berthe Voraud en lui disant :
— J’ai pensé à vous constamment depuis que je vous ai vue.
Ces simples mots (prononcés, il est vrai, sur un ton presque tragique), devaient troubler profondément la jeune fille, qui répondait très faiblement :
— Pourquoi ?
— Parce que je vous aime, répondait Daniel.
À ce moment, elle se couvrait de confusion et s’en allait pour cacher son trouble.
Et Daniel n’en était pas fâché, car, poussée à ce diapason, la conversation lui paraissait difficile à soutenir.
Dans ses imaginations, Daniel allait toujours vite en besogne. L’effort lui était insupportable.
Il voulait n’avoir qu’à ouvrir les bras, et que les dames lui tombassent du ciel, toutes préparées.
Des conquérants patients lui paraissaient manquer de gloire.
Comme il pensait à autre chose, il aperçut devant lui Mlle Voraud.
— Monsieur Henry ? Comment va Madame votre mère ? Pourquoi n’est-elle pas venue ?
Il répondit poliment, mais avec une grande sécheresse, et ne dit rien de ce qu’il avait préparé.
D’ailleurs, Berthe Voraud avait déjà passé à un autre invité, pendant que Daniel Henry, très rouge, regardait devant lui d’un air profond, c’est-à-dire en fermant à demi les yeux, comme s’il était myope.
— Monsieur Henry, vous ne m’avez pas invitée ?
C’était encore Berthe Voraud, qui se présentait inopinément, sans se faire annoncer. Aussi, tant pis pour elle, il ne trouvait pas de phrase aimable pour la recevoir.
— Vous allez me faire danser cette valse ?
— C’est que… je ne valse pas.
— Eh bien ! nous nous promènerons. Offrez-moi votre bras.
Daniel offrit donc son bras à Mlle Voraud et ce simple geste mit en fuite tous les sujets de conversation. Il en attrapa un ou deux au passage, comme on attrape des volailles à tâtons, dans un poulailler obscur. Puis il les essaya mentalement et les laissa aller ; ils étaient vraiment trop misérables.
Alors il fronça le sourcil et prit un air méditatif. Ce qui lui attira cette question providentielle :
— Vous paraissez triste ? Avez-vous des ennuis ?
— Toujours un peu.
— Vous avez pourtant passé brillamment vos examens de droit.
— C’est si facile, répondit-il honnêtement.
— C’est facile pour vous, dit Berthe, parce que vous êtes intelligent et savant.
Cet éloge lui fit perdre l’équilibre. Il rougit et son regard vacilla.
— Et vous étiez au Salon ? dit Berthe.
— J’y suis allé deux fois.
— Vous aimez la peinture ?
— Oui, répondit-il à pile ou face. Beaucoup.
— J’ai failli y avoir mon portrait. C’est d’un jeune homme de grand talent, un prix de Rome, M. Leguénu. Nous l’avons connu à Étretat. C’est un élève de Henner Malheureusement, le portrait n’a pas été prêt assez tôt.
— Il est ressemblant ?
— Les avis sont partagés. Maman dit que c’est bien moi. Papa prétend qu’il ressemble à ma cousine Blanche. Moi, je trouve que mes yeux, à leur couleur naturelle, ne sont pas aussi bleus.
— Ils sont pourtant bien bleus.
— Non, ils sont gris. Moi, d’ailleurs, j’aime mieux les yeux bruns. Surtout pour un homme. Je trouve qu’un homme doit être intelligent et avoir les yeux bruns.
— Les miens sont jaunes.
— Non, ils sont bruns. Je vais vous faire des compliments : vous avez de beaux yeux.
— Ce sont les yeux de ma mère, dit gravement Daniel.
— Est-ce que vous irez cette année à Étretat ?
— Oui, dit Daniel, surtout si vous y allez.
La conversation l’avait lancé en pleine mer. Il nageait.
— Asseyons-nous un peu, dit Berthe au moment où ils entraient dans un petit salon. Tâchez de venir à Étretat. On s’amusera un peu. On se réunira l’après-midi. Nous jouerons la comédie.
— Et puis je vous verrai.
— Vous tenez tant que ça à me voir ?
Il inclina la tête.
— Eh bien, pourquoi ne venez-vous pas plus souvent ? Tous les mercredis, à quatre heures, j’ai des amies et des amis. On fait un peu de musique. Venez, n’est-ce pas ? C’est entendu. Vous serez gentil, et vous me ferez plaisir.
Berthe se leva. La valse venait de finir. D’autres danseurs l’attendaient.
Daniel était, d’ailleurs, ravi que l’entretien eût pris fin. C’était assez pour ce jour-là. Il avait besoin de faire l’inventaire des premières conquêtes.
Il sortit du bal peu après. Il rentra à pied.