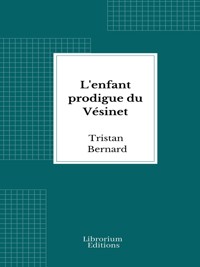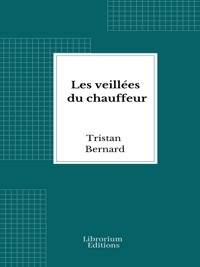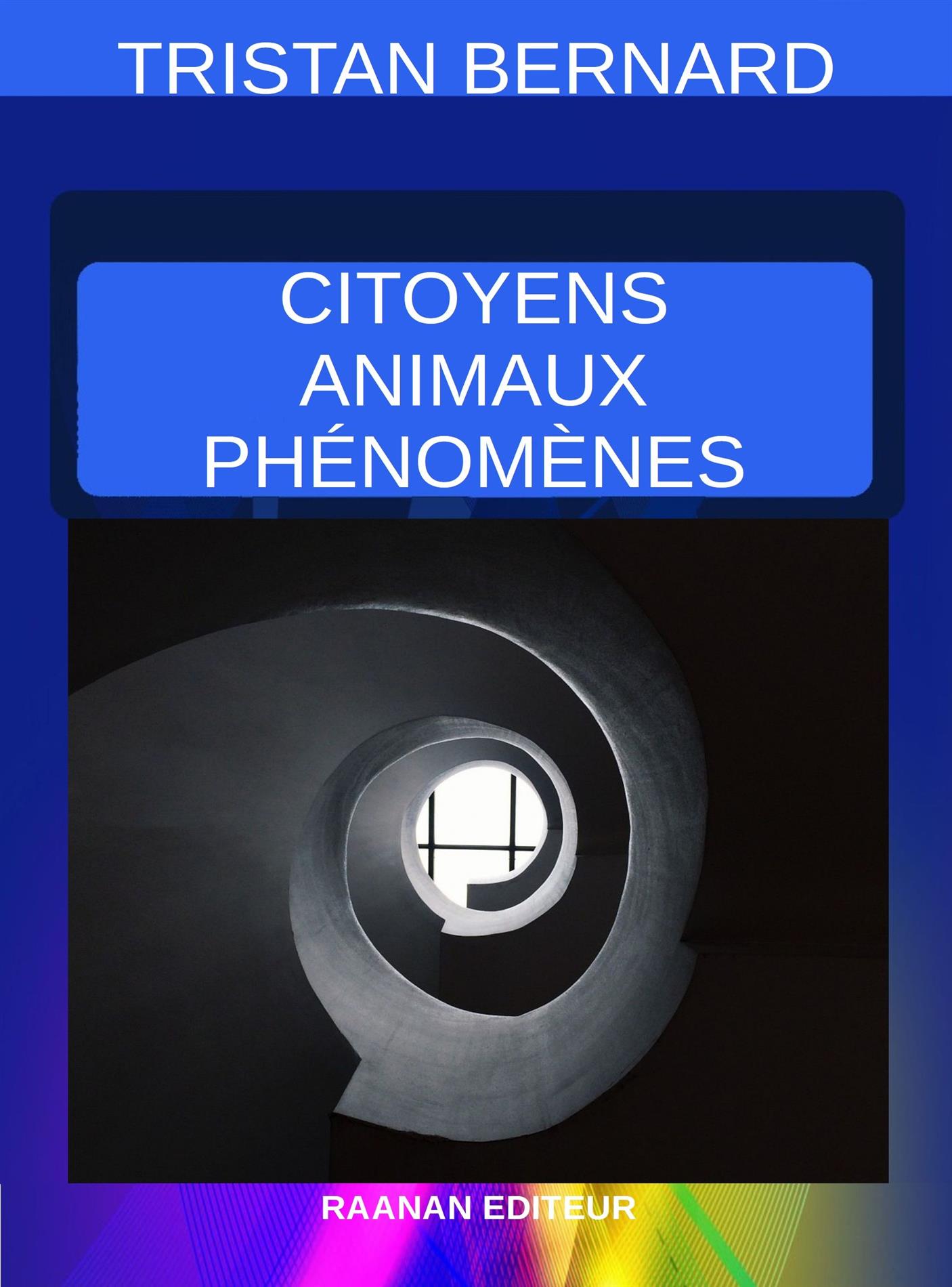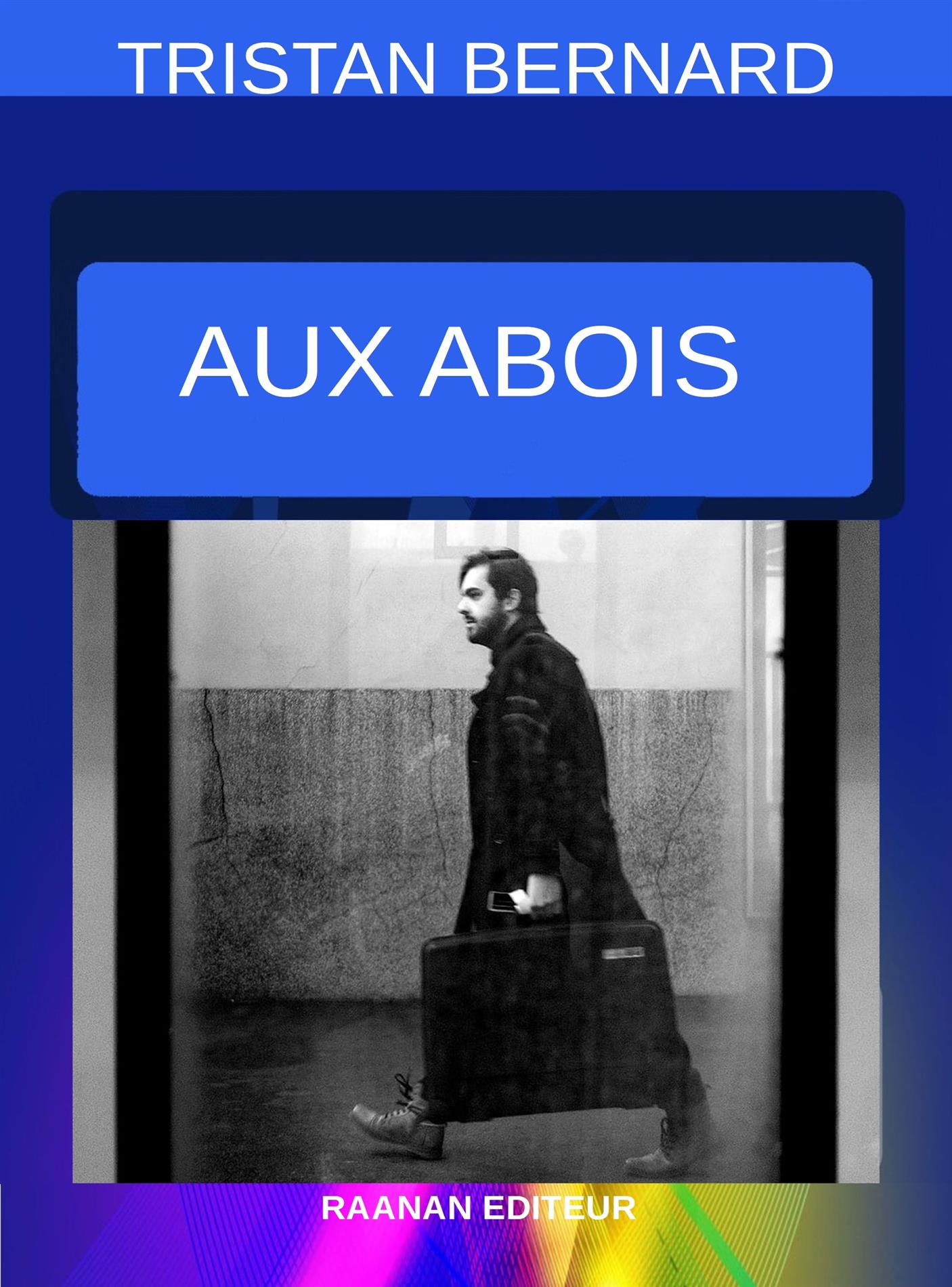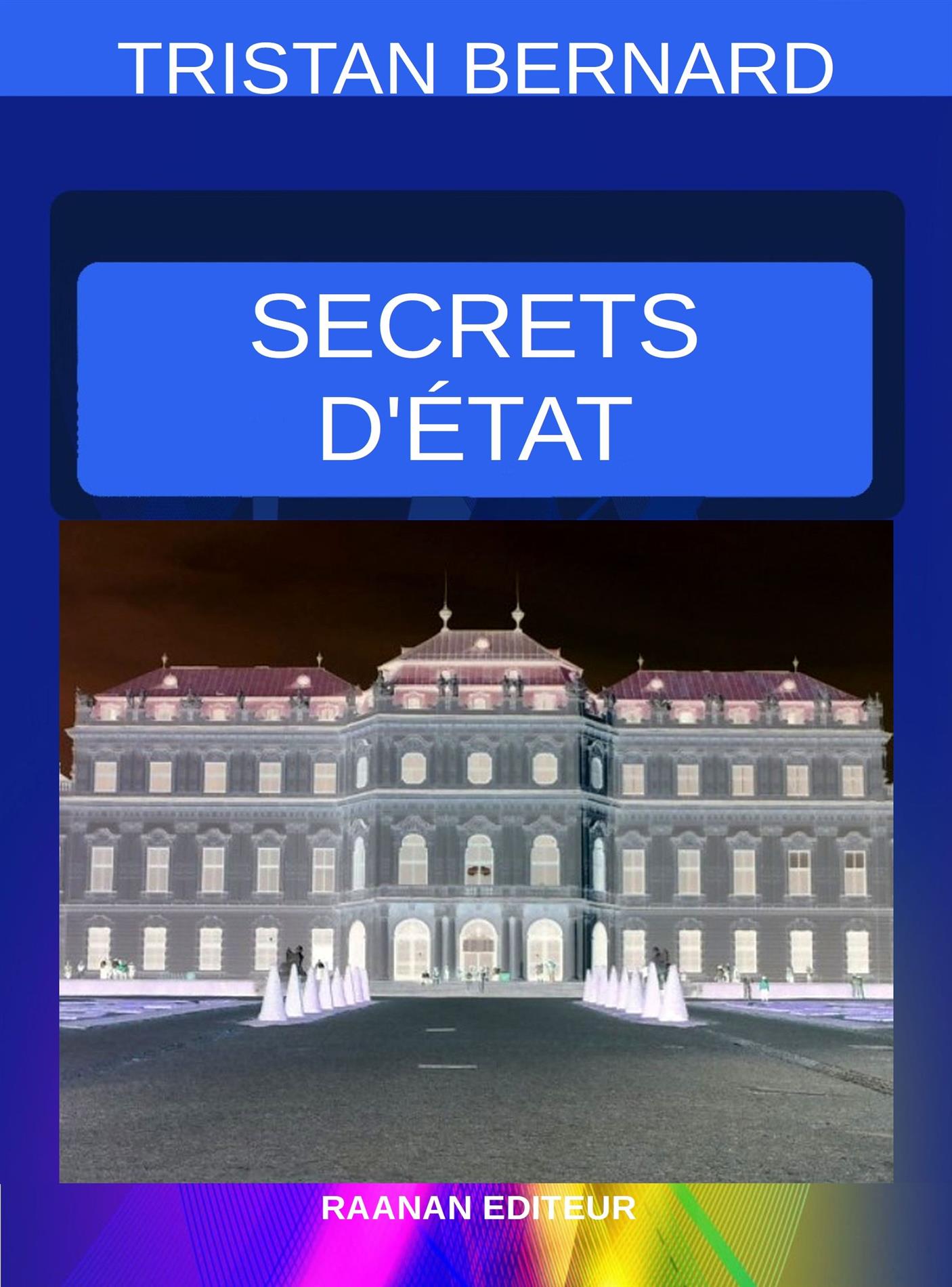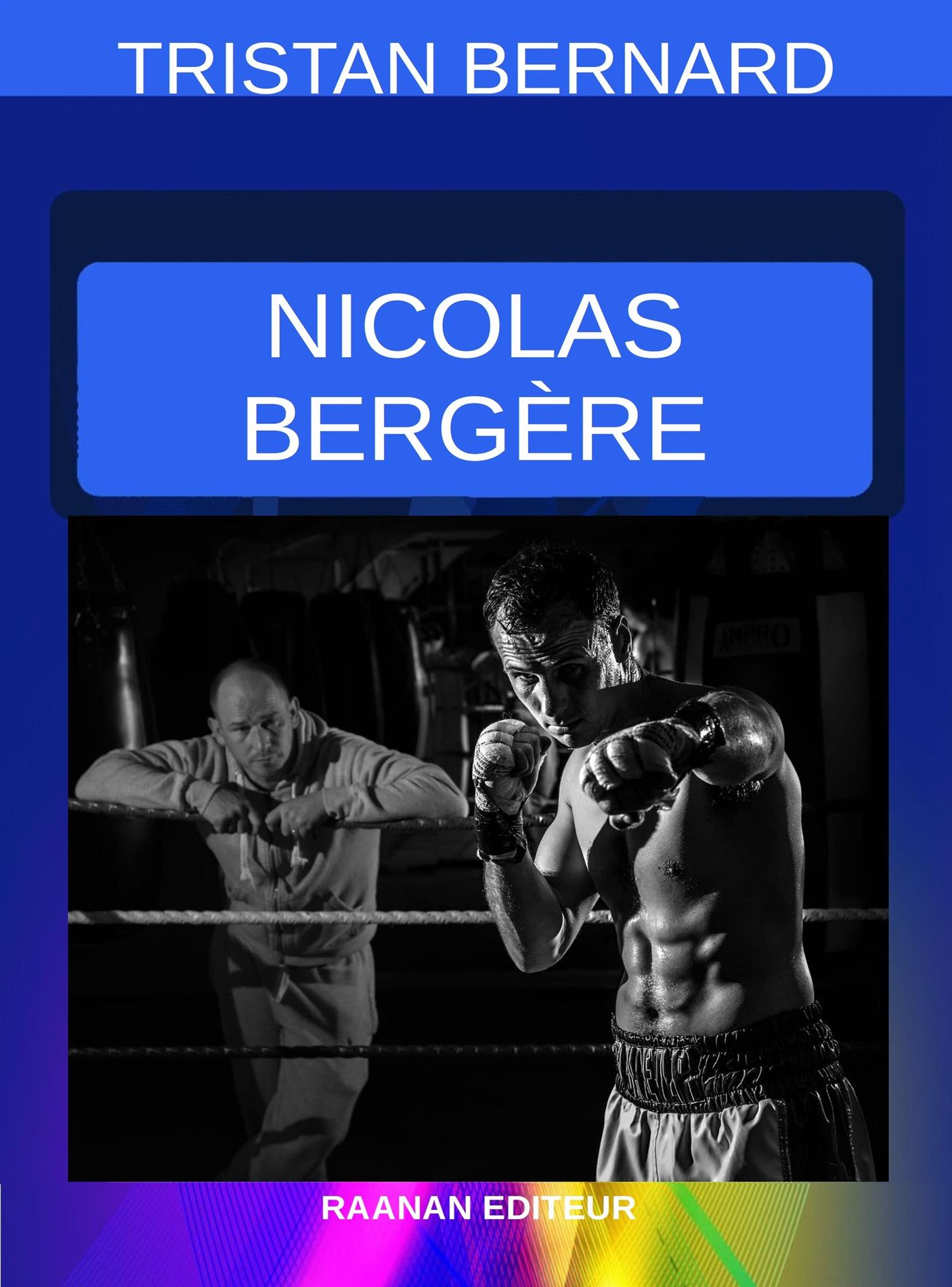1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un mari pacifique est un roman de Tristan Bernard publié en 1901.
Extrait
I-EN RETARD
| Quand Daniel rentra du bureau, après avoir attendu assez longtemps chez le coiffeur, Berthe était déjà en toilette de soirée. Avec une irritation que ne calmait point la présence sur son menton d’un petit bouton rouge, la jeune femme affirma qu’il était près de huit heures. « Et la carte des Capitan, ajouta-t-elle, porte sept heures trois quarts exactement. » Daniel essaya de prétendre qu’il n’était que sept heures et demie et que, lorsqu’on dit sept heures trois quarts, c’est huit heures… Vraiment, ce n’était pas gai de se mettre en retard avec des gens qui vous invitent pour la première fois. M. Capitan, un ancien commis de magasin, avait dû sa fortune et son élévation à son air distingué, toujours trop distingué, semblait-il, pour les positions où il se trouvait ; quand il fut parvenu à la grande opulence, on commença à s’apercevoir qu’il ressemblait à un prestidigitateur hongrois. Tel qu’il était, il impressionnait beaucoup le jeune ménage. Berthe et Daniel avaient été surpris et charmés de cette invitation à dîner. Ils s’attendaient tout au plus à une carte pour le bal.
Daniel enleva précipitamment ses vêtements un peu crottés. La femme de chambre était sortie chercher des épingles neige pour le front de madame, et la cuisinière ne savait pas où était l’habit. Daniel se souvint tout à coup qu’il n’avait qu’un bouton de perle pour les deux boutonnières de son devant de chemise. L’autre bouton avait été perdu et Daniel portait pour toute sa vie le remords de n’avoir pas attaché toute la garniture avec un fil de soie ; ce qui est une précaution indispensable quand on porte des plastrons mous.
Il dut se contenter de deux boutons ordinaires retrouvés au fond d’un tiroir. Mieux valait être modeste et correct avec de la nacre que d’afficher un luxe de perles fines incomplet. Une autre déception, au moment d’enfiler ses chaussures, attendait le malheureux dîneur. La semelle de la bottine gauche était trouée. Il avait bien des bottines non vernies toutes neuves avec de triples semelles. Peut-on, avec l’habit, mettre des bottines non vernies ? Son ami Julius prétendait, mais était-ce bien sûr ? que c’était le chic américain...|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
SOMMMAIRE
I EN RETARD
II EN PARTIE FINE
III DU NOUVEAU
IV CHEF DU CONTENTIEUX
V PATERNITÉ
VI UN TIERS
VII CHAPITRE DEUX
VIII PREMIÈRES ALARMES
IX INCIDENTS
X ALTERNATIVES
XI LA VÉRITÉ
XII RÉSOLUTIONS
XIII L’ENTREVUE
XIV RÉFLEXIONS
XV EN LIBERTÉ
XVI LE FOYER CONJUGAL
XVII UN PHILOSOPHE
XVIII DES NOUVELLES D’ÉRIC
XIX UNE DÉMARCHE
XX
XXI
TRISTAN BERNARD
UN MARI PACIFIQUE
ROMAN
Paris, 1901
Raanan Editeur
Livre 741 | édition 1
À Lucien GUITRY
Son ami,
T. B.
I EN RETARD
Quand Daniel rentra du bureau, après avoir attendu assez longtemps chez le coiffeur, Berthe était déjà en toilette de soirée. Avec une irritation que ne calmait point la présence sur son menton d’un petit bouton rouge, la jeune femme affirma qu’il était près de huit heures. « Et la carte des Capitan, ajouta-t-elle, porte sept heures trois quarts exactement. » Daniel essaya de prétendre qu’il n’était que sept heures et demie et que, lorsqu’on dit sept heures trois quarts, c’est huit heures… Vraiment, ce n’était pas gai de se mettre en retard avec des gens qui vous invitent pour la première fois. M. Capitan, un ancien commis de magasin, avait dû sa fortune et son élévation à son air distingué, toujours trop distingué, semblait-il, pour les positions où il se trouvait ; quand il fut parvenu à la grande opulence, on commença à s’apercevoir qu’il ressemblait à un prestidigitateur hongrois. Tel qu’il était, il impressionnait beaucoup le jeune ménage. Berthe et Daniel avaient été surpris et charmés de cette invitation à dîner. Ils s’attendaient tout au plus à une carte pour le bal.
Daniel enleva précipitamment ses vêtements un peu crottés. La femme de chambre était sortie chercher des épingles neige pour le front de madame, et la cuisinière ne savait pas où était l’habit. Daniel se souvint tout à coup qu’il n’avait qu’un bouton de perle pour les deux boutonnières de son devant de chemise. L’autre bouton avait été perdu et Daniel portait pour toute sa vie le remords de n’avoir pas attaché toute la garniture avec un fil de soie ; ce qui est une précaution indispensable quand on porte des plastrons mous.
Il dut se contenter de deux boutons ordinaires retrouvés au fond d’un tiroir. Mieux valait être modeste et correct avec de la nacre que d’afficher un luxe de perles fines incomplet. Une autre déception, au moment d’enfiler ses chaussures, attendait le malheureux dîneur. La semelle de la bottine gauche était trouée. Il avait bien des bottines non vernies toutes neuves avec de triples semelles. Peut-on, avec l’habit, mettre des bottines non vernies ? Son ami Julius prétendait, mais était-ce bien sûr ? que c’était le chic américain.
Il se décida à consulter Berthe et parut dans l’embrasure du cabinet de toilette :
— Est-ce que tu crois qu’on peut se mettre en habit avec des bottines non vernies ?
Mais il n’obtint aucune réponse de cette femme irritée, et désireuse de sanctionner sa rancune par un mutisme d’une heure au moins. Il prit donc le parti de s’en tenir aux bottines vernies. Il aurait simplement la préoccupation, en croisant les jambes, de placer toujours la jambe droite en dessus, afin de maintenir le pied gauche et la semelle ulcérée en contact avec le tapis.
Son habit endossé, son faux-col serré un peu trop par une cravate élastique, sa barbe taillée de frais, et l’intérieur de ses oreilles semé de petits poils récemment coupés, il entra dans le cabinet de toilette de sa femme. Il avait un peu chaud de s’être habillé vite et ne laissait pas d’être inquiet, car sait-on jamais, au moment de partir pour une fête, si on est absolument en règle avec ses intestins ? Berthe semblait en être encore au même point : assise devant sa toilette, une longue épingle à chapeau au bout des doigts, elle en avait toujours à la même mèche, qu’elle arrondissait sur son front. Daniel sentit, avec un âcre plaisir, que c’était son tour à lui d’avoir un sujet d’irritation, mais il le mit sagement de côté pour plus tard, pour ne pas perdre encore un temps précieux. Quelle heure, d’ailleurs, était-il ? Les trois pendules de la maison, profitant de ce qu’elles étaient chez un jeune ménage, n’avaient jamais marché que quinze jours à peine, tout au début. Un grand discrédit pesait sur la montre de la cuisinière, qui, selon que le dîner était prêt ou non, avançait ou retardait d’une façon invraisemblable. La première indication sérieuse leur fut fournie, quand ils descendirent, par la pendule de la concierge : huit heures vingt-cinq ! Il faut dire qu’elle avançait de dix minutes… peut-être de vingt. Le trajet était long de la rue Caumartin au boulevard Pereire. Daniel aurait bien voulu choisir un bon cheval, mais Berthe n’était pas disposée à attendre dans le courant d’air de la porte. Il fallut se décider pour une voiture qui fermait mal. Un cocher informe et bastionné de cache-nez inutiles effleura de son fouet le doyen des chevaux arqués. On prétend que les chevaux arqués, qui paient peu de mine, sont meilleurs que les autres. Mais ce n’était pas sans doute à propos de celui-là que cet axiome avait pris naissance.
Comme Daniel, désireux de guetter les horloges à l’intérieur des boutiques, faisait mine de baisser la glace, la jeune femme eut une petite toux sèche et un regard résigné qui firent entrevoir au cruel mari tout le sombre cortège des bronchites capillaires et des pleurésies. Alors il essuya tant bien que mal la buée des vitres, juste pour apercevoir l’horloge du boucher, qui, au-dessus du petit kiosque où se trouvait la caissière, marquait huit heures vingt, froidement. Et tout de suite après, au fond d’un magasin de modes, une pendule d’aspect gothique, aux chiffres émaillés, n’allait-elle pas jusqu’à annoncer huit heures trente-cinq, avec ses aiguilles contournées ! Mais cela, c’était évidemment de la fantaisie diabolique.
Daniel ne fut pas rassuré par l’horloge d’un pharmacien, qui marquait sept heures trois quarts ; ce qui était d’un optimisme fou. Il eût désiré un mensonge plus plausible. Enfin le chiffre officiel de huit heures vingt-trois fut accusé par l’horloge du chemin de fer de l’Ouest qu’on apercevait depuis le pont de l’Europe. Daniel osait à peine se dire que c’était l’heure intérieure, et qu’il fallait encore ajouter cinq minutes.
S’il eût été seul il serait assurément retourné chez lui, laissant l’orage, qui s’amoncelait dans la salle à manger des Capitan, éclater un peu loin de sa tête. Mais ce n’était pas une chose à proposer à Berthe. Il se borna à dire, d’une voix faible :
— Huit heures et demie.
Elle répondit sèchement :
— C’est ta faute.
Il ne discuta pas. Plus impartial qu’elle, il reconnaissait que, d’une façon générale, il est difficile de démêler la responsabilité des époux dans un retard de ce genre, où chacun s’autorise, pour ne pas se presser, de la complicité forcée de l’autre.
Cependant le cocher emmitouflé mettait son cheval au pas dans des montées imperceptibles, où il se faisait dépasser par les piétons les plus languissants. Sur le plat, l’allure du pas était remplacée par une sorte de sautillement rétrograde. Daniel, s’il eût été seul, eût pris bravement un autre fiacre, après avoir réglé celui-là. Mais, avec Berthe, il ne fallait pas songer à des prodigalités pareilles.
Enfin l’on arriva au boulevard Pereire, et le cocher s’arrêta, en se trompant de deux numéros. Il n’y avait qu’à descendre là, et à faire vingt-cinq pas à pied. Mais Berthe s’y opposa ; ce qui donna lieu à une remise en train de tout l’appareil.
Dans la maison, une nouvelle perte de temps fut occasionnée par la recherche infructueuse de la corde verticale qui fait monter l’ascenseur. Daniel, sous le regard méprisant de Berthe, alla demander l’aide du concierge.
— Ah ! se dit Daniel, quand ils arrivèrent sur le palier des Capitan, pourvu qu’ils ne nous aient pas attendus et qu’ils se soient mis à table !
Il sonna. Un moment très long se passa avant qu’on donnât signe de vie. Il espéra un instant qu’ils s’étaient trompés de jour ; mais, quand un domestique leur ouvrit la porte, ils aperçurent dans l’antichambre un nombre imposant de chapeaux hauts de forme.
— On est à table ? demanda Daniel au garçon.
— Oui, monsieur, on est encore à table…
Il les introduit dans un grand salon vide, presque éteint, et dont il ranime la lumière.
Encore à table ?
Qu’est-ce que ça voulait dire ?
L’instant d’après, M. Capitan lui-même arrive au salon, après s’être arrêté sur le seuil de la porte pour avaler une bouchée : « Excusez-nous, dit-il, nous sommes encore en train de dîner. » On entend dans sa bouche le bruit sifflant de petits appels d’air, destinés à dégager ses dents. « Nous nous sommes mis à table un peu tard. Excusez-nous », répète-t-il.
Il les quitte, en leur indiquant d’un geste vague les vitrines d’objets d’art. Certainement, en se rasseyant à table, il s’étonnera tout haut que des gens, invités pour la soirée, soient arrivés de si bonne heure. Et les convives auront, grâce à Daniel, cette impression gênante qu’il y a une limite à leur plaisir gastronomique, qu’ils ne mangeront pas éternellement et ne digéreront pas en paix, et qu’on va tant soit peu brusquer le service, pour ne pas trop faire languir les réprouvés du salon.
— Il y a pourtant dîner et sept heures trois quarts sur la carte ? dit Daniel à Berthe.
Elle hausse les épaules.
— Tu le sais bien.
C’est vrai qu’il le sait bien.
— Ils se sont trompés. Elle est bonne ! ajouta-t-il avec un accent qu’il veut rendre joyeux.
Si elle pouvait rire de tout cela !
Elle ne rit pas. Elle se mord la lèvre. Elle pleurerait sans doute, sans le sentiment héroïque qu’il ne faut pas se rougir les yeux.
— Sais-tu ce que nous devrions faire ? dit Daniel. Allons dîner au restaurant.
— Je n’ai pas faim.
Elle ne fera jamais rien pour arranger les choses.
Chaque fois que le Hasard mauvais joue des tours à Daniel, elle se met du côté du Hasard.
D’ailleurs Daniel est content que sa proposition d’aller au restaurant ne soit pas acceptée… Il faudrait redemander son vestiaire. Et c’est bien compliqué.
Mais quelques minutes après, voici que Berthe a faim, et qu’elle le dit : « J’ai une faim terrible. » « Allons au restaurant ! » s’écrie Daniel, avec le plus d’entrain possible.
Il sort dans l’antichambre qui est vide… Il entrebâille doucement une porte qui donne peut-être sur l’office… Mais elle s’ouvre sur la salle à manger où le dîner bat son plein dans la lumière et les éclats de joie… Daniel referme la porte. Enfin un maître d’hôtel vient à passer. Daniel, pour ravoir son pardessus, lui raconte une histoire qui ne tient pas debout. (Il veut profiter, dit-il, de ce qu’il a un moment à lui pour aller voir avec sa femme des parents qu’ils ont dans le quartier.) Le domestique l’écoute d’un air pressé et incompétent.
Heureusement que Berthe se ravise. Elle a réfléchi qu’elle se décoifferait et se friperait ; elle préfère se passer de manger. Daniel rentre au salon et tous deux regardent tristement les tableaux et les bronzes.
Enfin on apporte des plateaux couverts de tasses, de petits verres et de flacons. M. Capitan, qui ne confie ce soin à personne, déploie sur la table des boîtes de cigares somptueux, qu’il semble sortir de ses manches. Le cortège échauffé des convives envahit lentement le salon. Les messieurs lâchent le bras de leurs voisines de table et s’inclinent avec un respect soulagé.
Mais M. Capitan, inquiet et embarrassé, s’est approché de Daniel.
— Il me vient à l’instant un soupçon, lui dit-il. Il y a déjà eu une erreur de commise, avec la distraction de mon secrétaire qui a envoyé les invitations. Ainsi mon beau-frère a reçu une invitation pour le bal. Il savait heureusement que c’était pour le dîner… Les cartes sont gravées, n’est-ce pas ?… et puis nous avons trois séries de dîners… On a confondu les séries… Bref… Est-ce que vous n’auriez pas reçu une invitation pour le dîner ?
— Non, non, répond Daniel, pour éviter des affaires.
Et il regrette aussitôt d’avoir dit : Non. Car il a faim.
— Vous m’enlevez un poids, dit M. Capitan, en lui tendant une boîte où Daniel, troublé, prend un cigare dont il ne saura que faire, puisqu’il ne fume pas.
M. Capitan continue sa ronde et présente à tout venant ses cigares, comme des occasions exceptionnelles dont il faut se hâter de profiter.
II EN PARTIE FINE
Au souper des Capitan, Daniel et Berthe se trouvèrent à la table de la belle Mme Alfreda, et de M. Alfreda, le coulissier. Le père de M. Alfreda n’était pas d’ici. Mais lui est un pur Parisien. C’est un homme obèse, à la moustache et aux cheveux luisants, aux paupières un peu lourdes. Jadis, quand il passait l’été au Vésinet, Julius et Daniel se moquaient de lui, et l’appelaient le baron Bouffi. Mais ce sobriquet est oublié, maintenant que M. Alfreda s’occupe de Daniel, lui parle, et lui propose même des parties carrées.
— Nous avons, ma femme et moi, dit-il, des goûts un peu bohèmes.
Il expose ses goûts bohèmes : c’est de ne pas prendre ses places à l’avance au théâtre, d’y aller comme ça, tout à coup, quand on se sent bien disposé, et de ne pas savoir, en sortant de chez soi, dans quel restaurant de nuit on ira souper.
Voilà l’agrément des ménages sans enfants.
— Les enfants, c’est charmant, dit Mme Alfreda, mais c’est une sujétion.
— Nous avons quinze ans de ménage, et nous sommes encore de nouveaux mariés, dit M. Alfreda. Allons ! le jeune couple ! Quand faisons-nous la fête ensemble ?
Daniel est confus, confus d’orgueil et aussi de peur. Depuis l’âge où il a cessé de sortir avec ses parents, il a toujours été épouvanté par les parties de plaisir. Quand des amis, des camarades venaient le chercher le soir, il était inquiet, troublé. Il se demandait dans quel endroit joyeux on allait le conduire.
Et puis il n’avait jamais aimé s’engager dans des aventures, sans être exactement fixé sur les frais qu’elles comportent.
Daniel ne sait pas s’il est avare ou prodigue. Il croit bien ne pas être avare, parce qu’il sent bien qu’il ne peut pas se retenir de dépenser son argent. Mais il ne pense pas non plus être prodigue, car il le dépense à regret.
Ses parents lui ont affirmé bien des fois qu’il ne connaissait pas la valeur de l’argent. Il a, au fond, sur la valeur de l’argent, les idées des personnes avec qui il se trouve. Il est économe avec les gens modestes, somptueux avec les viveurs.
Malheureusement, il ignore encore le secret de paraître large à peu de frais. Dans les milieux où il est bien porté de dédaigner l’argent, il ne saura pas prouver son dédain par de simples paroles ; il lui faudra recourir à des exemples coûteux.
L’incertitude des restaurants de nuit l’effraie. C’est un engrenage terrible. On ne sait jamais jusqu’où vous entraînera l’élégance des gens que l’on traite, l’importance des maîtres d’hôtel, l’affabilité imprévue d’un gérant qu’on ne connaît pas.
Va-t-on dépenser vingt francs ou cent cinquante francs ? Et la présence de Berthe complique encore la situation. Si elle n’était pas là, Daniel se dirait : « Après nous le déluge ! » Mais elle est là, et surveille.
Ce jour-là, au moins, les Alfreda paieront le souper, puisqu’ils doivent dîner chez les Daniel Henry. Le jour de la revanche, quand on fera la partie de plaisir strictement inverse, Daniel n’aura qu’à copier le menu du souper précédent.
Pour le dîner chez eux, ils sont tranquilles ; Mme Voraud est là pour tout organiser. Elle a commandé l’aspic et la glace. Elle leur prêtera son domestique et deux petites salières en vermeil. Ils ont de l’argenterie toute neuve, des serviettes damassées qu’ils étrennent, et pas moins de quatre couverts à salade, des cadeaux de noce. Ils ne peuvent pas servir tous les quatre : mais Berthe en parlera.
Vers sept heures, Mme Voraud, qui doit se retirer discrètement avant l’arrivée des invités, appelle son gendre pour qu’il voie l’aspect de la table. Daniel, déjà en habit, est ému. C’est la première fois qu’il reçoit du monde chez lui. Et l’impression d’heureuse fierté qu’il espérait en avoir est abolie par la crainte des incidents imprévus. Sans parler des détails précis, qui l’obsèdent déjà. Il n’y a que deux sortes de liqueurs, pas de cherry-brandy. D’autre part, le poisson, qu’il a entrevu à la cuisine, n’a qu’un œil… Et c’est peut-être vilain.
Enfin, les invités arrivent et le dîner est mené assez rapidement. La conversation se soutient, grâce à deux catastrophes de chemins de fer, survenues pendant la semaine, et dont l’une s’est précisément produite sur une ligne où M. Alfreda aurait pu voyager. Daniel parle peu. Il écoute Berthe, qui se lance dans la conversation avec une hardiesse qui le fait trembler, sur des sujets où il la sait peu documentée. Elle s’en tire cependant à son avantage.
Le dessert, le café et les liqueurs passent sans encombre. Daniel, qui n’est pas fumeur, a acheté au bureau de tabac deux paquets de cigares, les plus chers qu’il a pu trouver, et les a mis dans une boîte de nickel. Mais M. Alfreda demande la permission de fumer un cigare très long, qu’il a dans sa poche.
— Si nous ne voulons pas, dit-il, arriver trop en retard, je crois qu’il serait temps de vous préparer, mesdames.
Daniel reste seul avec son invité. Il se repent d’avoir gaspillé, pendant le dîner, tous les sujets d’actualité.
Il pense déjà, depuis un instant, à rembourser le prix de la loge que M. Alfreda a louée, l’après-midi, aux Variétés. Comment va-t-il s’y prendre ? Il ne sait pas très bien rembourser.
— Nous reparlerons de cela, dit M. Alfreda.
Mais Daniel ne veut plus reparler de cela. L’important est de régler au plus vite la question de la loge, afin qu’il ne subsiste aucun doute, dans le compte des politesses, sur le paiement du souper.
— C’est une loge de cinquante francs, dit enfin M. Alfreda.
Daniel, qui a préparé dans les poches de son gilet toute espèce de monnaie d’or et d’argent, dépose sa quote-part sur la nappe, non loin de la main de M. Alfreda, qui pianote au bord. M. Alfreda ne semble pas voir ce numéraire. À un moment, pourtant, sa main cesse de pianoter, balaie doucement la nappe, et fait couler les vingt-cinq francs dans la poche du gilet.
Puis, cette main monte aux sourcils de M. Alfreda, qu’elle frotte avec véhémence, comme si ç’eût été là le geste essentiel, et comme si le reste eût été accompli chemin faisant, par simple distraction.
On arrive aux Variétés au milieu du premier acte. Daniel aime beaucoup le théâtre. Julius et lui, jadis, ne manquaient pas un vaudeville. Ils louaient des stalles d’orchestre et se trouvaient là dès le lever du rideau. Daniel savait une ou deux phrases qu’il disait, avec la voix de certains acteurs ; et c’était à s’y méprendre, les jours où il était bien disposé.