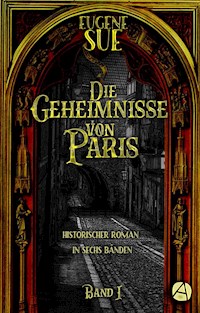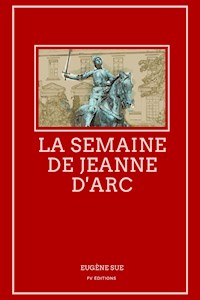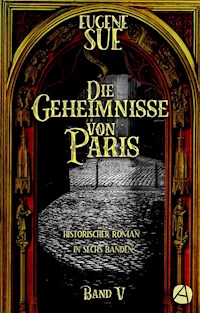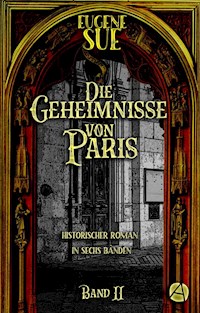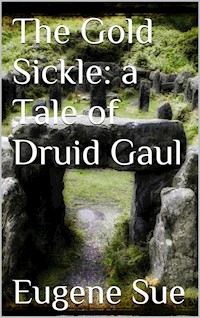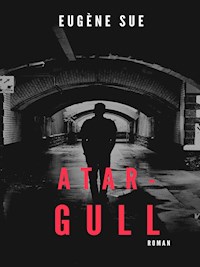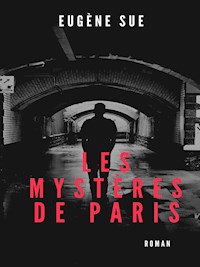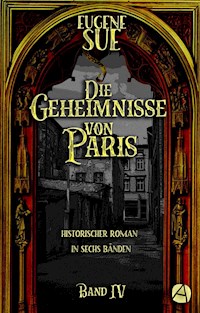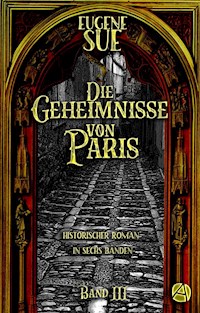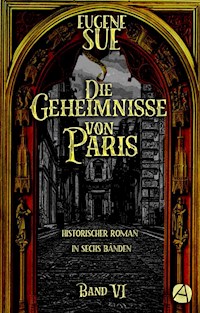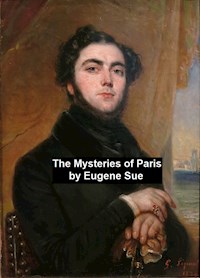Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Histoire d'une famille de prolétaires à travers les âges. (16 volumes.) Tome IV Les Korrigans. 375 à 529. La garde du poignard. Karadeuk-le Bagaude et Ronan-le Vagre. 529 à 615. Le monastère de Charolles et le palais de la Reine Brunehaut. 560 à 615. Au VIIe siècle la Gaule a été entièrement conquise par les Franks. Clovis et ses fils avec l'aide des évêques avides de richesses ont réduit le peuple en esclavage. Quelques révoltes ou bagaudies éclatent pour renverser leur pouvoir. Ronan le vagre, c'est-à-dire le brigand, part sur les traces de son père Karadeuk qui a participé à ces bagaudies. Il fera bien des rencontres surtout celle d'un des descendants de Neroweg l'aigle terrible.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 666
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les Mystères du peuple
Les Mystères du peupleL’AUTEUR AUX ABONNÉS DES MYSTÈRES DU PEUPLELA GARDE DU POIGNARD KARADEUK-LE BAGAUDE ET RONAN-LE VAGRELA GARDE DU POIGNARD KARADEUK-LE BAGAUDE ET RONAN LE VAGRE (De 529 à 615)ÉPILOGUE LE MONASTÈRE DE CHAROLLES ET LE PALAIS DE LA REINE BRUNEHAUT 560-615Page de copyrightLes Mystères du peuple
Eugène Sue
Il n’est pas une réforme religieuse, sociale ou politique que nos pères n’aient été forcés de conquérir, de siècle en siècle, au prix de leur sang, par l’INSURRECTION.
L’AUTEUR AUX ABONNÉS DES MYSTÈRES DU PEUPLE
CHERS LECTEURS,
Il faut vous l’avouer, notre œuvre n’est point du goût des gouvernements despotiques : en Autriche, en Prusse, en Russie, en Italie, dans une partie de l’Allemagne, les MYSTÈRES DU PEUPLE sont défendus ; à Vienne même, une ordonnance royale contre-signée Vindisgraëtz (un des bourreaux de la Hongrie), prohibe la lecture de notre livre. Les préfets et généraux de nos départements en état de siège font les Vindisgraëtz au petit pied ; ils mettent notre œuvre à l’index dans leurs circonscriptions militaires ; ils vont plus loin : le général qui commande à Lyon a fait saisir des ballots de livraisons des Mystères du Peuple que le roulage, muni d’une lettre de voiture régulière, transportait à Marseille. Dans les villes qui ne jouissent pas des douceurs du régime militaire, les libraires et les correspondants de notre éditeur ont été exposés aux poursuites, aux tracasseries, aux dénis de justice les plus incroyables. Pourquoi cela ? Notre ouvrage a-t-il été incriminé par le procureur de la République ? Jamais. Contient-il quelque attaque directe ou indirecte à la RELIGION, à la FAMILLE, à la PROPRIÉTÉ ? Vous en êtes juges, chers lecteurs. En ce qui touche la religion, j’ai exalté de toute la force de ma conviction, la céleste morale de Jésus de Nazareth, le divin sage ; en ce qui touche la famille, j’ai pris pour thème de nos récits l’histoire d’une famille, idéalisant de mon mieux cet admirable et religieux esprit familial, l’un des plus sublimes caractères de la race gauloise ; en ce qui touche la propriété, j’essaye de vous faire partager mon horreur pour la conquête franque, sacrée, légitimée par les évêques ; conquête sanglante, monstrueuse, établie par le pillage, la rapine et le massacre ; en un mot l’une des plus abominables atteintes qui aient jamais été portées au droit de propriété, de sorte que l’on peut, que l’on doit dire de l’origine des possessions de la race conquérante, rois, seigneurs ou évêques : la royauté, c’est LE VOL ! la propriété féodale, c’est LE VOL ! la propriété ecclésiastique, C’EST LE VOL !… puisque royauté, biens féodaux, biens de l’Église, n’ont eu d’autre origine que la conquête franque. Notre livre est-il immoral, malsain, corrupteur ? Jugez-en, chers lecteurs, jugez-en. Nous avons voulu populariser les grandes et héroïques figures de notre vieille nationalité gauloise et inspirer pour leur mémoire un filial et pieux respect ; nous ne prétendons pas créer une œuvre éminente, mais nous croyons fermement écrire un livre honnête, patriotique, sincère, dont la lecture ne peut laisser au cœur que des sentiments généreux et élevés. D’où vient donc cette persécution acharnée contre les Mystères du Peuple ? C’est que notre livre est un livre d’enseignement : c’est que ceux qui auront bien voulu le lire et se souvenir, garderont conscience et connaissance des grands faits historiques, nationaux, patriotiques et révolutionnaires qui ont toujours épouvanté les gouvernements ; car jusqu’ici tout gouvernement, tout pouvoir a tendu plus on moins, lui et ses fonctionnaires, à jouer le rôle de conquérant et à traiter le peuple en race conquise. Qu’était-ce donc, sous le dernier régime, que ces deux cent mille privilégiés gouvernant la France par leurs députés, sinon une manière de conquérants dominant trente-cinq millions d’hommes de par leur droit électoral ? Qu’est-ce que cette armée, ces canons, en pleine paix, au milieu de la cité, au milieu de citoyens désarmés, sinon l’un des vestiges de l’oppression brutale de la conquête ?… Aussi, le jour de l’avènement définitif de la République démocratique effacera-t-il les dernières traces de ces traditions conquérantes, et la France, sincèrement, réellement gouvernée par elle-même, sera seulement alors un pays libre. – Cela dit, passons.
Nous voici donc arrivés à l’une des plus douloureuses époques de notre histoire. Les Franks, appelés, sollicités par les évêques gaulois, ont envahi et conquis la Gaule. Cette conquête, accomplie, nous l’avons dit, par le pillage, l’incendie, le massacre ; cette conquête, inique et féroce comme le vol et la meurtre, le clergé l’a désirée, choyée, caressée, légitimée, bénie, presque sanctifiée dans la personne de Clovis, roi de ces conquérants barbares, en le baptisant, dans la basilique de Reims, fils soumis de la sainte Église catholique, apostoliqueet ROMAINE, par les mains de saint Rémi. Pourquoi les prêtres d’un Dieu d’amour et de charité ont-ils ainsi légitimé des horreurs qui soulèvent le cœur et révoltent la conscience humaine ? Pourquoi ont-ils ainsi trahi et livré la Gaule, hébétée, avilie, châtrée par eux à dessein et de longue main ? Pourquoi l’ont-ils ainsi trahie et livrée, notre sainte patrie, elle, ses enfants, ses biens, son sol, son drapeau, sa nationalité, son sang, au servage affreux de l’étranger ? Pourquoi ? Trois des grands historiens qui résument la science moderne, quoique à des points de vue différents, vont nous l’apprendre.
« …… Presque immédiatement après la conquête des Franks, les évêques et les chefs des grandes corporations ecclésiastiques, abbés, prieurs etc., prirent place parmi les LEUDES[1] DU ROI Clovis… Aucune magistrature, aucun pouvoir n’a été en aucun temps le sujet de plus de brigues et d’efforts que l’épiscopat. La vacance d’un siège devenait même souvent un sujet de guerre : Hilaire, archevêque d’Arles, écarta plusieurs évêques contre toute règle, et en ordonna d’autres de la manière la plus indécente, malgré le vœu formel des habitants des cités. Et comme ceux qui avaient été nommés de la sorte ne pouvaient se faire recevoir de bonne grâce par les citoyens qui ne les avaient pas élus, ils rassemblaient des bandes de gens armés et allaient exiger la ville où ils avaient été nommés évêques… On peut voir dans l’édit d’Athalarik, roi des Visigoths, quelles mesures le législateur civil dut prendre contre les candidats à l’épiscopat. Nul code électoral ne s’est donné plus de peine pour empêcher la violence, la fraude et la corruption.
»……… Loin de porter atteinte à la puissance du clergé, l’établissement des Franks dans les Gaules ne servit qu’à l’accroître ; par les bénéfices, les legs, les dévotions en tous genres, ils acquéraient des biens immenses et prenaient place parmi L’ARISTOCRATIE DES CONQUÉRANTS.
» Là fut le secret de la puissance du clergé. Il en pouvait faire, il en faisait chaque jour des usages coupables et qui devaient être funestes à l’avenir : … Souvent conduit, comme les Barbares, par des intérêts et des passions purement terrestres, le clergé partage avec eux la richesse, le pouvoir, TOUTES LES DÉPOUILLES DE LA SOCIÉTÉ, etc., etc. » (Guizot, Essais sur l’histoire de France.)
M. Guizot, en signalant aussi énergiquement et en déplorant la part monstrueuse que le clergé se fit lors de la conquête et de l’asservissement de la Gaule, ajoute que c’était presque un mal nécessaire en un temps désastreux où il fallait chercher à opposer une puissance morale à la domination sauvage et sanglante des conquérants. Nous nous permettrons de ne pas partager l’opinion de l’illustre historien, et nous dirons tout à l’heure en quelques mots les raisons de notre dissidence.
« À la tête des Franks se trouvait un jeune homme nommé Hlode-Wig (Clovis), ambitieux, avare et cruel : les évêques gaulois le visitèrent et lui adressèrent leurs messages ; plusieurs se firent les complaisants domestiques de sa maison, que dans leur langage romain ils appelaient sa royale cour…
»…… Des courriers portèrent rapidement au pape de Rome la nouvelle du baptême du roi des Franks ; des lettres de félicitations et d’amitié furent adressées de la ville éternelle à ce roi QUI COURBAIT LA TÊTE SOUS LE JOUG DES ÉVÊQUES… Du moment que le Frank Clovis se fut déclaré le fils de l’Église et le vassal de saint Pierre, SA CONQUÊTE S’AGRANDIT EN GAULE, etc.… Bientôt les limites du royaume des Franks furent reculées vers le sud-est, et, à l’instigation des évêques qui l’avaient converti, le néophyte (Clovis) entra à main armée chez les Burgondes (accusés par le clergé d’être hérétiques). Dans cette guerre les Franks signalèrent leur passage par le meurtre et par l’incendie, et retournèrent au nord de la Loire avec un immense butin ; le clergé orthodoxe qualifiait cette expédition sanglante de pieuse, d’illustre, de sainte entreprise pour la vraie foi.
» La trahison des prêtres livra aux Franks les villes d’Auvergne qui ne furent pas prises d’assaut ; une multitude avide et sauvage se répandit jusqu’au pied des Pyrénées, dévastant la terre et traînant les hommes esclaves deux à deux comme des chiens à la suite des chariots ; partout où campait le chef frank victorieux,les évêques orthodoxes assiégeaient sa tente. Germinius, évêque de Toulouse, qui reste vingt jours auprès de lui, mangeait à la table du Frank, reçut en présent des croix d’or, des calices, des patènes d’argent, des couronnes dorées et des voiles de pourpre, etc. » (Augustin Thierry, Histoire de la Conquête de l’Angleterre par les Normands.)
M. Augustin Thierry ne voit pas, comme M. Guizot, une sorte de nécessité de salut public dans l’abominable trahison, dans la hideuse complicité du clergé gaulois, lançant les Barbares sur des populations inoffensives et chrétiennes (les Visigoths étaient chrétiens, mais n’admettaient pas la Trinité), et, partageant avec les pillards et les meurtriers les richesses des vaincus. M. Augustin Thierry signale surtout ce fait capital : les félicitations du pape de Rome à Clovis, après que le premier de nos rois de droit divin, souillé de tous les crimes, se fût déclaré le vassal du pape, en courbant le front devant saint Rémi, qui lui dit : Baisse le front, fier Sicambre ! de ce moment, le pacte sanglant des rois et des papes, de l’aristocratie et du clergé, était conclu… Quatorze siècles de désastres, de guerres civiles ou religieuses pour le pays, d’ignorance, de honte, de misère, d’esclavage et de vasselage pour le peuple devaient être les conséquences de cette alliance du pouvoir clérical et du pouvoir royal.
« La monarchie franque s’était surtout affirmée par l’accord parfait du clergé avec le souverain, il s’en est fallu de peu que Clovis n’ait été reconnu POUR SAINT, et qu’il n’ait été honoré à ce titre par l’ÉGLISE, aussi bien que l’est encore aujourd’hui son épouse SAINTE CLOTIDE. À cette époque, les bienfaits accordés à l’Église étaient un meilleur titre pour gagner le ciel que les bonnes actions. La plupart des évêques des Gaules contemporains de Clovis furent liés d’amitié avec ce prince, et sont réputés saints ; on assure même que saint Rémi fut son conseiller le plus habituel… Des conciles réglèrent l’usage des donations immenses faites par Clovis aux églises. Ils déclarèrent les biens-fonds du clergé exempts de toutes les taxes publiques, inaliénables, et le droit que l’Église avait acquis sur eux imprescriptible. » (Sismondi, Histoire des Français, tome I.)
Les plus éminents historiens sont d’accord sur ce fait : Le clergé a appelé, sollicité, consacré la conquête franque et a partagé avec les conquérants les dépouilles de LA GAULE. Certes, dit M. Guizot, ainsi que les écrivains de son école, la conduite du clergé était déplorable, funeste au présent et à l’avenir ; mais il fallait avant tout opposer une puissance morale à la domination brutale des Barbares. La divine mission du christianisme était de civiliser, d’adoucir ces sauvages conquérants. Soit. Admettons que la trahison envers le peuple, que d’une cupidité effrénée, que d’une ambition impitoyable, il puisse naître une puissance morale quelconque, le devoir du clergé était donc de montrer à ces farouches conquérants que la force brutale n’est rien ; que la puissance morale est tout ; que le fidèle selon le Christ est saint et grand par l’humilité, par la charité, par l’égalité. Il fallait surtout prêcher à ces barbares que rien n’était plus horrible, plus sacrilège que de tenir son prochain en esclavage, Jésus de Nazareth ayant dit : Les fers des esclaves doivent être brisés. Il fallait enfin, et par l’influence divine dont il se disait dépositaire, et surtout par ses propres exemples, que le clergé s’occupât sans relâche de rendre les Franks humbles, humains, charitables, sobres, chastes, désintéressés. Or, que fait le clergé gaulois pour établir cette puissance morale civilisatrice ? Des richesses ensanglantées, fruit du pillage et du meurtre de ses concitoyens, il en demande sa part aux conquérants. Ces esclaves, ses frères, il les reçoit en don ou les achète, les exploite et les garde en esclavage !… lui !… qui prétend agir et parler au nom du Christ !… Oui… Jusqu’au huitième siècle le clergé a eu des esclaves, comme il a eu des serfs et des vassaux jusqu’au dix-huitième : il n’y a pas de cela soixante ans. Les crimes horribles des conquérants, le clergé les absout moyennant finance, et les tolère quand il ne les sanctifie. Lisez plutôt saint Grégoire, évêque de Tours, le seul historien complet de la conquête.
Après une nomenclature des crimes innombrables du roi Clovis, l’évêque poursuit ainsi :
« Après la mort de ces trois rois (qu’il fit tuer), Clovis recueillit leurs royaumes et leurs trésors. Ayant fait périr encore plusieurs autres rois et même ses plus proches parents, dans la crainte qu’ils ne lui enlevassent son royaume, il étendit son pouvoir sur toutes les Gaules ; cependant ayant un jour rassemblé les siens, on rapporte qu’il leur parla ainsi des parents qu’il avait lui-même fait périr :
« Malheur à moi, qui suis resté comme un voyageur parmi des étrangers, et qui n’ai plus de parents qui puissent, en cas d’adversité, me prêter leur appui ! – Ce n’était pas qu’il s’affligeât de leur mort (ajoute Grégoire de Tours), mais il parlait ainsi par ruse et pour découvrir s’il lui restait encore quelqu’un à tuer (si forte potuisset adhuc aliquem reperire ut interficeret). Après ces événements, Clovis mourut à Paris, et fut enterré dans la basilique des saints apôtres. » (L. II, p. 261.)
Cette scène atroce, où la ruse du sauvage le dispute à sa férocité, inspire-t-elle au prêtre chrétien une légitime horreur ? Va-t-il crier anathème ?… ou du moins gardera-t-il un silence presque criminel ?… Écoutons encore l’évêque de Tours :
« Le roi Clovis, qui confessa l’Indivisible Trinité, dompte les hérétiques, par l’appui qu’elle lui prête, et étend son royaume par toutes les Gaules. (L. III, p. 255.)
» Chaque jour, Dieu faisait ainsi tomber les ennemis de Clovis sous sa main, et étendait son royaume, parce qu’il marchait avec un cœur pur devant lui, et faisait ce qui était agréable aux yeux du Seigneur. » (L. II, p. 255.)
De bonne foi, quelle puissance morale et civilisatrice attendre d’un clergé dont l’un des plus éminents représentants s’exprime ainsi ? d’un clergé qui comptait parmi ses membres ce saint Rémi, le conseiller habituel de ce monstre couronné, dont les forfaits révoltent la nature ?
« Que voulez-vous ? c’étaient les mœurs du temps ! – disent certains historiens… – Et puis, que pouvaient faire les évêques contre cette invasion barbare ? Ne devaient-ils pas tâcher de dominer les Franks par l’ascendant de notre sainte religion, afin de leur reprendre, par la persuasion, une partie des biens et des richesses qu’ils avaient conquis à l’aide de la violence… Il fallait enfin civiliser ces barbares par l’influence chrétienne. »
Or, l’histoire apprend quelle fut l’influence civilisatrice de la religion sur ces fils de l’Église et sur leur descendance, dont les crimes surpassèrent encore ceux du fondateur de cette dynastie de meurtriers, de fratricides et d’incestueux.
Les mœurs du temps ! les mœurs du temps ! répètent les historiens. Que fait le temps à la morale des choses ? Est-ce que le meurtre, l’inceste, le fratricide, n’ont pas été réprouvés avec horreur, même par l’antiquité païenne ? Et vous, prêtres catholiques, cédant à votre ambition et à votre cupidité traditionnelles, loin de tonner du haut de votre chaire évangélique contre les crimes inouïs des conquérants de votre pays, vous les sanctifiez, parce que ces féroces barbares confessent votre Trinité, votre Dieu et surtout enrichissent vos églises en se laissant subalterniser par votre habituelle astuce !
Je me trompe, les évêques qui enregistraient si benoîtement les crimes des rois, dont ils étaient grassement payés, avaient parfois de véhémentes paroles de blâme contre les puissants du monde. Grégoire de Tours traita de Néron Chilpéric, un des fils de Clovis. Ce pauvre Chilpéric n’était pourtant ni plus ni moins Néron que ceux de sa race. « Mais, – dit l’évêque de Tours, – ce Chilpéric invectivait continuellement contre les prêtres du Seigneur, ne trouvant pas de prétexte plus fécond pour ses dérisions et ses persécutions que les évêques des églises : l’un, selon lui, était léger ; l’autre superbe ; l’autre débauché ; l’autre trop riche ; il ne haïssait rien tant que les églises. Il disait ordinairement : – Voici que notre fisc est appauvri ; nos richesses ont passé aux églises. – Et en se plaignant ainsi, il annulait souvent des donations faites au clergé. »
On le voit, la tradition ultramontaine n’a pas varié : ambition effrénée, cupidité implacable…
Que pouvaient faire les évêques contre l’invasion des Franks, dites-vous ? Ils devaient imiter le patriotique héroïsme des Druides, qu’ils ont fait périr jusqu’au dernier dans les supplices !… Oui, la croix d’une main, l’étendard gaulois de l’autre, les évêques, au lieu de prêcher une guerre de religion et de pillage contre les ariens, devaient prêcher la guerre nationale contre les Franks, la guerre de l’indépendance, cette guerre sainte, trois fois sainte, du Peuple qui défend son foyer, sa famille, son pays et son Dieu !… Que pouvaient faire les évêques ?… Appeler aux armes la vieille Gaule au nom de la Patrie et de la Foi chrétienne menacées par les barbares !…
Oh ! alors, à cette voix véritablement divine, les Peuples se soulevaient en masse, et comme au jour de la sublime influence druidique, les Vercingétorix, les Marik, les Civilis, les Sacrovir, les Vindex, héros patriotes, auraient surgi du flot populaire ; vieillards, femmes, enfants, comme aux jours de l’invasion romaine, auraient marché à l’ennemi ; lances, épées, fourches, faux, pierres, bâtons, tout eût servi d’armes. Les Barbares étaient refoulés hors des frontières ; l’indépendance de la Gaule sauvée, la doctrine évangélique acclamée de nouveau, dans l’enthousiasme du plus saint des triomphes, celui d’un Peuple libre triomphant de l’oppression étrangère !… Alors des débris du monde païen et barbare s’élevait pure, fière, radieuse, la société nouvelle réalisant enfin ce vœu suprême de Jésus : Liberté ! Égalité ! Fraternité !
Mais non, les évêques ne l’ont pas voulu ! Leur alliance sacrilège avec les Franks a coûté à nos pères esclaves, serfs ou vassaux, quatorze siècles d’ignorance, de douleurs et de misères… Mais qu’importait aux princes de l’Église catholique ? Ils dominaient les Peuples par les rois, savouraient l’orgueil de leur toute-puissance, riaient des sots qu’ils épouvantaient, jouissaient des biens de la terre, en ne se plongeant que trop souvent dans la débauche, la crapule et les plus sanglants excès !…
Est-ce exagération que de parler ainsi ? Empruntons à Grégoire de Tours, évêque lui-même, quelques portraits d’évêques de son temps. « L’évêque Priscus, qui avait succédé à Sacerdos (évêque de Lyon), d’accord avec Suzanne, son épouse[2], se mit à persécuter et à faire périr plusieurs de ceux qui avaient été dans la familiarité de son prédécesseur. Le tout par malice et uniquement par jalousie de ce qu’ils lui avaient été attachés ; lui et sa femme se répandaient en blasphèmes contre le saint nom de Dieu, et malgré la coutume observée depuis longtemps de ne permettre l’entrée de la maison épiscopale à aucune femme, celle de Priscus entrait dans sa chambre avec des jeunes filles. » (Grégoire de Tours, L. IV, p. 105.)
« Palladius, comte de la ville de Javols en Auvergne, disait à l’évêque Parthénius, qu’il accusait de sodomie : – Où sont-ils tes maris, avec lesquels tu vis dans le désordre et l’infamie ? »
« Felix, évêque de Nantes, était d’une jactance et d’une avidité extrêmes ; mais je m’arrête pour ne pas lui ressembler. » (Liv. V, p. 183).
« Les gens de Langres, après la mort de Sylvestre, demandèrent un autre évêque ; on leur donna Pappol, autrefois archidiacre d’Autun. Au rapport de plusieurs, il commit beaucoup d’iniquités ; mais nous n’en dirons rien pour qu’on ne nous croie pas détracteurs de nos frères. » (Liv. V, p. 189.)
« … Le mari accusa vivement l’évêque Bertrand. – Tu as enlevé, dit-il, ma femme et ses esclaves, et ce qui ne convient point à un évêque, vous vous livrez honteusement à l’adultère, toi avec mes servantes, elle avec tes serviteurs – Alors le roi, transporté de colère, exigea de l’évêque la promesse de rendre la femme à son mari. » (Liv. IX, p. 349, v. 3.)
« La ville de Soissons avait pour évêque Droctigisill, qui, par excès de boisson, avait perdu la raison depuis quatre ans. » (liv. IX, p. 359, v. 3)
« Sunigésill, livré à la torture, avoua qu’Égidius, évêque de Reims, avait été complice de Raukhing dans le projet de tuer le roi Childebert (la complicité fut prouvée.) L’on trouva dans le trésor de cet évêque, des masses considérables d’or et d’argent, fruit de son iniquité. » (P. 4, liv. X, p. 97.)
« L’évêché de Paris fut donné à un marchand nommé Eusèbe, qui, pour obtenir l’épiscopat, fit de nombreux présents. » (T. IV, p. 113.)
« Berthécram, évêque de Bordeaux, et Pallado, évêque de Sens, avaient souvent trompé le roi par leurs fourberies. Dans la suite, Pallado et Berthécram s’emportèrent l’un contre l’autre et se reprochèrent mutuellement un grand nombre d’adultères et de fornications. Ils se traitèrent aussi de parjures. Cela donna à rire à plusieurs. » (Liv. VIII, p. 139).
« L’abbé Dagulf commettait à chaque instant des vols et des meurtres, et se livrait à l’adultère avec une extrême dissolution. Épris de passion pour la femme de son voisin, il chercha tous les moyens d’attirer cet homme dans son monastère pour le tuer. » (Liv. VIII, p. 179, t. 3.)
« Badegesil, évêque du Mans, était un homme très-dur au peuple ; qui enlevait de force ou pillait le bien d’autrui ; il avait une femme nommée Magnatrude, encore plus méchante et plus cruelle que lui, et qui par de détestables conseils, excitait sa cruauté naturelle, et le poussait à commettre des crimes. Cette femme coupa souvent à des hommes les parties naturelles et la peau du ventre, et brûla à des femmes avec des lames rougies au feu les parties les plus secrètes de leurs corps. » (Liv. VIII, p. 231, tom. 3.)
« Le neveu de l’évêque, ayant fait mettre l’esclave à la torture, il dévoila toute l’affaire : – J’ai reçu, dit-il, pour commettre le crime cent sous d’or de la reine Frédégonde, cinquante de l’évêque Mélanthius et cinquante autres de l’archidiacre de la ville. » (T. 3, liv. VIII, p. 235.)
« Salone et Sagittaire furent évêques, le premier d’Embrun, le second de Gap ; mais une fois en possession de l’épiscopat, ils commencèrent à se signaler avec une fureur insensée, par des usurpations, des meurtres, des adultères et d’autres excès ; quittant la table au lever de l’aurore, ils se couvraient de vêtements moelleux et dormaient ensevelis dans le vin et le sommeil jusqu’à la troisième heure du jour. Ils ne se faisaient pas faute de femmes pour se souiller avec elles. » (Liv. V, p. 263.)
« L’évêque Oconius était adonné au vin outre mesure ; il s’enivrait souvent d’une manière si ignoble qu’il ne pouvait faire un pas. » (Liv. V, p. 313).
« Nous avons appris, – dit le concile de 589, – que les évêques traitent leurs paroisses non épiscopalement, mais cruellement. Et tandis qu’il a été écrit : Ne dominez pas sur l’héritage du Seigneur, mais rendez-vous les modèles du troupeau, ils accablent leurs diocèses de pertes et d’exactions. »
Un autre concile, tenu en 675, dit :
« Il ne convient pas que ceux qui ont déjà obtenu les degrés ecclésiastiques, c’est-à-dire les prêtres, soient sujets à recevoir des coups, si ce n’est pour des choses graves ; il ne convient pas que chaque évêque, à son gré et selon qu’il lui plaît, frappe de coups et fasse souffrir ceux qui lui sont soumis. »
Un autre concile de 527 : – « Il nous est parvenu que certains évêques s’emparent des choses données par les fidèles aux paroisses ; de sorte qu’il ne reste rien ou presque rien aux églises. »
Le concile de 633 est non moins formel : « Ces évêques, ainsi que l’a prouvé une enquête, accablent d’exactions leurs églises paroissiales, et pendant qu’ils vivent eux-mêmes avec un riche superflu, il est prouvé qu’ils ont réduit presque à la ruine certaines basiliques. Lorsque l’évêque visite son diocèse, qu’il ne soit à charge à personne par la multitude de ses serviteurs, et que le nombre de ses voitures ne soit pas de plus de cinq. »
M. Guizot, dans son admirable ouvrage : Histoire de la civilisation en France, après avoir cité des preuves nombreuses, irréfragables de la hideuse cupidité de l’épiscopat et de son implacable ambition, ajoute : « En voilà plus qu’il n’en faut sans doute pour prouver l’oppression et la résistance, le mal et la tentation d’y porter remède ; la résistance échoua, le remède fut inefficace ; le despotisme épiscopal continua de se déployer ; aussi au commencement du septième siècle, l’Église était tombée dans un état de désordre presque égal à celui de la société civile… Une foule d’évêques se livraient aux plus scandaleux excès ; maîtres des richesses toujours croissantes de l’Église, rangés au nombre des grands propriétaires, ils en adoptaient les intérêts et les mœurs ; ils faisaient contre leurs voisins des expéditions de violence et de brigandage, etc., etc. » (P. 396, v. 1.)
« Cautin, devenu évêque, se conduisit de manière à exciter l’exécration générale ; il s’adonnait au vin outre mesure, et souvent il se plongeait tellement dans l’ivresse, que quatre hommes avaient peine à l’emporter de table. Il en devint épileptique ; il était en outre excessivement livré à l’avarice, et quelle que fût la terre dont les limites touchaient à la sienne, il se croyait mort s’il ne s’appropriait pas quelque partie des biens de ses voisins, l’enlevant aux plus forts par des procès et des querelles, l’arrachant aux plus faibles par la violence. » (L. IV, p. 29, v. 2.)
Dans son amour pour le bien d’autrui, l’évêque Cautin fit un autre tour fort longuement raconté par saint Grégoire. Il s’agissait d’un prêtre nommé Anastase, qui, par une charte de la reine Clotilde, possédait une propriété ; ce bien, l’évêque Cautin le convoita ; il le demanda à Anastase ; celui-ci refusa de se déposséder ; l’évêque l’attire alors chez lui sous un prétexte, le renferme et lui signifie qu’il le laissera mourir de faim s’il ne lui abandonne ses titres de propriété ; Anastase persiste dans ses refus ; alors, dit Grégoire de Tours :
« Anastase est remis à des gardiens et condamné par Cautin, s’il ne remet les chartes, à mourir de faim ; dans la basilique de saint Cassius, martyr, était une crypte antique et profonde ; là se trouvait un vaste tombeau de marbre de Paros, où avait été déposé le corps d’un grand personnage dans le sépulcre. Anastase (par l’ordre de Cautin) est enseveli avec le mort ; on met sur lui une pierre qui servait de couvercle au sarcophage, et on place des gardes à l’entrée du souterrain. »
Entre autres détails que donne Grégoire de Tours sur cette torture atroce, il cite celui-ci :
« … Des os du mort, – c’est Anastase qui le racontait ensuite, – s’exhalait une odeur pestilentielle, et il aspirait, non-seulement par la bouche et par les narines, mais, si j’ose le dire, par les oreilles même cette atmosphère cadavéreuse. » (L. IV, p. 31)
Au bout de quelques heures, Anastase put soulever la pierre du sépulcre, appela à son aide, et fut délivré. Quant à l’évêque Cautin, il songea à d’autres tours, et conserva bel et bien son évêché.
Certes, il y eut des évêques purs de ces crimes abominables ; mais les plus purs de ces prêtres achetaient, vendaient, exploitaient des esclaves, crime inexpiable pour un prêtre du Christ ; aucune puissance humaine, morale ou physique, ne pouvait les forcer à conserver leur prochain en esclavage ; mais les plus purs de ces prêtres étaient enrichis des dépouilles ensanglantées de leurs concitoyens ; mais les plus purs de ces prêtres se rendaient complices des conquérants pour asservir la Gaule, leur patrie ; mais le nombre de ces évêques, moins coupables que l’universalité de leurs confrères, était bien minime. Citons encore l’histoire :
« La religion, – écrivait saint Boniface au pape Zacharie, – est partout foulée aux pieds ; les évêchés sont presque toujours donnés à des laïques avides de richesses, on à des prêtres débauchés et prévaricateurs qui en jouissent selon le monde. J’ai trouvé, parmi les diacres, des hommes habitués dès l’enfance à la débauche, à l’adultère, aux vices les plus infâmes ; ils ont dans leur lit, pendant la nuit, quatre ou cinq concubines et même davantage ; tout récemment on a vu des gens de cette espèce monter ainsi de grade en grade jusqu’à l’épiscopat…, etc., etc. »
Vous avez eu et vous aurez connaissance, chers lecteurs, des crimes et des mœurs de ces rois franks, nos premiers rois de droit divin, ainsi que disent les royalistes et les ultramontains ; quant aux mœurs des seigneurs ducs et des seigneurs comtes franks, leurs compagnons de pillage, de viol et de massacre, nous emprunterons au hasard à Grégoire de Tours quelques traits caractéristiques des habitudes de nos doux conquérants :
« Le comte Amal s’éprit d’amour pour une jeune fille de condition libre ; quand vint la nuit, pris de vin, il envoya des serviteurs chargés d’enlever la jeune fille et de l’amener dans son lit. Comme elle résistait, on la conduisit de force dans la demeure du comte, et comme ou lui donnait des soufflets, le sang coulait à flots de ses narines, et le lit du comte en fut tout rempli ; lui-même lui donna des coups de poing, des soufflets et autres coups ; puis il la prit dans ses bras et s’endormit accablé par le sommeil. » (L. IX, p. 331).
Un autre de ces seigneurs franks, amis et complices des évêques, le duc Runking, était plus inventif et plus recherché dans ses cruautés :
« Si un esclave tenait devant lui un cierge allumé, comme c’est l’usage pendant son repas, il lui faisait mettre les jambes à nu et le forçait d’y serrer avec force le flambeau jusqu’à ce qu’il fût éteint ; quand on l’avait rallumé, il faisait recommencer jusqu’à ce que les jambes de l’esclave fussent toutes brûlées. » (L. V., p. 175).
Une autre fois, on lui demanda de ne pas séparer deux de ses esclaves, un jeune homme et une jeune fille qui s’aimaient : « – Il le promet, et les fait enterrer tous deux vivants, disant : Je ne manque pas au serment que j’ai fait de ne pas les séparer. » (Ibid., V., p. 177.)
Je vais donc tâcher, chers lecteurs, dans le récit suivant, de retracer à vos yeux cette funeste période de notre histoire : la conquête de la Gaule par l’invasion franque, appelée, soutenue par les évêques. Ce récit nous le ferons moins encore au point de vue de la fondation de la royauté de droit divin et de l’énorme puissance de l’Église, qu’au point de vue de l’asservissement, des douleurs, des misères du peuple. Hélas ! ce peuple gaulois que nous avons vu jadis sous l’influence druidique, si fier, si vaillant, si intelligent, si patriote, si impatient du joug de l’étranger, nous allons le retrouver déchu de ses mâles et patriotiques vertus des temps passés, hébété, craintif, soumis devant les Franks et les évêques ; il n’a plus de Gaulois que le nom, et ce nom, il ne le conservera pas longtemps. Aux lueurs divines de l’Évangile émancipateur, vers lesquelles ce peuple a d’abord couru confiant et crédule à la voix des premiers apôtres prêchant l’égalité, la fraternité, la communauté, ont succédé pour lui les menaçantes ténèbres de l’obscurantisme, mettant le salut au prix de l’ignorance, de l’asservissement et de la douleur. Le souffle mortel, cadavéreux de l’Église romaine, a glacé ce noble peuple jusque dans la moelle des os, refroidi son sang, arrêté les battements de son cœur, autrefois palpitant d’héroïsme et d’enthousiasme, à ces mots sacrés : patrie et liberté. Cependant, pour quelque temps encore, l’antique patriotisme de la vieille Gaule s’est réfugié dans un coin de ce vaste pays, l’indomptable Bretagne, encore toute imbue de la foi druidique, si étroitement liée au sentiment d’indépendance et de nationalité, mais rajeunie, vivifiée par l’idée purement chrétienne et libératrice, l’indomptable Bretagne avec ses dolmens surmontés de la croix, avec ses vieux chênes druidiques greffés de christianisme, ainsi que l’ont dit les historiens, résista seule, résistera seule jusqu’au huitième siècle, luttant contre la Gaule… Que disons-nous ! les conquérants lui ont, hélas ! volé jusqu’à son nom ! résistera seule, luttant contre la FRANCE royale et catholique. Ceci, comme toutes les leçons de l’histoire, porte en soi, un grave enseignement. L’Église de Rome a de tout temps été fatale, mortelle à la liberté des peuples ; voyez même à cette heure, les états purement catholiques ne sont-ils pas encore plus ou moins asservis, la Pologne, la Hongrie, l’Irlande, l’Espagne ? dites quel est leur sort ? Et cet abominable système d’abrutissement superstitieux et d’esclavage, le parti absolutiste et ultramontain rêve encore de nous l’imposer. N’avez-vous pas entendu à la tribune un représentant de ce parti demander une expédition de Rome à l’intérieur de la France ? N’entendez-vous pas chaque jour les nombreux journaux de ce parti répéter, selon le mot d’ordre des ennemis de la révolution et de la république, « la société menacée n’a plus de salut que dans l’antique monarchie de droit divin, soutenue par une religion d’État puissamment organisée, et au besoin défendue par une formidable armée étrangère. Écoutez les absolutistes ultramontains, que disent-ils tous les jours ? Nous aimons mieux les Cosaques que la République. »
Oui, le jésuite pour anéantir l’âme, le Cosaque pour garrotter le corps, l’inquisiteur pour appliquer la torture ou la mort aux mécréants rebelles, voilà l’idéal de ce parti qui n’a pas changé depuis quatorze siècles, tel est son désir, tel est son espoir dans sa réalité brutale. Un de nos amis, causant un jour avec un des plus fougueux champions du parti clérical, lui disait :
« – Je vous crois fort peu patriote ; cependant, avouez que vous ne verriez pas sans honte une nouvelle invasion étrangère occuper la France… votre pays, puisque, après tout, vous êtes Français ?…
« – Je ne suis pas plus Français qu’Anglais ou Allemand, – répondit l’ultramontain avec un éclat de rire sardonique, – je suis citoyen des États de l’Église ; mon souverain est à Rome, seule capitale du monde catholique ; quant à votre France, je verrais sans déplaisir les Cosaques chargés de la police en ce pays, ils n’entendent point le français, l’on ne pourrait les pervertir, comme on a malheureusement perverti notre armée. »
Voilà donc le dernier mot du parti clérical et absolutiste : appeler de tous ses vœux l’invasion des Cosaques, de même qu’il y a quatorze siècles, il appelait, par la voix des évêques, l’invasion des Franks…
Qui sait ? quelque nouveau saint Rémi rêve peut-être à cette heure, sous sa cagoule, le baptême de l’hérétique Nicolas de Russie dans la basilique de Notre-Dame de Paris, espérant dire à son tour à l’autocrate du Nord : « Courbe la tête, fier Sicambre… te voici catholique, partageons-nous la France… »
Nous allons donc tâcher, chers lecteurs, de vous montrer au vrai quel a été le berceau de la monarchie de droit divin et de la terrible puissance de l’Église catholique, apostolique et romaine.
Eugène SUE,
Représentant du Peuple.
18 septembre 1850.
[1] Les anstrustions et les leudes étaient les compagnons de guerre des rois et des chefs franks qu'ils choisissaient pour les commander, mais avec lesquels ils vivaient d'ailleurs sur le pied d'une égalité presque parfaite. Les anstrustions ou leudes du roi sont devenus plus tard les grands vassaux.
[2] Beaucoup de prêtres s'étaient mariés avant d'être appelés à l'épiscopat. On appelait leurs femmes episcopæ, ÉVÊCHESSES.
LA GARDE DU POIGNARD KARADEUK-LE BAGAUDE ET RONAN-LE VAGRE
PROLOGUE. LES KORRIGANS – 375-529
Le vieil Araïm. – Danse magique des Korrigans et des Dûs. – Le colporteur. – Le roi Hlod-Wig et ses crimes. – Sa femme Chrotechild. – La basilique des saints apôtres à Paris. – Bagaudes et Bagaudie. – Karadeuk, favori du vieil Araïm, veut rencontrer les Korrigans. – Ce qu’il en advient.
Ils ont parfois la vie longue, les descendants du bon Joel, qui vivait en ces mêmes lieux, près les pierres sacrées de la forêt de Karnak, il y a cinq cent cinquante ans et plus.
Oui, ils ont parfois la vie longue, les descendants du bon Joel, puisque moi, qui aujourd’hui écris ceci dans ma soixante-dix-septième année, j’ai vu mourir, il y a cinquante-six ans, mon grand père Gildas, alors âgé de quatre-vingt-seize ans… après avoir écrit dans sa première jeunesse, sur notre légende, les dernières lignes tracées avant celles-ci.
Mon grand-père Gildas a vu mourir son fils Goridek (mon père) ; j’avais dix ans lorsque je l’ai perdu ; neuf ans après, mon aïeul est mort… Plus tard, je me suis marié ; j’ai survécu à ma femme Martha, et j’ai vu mon fils Jocelyn devenir père à son tour : il a aujourd’hui une fille et deux garçons : la fille s’appelle Roselyk ; elle a dix-huit ans ; l’aîné des garçons, Kervan, a trois ans de plus que sa sœur ; le plus jeune, Karadeuk, mon favori, a dix-sept ans.
Lorsque tu liras ceci, mon fils Jocelyn, tu diras sans doute :
« Pourquoi donc mon bisaïeul Gildas n’a-t-il écrit rien autre chose dans notre chronique que la date de la mort de son père Amaël ? Pourquoi donc mon grand-père Goridek n’a-t-il rien écrit non plus ? Pourquoi donc enfin mon père Araïm a-t-il attendu si tard… si tard… pour accomplir le vœu du bon Joel, notre ancêtre ? »
À ceci, mon fils Jocelyn, je répondrai :
Ton bisaïeul Gildas avait l’horreur des écritoires et des parchemins ; de plus, ainsi que son père Amaël, il avait coutume de remettre toujours au lendemain ce qu’il pouvait se dispenser de faire le jour. Sa vie de laboureur n’était d’ailleurs ni moins paisible, ni moins laborieuse que celle de nos pères. Depuis la descendance de Scanvoch, revenu au berceau de notre famille, après qu’un grand nombre de nos générations en avaient été éloignées par les dures vicissitudes de la conquête romaine et de l’esclavage antique, ton bisaïeul Gildas disait d’habitude à mon père :
« J’aurai toujours le temps d’ajouter quelques lignes à notre légende ; et puis, il me paraît (et c’est sottise, je l’avoue,) qu’écrire : J’ai vécu, cela ressemble beaucoup à écrire : Je vais mourir… Or, moi, je suis si heureux, que je tiens à la vie ni moins ni plus que les huîtres de nos côtes tiennent à leurs rochers. »
Et voici comment, de demain en demain, ton bisaïeul Gildas est arrivé jusqu’à quatre-vingt-seize ans sans avoir augmenté d’un mot l’histoire de notre famille… Alors, se voyant mourir, il m’a dit :
– Mon enfant, tu écriras seulement ceci sur notre légende :
« Mon grand-père Gildas et mon père Goridek (puisque j’ai survécu à mon fils) ont vécu dans notre maison, calmes, heureux, en bons laboureurs, fidèles à l’amour de la vieille Gaule et à la foi de leurs pères, bénissant Hésus de les avoir fait naître et mourir au fond de la Bretagne, seule province où depuis tant d’années l’on n’aie presque jamais ressenti les secousses qui ébranlent le reste de la Gaule, car ces agitations viennent mourir aux frontières impénétrables de l’Armorique bretonne, comme les vagues furieuses de notre Océan viennent se briser au pied de nos rocs de granit. »
Or, mon fils Jocelyn, voici pourquoi ni ton aïeul, ni son fils Goridek, mort avant son père, n’ont pas écrit un mot sur nos parchemins.
« – Et pourquoi, – diras-tu, – vous, Araïm vous, mon père, si vieux déjà, ayant fils et petit-fils, pourquoi avez-vous payé si tard votre tribut à notre chronique ? »
– Il y a deux raisons à ce retard, mon fils Jocelyn : la première est que je n’avais pas assez à dire, la seconde est que j’aurais eu trop à dire.
« – Bon, – penseras-tu en lisant ceci, – le vieux Araïm a trop attendu pour écrire… Hélas ! le grand âge a troublé la raison du digne homme ; ne dit-il pas avoir à la fois trop et trop peu à raconter ? est-ce raisonnable ? S’il a trop, il a assez… s’il n’a pas assez, il n’a point trop… »
– Attends un peu, mon garçon… ne te hâte pas de croire que le bon grand-père tombe en enfance… Or, voilà comment j’ai à la fois trop et point assez à écrire ici.
En ce qui touche ma vie à moi, vieux laboureur, je n’ai pas, non plus que nos aïeux, depuis Scanvoch, assez à raconter ; car, en vérité, voyez un peu l’intéressant et beau récit :
L’an passé les semailles d’automne ont été plus plantureuses que les semailles d’hiver ; cet an-ci, c’est le contraire ; ou bien, la grande taure noire donne quotidiennement six pintes de plus de lait que la grosse taure poil de loup ; ou bien, l’aignelée de janvier est plus laineuse que l’aignelée de mars de l’an dernier ; ou bien encore, l’an passé, le froment était si cher, si cher, qu’un muids de blé vieux se vendaient douze à treize deniers[1] ; de ce temps-ci, le prix des bestiaux et des volailles va toujours augmentant, puisque nous payons maintenant un bœuf de travail deux sous d’or[2] ; une bonne vache laitière, un sou d’or ; un bon cheval de trait, six sous d’or… Voire encore : notre descendance ne sera-t-elle point fort aise de savoir qu’en ce temps-ci un bon porc, très en chair, vaut, en automne, douze deniers[3], ni plus ni moins qu’un maître bélier ? et que notre dernière bande d’oies grasses a été vendue cet hiver, au marché de Vannes, une livre d’argent pesant[4] ? La voilà-t-il pas bien avisée, notre descendance, quand elle saura que les journaliers que nous prenons en la moisson, nous les payons un denier par jour[5] ? Oui, voilà-t-il pas de beaux et curieux récits à lui laisser, à notre race ?
D’autre part, en sera-t-elle plus fière, quand je lui dirai : Ce qui fait ma fierté, à moi, c’est de penser qu’il n’y a point de plus fin laboureur que mon fils Jocelyn, de meilleure ménagère que sa femme Madalèn, de plus douce créature que ma petite-fille Roselyk, de plus beaux et de plus hardis garçons que mes petits-fils Kervan et Karadeuk ; celui-ci surtout, le dernier né, mon favori, un vrai démon de gentillesse et de courage… Il faut le voir, à dix-sept ans, dompter les poulains sauvages de nos prairies, plonger dans la mer comme un poisson, ne pas perdre une flèche sur dix lorsqu’il tire au vol des corbeaux de mer sur la grève pendant la tempête… et quand il vous manie le pèn-bas, notre terrible bâton breton… voire cinq ou six soldats, armés de lances ou d’épées, auraient plus de horions que de plaisir s’ils s’y frottaient, au pèn-bas de mon Karadeuk… Il est si robuste, si agile, si dextre ! et puis si beau, avec ses cheveux blonds coupés en rond, tombant sur le col de sa saie gauloise ; ses yeux bleus de mer et ses bonnes joues hâlées par l’air des champs et l’air marin !…
Non, par les glorieux os du vieux Joel ! non, il ne pouvait être plus fier de ses trois fils : Guilhern, le laboureur ; Mikaël, l’armurier ; Albinik, le marin ; et de sa douce fille Hêna, la vierge de l’île de Sên, île aujourd’hui déserte, qu’en ce moment, à travers ma fenêtre, je vois là-bas, là-bas… en haute mer, noyée dans la brume… Non, le bon Joel ne pouvait être plus fier de sa famille que moi, le vieil Araïm, je ne suis fier de mes petits-enfants !… Mais ses fils, à lui, ont vaillamment combattu ou sont morts pour la liberté ; mais sa fille Hêna, dont le saint et doux nom a été jusqu’à aujourd’hui chanté de siècle en siècle, a offert vaillamment sa vie à Hésus pour le salut de la patrie, tandis que les enfants de mon fils mourront ici, obscurs comme leur père, dans ce coin de la Gaule ; libres du moins ils mourront, puisque les Franks barbares, deux fois venus jusqu’aux frontières de notre Bretagne, n’ont osé y pénétrer : nos épaisses forêts, nos marais sans fonds, nos rochers inaccessibles, et nos rudes hommes, soulevés en armes à la voix toujours aimée de nos druides chrétiens ou non chrétiens, ont fait reculer ces féroces pillards, maîtres pourtant de nos autres provinces depuis près de quinze ans.
Hélas ! elles se sont enfin réalisées après deux siècles, les sinistres divinations de la sœur de lait de notre aïeul Scanvoch. Victoria la Grande ne l’a que trop justement prédit… les Franks ont depuis longtemps conquis et asservi la Gaule, moins notre Armorique, grâce aux dieux…
Voilà pourquoi le vieux Araïm pensait que, comme père et comme Breton, son obscur bonheur ne méritait pas d’être relaté dans notre chronique, et qu’il avait, hélas ! trop à écrire comme Gaulois… N’est-ce point trop, que d’écrire la défaite, la honte, l’esclavage de notre patrie commune, quoique nous soyons ici à l’abri des malheurs qui écrasent ailleurs nos frères ?
« – Alors, – diras-tu, mon fils Jocelyn, – puisque le vieil Araïm a trop et pas assez à écrire dans cette légende, pourquoi avoir commencé ce récit plutôt aujourd’hui qu’hier ou demain ? »
Voici ma réponse, mon fils : Lis le récit suivant, que j’écris en ce moment, à la tombée de ce jour d’hiver, pendant que toi, ta femme et tes enfants, vous vous préparez à la veillée dans la grande salle de la métairie, attendant le retour de mon favori Karadeuk, parti à la chasse au point du jour pour rapporter une pièce de venaison… Lis ce récit, il te rappellera la soirée d’hier, mon fils Jocelyn, et t’apprendra aussi ce que tu ignores… et ensuite tu ne diras plus :
« – Pourquoi le bonhomme Araïm a-t-il écrit ceci aujourd’hui plutôt qu’hier où demain. »
*
* *
La neige et le givre de janvier tombent par rafales, le vent siffle, la mer gronde au loin et se brise jusque sur les pierres sacrées de Karnak… Il est quatre heures, pourtant voici déjà la nuit : le bétail affouragé est renfermé dans les chaudes étables ; les portes de la cour de la métairie sont closes, de peur des loups rôdeurs ; un grand feu flambe au foyer de la salle ; le vieux Araïm est assis dans son siège à bras, au coin de la cheminée, son grand chien fauve, à tête blanchie par l’âge, étendu à ses pieds… le bonhomme travaille à un filet pour la pêche ; son fils Jocelyn charonne un manche de charrue ; Kervan ajuste des attèles neuves à un joug ; Karadeuk aiguise sur une pierre de grès la pointe de ses flèches : la tempête durera jusqu’au matin et davantage, car le soleil s’est couché tout rouge derrière de gros nuages noirs qui enveloppaient l’île de Sên comme un brouillard. Or, quand le soleil se couche ainsi, et que le vent souffle de l’ouest, la tempête dure deux, trois, et parfois quatre ou cinq jours. Le lendemain matin Karadeuk ira donc tirer des corbeaux de mer sur la grève, quand ils raseront de leurs fortes ailes les vagues en furie… C’est le plaisir de ce garçon ; il est si adroit, mon petit-fils Karadeuk, il est si bon archer, mon favori… Pendant qu’il affûte ses flèches, sa mère et sa sœur Roselyk vont activement de çà, de là, préparant la table et les mets pour le repas du soir.
La mer gronde au loin comme un tonnerre, le vent souffle à ébranler la maison, le givre tombe dans la cheminée. Gronde, tempête ! souffle, vent de mer ! tombe, givre et neige ! Oh ! qu’il fait bon, qu’il fait bon d’entendre rugir cet ouragan, chargé de frimas, lorsqu’en famille on est joyeusement réuni dans sa maison autour d’un foyer flambant !
Et puis, les jeunes garçons et leurs sœurs disent à demi-voix de ces choses qui les font à la fois frissonner et sourire ; car, en vérité, depuis cent ans, on dirait que tous les lutins et toutes les fées de la Gaule se sont réfugiés en Bretagne… N’est-ce pas encore un plaisir que d’ouïr à la veillée, durant la tempête, ces merveilles, auxquelles on croit toujours un peu quand on ne les a point vues, et bien plus encore quand on les a vues ?
Et voici ce qu’ils se disaient, ces enfants, mon petit-fils Kervan commence en secouant la tête :
– Un voyageur égaré qui passerait cette nuit près la caverne de Penmarch entendrait, plus qu’il ne le voudrait, résonner les marteaux…
– Oui, les marteaux qui tombent en mesure, pendant que ces marteleurs du diable chantent leur chanson, dont le refrain est toujours : Un, deux, trois, quatre, cinq, six, lundi, mardi, mercredi…
– Ils ont même ajouté, dit-on : Jeudi, vendredi et samedi, jamais dimanche, le jour de la messe… des chrétiens[6].
– Bien heureux encore est le voyageur, si les petits Dûs, quittant leurs marteaux de faux-monnayeurs pour la danse, ne le forcent pas à se mêler à leur ronde jusqu’à ce que pour lui mort s’ensuive…
– Quels dangereux démons pourtant, que ces nains, hauts de deux pieds… Il me semble les voir, avec leur figure vieillotte et ratatinée, leurs griffes de chat, leurs pieds de bouc et leurs yeux flamboyants : c’est à frissonner… rien que d’y penser…
– Prends garde, Roselyk, en voici un sous la huche… prends garde…
– Que tu es imprudent de rire ainsi des Dûs, mon frère Karadeuk ! ils sont vindicatifs… je suis toute tremblante… j’ai failli laisser tomber ce plat…
– Moi, si je rencontrais une bande de ces petits bonshommes, je vous en prendrais deux ou trois paires que je lierais par les pattes comme des chevreaux… et en route pour quelque fondrière bien profonde…
– Oh ! toi, Karadeuk, tu n’as peur de rien…
– Il faut rendre justice aux petits Dûs, s’ils font de la fausse monnaie dans les cavernes de Pen-March, on les dit très-bons maréchaux et sans pareils pour la ferrure des chevaux.
– Oui… fiez-vous-y ; dès qu’un cheval a été ferré par l’un de ces nains du diable, il jette du feu par les naseaux, et de courir… de courir sans plus jamais s’arrêter… ni jour ni nuit ; voyez un peu la figure de son cavalier !
– Mes enfants, quelle tempête ! quelle nuit !
– Bonne nuit pour les petits Dûs, ma mère ; ils aiment l’orage et les ténèbres, mais mauvaise pour les jolies petites Korrigans[7] qui n’aiment que les douces nuits du mois de mai…
– Certes, moi, j’ai grand’peur des petits Dûs noirs, velus, griffus, avec leur bourse de fausse monnaie à la ceinture, et leur marteau de forgeron sur l’épaule ; mais j’aurais plus grand’peur encore de rencontrer au bord d’une fontaine solitaire une Korrigan, haute de deux pieds, peignant ses blonds cheveux, dont elles sont si glorieuses en se mirant dans l’eau claire.
– Quoi ! peur de ces jolies petites fées, mon frère Kervan ! moi, au contraire, souvent j’ai tâché d’en rencontrer. On assure qu’elles se rassemblent à la fontaine de Lyrwac’h-Hèn, au plus épais du grand bois de chênes qui ombragent un dolmen… trois fois j’y suis allé… trois fois je n’ai rien vu…
– Heureusement pour toi tu n’as rien vu, Karadeuk ; Caron dit que c’est toujours près des pierres sacrées que se réunissent les Korrigans pour leurs danses nocturnes : malheur à qui les rencontre…
– Il paraît qu’elles sont fort curieuses de musique, et qu’elles chantent comme des rossignols.
– Et qu’elles sont gourmandes ?
– Les Korrigans, gourmandes ?
– Comme des chattes… oui, Karadeuk, tu as beau rire… tu dois me croire, je ne suis point menteuse : le bruit court que dans leurs fêtes de nuit elles étendent sur le gazon, toujours au bord d’une fontaine, une nappe blanche comme la neige, et tissée de ces légers fils blancs qu’on voit l’été sur les prairies. Au milieu de la nappe, elles mettent une coupe de cristal, remplie d’une liqueur merveilleuse, qui répand une clarté si vive, si vive qu’elle sert de flambeau à ces fées… L’on ajoute qu’une goutte de cette liqueur rendrait aussi savant que Dieu[8].
– Et que mangent-elles sur leur nappe d’un blanc de neige, les Korrigans ? le sais-tu, Karadeuk, toi qui les aimes tant ?
– Chères petites ! leur corps rose et transparent, à peine haut de deux pieds, n’est pas gros à nourrir… Ma sœur Roselyk les dit gourmandes… Que mangent-elles donc ? le suc des fleurs de nuit, servies sur des feuilles d’herbe d’or ?
– L’herbe d’or ?… cette herbe magique qui, si on la foule par mégarde, vous endort et vous donne connaissance de la langue des oiseaux[9].
– Celle-là même.
– Et que boivent-elles, les Korrigans ?
– La rosée des nuits dans la coquille azurée des œufs du roitelet… voyez-vous les ivrognesses ? Mais au moindre bruit humain… tout s’évanouit, et elles disparaissent dans la fontaine pour retourner au fond de l’onde, dans leur palais de cristal et de corail… c’est afin de pouvoir se sauver ainsi qu’elles restent toujours au bord des eaux. Ô gentilles naines… belles petites fées… ne vous verrai-je donc jamais ! je donnerais dix ans, vingt ans de ma vie pour rencontrer une Korrigan !…
– Karadeuk, ne faites pas de ces vœux impies par une pareille nuit de tempête… cela porte malheur… jamais je n’ai entendu la mer en furie gronder ainsi… c’est comme un tonnerre…
– Ma bonne mère, je braverais nuit, tempête et tonnerre pour voir une Korrigan…
– Taisez-vous, méchant enfant… vous m’effrayez… ne parlez pas ainsi… c’est tenter Dieu !
– Quel aventureux et hardi garçon tu fais, mon petit-fils…
– Grand-père, blâmez donc aussi mon frère Karadeuk, au lieu de l’encourager dans ses désirs périlleux… Ne savez-vous pas…
– Quoi ! ma blonde Roselyk ?
– Hélas ! grand-père, les Korrigans volent les enfants des pauvres femmes, et mettent à leur place de petits monstres ; la chanson le dit.
– Voyons la chanson, ma Roselyk.
– La voici, grand-père :
*
* *
« – Mary, la belle, est bien affligée ; elle a perdu son petit Laoïk ; la Korrigan l’a emporté.
*
* *
» – En allant à la fontaine puiser de l’eau, je laissai mon Laoïk dans son berceau ; quand je revins à la maison, il était bien loin.
*
* *
» – Et à sa place la Korrigan avait mis ce monstre ; sa face est aussi rousse que celle d’un crapaud ; il égratigne, il mord sans dire mot.
*
* *
» – Et toujours il demande à téter, et il a sept ans passés, et il demande encore à téter.
*
* *
» – Mary, la belle, est bien affligée ; elle a perdu son petit Laoïk ; la Korrigan l’a emporté.
*
* *
– Telle est la chanson, grand-père. Maintenant, mon frère Karadeuk voudra-t-il rencontrer ces méchantes Korrigans, ces voleuses d’enfants ?
– Qu’as-tu à répondre pour défendre tes fées, Karadeuk, mon favori ?
– Grand-père, ma gentille sœur Roselyk a été abusée par de mauvaises langues ; toutes les mères qui ont de laids marmots crient qu’elles avaient un ange au berceau, et que les Korrigans ont mis en place un petit monstre !
– Bien trouvé, mon favori !
– Je soutiens, moi, que les Korrigans sont avenantes et serviables… Vous savez bien, grand-père, le vallon de l’Hellé ?
– Oui, mon intrépide.
– Il y avait autrefois les plus beaux foins du monde dans ce vallon…
– C’est la vérité : Foin de l’Hellè, foin parfumé, dit le proverbe.
– Or, c’était grâce aux Korrigans…
– Vraiment ! conte-moi ça…
– Le temps de la fauchaison et de la fenaison venu, elles arrivaient sur la cime des rochers du vallon pour veiller sur les prés… S’ils avaient, pendant le jour, trop séché, les Korrigans y faisaient tomber une abondante rosée… Si le foin était coupé, elles éloignaient les nuées qui auraient pu gâter la fenaison… Un sot et méchant évêque voulut chasser ces bonnes petites fées si serviables ; il fit, à la tombée du jour, allumer un grand feu de bruyère sur les rochers ; puis, quand ils furent très-chauds, on balaya la cendre… La nuit venue, les Korrigans ne se doutant de rien, arrivent pour veiller à la fenaison ; mais aussitôt elles se brûlent leurs petits pieds sur la roche ardente… Alors elles se sont écriées en pleurant : Oh ! méchant monde ! oh ! méchant monde !… Et depuis, elles ne sont plus jamais revenues, et aussi depuis, le foin a toujours été pourri par la pluie ou desséché par le soleil dans le vallon de l’Hellè… Voilà ce que c’est que de faire du mal aux petites Korrigans… Non, je ne mourrai pas content si je n’en ai rencontré une…
– Mes enfants, mes enfants, ne croyez pas à ces magies, et surtout ne désirez pas en être témoins, cela porte malheur…
– Quoi, mère, parce que je désire voir une Korrigan, il m’arriverait malheur… quel malheur ?
– Hésus le sait, méchant enfant… car vos paroles me serrent le cœur…
– Quelle tempête ! quelle tempête ! la maison en tremble…
– Et c’est par une nuit pareille que ce méchant enfant ose dire qu’il donnerait sa vie pour voir des Korrigans…
– Femme, cette alarme est faiblesse.
– Les mères sont faibles et craintives, Jocelyn… Il ne faut pas tenter Dieu…
Le vieil Araïm cesse un moment de travailler à son filet ; sa tête se baisse sur sa poitrine… il rêve.
– Qu’avez-vous, mon père, que vous voici tout pensif ? Croyez-vous, comme Madalèn, qu’un malheur menace Karadeuk, parce que, par une nuit de tempête, il a voulu voir une Korrigan ?
– Je pense, non point aux fées, mais à la nuit de tempête, Jocelyn… Je t’ai lu, ainsi qu’à tes enfants, les récits de notre aïeul Joel, qui vivait il y a cinq cents et tant d’années, sinon dans cette maison, du moins dans ces lieux où nous sommes.
– Oui, mon père.
– Sais-tu à quoi je suis là songeant ?
– À quoi donc, grand-père ?
– À quoi ? dis-tu, mon Karadeuk, mon adroit archer ? Je songeais que par un pareil jour de tempête, le bon Joel et son fils, avides de récits, comme de curieux Gaulois qu’ils étaient…
– Ont fait ce bon tour d’arrêter un voyageur dans la cavée du Chraig’h (j’y suis encore passé ce matin, dit Kervan) ; puis ils ont garrotté cet étranger, et l’ont amené à la maison pour l’entendre raconter…
– Et ce voyageur, c’était le chef des cent vallées… un martyr ! un héros !…
– Oh ! oh ! comme tes yeux brillent en parlant ainsi, Karadeuk, mon favori…
– S’ils brillent, grand-père, c’est qu’ils sont humides… Quand j’entends parler du chef des cent vallées, les larmes me viennent aux yeux…
– Qu’est-ce que cela, mon père ? Voyez donc, votre vieil Erer gronde entre ses dents et dresse les oreilles.
– Grand-père, entendez-vous aboyer les chiens de garde ?
– Il faut qu’il se passe quelque chose au dehors de la maison…
– Hélas ! si les dieux veulent punir mon fils de son désir audacieux, leur colère ne se fait pas attendre… Karadeuk, venez, venez près de moi, méchant enfant…
– Quoi ! Madalèn… te voici pleurant et embrassant ton fils, comme si quelque malheur le menaçait… Allons, chère femme, plus de raison.
– N’entends-tu pas les aboiements redoublés des chiens au dehors ? Tiens, voici Erer qui court en grondant vers la porte… Je vous dis qu’il se passe quelque chose de sinistre autour de la maison…
– Ne crains rien, mère, c’est un loup qui rôde… À moi mon arc !
– Karadeuk, ne bougez pas… Non, moi, votre mère, je vous le défends…
– Ma chère fille, ne tremblez pas ainsi pour votre fils, ni toi non plus pour ton frère, ma douce Roselyk… Peut-être vaut-il mieux ne point braver les lutins et les fées en une nuit de tempête, mais vos craintes sont vaines… D’abord ce n’est pas un loup qui rôde au dehors ; il y a longtemps que le vieux Erer mordrait les ais de la porte pour aller recevoir ce mauvais hôte…
– Mon père a raison… c’est peut-être un étranger égaré.
– Viens, Kervan, viens, mon frère, allons à la porte de la cour voir ce que c’est…
– Mon fils, restez près de moi…
– Mais, ma mère, je ne peux laisser mon frère Kervan aller seul.
– Écoutez… écoutez… il me semble entendre, au milieu du vent, une voix appeler ou crier…
– Hélas ! ma bonne mère, un malheur menace notre maison… vous l’avez dit…
– Roselyk, mon enfant, n’augmente pas ainsi la frayeur de ta mère… Qu’y a-t-il d’étonnant à ce qu’un voyageur appelle du dehors pour qu’on lui ouvre la porte…
– Ces cris n’ont rien d’humain… je me sens glacée de frayeur…
– Viens avec moi, Kervan, puisque ta mère veut garder Karadeuk auprès d’elle… Quoique le pays soit tranquille, donne-moi mon pèn-bas, et prends le tien, mon garçon.
– Mon mari, mon fils, je vous en conjure, ne sortez pas…
– Chère femme… Et si un étranger est au dehors par un temps pareil… viens, Kervan…
– Hélas ! je vous le dis… les cris que j’ai entendus n’avaient rien d’humain… Kervan ! Jocelyn !… Ils ne m’écoutent pas… les voilà partis…
– Mon père et mon frère vont au danger, s’il y en a, et moi je reste ici…
– Ne frappez pas ainsi du pied, méchant enfant ! Peut-être êtes-vous cause de tout le mal, avec vos vœux impies…
– Calmez-vous, Madalèn… et vous, mon favori, ne prenez point, s’il vous plaît, de ces airs de poulain sauvage regimbant contre ses entraves, et, sans murmurer, obéissez à votre mère…
– J’entends des pas… on approche… Oh ! grand-père !…
– Eh bien, ma douce Roselyk, pourquoi trembler ? quoi d’effrayant dans ces pas qui s’approchent ? Bon, voici maintenant au dehors de grands éclats de rire… Êtes-vous rassurée, Madalèn ?
– Des éclats de rire… pendant une pareille nuit !
– Sont très-effrayants, n’est-ce pas, Roselyk, surtout lorsque les rieurs sont ton père et ton frère ? Tiens, les voici. Eh bien, mes enfants, pourquoi si joyeux ?
– Ce malheur, qui menaçait la maison…
– Ces cris, qui n’avaient rien d’humain…
– Achevez donc, avec vos rires… Voire ! le père est aussi fou que le fils… Parlerez-vous enfin ?
– Ce grand malheur, c’est un pauvre colporteur égaré…
– Cette voix surhumaine, c’était la sienne…
Et le père et le fils de rire, il faut l’avouer, comme gens enchantés d’être rassurés. La mère, pourtant, toujours inquiète, ne riait point ; mais les jeunes garçons, mais la jeune fille, mais Jocelyn lui-même, tous de s’écrier joyeux :
– Un colporteur ! un colporteur !…
– Il a des rubans jolis et de fines aiguilles.
– Des fers pour les flèches, des cordes pour les arcs.
(Qui peut parler ainsi, sinon Karadeuk, mon favori, l’adroit archer.)
– Des ciseaux pour tondre les brebis.
– Des hameçons pour la pêche, puisqu’il vient sur la côte.
– Et il nous racontera ce qu’il sait des contrées lointaines, s’il vient de loin.
– Où est-il donc ? où est-il donc, ce bon colporteur qu’Hésus nous envoie par cette longue veillée d’hiver ?
– Quel bonheur de voir en détail toutes ses marchandises !
– Où est-il donc ? où est-il donc ?
– Il secoue sous le porche les frimas dont il est couvert.
– Bonne mère, tel est donc le malheur qui nous menaçait parce que je désire voir une Korrigan ?
– Taisez-vous, mon fils… demain est à Dieu !
– Voici le colporteur ! le voici…
C’était lui… Il secoua au seuil de la porte ses bottines de voyage, si couvertes de neige, qu’il semblait porter des chaussons blancs. Homme robuste, d’ailleurs, trapu, carré, dans la force de l’âge, à l’air jovial, ouvert et déterminé. Madalèn, toujours inquiète, ne le quittait point des yeux, et par deux fois elle fit signe à son fils de revenir à ses côtés ; le colporteur, relevant le capuchon de son épaisse casaque où miroitait le givre, se débarrassa de sa balle, lourd fardeau qui semblait léger pour ses fortes épaules ; puis, ôtant son bonnet de laine, il s’avança vers Araïm, le plus vieux de la maisonnée :
– Longue vie et heureux jours aux gens hospitaliers ! c’est le vœu que fait pour toi et ta famille Hêvin, le colporteur. Je suis Breton ; je m’en allais à Falgoët, lorsque la nuit et la tempête m’ont surpris sur la côte ; j’ai vu au loin la lumière de cette demeure, je suis venu, j’ai appelé, l’on m’a ouvert… Encore une fois, merci aux gens hospitaliers…
– Madalèn, qu’avez-vous à rêver ainsi, pensive et triste ? la bonne figure et les bonnes paroles de ce colporteur ne vous rassurent-elles pas ? lui croyez-vous une Korrigan dans sa manche ?
– Mon père, demain appartient à Dieu… Je me sens plus chagrine encore depuis l’entrée de cet étranger.
– Plus bas, parlez plus bas encore, chère fille ; ce pauvre homme pourrait vous entendre et se chagriner… Ah ! ces mères ! ces mères !
Et s’adressant à l’étranger :
– Approche-toi du feu, brave porte-balle ; la nuit est rude. Karadeuk, en attendant le souper, un pot d’hydromel pour notre hôte.
– J’accepte, bon vieux père… le feu réchauffera le dehors, l’hydromel le dedans.
– Tu me parais un joyeux routier ?